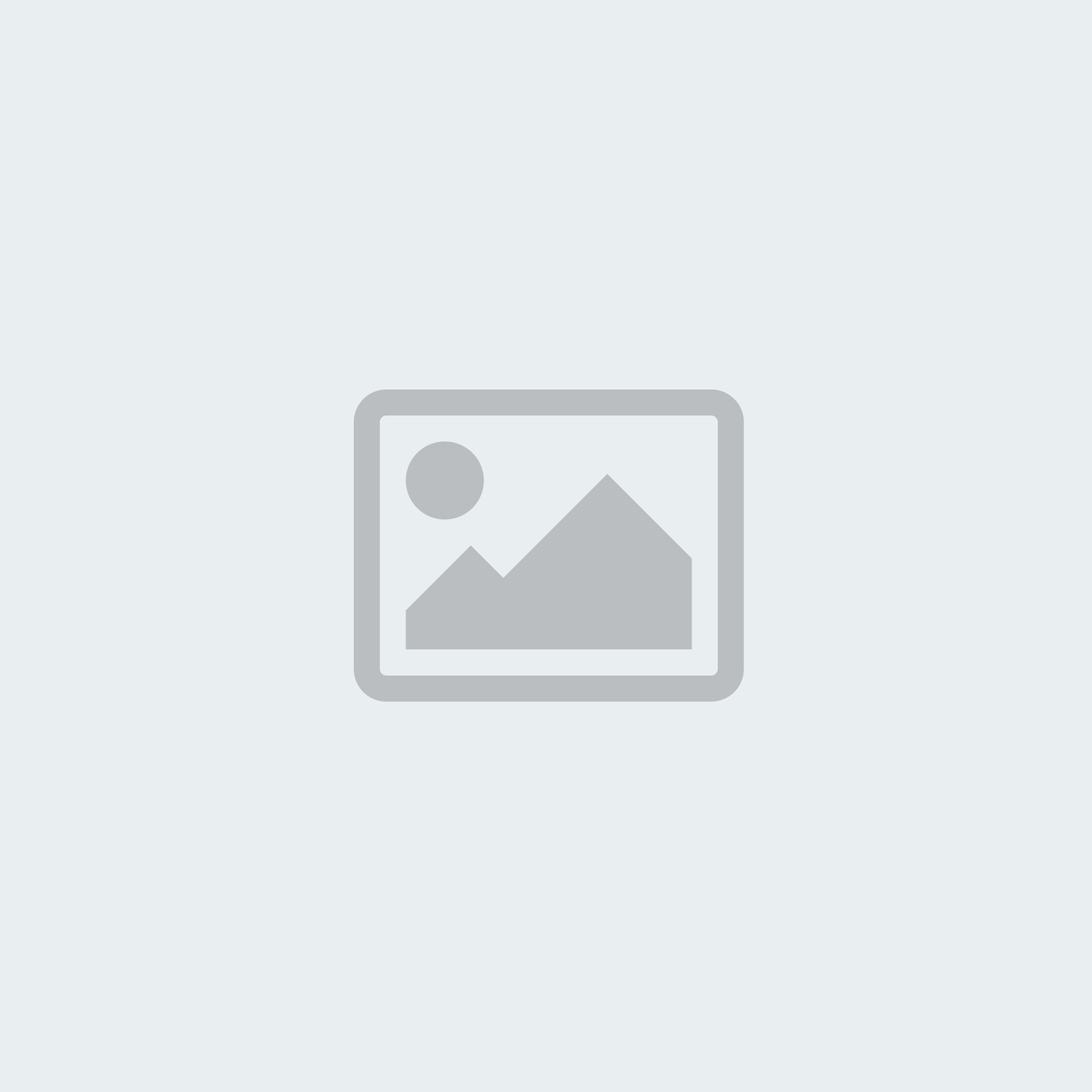Le droit européen reconnaît aux personnes ayant une activité et à leur famille la liberté de circuler dans l'Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE) et d'y exercer leur activité à égalité de traitement avec les ressortissants des autres pays membres (TraitéTFUE art. 4513/12/2007 ; Dir. 2004/38 du 29-4-2004). Sont concernés les salariés mais aussi les personnes qui exercent une activité indépendante ou qui fournissent une prestation de services.
Leur famille se compose du conjoint ou compagnon, des enfants de moins de 21 ans ou à charge et des parents à charge, indépendamment de leur nationalité.
Depuis le 1er juillet 2013, l'Union européenne comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. En tant que citoyens européens, les ressortissants des 28 Etats membres peuvent librement circuler et séjourner dans l'Union élargie. La libre circulation des travailleurs fonctionne également entre les Etats membres de l'UE et l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ainsi qu'avec la Suisse.
La zone euro comprend actuellement l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie.
Le pays d'accueil doit admettre les ressortissants communautaires qui se déplacent sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité (certains pays tolèrent même un passeport périmé). Il ne peut imposer un visa d'entrée que pour les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un des pays membres.
Lorsqu'un salarié vient travailler pour une durée inférieure à trois mois, sa carte d'identité ou son passeport couvre son séjour s'il détient une déclaration de son employeur indiquant la période prévue de l'emploi.
S'il prévoit d'y séjourner plus de trois mois, il doit demander pour lui-même et pour chaque membre de sa famille qui l'accompagne un titre de séjour (ou attestation d'enregistrement) à la mairie ou commissariat de police. Il doit lui être délivré immédiatement.
Pour que les ressortissants communautaires puissent exercer leur métier dans un autre pays de l'UE, il faut leur garantir, ainsi qu'à leur famille, un traitement identique à celui qui est réservé aux nationaux du pays où ils vont travailler. Corollaire de la libre circulation des travailleurs, l'égalité implique d'abolir, en matière d'emploi, de rémunération et d'autres conditions de travail, toute discrimination fondée sur la nationalité.
Lorsqu'un Etat subordonne l'accès ou l'exercice d'une profession, à titre indépendant ou salarié, à une qualification professionnelle - on parle dans ce cas de profession réglementée - l'égalité de traitement suppose la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
La reconnaissance des qualifications professionnelles a fait l'objet d'une directive globale couvrant plus de 800 professions réglementées (Dir.CE 2005/36 du 7-9-2005). Celle-ci établit un système général de reconnaissance qui permet à l'Etat d'accueil d'exiger que la personne ait, dans son Etat d'origine, un niveau de formation au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il exige de ses propres ressortissants. Elle a permis de consolider plusieurs régimes de reconnaissance automatique (médecin, infirmier, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien, architecte et de nombreuses professions du secteur de l'artisanat et du commerce). Ces professions sont reconnues sur la base de la coordination des conditions minimales de formation au sein des différents Etats membres. Leur reconnaissance est accordée dès lors que le professionnel justifie de l'obtention dans son Etat d'origine de l'un des titres énumérés en annexe de la directive.
Un projet de création d'une carte professionnelle européenne permettant à certains professionnels partant exercer dans un autre Etat membre de justifier plus rapidement et facilement de leurs compétences est à l'étude au niveau des instances de l'Union européenne.
L'égalité de traitement concerne aussi les conditions d'emploi et de travail (notamment rémunération, licenciement et réintégration, formation professionnelle, droit d'adhérer aux organisations syndicales et d'exercer des droits syndicaux dans le pays d'accueil).
Le travailleur communautaire et sa famille à charge doivent bénéficier dans le pays d'accueil des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux. Ce sont par exemple les avantages accordés aux familles nombreuses (par exemple, tarifs préférentiels sur les prix des transports par chemin de fer), une aide à la poursuite d'études universitaires ou l'accès à un logement social. Quant à l'égalité devant les avantages fiscaux, le pays d'accueil peut imposer plus lourdement les salaires d'un non-résident que ceux d'un résident mais il doit respecter l'égalité de traitement quand la situation du non-résident est comparable à celle du résident, ce qui est le cas quand il tire la totalité ou la quasi-totalité de ses ressources imposables du pays où il travaille.
L'égalité de traitement ne s'applique pas à l'accès aux emplois de l'administration publique dans la mesure où les emplois comportant une participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux peuvent être réservés aux nationaux. Les autres emplois publics sont ouverts à tous les ressortissants communautaires et, une fois qu'ils sont embauchés, l'égalité de traitement régit les conditions de travail et les avantages sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que pour les emplois du secteur privé.
L'égalité de traitement va au-delà des rapports individuels et collectifs de travail. Elle comprend l'égal accès au logement ou à l'enseignement public. Dans le même esprit, les permis de conduire délivrés par les Etats membres ainsi que les contrôles techniques sont mutuellement reconnus.
Dès que l'affectation à l'étranger dure plus d'un mois, l'employeur doit indiquer par écrit sa durée, la devise dans laquelle le salarié sera payé, le cas échéant les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation et les conditions de rapatriement (C. trav. art. R 1221-34). Ces modifications sont généralement la base de la « lettre de mission » (courte durée) ou de l'avenant au contrat (généralement mission de plus de six mois). Un avenant est en effet nécessaire lorsque le contrat de travail ne contient pas une clause de mobilité internationale, car l'affectation constitue alors une modification du contrat de travail. Si le contrat inclut une telle clause, le refus d'une mission temporaire à l'étranger peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en revanche, la clause ne peut pas prévoir qu'il renonce à son droit de refuser une mutation dans une autre société du groupe (Cass. soc. 23-9-2009 no 07-44.200 : RJS 12/09 no 898).
SavoirLes entreprises qui envoient souvent du personnel à l'étranger ont un document interne rassemblant toutes les dispositions en la matière et codifiant la coutume maison (manuel de l'expatriation, statut du personnel expatrié, etc.). L'avenant au contrat de travail peut s'y référer globalement ou adapter certains termes à la situation personnelle du salarié. Quand un tel document n'existe pas, l'avenant est nécessairement plus précis (employeur pendant la mission, lieu de travail, fonction, rémunération, protection sociale, régime fiscal, clause de retour).
La mise à disposition internationale, fréquente entre sociétés membres d'un même groupe, entraîne la suspension, voire la rupture du contrat initial et la conclusion d'un nouveau contrat avec la société étrangère.
Les conditions de rapatriement que prévoit l'avenant doivent être au moins aussi favorables au salarié que celles de la convention collective applicable dans l'entreprise, s'il en existe une. Quant aux conditions de la réintégration dans l'entreprise, dans la mesure où l'entreprise d'origine est restée l'employeur du salarié, elle doit le réintégrer dans son emploi antérieur ou le licencier en l'absence de poste disponible ou de possibilité de reclassement.
Bénéficient d'une protection spéciale les salariés engagés par une société mère française et mis à la disposition d'une filiale étrangère avec laquelle ils ont conclu un contrat de travail : la société mère doit les réintégrer si la filiale les licencie (C. trav. art. L 1231-5). Il en va ainsi même si :
- le salarié n'a pas exercé de fonctions effectives au sein de la société mère avant son détachement (Cass. soc. 9-1-2013 no 11-20.013 : RJS 3/13 no 239) ;
- le contrat initial avec la société mère n'a pas été maintenu lors de la mise à disposition ou s'il s'agissait d'un CDD, il est arrivé à son terme.
La société mère doit assurer leur rapatriement (ainsi que celui de leur famille) et leur réintégration dans un nouvel emploi. L'offre de réemploi doit être sérieuse, précise et compatible avec l'importance de leurs précédentes fonctions et doit avoir été acceptée expressément par le salarié (Cass. soc. 21-11-2012 no 10-17.978 : RJS 2/13 no 169). La société mère doit en prendre l'initiative dès qu'elle a connaissance du licenciement (quelle qu'en soit la cause) et même si la filiale leur a versé des indemnités de rupture calculées sur l'ensemble de leur carrière.
Si la société mère ne les réintègre pas, elle prend la responsabilité de la rupture. Elle doit justifier d'un motif de licenciement réel et sérieux, respecter la procédure, observer le préavis et verser les indemnités de licenciement.
Le licenciement pourra être jugé abusif à défaut, pour la société mère, de justifier de réels efforts de reclassement. A l'inverse, il sera justifié si elle propose un poste de qualification équivalente que le salarié refuse.
Un salarié qui refuse le reclassement proposé n'est considéré comme démissionnaire que s'il exprime sa volonté claire et non équivoque de prendre lui-même la responsabilité de la rupture.
La réglementation européenne en matière de protection sociale des salariés ne supprime pas les régimes nationaux mais garantit seulement que les ressortissants de l'UE et de l'EEE assurés dans d'autres pays membres ou en Suisse ne sont pas lésés par rapport à ceux qui travaillent dans un seul pays (Règl.CE 883/2004 du 29-4-2004 et Règl.987/2009 du 16-9-2009). Autrement dit, votre mobilité professionnelle en Europe ne doit pas vous faire perdre de droits.
Plusieurs principes garantissent, sur le plan de la protection sociale, une véritable liberté de circulation à tous les assurés sociaux citoyens de l'UE :
- vous êtes, en principe, affilié à un seul régime de sécurité sociale pour tous les risques, ce qui vous évite de n'être assuré nulle part ou, à l'inverse, de devoir cotiser à deux régimes. Ce régime est celui du pays où vous travaillez mais, si votre affectation à l'étranger est temporaire (vous êtes « détaché »), vous restez à la sécurité sociale française ;
- les périodes d'assurance, de résidence ou d'emploi effectuées dans un pays sont totalisées pour tous les risques, autrement dit prises en compte pour l'ouverture des droits dans l'autre pays ; si par exemple la loi espagnole impose un délai de carence avant de vous fournir une prestation, la sécurité sociale espagnole tient compte des périodes accomplies en France. Les droits en cours d'acquisition dans un pays sont conservés dans l'autre et chaque pays tient compte de l'activité exercée dans l'autre pays pour le calcul des prestations qui dépendent des périodes préalables d'emploi ou d'assurance (pension de retraite) ;
- les droits acquis sont maintenus, ce qui vous permet de ne pas perdre les prestations acquises (allocations de chômage, pension de retraite) du seul fait que vous résidez dans un pays autre que celui où vous avez acquis le droit. On dit que les prestations sont « exportées ».
Le système fonctionne sur présentation dans le pays de séjour ou de résidence de votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM, distincte de la carte Vitale) pour les soins inopinés nécessités pendant un séjour temporaire dans tout pays membre de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse, et au moyen de divers formulaires communautaires délivrés par la caisse à laquelle vous êtes affilié (et progressivement dématérialisés).
Lorsqu'un employeur établi en France envoie un salarié travaillant normalement en France effectuer temporairement un travail dans l'UE et qu'il s'engage à continuer de payer l'ensemble des charges sociales françaises, le salarié est maintenu à la sécurité sociale française (CSS art. L 761-1 s.). Ce système, qui s'appelle le détachement, dispense d'affilier le salarié dans le pays d'accueil pour la durée de la mission, tout en lui ouvrant droit aux prestations de santé de ce pays. Il est obligatoire dès lors que certaines conditions sont réunies : voir no 58059.
Dans l'autre système, qui s'appelle l'expatriation, l'employeur doit affilier le salarié à la protection sociale du pays d'accueil. Ce régime s'applique dans deux cas :
- les conditions du détachement ne sont pas remplies ou elles cessent de l'être. Si le niveau de protection sociale du pays d'emploi est moins bon, l'employeur peut renforcer la couverture locale en assurant volontairement le salarié à une caisse de sécurité sociale propre aux Français à l'étranger, la CFE, voire renforcer l'assurance volontaire par une mutuelle complémentaire adaptée ;
- une personne part travailler pour le compte d'un employeur établi dans le pays d'emploi (cas d'un Français qui part en Italie pour travailler pour un employeur italien).
Le régime de l'expatriation est exposé nos 58170 s.
AttentionIl existe une limite aux deux statuts, détachement ou expatriation + assurance volontaire à la CFE : le remboursement des frais médicaux ou hospitaliers est plafonné aux tarifs de la sécurité sociale française (CSS art. R 332-3), alors que le coût de la santé à l'étranger est parfois plus élevé qu'en France. C'est notamment le cas des pays où coexistent un secteur public gratuit et un secteur privé, plus rapide et prisé des expatriés (Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Portugal).
Le salarié détaché doit remplir toutes les conditions suivantes :
- s'il est embauché en vue d'être détaché, maintenir un lien organique avec son entreprise, laquelle doit exercer habituellement des activités substantielles en France ;
- partir faire un travail déterminé pour le compte de son employeur, identifié principalement comme celui qui s'engage à payer et qui paie l'intégralité des cotisations sociales françaises ;
- partir pour une durée limitée à 24 mois, avec une prolongation possible d'une année supplémentaire si le travail se poursuit à raison de circonstances imprévisibles. Dans certains cas particuliers, un détachement pour une durée supérieure à 2 ans et au plus égale à 6 ans peut être autorisé. Un second détachement est possible sur le même poste de travail, à condition de respecter un délai de carence de 2 mois ;
- ne pas être envoyé en remplacement d'un autre salarié parvenu au terme de la période de son détachement (pas de rotation sous couvert de détachements répétés).
L'employeur demande à sa caisse d'établir un formulaire communautaire spécial, de préférence avant le départ en mission. Si les conditions du détachement sont remplies, ce document permet au salarié d'être dispensé de s'affilier au régime de l'Etat de détachement.
SavoirIl existe des procédures simplifiées (Circ. DSS 501 du 22-10-2004). L'employeur peut simplement aviser la caisse puis régulariser la demande en cas de détachement urgent ou il se contente de remplir un formulaire préétabli pour un détachement de trois mois au plus. Pour les détachements répétés et de courte durée, il peut adresser à la caisse une déclaration trimestrielle préalable, mentionnant la liste des salariés susceptibles d'être détachés pendant la période.
En cas de détachement exceptionnel (c'est-à-dire lorsque les conditions du détachement, notamment de durée, ne sont pas remplies), la demande se fait auprès du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) et nécessite l'accord des deux Etats membres concernés.
Pendant le détachement, l'employeur verse sur l'ensemble de la rémunération toutes les charges sociales françaises (parts patronales et salariales), y compris les cotisations à l'assurance chômage et aux régimes de retraite complémentaire. Les salariés détachés ne restent assujettis à la CSG et à la CRDS que s'ils gardent leur domicile fiscal en France (CSS art. L 136-1).
Pas de changement pour les prestations à long terme : le salarié continue à acquérir de nouveaux droits à prestations pour les risques vieillesse, veuvage, décès, invalidité et accident du travail (rentes).
Pour les risques maladie, maternité, accident du travail, les indemnités journalières continuent d'être versées au salarié directement par la caisse primaire où il est resté affilié (ou par la caisse locale pour le compte de la caisse française, selon les accords).
En revanche, les prestations en nature (soins médicaux ou hospitaliers) sont servies dans le pays d'accueil par la caisse ou le système de santé local, selon sa législation.
La famille restée en France continue d'y être soignée à titre personnel ou comme ayant droit de l'assuré. Si la famille accompagne le salarié détaché, elle bénéficie de la même couverture sociale que lui.
Pour se faire soigner dans le pays d'accueil, le salarié et les autres membres de sa famille doivent s'inscrire à la caisse locale ou au système national de santé (Royaume-Uni, Espagne, Irlande) en présentant chacun une attestation S1 délivrée par la caisse française.
Pour se faire rembourser les « soins de séjour », le salarié envoie des feuilles de soins spéciales accompagnées des factures soit à sa caisse française (remboursement sur la base des frais réels mais dans la limite des tarifs français), soit à la caisse locale. Le salarié continue de bénéficier, le cas échéant, du régime de prévoyance complémentaire souscrit par l'employeur, mais si les frais médicaux sont plus chers qu'en France, il est conseillé de prévoir de souscrire une assurance complémentaire spécifique.
Pour le remboursement de soins programmés dispensés dans un établissement non conventionné ou de traitements vitaux nécessitant des équipements lourds (scanner par exemple), l'autorisation préalable de la caisse française est nécessaire (document portable S2). Celle-ci ne peut la refuser que si les soins envisagés ne sont pas pris en charge en France ou si un traitement identique ou aussi efficace ne peut être donné en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé (CSS art. R 332-4 s.).
Dans les zones frontalières, des accords permettent la prise en charge par le régime français de soins dispensés dans un hôpital étranger (notamment en Allemagne, Belgique et Espagne).
La réglementation sur les prestations de soins de santé transfrontaliers et leur remboursement n'est pas toujours claire ni facile à comprendre. Le Cleiss est chargé de fournir toutes les informations aux patients sur leurs droits en la matière (CSS art. R 767-2 modifié par le décret 2015-223 du 26-2-2015).
SavoirQuand les membres de la famille ne font que des séjours occasionnels dans l'Etat d'accueil (ou dans tout Etat membre, d'ailleurs), il leur suffit de présenter leur carte européenne d'assurance maladie (CEAM) pour y recevoir des soins inopinés. Le salarié qui fait des séjours temporaires en France, y compris pour traitement médical, peut s'y faire soigner comme s'il y avait gardé sa résidence.
Le salarié informe directement la caisse primaire française de son arrêt de travail dans les 48 heures. Selon ce que prévoit la législation locale, l'avis se fait par l'envoi d'un certificat délivré par le médecin traitant ou par une déclaration du salarié (cas du Royaume-Uni). La caisse française sert les indemnités journalières. La caisse locale peut procéder au contrôle médical du salarié détaché, pour le compte de la caisse primaire française.
Le salarié reste sous la protection de la législation française en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
C'est son employeur qui fait la déclaration à la caisse française (dans le délai de 48 h à compter du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant), avec copie à la caisse locale. La caisse locale transmet à la caisse française les certificats médicaux que lui envoie la victime. Les indemnités journalières pendant son arrêt de travail, voire une rente d'incapacité, lui sont servies selon la législation française par la caisse française (ou par la caisse locale pour le compte de la caisse française).
Les soins lui sont dispensés dans le pays d'accueil, selon sa législation. L'envoi par la caisse française du formulaire DA1 vaut reconnaissance pour la caisse locale du caractère professionnel de l'accident.
Aucun changement si la famille du salarié continue à résider en France : les prestations familiales continuent à lui être servies comme s'il travaillait toujours en France.
Si elle l'accompagne, il n'a plus droit aux prestations dites « non exportables », soit l'allocation logement ; des prestations équivalentes peuvent toutefois lui être fournies par les organismes compétents de l'Etat d'accueil. Pour recevoir les autres prestations, celles qui sont « exportables », le salarié doit adresser à sa caisse d'allocations familiales un certificat indiquant chaque membre de sa famille qui réside avec lui. Il est délivré par les autorités locales compétentes en matière d'état civil ou par la caisse locale d'assurance maladie.
SavoirSi votre conjoint travaille dans le pays d'accueil, il a un droit propre aux prestations familiales de ce pays pour les membres de sa famille qui résident avec lui (Règl. 883/2004 art. 68). Pour éviter le cumul des prestations, votre caisse française compare les prestations dues dans chaque pays, enfant par enfant. Comme celles du pays d'accueil sont prioritaires, si elles s'avèrent inférieures aux prestations françaises, votre caisse d'allocations familiales vous versera un complément différentiel.
La période du détachement est validée comme si le salarié était resté en France, au regard des régimes obligatoires de retraite (la retraite de base de la sécurité sociale et les retraites complémentaires de l'Arrco pour les non-cadres et de l'Agirc pour les cadres).
Les « surretraites » ou « retraites surcomplémentaires » échappent au dispositif du détachement car ce sont des systèmes de retraite par capitalisation, souvent souscrits auprès de compagnies d'assurance-vie à titre facultatif et individuel. En fait, ce sont plutôt des formes de rémunération différée que l'entreprise utilise comme incitation financière à la mobilité internationale.
Si le salarié décède pendant sa mission, les prestations sont servies à ses survivants (pension de veuvage et allocation pour orphelins) comme s'il n'avait pas quitté la France.
Comme l'employeur doit continuer de cotiser au régime français de l'assurance chômage, le salarié qui perd son emploi est indemnisé en France s'il s'y inscrit comme demandeur d'emploi (C. trav. art. L 5422-13). Pôle emploi calcule son salaire de référence à partir du dernier salaire brut perçu dans le pays du détachement.
Un salarié détaché au chômage complet peut aussi opter pour être indemnisé dans le pays où il a été détaché et où il réside encore. Il manifeste son choix en s'inscrivant comme demandeur d'emploi dans l'un ou l'autre pays.
Détaché à l'étranger par son employeur, le salarié peut se trouver dans l'une des deux situations suivantes :
- soit il a conservé son domicile fiscal en France, auquel cas il est assujetti à l'impôt en France sur ses revenus mondiaux, quelle qu'en soit la source et indépendamment du lieu où ils ont été encaissés, sauf disposition contraire de la convention fiscale passée entre la France et le pays de détachement. Pour les modalités d'imposition, voir no 57680 ;
- soit son domicile fiscal se trouve être transféré à l'étranger. Il échappe alors à l'impôt sur le revenu en France, sauf pour ses revenus de source française.
En cas de conflit sur la résidence fiscale entre la France et le pays du détachement, c'est la convention fiscale passée entre les deux pays qui va apporter la solution par le recours à des critères d'application successive : foyer d'habitation permanent (dans un logement dont on est propriétaire ou locataire), liens personnels et économiques les plus étroits (pays où les relations familiales et sociales et/ou les intérêts économiques sont les plus importants), lieu de séjour habituel et nationalité.
SavoirLa France est liée avec chacun des autres pays membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) et avec la Suisse par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions en matière d'imposition du revenu. Seules certaines de ces conventions contiennent également des dispositions en matière d'impôt sur la fortune (avec l'Allemagne, l'Autriche, Chypre, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse). En matière de droits de succession et de donation, la France est liée par une convention avec l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suède, (successions et donations) et avec la Belgique, l'Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni (successions).
L'année du transfert du domicile à l'étranger, l'impôt sur le revenu français est dû à raison des revenus perçus ou dont on a pu disposer du 1er janvier à la date du départ, ainsi que des revenus acquis avant cette date sans en avoir la disposition. Il n'y a pas de formalités particulières mais nous vous conseillons de signaler votre départ au centre des impôts. Il établira les impôts directs immédiatement exigibles à cette occasion (impôt déjà mis en recouvrement et impositions en cours) et vous remettra sur demande un quitus fiscal.
Pour les revenus tirés de son activité dans le pays où il travaille et dont il est devenu résident fiscalement, le salarié est soumis à la fiscalité locale. Si on prend l'exemple du Royaume-Uni, le barème comprenant les revenus du travail ne prévoit que trois tranches imposées à 20, 40 et 45 % mais comme le système fiscal britannique est très différent et ne connaît pas le quotient familial, la comparaison entre les régimes est difficile.
Les contribuables domiciliés dans un pays d'Europe qui perçoivent des revenus ou plus-values de source française (salaire au titre d'une activité exercée en France, capitaux mobiliers, bien immobilier situé en France) doivent remplir la déclaration d'ensemble des revenus 2042 s'ils n'ont pas déjà été soumis à retenue à la source ou à prélèvement libératoire. Les plus-values immobilières peuvent être exonérées sous certaines conditions lors de la cession d'une habitation en France, dans la limite d'un seul logement et de 150 000 €.
AttentionCes contribuables ont comme interlocuteur unique le Service des impôts des particuliers non résidents (TSA 10010, 10, rue du Centre 93465 Noisy-le-Grand Cedex ou sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr ou www.impots.gouv.fr puis particuliers>vos préoccupations>vivre hors de France). Ils peuvent déclarer en ligne en téléchargeant les déclarations. Ils peuvent aussi payer en ligne, gérer leurs contrats de prélèvement (mensualisation ou paiement à l'échéance avec un certificat) et accéder à tous leurs avis d'imposition en consultant leur « compte fiscal ».
Lorsqu'elles sont imposables à l'ISF, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France en application de l'article 4 du CGI ou des conventions fiscales (voir no 58089) ne peuvent y être assujetties qu'à raison de leurs biens situés en France. Il s'agit des meubles et des immeubles qui ont leur assiette matérielle en France, des créances sur des débiteurs établis en France et des valeurs mobilières émises en France ; leurs placements financiers sont exonérés (dépôts, obligations, actions, participations jusqu'à 10 % du capital d'une entreprise). La déclaration 2725 doit être déposée et l'impôt payé au Service des impôts des particuliers non résidents. Toutefois, les contribuables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 million et 2,57 millions d'euros et qui déposent une déclaration 2042 en France déclarent leur patrimoine sur leur déclaration de revenus et reçoivent un avis d'imposition spécifique. L'assujettissement à l'ISF s'appréciant au 1er janvier de chaque année, le transfert du domicile fiscal hors de France après cette date permet d'échapper à l'ISF l'année suivante, sauf pour les biens français.
L'expatriation d'une personne est susceptible de mettre en jeu une législation tant juridique que fiscale en matière de droits de succession et de donation autre que la loi française et une convention fiscale (voir no 58089). En l'absence d'une convention fiscale applicable en la matière, si le bénéficiaire (héritier, donataire ou légataire) d'une personne qui réside hors de France est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens, les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France sont imposables en France (CGI art. 750 ter, 3o ).
SavoirUn règlement européen, applicable aux décès intervenus depuis le 17 août 2015, règle les problèmes d'héritage, notamment dans le cas où le défunt et ses héritiers ne résidaient pas dans le même pays de l'Union européenne (Règl.CE 650/2012 du 4-7-2012). La loi qui s'applique sera, par défaut, celle du pays de la dernière résidence habituelle du défunt mais le testateur pourra choisir le droit de son pays d'origine. Un « certificat successoral européen » permettra d'aider les héritiers à faire valoir leurs droits. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne sont pas concernés.
Le contribuable précédemment domicilié à l'étranger est imposable en France au titre de l'année où il y établit son domicile à raison de l'ensemble des revenus perçus ou dont il a disposé à compter de cette date, d'où qu'ils proviennent.
Pour les personnes passibles de l'impôt sur la fortune, un retour en France après le 1er janvier permet de n'être soumis à l'impôt qu'à compter de l'année suivante.
Comme tout citoyen d'un pays de l'UE, vous pouvez aller séjourner dans un autre pays membre pendant trois à six mois (selon le pays) pour y chercher un emploi avec l'aide des services de l'emploi de ce pays ou du portail européen sur la mobilité de l'emploi (http://ec.europa.eu/eures). Si vous perceviez des allocations de chômage en France, vous pourrez même continuer à être indemnisé par Pôle emploi pendant une période globale de trois mois. Mais pour pouvoir ainsi « exporter » votre droit à indemnisation et ne pas perdre vos droits en France au-delà de cette période, vous devez respecter les formalités suivantes (Règl.CE 883/2004 art. 61 à 65) :
- avant votre départ, être inscrit comme demandeur d'emploi en France et être resté à la disposition des services de l'emploi pour une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage (ce délai peut être raccourci) ;
- faire remplir par Pôle emploi un document U2 attestant du maintien de vos droits aux prestations de chômage et de la date à laquelle vous cessez d'être à sa disposition ;
- vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'autre pays dans un délai de sept jours à compter de cette date, remettre le formulaire à l'organisme payeur local pour qu'il poursuive votre indemnisation et vous soumettre à leurs contrôles ;
- si vous ne retrouvez pas d'emploi dans l'autre pays, revenir en France avant l'expiration des trois mois et vous réinscrire pour conserver vos droits aux allocations de chômage françaises. Si vous retrouvez un emploi dans l'autre Etat, vous serez indemnisé par l'organisme de cet Etat si vous le perdez à nouveau (au titre de l'Etat du dernier emploi).
Si vous tombez malade pendant votre séjour, vous serez soigné dans cet Etat sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie qui atteste du maintien de votre affiliation à la caisse primaire française. Pensez à la lui demander avant votre départ. L'Etat d'accueil est en droit de limiter votre accès à celles des prestations d'assistance sociale qui sont sans lien avec l'accès à l'emploi.
Vous pouvez être indemnisé pendant trois mois dans le pays d'emploi de votre conjoint si vous avez accompli les formalités exposées ci-dessus et si vous avez, en outre, transmis à Pôle emploi les justificatifs de votre qualité de conjoint et du motif professionnel à l'origine de votre transfert de résidence.
Si vous n'accomplissez pas ces formalités, l'organisme payeur du pays d'accueil ne vous indemnisera pas. En revanche, si vous retrouvez un emploi dans l'autre Etat sans toutefois le conserver, vous serez indemnisé par cet organisme. Il prendra en compte les périodes d'emploi exercées en France si, avant votre départ, vous avez pris soin de demander à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de l'employeur que vous quittez de remplir le document U1 qui atteste des périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage.
A votre retour en France, si vous n'avez pas travaillé dans le pays d'accueil, vos droits aux allocations de chômage sont préservés en France, à condition que votre retour et votre inscription comme demandeur d'emploi interviennent dans les quatre ans suivant votre démission.
Si vous y avez travaillé, voir no 58204.
Le programme « Erasmus pour jeunes entrepreneurs » est fait pour ! Si votre candidature est retenue, vous pourrez vous familiariser pendant un à six mois avec l'environnement des entreprises de cet Etat au contact d'un entrepreneur chevronné (www.erasmus-entrepreneurs.eu).
L'expatrié qui trouve un emploi hors de France signe avec l'employeur établi dans le pays d'emploi un contrat de travail qui est soumis au droit de ce pays. Il est donc nécessaire de se renseigner au cas par cas sur le droit du travail du pays d'emploi.
L'Europass vise à aider les citoyens à démontrer leurs qualifications et leurs compétences et à faciliter leur mobilité partout en Europe. Cet outil réunit cinq documents (dont un CV européen et un supplément au diplôme/certificat) qui améliorent la transparence des qualifications (http://europass.cedefop.europa.eu).
Le travailleur s'affilie obligatoirement au régime de protection sociale du pays où il a son emploi (Règl.CE 883/2004 du 29-4-2004). Ce régime, dit de l'expatriation, s'applique à lui dans deux hypothèses :
- quand il s'expatrie dans un autre pays d'Europe pour devenir salarié d'un employeur établi dans ce pays. Il y acquitte ses cotisations (même si elles sont plus chères que dans son pays d'origine) et il reçoit toutes les prestations que prévoit ce régime et à ses tarifs. Mais tout Français qui part à l'étranger peut, en outre, choisir de rester à la Sécurité sociale française, souvent plus protectrice, en souscrivant une assurance volontaire ;
- quand il est envoyé par un employeur établi en France, en dehors du système du détachement. L'employeur doit alors payer la part patronale des cotisations sociales locales et il est fréquent qu'il prenne en charge tout ou partie de l'assurance volontaire française.
En plus de l'affiliation au régime local, vous pouvez renforcer votre protection sociale en adhérant à titre facultatif et risque par risque (maladie-maternité-invalidité, accident du travail, vieillesse) à une caisse de sécurité sociale propre aux Français à l'étranger, la CFE. Pour être mieux remboursé si les soins sont plus onéreux dans le pays d'emploi qu'en France, vous pouvez aussi prendre une assurance complémentaire fonctionnant avec la CFE ou souscrire une assurance médicale privée remboursant sans franchise. C'est à chacun d'apprécier l'opportunité d'une double couverture, locale obligatoire et française volontaire, selon le coût des cotisations sociales locales (faible au Royaume-Uni par exemple), l'étendue de la couverture sociale recherchée et la composition de sa famille.
Lorsqu'un Français va travailler dans un autre pays de l'UE où il s'installe avec sa famille, il bénéficie, au titre de l'égalité de traitement, de la protection sociale locale dans son ensemble, dans les mêmes conditions que les nationaux. Il a, en outre, divers droits spécifiques, pour lui et sa famille, au titre de la coordination communautaire de sécurité sociale, à condition d'avoir demandé les formulaires requis à sa caisse d'affiliation.
L'expatrié et sa famille l'accompagnant ont droit aux prestations maladie-maternité du régime local dès le début de l'emploi dans le pays étranger, donc sans délai de carence, si l'expatrié s'est procuré auprès de son ancienne caisse d'affiliation en France le formulaire E 104.
La présentation de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) permet à un expatrié ou à sa famille l'accompagnant de recevoir tous les soins inopinés que leur état de santé (maladie, maternité) vient à nécessiter pendant tout séjour temporaire dans un autre pays de l'UE (vacances en France, tourisme, voyage d'affaires), pourvu que le séjour ne soit pas à but thérapeutique. Il doit demander la carte à sa nouvelle caisse d'affiliation avant le voyage. Elle le dispense du paiement de la partie sécurité sociale en cas d'hospitalisation et lui permet de demander à sa caisse d'affiliation le remboursement des honoraires médicaux et des médicaments qu'il a payés. Si un arrêt de travail lui est prescrit, l'expatrié doit aviser sa caisse d'affiliation selon les modalités prévues dans le pays d'emploi et en lui envoyant le formulaire E 115, afin qu'elle lui verse les indemnités journalières.
La situation est différente si l'expatrié ou sa famille l'accompagnant veut se rendre dans un autre pays de l'UE, généralement son pays d'origine, pour un séjour temporaire à but thérapeutique ou pour des soins programmés. Sa caisse d'affiliation lui délivrera une autorisation préalable si les soins ne peuvent lui être dispensés sur place dans un délai acceptable sur le plan médical (formulaire S2 « Soins programmés »).
L'expatrié convalescent peut recevoir dans le pays où il est soigné les indemnités journalières versées par sa caisse d'affiliation.
L'expatrié a des droits spécifiques dans l'hypothèse où les membres de sa famille restent en France. Chaque ayant droit bénéficie des prestations en nature françaises, au titre de l'activité de l'expatrié dans un autre pays membre. Pour cela, les membres de sa famille doivent se faire inscrire auprès de la caisse primaire de leur lieu de résidence en France, en présentant le formulaire S1 que l'expatrié doit demander à sa caisse d'affiliation.
Si la famille n'accompagne pas l'expatrié dans le pays d'emploi, elle peut y recevoir des soins, inopinés ou programmés, lors d'un séjour temporaire (sur simple présentation de la CEAM).
Le salarié expatrié bénéficie de la protection de la législation du pays d'emploi en cas d'accident de travail survenu au cours ou à l'occasion des actes ou déplacements professionnels ainsi qu'en cas de maladie professionnelle (Règl.CE 883/2004 art. 21 et 36).
Si l'accident a lieu dans un autre pays que le pays d'emploi, pour un Français travaillant en Espagne et accidenté en Belgique par exemple, son employeur espagnol doit effectuer la déclaration à la caisse espagnole conformément à la législation espagnole, avec copie à la caisse belge. Les prestations en nature sont servies à la victime par la caisse belge pour le compte de la caisse espagnole sur présentation du formulaire DA1. Les indemnités journalières lui sont servies par la caisse espagnole.
L'expatrié qui, en cours d'indemnisation par la caisse d'affiliation, veut rentrer en France (ou se rendre dans un autre pays) pour s'y faire soigner doit au préalable demander à sa caisse d'affiliation le formulaire DA1. Elle peut le lui refuser si les soins peuvent être dispensés sur place dans un délai acceptable. Si elle accepte le transfert, elle lui verse ses indemnités journalières en France et les soins sont dispensés en France pour le compte de la caisse d'affiliation.
Si la famille de l'expatrié l'accompagne, il a droit, en vertu de l'égalité de traitement, à toutes les prestations prévues par la législation du pays d'emploi.
Si elle conserve sa résidence en France, l'expatrié a droit, en sa qualité de salarié (ou de chômeur indemnisé), aux prestations familiales de son pays d'emploi mais si celles-ci s'avèrent inférieures aux prestations auxquelles la famille peut prétendre au titre de sa résidence en France, la caisse française lui verse un complément différentiel.
Lorsque le conjoint travaille en France, il a un droit propre aux prestations familiales françaises. Pour éviter le cumul des prestations, elles sont prioritaires et si elles s'avèrent inférieures aux prestations du pays d'emploi de l'expatrié, sa caisse d'affiliation lui verse un complément différentiel.
L'expatrié doit adhérer et cotiser au régime d'assurance vieillesse du pays d'emploi et il n'est pas tenu de maintenir ses cotisations françaises au régime de base de la sécurité sociale, même si, en pratique, il a intérêt à le faire sur une base volontaire (voir ci-après).
Des règles de coordination communautaire viennent garantir à un salarié ayant cotisé dans plusieurs pays qu'il ne sera pas lésé par rapport à celui qui a cotisé dans un seul (Règl.CE 883/2004 art. 50 à 60) :
- chaque institution des divers pays où il a été assuré devra lui verser directement une pension en appliquant sa propre législation sur l'âge de la retraite. Le retraité touchera donc autant de pensions qu'il a eu de pays d'emploi ;
- chaque institution prend en compte les périodes accomplies dans les autres pays, y compris celles consacrées à l'éducation des enfants (CJUE 19-7-2012 aff. 522/10 : RJS 1/13 no 83), pour calculer le taux de la retraite due au titre des périodes accomplies sous sa législation.
Depuis le 1er janvier 2015, les candidats à l'expatriation et leur conjoint bénéficieront, à leur demande, d'un entretien d'information sur leurs droits à retraite (Décret 2014-517 du 22-5-2014).
AttentionLe système dit de « totalisation/proratisation » prend en compte les périodes accomplies dans divers pays pour l'ouverture du droit à pension, mais pas pour le calcul de la pension. Il est donc recommandé de cumuler l'assurance obligatoire dans le pays d'emploi avec une assurance volontaire dans le pays d'origine, afin d'y bénéficier de la continuité d'assurance et donc d'améliorer le montant de la pension de base (et, indirectement, celle du régime complémentaire).
Pour continuer à cotiser au régime français, on peut adhérer au risque vieillesse-veuvage de la Caisse des Français à l'étranger. Pour cela, il faut travailler à l'étranger et avoir été précédemment affilié à un régime français de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit, pendant une durée minimale de cinq ans. L'adhésion se fait auprès de la CFE dans un délai de dix ans à compter du départ. Elle prend effet au 1er jour du trimestre mais il est possible de racheter, dans un délai de dix ans, des cotisations pour les périodes antérieures à l'adhésion. Les cotisations encaissées par la CFE sont reversées à la caisse nationale d'assurance vieillesse et les pensions sont liquidées suivant les règles de l'assurance vieillesse.
La cotisation est trimestrielle et forfaitaire pour chacune des quatre catégories déterminées selon l'âge et le niveau de salaire (voir www.cfe.fr/pages/assurances/particuliers/salarie/vieillesse/cotisations.php).
SavoirLe conjoint français d'un expatrié peut, lui aussi, bénéficier de la continuité du régime général en adhérant volontairement à un régime de la CFE dit « assurance-vieillesse des personnes chargées de famille », à condition d'avoir été affilié pendant une durée minimale de cinq ans, d'accompagner l'expatrié à l'étranger, de ne pas y avoir d'activité professionnelle et d'élever au moins un enfant à charge. La cotisation trimestrielle est de 849 €.
Un salarié qui est expatrié dans l'UE par un employeur établi en France est maintenu aux régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco si son employeur en a fait la demande (« extension territoriale »).
Si votre employeur est établi à l'étranger, vous pouvez toujours demander vous-même une adhésion individuelle, à condition d'avoir déjà acquis des droits auprès de ces régimes. Peu importe que votre contrat de travail soit soumis au droit français ou au droit local. Vous prenez alors à votre charge la part patronale et la part salariale. La demande se fait auprès des institutions de l'Agirc et de l'Arrco habilitées à délivrer ces extensions : la caisse de retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et, si vous êtes cadre, l'Institution des retraites des cadres et assimilés hors de France (Ircafex) : www.humanis.com, espace international > particuliers ou ww.cfe.fr puis nos assurances>particuliers>salariés>retraite complémentaire.
L'expatrié dépend du système d'assurance chômage du pays d'emploi auquel son employeur doit l'affilier (Règl.CE 883/2004 art. 61 à 65).
Lorsqu'un expatrié perd son emploi, l'organisme compétent pour lui verser les allocations de chômage est celui du pays de son dernier emploi, c'est-à-dire le pays d'expatriation. Mais un dispositif communautaire lui permet, en cours d'indemnisation, d'aller chercher du travail dans un autre pays membre. Si vous rentrez en France, c'est donc Pôle emploi qui prendra le relais de votre indemnisation pendant trois mois au maximum (voir no 58133).
Si l'expatrié au chômage rentre en France, ses droits sont différents selon que, avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi (www.pole-emploi.fr), il a ou non retravaillé en France :
- il a retravaillé en France : les périodes de travail pendant l'expatriation sont prises en compte par Pôle emploi si, avant son retour en France, il a pris soin de faire remplir par les services du travail locaux le formulaire U2. Le salaire retenu pour le calcul des indemnités se calcule sur la base du salaire perçu en France après le retour d'expatriation ;
- il n'y a pas retravaillé : il n'a droit qu'à l'allocation temporaire d'attente.
Lorsqu'un expatrié rentre en France, la caisse primaire de son nouveau lieu de résidence va lui rouvrir ses droits à l'assurance maladie sur la base des périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays, sur présentation des formulaires retirés auprès de sa précédente caisse d'affiliation à l'étranger :
- reprise d'activité dès le retour : le formulaire E 104 permet la totalisation des périodes d'assurance et la réouverture automatique des droits à l'assurance maladie ;
- recherche d'emploi : si le chômeur n'est pas indemnisé par le pays de son dernier emploi, le formulaire S1 lui permet d'être couvert par la sécurité sociale française pour tous les soins, y compris pour ceux qui ne présentent pas un caractère d'urgence. S'il est indemnisé, sa carte européenne d'assurance maladie lui permet de recevoir des soins en France pendant les trois mois où son allocation chômage communautaire est « exportée » en France (voir no 58133).
Une fois établi à l'étranger, l'ancien contribuable français va se trouver soumis au régime fiscal de son nouveau pays de résidence. En cas de conflit sur la résidence fiscale entre la France et le pays d'expatriation, voir no 58089.
Des règles particulières s'appliquent aux frontaliers en application des conventions fiscales signées par la France avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. En règle générale, les salaires des frontaliers sont imposables dans leur pays de résidence (par exception, les frontaliers exerçant dans le canton de Genève sont imposés en Suisse).
Le statut de frontalier est accordé par les conventions aux personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un pays limitrophe (par exemple cantons limitrophes pour la Suisse, liste de communes de part et d'autre de la frontière pour la Belgique ou l'Allemagne) et qui retournent, en principe chaque jour, dans leur pays d'origine.
Les impôts dont une personne qui a « émigré » peut rester redevable en France sont principalement les suivants : retenues à la source sur des revenus de source française au taux prévu par la convention fiscale applicable, impôt sur les revenus d'immeubles situés en France, ISF à raison des biens dont l'imposition est attribuée à la France par la convention fiscale éventuellement applicable ou situés en France (voir no 58093 s.), impôts locaux (taxe foncière à raison des immeubles dont elle est propriétaire et taxe d'habitation pour l'habitation meublée dont elle dispose, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant à titre gratuit), redevance audiovisuelle si l'habitation en France est équipée d'un téléviseur. Le site Internet du ministère des affaires étrangères et européennes précise les formalités à accomplir au départ de France et les modalités d'imposition les années suivantes : www.mfe.org/index.php puis thématiques>fiscalité.
SavoirLe transfert du domicile fiscal hors de France entraîne, sous certaines conditions, l'imposition des plus-values constatées sur les valeurs mobilières détenues par le contribuable. Cette exit tax a pour objet de dissuader les résidents français disposant d'un patrimoine mobilier représentant au moins 50 % des bénéfices d'une société ou d'une valeur supérieure à 800 000 euros de s'expatrier à l'étranger pour profiter d'une fiscalité plus favorable sur les plus-values dégagées au moment de la vente. Pour les personnes partant dans un Etat de l'Union européenne, la taxe est payable au moment de la vente effective des titres et non au moment du départ. Si les titres sont conservés quinze ans après le départ, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux de 15,5 %.
Le salarié qui tombe malade ou est victime d'un accident et qui ne peut pas travailler doit prévenir l'employeur dans les plus brefs délais. Si l'absence est programmée (intervention chirurgicale par exemple), l'employeur doit être prévenu le plus tôt possible et non la veille de l'absence (Cass. soc. 21-11-2012 no 11-18.686 : RJS 2/13 no 105).
Le salarié doit aussi lui envoyer par courrier simple ou recommandé un certificat médical d'arrêt de travail (le volet no 3). C'est obligatoire même si l'absence est de très courte durée (sauf, dans ce dernier cas, tolérance de l'employeur ou disposition particulière de la convention collective). Le délai d'usage est de 48 heures à compter du début de l'absence.
Quels sont les risques en cas de retard ou d'oubli ? Le salarié s'expose à des sanctions disciplinaires, voire à un licenciement pour absence injustifiée (Cass. soc. 26-5-2010 no 08-41.595 : RJS 8-9/10 no 659, validant un licenciement pour faute grave prononcé après 19 jours d'absence injustifiée). Mais les tribunaux retiennent des circonstances atténuantes, par exemple l'impossibilité physique de se déplacer ou une grève des postes. Ils considèrent aussi que l'employeur se met en tort s'il procède au licenciement avec une hâte excessive ou alors qu'il connaissait l'état de santé du salarié. En tout état de cause, celui-ci ne peut en aucun cas être considéré comme démissionnaire.
SavoirSi le salarié a envoyé un certificat médical, l'employeur ne peut pas le sanctionner sous prétexte qu'il a des doutes sur la réalité de la maladie (Cass. soc. 24-9-2013 no 12-13.537 : RJS 1/14 no 11, arrêt maladie transmis simultanément par plusieurs salariés appartenant au même service). Il doit prouver que le certificat médical est un certificat de complaisance. Cette preuve est difficile : la contre-visite médicale lui permet seulement d'interrompre le versement des indemnités complémentaires de maladie.
L'exercice d'une activité pendant l'arrêt maladie peut justifier le licenciement si cette activité implique un acte de déloyauté vis-à-vis de l'employeur et lui porte préjudice. Il y a comportement déloyal, par exemple, si le salarié se livre à une activité lucrative concurrente pour son propre compte (Cass. soc. 21-10-2003 no 01-43.943 : RJS 12/03 no 1384) ou s'il démarche les clients de son employeur pour la société gérée par son conjoint (Cass. soc. 23-11-2010 no 09-67.249 : RJS 2/11 no 121).
Ne sera en revanche pas considéré comme fautif l'exercice d'une activité non lucrative et occasionnelle, par exemple une activité bénévole pour une association ou des travaux de peinture à son domicile. Mais cet exercice peut avoir des incidences sur son droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Le salarié est dispensé de tout travail. L'employeur peut cependant lui demander de restituer du matériel ou de communiquer des informations nécessaires à l'activité de l'entreprise. Si le salarié est en période d'essai, la durée de celle-ci est prolongée autant de jours que le salarié a été arrêté.
Le versement du salaire est en principe interrompu. Mais l'employeur est souvent tenu de verser une indemnité complémentaire, voire de maintenir l'intégralité du salaire. En revanche, le salarié conserve l'usage de l'ensemble des avantages (voiture, téléphone, ordinateur) pour lesquels un usage personnel est autorisé. Et même si l'arrêt est très long, l'employeur ne peut demander au salarié de quitter son logement de fonction ou de lui verser un loyer (Cass. soc. 26-1-2011 no 09-43.193 : RJS 4/11 no 286).
Les indemnités journalières, également appelées prestations en espèces, sont versées aux salariés contraints d'interrompre leur activité professionnelle en raison d'une maladie ou d'un accident et qui ont travaillé pendant une durée suffisante durant la période précédant l'arrêt de travail.
Les chômeurs perçoivent les indemnités journalières, sauf si leur activité antérieure n'était pas suffisante pour leur donner droit aux prestations de sécurité sociale.
Contrairement aux prestations en nature, les indemnités journalières ne sont pas accordées aux ayants droit de l'assuré.
L'assuré ne doit se livrer à aucune activité, sans quoi il devra restituer l'intégralité des indemnités journalières reçues. S'il perçoit une rémunération, il s'expose à des pénalités financières et peut même être pénalement sanctionné. Les tribunaux appliquent très strictement cette condition. Par exemple, ils ont jugé justifiée la suppression des indemnités journalières d'un assuré qui, lors d'un contrôle, effectuait des travaux de peinture dans la maison de ses parents (Cass. soc. 11-1-1989 no 86-13.442) ou de celui qui participait à une compétition sportive pendant ses heures de sortie autorisées (Cass. 2e civ. 9-12-2010 no 09-14.575 : RJS 2/11 no 175). A noter que le salarié privé de ses indemnités pour avoir travaillé, même ponctuellement, au bénéfice de son employeur peut se retourner contre lui et obtenir un dédommagement (Cass. soc. 21-11-2012 no 11-23.009 : RJS 2/13 no 94).
Il existe toutefois des dérogations. Le médecin traitant peut, dans un but thérapeutique, autoriser la pratique de certaines activités. Le salarié en arrêt de travail ou qui souffre d'une maladie professionnelle ou d'une incapacité non professionnelle est autorisé à suivre une formation s'il bénéficie de l'accord de son médecin ou de celui de la CPAM.
Pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois de congé maladie, il faut avoir cotisé pendant les six mois civils précédant l'arrêt de travail sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le Smic horaire (valeur au 1er jour de la période de référence), soit 9 754,15 € pour un congé commençant le 1er juillet 2015. A défaut, il faut avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt.
Après six mois d'arrêt de travail, les indemnités sont réservées aux salariés immatriculés depuis au moins 12 mois, cette condition étant appréciée au premier jour du mois au cours duquel est survenu l'arrêt de travail. Il faut avoir cotisé pendant les 12 mois civils précédant l'arrêt de travail sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le Smic (valeur au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période) ; à défaut, il faut avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois ou 365 jours précédant l'arrêt de travail.
En cas d'arrêts de travail fréquents, la prise en charge peut être soumise à l'accord préalable du service de contrôle médical de la CPAM pour une durée maximale de six mois.
SavoirLes personnes qui perdent la qualité d'assuré parce qu'elles cessent leur activité salariée conservent leurs droits aux indemnités journalières pendant une durée maximale d'un an. Autrement dit, si elles remplissaient avant leur cessation d'activité les conditions pour bénéficier des indemnités journalières, elles continueront à percevoir celles-ci pendant un an maximum. Sont notamment concernés les salariés qui démissionnent et ceux qui prennent un congé sans solde, un congé sabbatique, un congé pour création d'entreprise ou encore un congé de solidarité familiale. Ne sont en revanche pas concernés les chômeurs indemnisés ainsi que les personnes qui cessent de résider en France.
Il faut d'abord envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie de son domicile, dans les 48 heures de l'interruption du travail, un avis médical d'arrêt de travail (volets 1 et 2), indiquant la durée probable de celui-ci et l'adresse où l'assuré pourra être contrôlé. Par la suite, pour que la caisse puisse calculer le montant des indemnités journalières, il faut lui adresser une attestation de l'employeur (le plus souvent, c'est ce dernier qui l'adresse à la caisse) indiquant le nombre de jours d'arrêt de travail et le salaire perçu par l'intéressé pendant la période précédant le congé.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, l'assuré doit avertir la CPAM dans les 48 heures. La prolongation doit être prescrite par le médecin traitant ou par le médecin qui a prescrit l'arrêt initial. A défaut, le salarié n'a pas droit aux indemnités journalières sauf dans les cas suivants : impossibilité pour l'un ou l'autre de ces médecins de prescrire la prolongation ; prolongation prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ou par un médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin traitant ; prolongation prescrite à l'occasion d'une hospitalisation (CSS art. R 162-1-9-1).
AttentionLe délai pour envoyer à la CPAM le certificat d'arrêt de travail ou la prescription de prolongation de celui-ci est un délai impératif : en cas d'envoi tardif, la caisse adresse au salarié un avertissement ; en cas de nouvel envoi tardif dans les deux années suivantes, les indemnités journalières dues pour la période comprise entre la date de la prescription de l'arrêt de travail et la date d'envoi de l'avis seront réduites de 50 %, sauf hospitalisation ou impossibilité d'envoyer l'avis en temps utile.
Les indemnités journalières sont dues pour chaque jour du congé maladie, y compris les jours habituellement non travaillés, les dimanches et les jours fériés, mais seulement à partir du 4e jour de l'arrêt de travail. En effet, la sécurité sociale applique un délai de carence de trois jours. Par exemple, si l'arrêt de travail débute le 9 mars, le salarié n'aura droit aux indemnités qu'à partir du 12 mars.
En cas d'arrêts de travail successifs, ce délai de carence est appliqué à chaque arrêt, sauf si l'assuré est atteint d'une maladie de longue durée.
La durée de versement des indemnités journalières est limitée.
Pour les maladies ordinaires, les assurés ne peuvent percevoir sur une période de trois ans plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies. A l'occasion de chaque arrêt de travail, la caisse recherche si cette limite n'a pas été dépassée durant les trois ans précédant chaque jour d'arrêt de travail, mais sans pouvoir tenir compte des périodes indemnisées au titre d'une affection de longue durée.
Pour les maladies chroniques ou de longue durée (à partir de six mois continus), les indemnités sont versées pendant une durée maximale de trois ans. Cette durée est calculée de date à date à compter du premier jour du premier arrêt de travail. Si l'arrêt est suivi d'une reprise du travail d'au moins un an, une nouvelle période de trois ans d'indemnisation commence. En revanche, si la reprise a duré moins d'un an, les périodes d'absence précédant la reprise seront prises en compte pour calculer la durée maximale d'indemnisation.
Si l'incapacité de travail persiste au-delà de trois ans, l'assuré peut prétendre à une pension d'invalidité s'il remplit les conditions requises.
SavoirLe versement des indemnités journalières est en principe interrompu lorsque l'assuré reprend le travail. Toutefois, le médecin peut lui prescrire une reprise du travail à temps partiel à titre thérapeutique (la prescription d'un temps partiel thérapeutique ne peut être prescrite dès le premier arrêt de travail) ; si le médecin-conseil de la CPAM l'autorise, l'assuré pourra continuer à percevoir les indemnités journalières en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse.
Les indemnités journalières sont calculées, dans la limite d'un plafond, d'après la rémunération perçue par le salarié pendant la période précédant l'arrêt de travail.
Pour les salariés mensualisés, l'indemnité est égale à la moitié du gain journalier de base, lui-même fixé à 1/91,25e du montant des trois dernières paies antérieures à l'arrêt de travail, chacune d'elles étant prise en compte dans la limite de 1,8 Smic mensuel en vigueur le dernier jour du mois précédant celui de l'arrêt de travail (soit 2 623,54 € pour un arrêt débutant le 1er juillet 2015).
Ainsi, le montant maximal de l'indemnité est, au 1er juillet 2015, de 43,13 € / jour, soit [(2 623,54 € × 3) / 91,25] / 2. Il est servi aux salariés qui ont un salaire égal ou supérieur à 1,8 Smic / mois. Pour ceux dont la rémunération est inférieure, il faut calculer. Par exemple, pour une rémunération brute mensuelle de 1 600 €, le gain journalier de base est égal à (3 × 1 600 €) : 91,25 = 52,60 €. En cas d'arrêt maladie, l'intéressé pourra prétendre à une indemnité journalière de 26,30 € (52,60 € : 2).
Lorsque le salarié a travaillé de manière discontinue (par exemple s'il est saisonnier), l'indemnité est portée à 1/365e des salaires des douze derniers mois (toujours dans la limite de 1,8 Smic mensuel).
A partir du 31e jour d'arrêt, l'indemnité est majorée au profit des assurés ayant au moins trois enfants à charge. Elle est alors égale aux 2/3 du gain journalier de base. Son montant maximal, au 1er juillet 2015, est de 57,50 € / jour.
Au-delà de trois mois d'arrêt, l'indemnité peut également être revalorisée, soit par application d'un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ministériel, soit à la demande du salarié si une augmentation des salaires minimaux fixés par la convention collective qui lui est applicable est intervenue pendant son arrêt de travail.
Pendant l'arrêt de travail, l'assuré peut faire l'objet d'un contrôle à son domicile ou être convoqué par le service de contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie. La suspension des indemnités journalières ou leur restitution peut être décidée si le médecin contrôleur considère après examen médical que la prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus justifiée. Il en est de même si l'assuré refuse de se soumettre à l'examen ou est absent de son domicile sans autorisation ni justification. Dans tous les cas, la caisse prévient l'employeur de l'assuré qui peut à son tour interrompre le versement des indemnités complémentaires.
Si les indemnités journalières sont suspendues à la suite d'une contre-visite médicale diligentée à la demande de l'employeur, l'assuré peut demander au service du contrôle médical un nouvel examen de sa situation dans les dix jours. La caisse prend sa décision dans les quatre jours suivant la réception de l'arrêt de travail (CSS art. D 315-4).
Si un assuré dont les indemnités journalières ont été suspendues se voit prescrire un nouvel arrêt de travail dans les dix jours suivant cette suspension, la reprise du versement est subordonnée à un avis favorable du service du contrôle médical rendu dans les quatre jours à compter de la réception de l'arrêt par la caisse (CSS art. L 323-7 et D 323-4).
Le médecin qui délivre l'avis d'arrêt de travail doit y mentionner soit que les sorties sont autorisées durant le congé maladie, soit qu'elles ne le sont pas. Si elles le sont, il est toutefois obligatoire de rester à son domicile de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux urgents à l'extérieur. Si l'état de santé de l'intéressé le justifie, son médecin peut autoriser des sorties totalement libres, à condition de mentionner les raisons d'ordre médical justifiant cette autorisation. En cas de sorties libres, le salarié est tenu à certaines obligations envers son employeur : voir no 59037.
Pour quitter le département de sa résidence habituelle pendant un congé maladie, il faut au préalable obtenir l'accord de la CPAM (Cass. 2e civ. 20-9-2012 no 11-19.181 : RJS 12/12 no 986). Si celle-ci le donne, le malade doit indiquer à son employeur et à la caisse l'adresse où il pourra être contrôlé.
Attention : séjourner à l'étranger (hors Union européenne) pendant un arrêt maladie, même pour des raisons familiales et avec l'autorisation du médecin traitant, expose à devoir rembourser les indemnités journalières reçues durant ce séjour (Cass. 2e civ. 28-4-2011 no 10-18.598 : RJS 8-9/11 no 726).
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, à l'exception de celles allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui sont exonérées.
Les indemnités journalières sont également soumises à la CSG (au taux réduit de 6,2 %) et à la CRDS (0,5 %). En revanche, elles échappent aux cotisations de sécurité sociale.
Sous certaines conditions, l'employeur garantit au salarié en arrêt maladie soit le versement d'indemnités complémentaires s'ajoutant aux indemnités journalières de sécurité sociale, soit le maintien du salaire.
Lorsque l'employeur maintient le salaire pendant le congé maladie, il se fait verser directement les indemnités journalières par la CPAM. Si le salaire maintenu est inférieur aux indemnités journalières (par exemple, le salarié ayant perçu des primes certains mois au cours de la période de référence, la moyenne des salaires servant au calcul des indemnités journalières est plus élevée que le salaire mensuel), le salarié perçoit les indemnités journalières versées par la CPAM s'il le désire. A défaut, l'employeur doit restituer au salarié la différence.
Sauf dispositions particulières du contrat de travail ou de la convention collective, sont privés d'indemnisation complémentaire les salariés intermittents, saisonniers ou intérimaires et les travailleurs à domicile.
Pour bénéficier du maintien du salaire ou des indemnités complémentaires pendant le congé maladie, le salarié doit selon la loi avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail mais certaines conventions collectives se contentent d'une ancienneté de quelques mois seulement.
Autres conditions : l'envoi à l'employeur dans les 48 heures d'un certificat médical d'arrêt de travail, une prise en charge par la sécurité sociale et des soins en France ou dans l'un des Etats de l'Union européenne.
La loi ne prévoit d'indemnisation complémentaire qu'à compter du 8e jour d'absence (on parle de « délai de carence »). Les conventions collectives peuvent cependant prévoir une indemnisation plus précoce, parfois dès le premier jour d'absence.
Sauf disposition plus favorable de la convention collective, le montant du salaire maintenu est de 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis pendant les 30 jours suivants des 2/3 seulement de cette rémunération. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au-delà d'un an, avec un maximum de 90 jours pour chacune des deux périodes d'indemnisation. Par exemple, les durées d'indemnisation sont chacune portées à 40 jours si le salarié a de 6 à 11 ans inclus d'ancienneté, à 50 jours entre 11 à 16 ans inclus d'ancienneté, et ainsi de suite.
La base de calcul de l'indemnisation est constituée par la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, avant déduction des cotisations sociales. Elle est calculée en tenant compte de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence.
En cas d'arrêts maladie antérieurs au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le salarié ne percevra pas d'indemnités pendant le nouveau congé maladie s'il a épuisé tous ses droits au titre de ses précédentes absences.
Les indemnités complémentaires versées par l'employeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi qu'aux cotisations de sécurité sociale. Elles supportent également la CSG (au taux de 7,5 %) et la CRDS (0,5 %).
Lorsqu'il maintient en tout ou partie le salaire pendant l'arrêt de travail, l'employeur a le droit de vérifier l'état de santé du salarié en le faisant examiner à son domicile par un médecin spécialisé dans le contrôle médical. Le contrôle médical patronal n'est pas possible lorsque le salarié ne perçoit pas d'indemnisation complémentaire faute d'ancienneté suffisante. Il n'est pas non plus possible en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'employeur ne doit pas abuser de cette possibilité (par exemple, demander un contrôle tous les mois) car il risque d'être accusé de harcèlement.
Si le salarié refuse de se laisser examiner par le médecin contrôleur ou s'il est absent de son domicile aux heures où il est tenu d'y demeurer, sans raison légitime (est par exemple légitime l'absence justifiée par la consultation du médecin traitant, sauf si celle-ci pouvait avoir lieu durant les heures de sortie autorisées), l'employeur peut cesser le versement des indemnités complémentaires ou du salaire pour la période suivant la date de la visite, mais pas pour la période précédant celle-ci (Cass. soc. 9-6-1993 no 90-42.701). En aucun cas l'attitude du salarié ne peut à elle seule justifier son licenciement ou une sanction disciplinaire (Cass. soc. 27-6-2000 no 98-40.952 : RJS 11/00 no 1061).
Si l'arrêt de travail mentionne que les sorties sont libres, le salarié doit informer son employeur du lieu et des heures où il pourra organiser une contre-visite médicale. Ainsi informé, de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par mail, l'employeur pourra suspendre le versement des indemnités complémentaires si le salarié est absent lors de la contre-visite aux horaires indiqués (sauf motif légitime). A défaut d'une telle information, l'employeur pourra, selon nous, organiser la contre-visite pendant les heures auxquelles le salarié doit rester à son domicile, soit dans le cas le plus courant de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.
Quelle est la portée de l'avis du médecin contrôleur ? Si celui-ci considère que l'arrêt de travail n'est pas justifié, le salarié n'est pas obligé de reprendre le travail. Mais l'employeur peut le priver des indemnités complémentaires pour la période postérieure au contrôle. Le salarié peut aussi perdre le bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale : le médecin contrôleur de l'employeur doit en effet transmettre son avis à la CPAM, qui peut décider de suspendre le versement des indemnités journalières pour la même période.
Si, après la contre-visite, le médecin traitant du salarié établit un certificat médical prolongeant l'arrêt de travail, les indemnités complémentaires devront lui être à nouveau versées (Cass. soc. 30-11-2005 no 03-45.665 : RJS 2/06 no 208).
Le salarié guéri doit reprendre le travail à l'expiration de l'arrêt maladie et retrouver le poste qu'il occupait auparavant. Lorsque la reprise fait suite à un arrêt pour longue maladie, un entretien professionnel doit lui être proposé (C. trav. art. L 6315-1, I, al. 2).
Si l'arrêt de travail a duré au moins 30 jours, l'intéressé doit passer une visite médicale dans les huit jours suivant son retour. Il est examiné par le médecin du travail qui apprécie s'il est apte à reprendre son ancien emploi et/ou si ses conditions de travail doivent être adaptées. S'il constate que le salarié n'est plus capable d'exercer tout ou partie de ses anciennes fonctions, l'employeur doit lui proposer un autre poste. Mais si c'est impossible, l'employeur a un mois pour licencier le salarié. Passé ce délai, il doit de nouveau lui verser son salaire (C. trav. art. L 1226-4).
Si le salarié n'est pas rétabli, il doit avertir son employeur et lui faire parvenir dans les 48 heures un certificat médical prescrivant une prolongation de l'arrêt de travail. S'il ne le fait pas ou le fait tardivement, il se met en tort et peut être licencié. Mais il ne peut pas être considéré démissionnaire.
Il s'agit de pathologies décrites dans des tableaux (établis par décrets) dont l'origine professionnelle est présumée si la victime justifie qu'elle a été dans le cadre de son travail exposée de façon habituelle au risque de leur contraction (par exemple, exposition prolongée à l'amiante). Le caractère professionnel d'une maladie peut également être reconnu après expertise individuelle, même si la pathologie ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ou si, y figurant, elle ne remplit pas toutes les conditions définies par eux (CSS art. L 461-1).
Dans tous les cas, les maladies professionnelles donnent lieu à la même protection du salarié que les accidents du travail (couverture des frais de santé, indemnisation des arrêts de travail, rentes et protection contre le licenciement). Condition : la caisse primaire d'assurance maladie doit en reconnaître le caractère professionnel, dans un délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie, ou de six mois si des examens et enquêtes complémentaires sont jugés nécessaires (CSS art. R 441-10 et CSSR 441-14). La déclaration est faite par le salarié dans les 15 jours suivant le début de son arrêt de travail à l'aide d'un imprimé spécial (www.ameli.fr).
C'est un accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (CSS art. L 411-1). Plus précisément :
- l'accident du travail suppose un fait accidentel, c'est-à-dire un événement survenu soudainement et ayant provoqué une lésion ; la lésion due à un état pathologique préexistant n'est pas un accident du travail, sauf si un événement sur le lieu de travail en a précipité l'évolution (Cass. soc. 16-12-1993 no 91-18.376 : RJS 2/94 no 185, pour un infarctus dont a été victime un salarié cardiaque en raison d'un rythme de travail inhabituel) ; un décalage dans le temps entre cet événement et l'apparition des troubles n'exclut pas la qualification d'accident du travail si ces troubles ont de façon certaine été provoqués à l'occasion du travail (Cass. soc. 2-4-2003 no 00-21.768 : RJS 6/03 no 801, troubles consécutifs à une vaccination imposée par l'employeur) ;
- l'accident du travail implique une lésion corporelle ou des troubles psychologiques : par exemple, une dépression nerveuse apparue à la suite d'un entretien d'évaluation a été jugée constitutive d'un accident du travail (Cass. 2e civ. 1-7-2003 no 02-30.576 : RJS 10/03 no 1222) ;
- l'accident doit présenter un lien avec le travail. Il doit en principe survenir dans un lieu (locaux de travail, vestiaires, cantine, lavabos, parking, etc.) et à un moment où le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur (temps de travail proprement dit, mais aussi temps de pause, de déjeuner ou de douche pris à l'intérieur de l'entreprise) ; l'accident qui se produit hors de l'entreprise ou en dehors du temps de travail n'est pas un accident du travail, à moins qu'il ne soit démontré qu'il est survenu par le fait du travail : tel est le cas du salarié qui se blesse à son domicile alors qu'il y travaille pour l'employeur (Cass. soc. 9-3-1995 no 93-10.918 : RJS 4/95 no 453), ou du salarié qui fait une tentative de suicide chez lui, en raison du harcèlement moral de son supérieur (Cass. 2e civ. 22-2-2007 no 05-13.771 : RJS 5/07 no 666).
L'accident de trajet est celui qui survient entre les points suivants, d'une part, le lieu du travail et, d'autre part (CSS art. L 411-2) :
- la résidence principale, une résidence secondaire ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d'ordre familial ;
- ou le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend régulièrement ses repas, lorsqu'il est situé en dehors de l'entreprise.
Un détour pendant le trajet peut faire perdre au salarié la protection attachée à l'accident de trajet, sauf si ce détour a lieu dans le cadre d'un covoiturage ou est motivé par les nécessités de la vie courante (par exemple l'achat de nourriture) ou par l'emploi.
Sauf interruption de la mission pour un motif personnel, l'accident survenu lors d'un déplacement professionnel est un accident du travail, qu'il ait eu lieu à l'occasion d'un acte professionnel, d'un acte de la vie courante ou pendant le trajet, à l'aller ou au retour, entre le lieu de la mission et l'entreprise ou le domicile du salarié.
L'accident de trajet n'a pas tout à fait les mêmes conséquences qu'un accident de travail : le salarié n'a pas droit à la même protection contre le licenciement, mais il bénéficie d'une couverture sociale identique (prise en charge des frais médicaux et indemnités journalières), bien plus favorable qu'en cas d'accident non professionnel.
Sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime, le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet doit avertir ou faire avertir l'employeur ou l'un de ses représentants dans les 24 heures. Cette déclaration peut être faite verbalement sur le lieu de l'accident ou par courrier envoyé en recommandé.
Dès qu'il en a la possibilité, le salarié doit remettre une feuille d'accident (délivrée par l'employeur) au médecin qui aura constaté ses lésions et établi un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles et, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail.
SavoirL'employeur doit déclarer tout accident du travail et accident de trajet à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, dans les 48 heures qui suivent le moment où il en est informé. En cas d'arrêt de travail, il doit adresser à la caisse une attestation de salaire indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent les paies, le montant et la date de ces paies. Ces formalités sont nécessaires pour permettre au salarié d'être pris en charge par la caisse. Si l'employeur ne les fait pas, le salarié a deux ans pour effectuer lui-même ces déclarations.
En cas d'accident du travail ou de trajet, les frais médicaux sont mieux pris en charge qu'en cas de maladie. Sauf pour les dépenses de transport, la victime bénéficie du système du tiers payant qui lui permet de ne pas faire l'avance des frais. Elle est dispensée du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier et du forfait de 18 € sur les actes lourds nécessités par son accident. En revanche, restent à la charge de la victime les autres participations forfaitaires visées no 59125, sauf si la victime en est dispensée à un autre titre, par exemple en cas d'hospitalisation, ainsi que les éventuels dépassements d'honoraires.
La prise en charge des frais médicaux selon ces modalités est assurée à une condition : la caisse primaire d'assurance maladie doit reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Elle a 30 jours à partir du moment où elle a connaissance de l'accident pour instruire le dossier et prendre sa décision. L'absence de réponse dans ce délai (éventuellement prolongé de quelques semaines si la caisse décide de procéder à des enquêtes ou examens médicaux complémentaires) vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (CSS art. R 441-10).
Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet a droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
- l'indemnité journalière est due dès le lendemain de l'arrêt de travail (la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit étant intégralement à la charge de l'employeur), jusqu'à la date de reprise du travail, de consolidation de la blessure ou de décès de la victime ;
- elle est versée pour tous les jours (même non ouvrables) d'arrêt de travail ;
- le montant de l'indemnité journalière est, en principe, égal à 60 % du salaire journalier de base (soit 1/30,42e de la dernière paie pour les salariés mensualisés et 1/365e des salaires des 12 derniers mois pour ceux travaillant de manière discontinue) pendant les 28 premiers jours de l'arrêt de travail et à 80 % de ce même salaire à partir du 29e jour. Mais, le salaire journalier de base étant plafonné (317,25 € en 2015), les indemnités journalières le sont également. En 2015, elles sont au plus de 190,35 € pour la première période et de 253,80 € pour la seconde ;
- les indemnités journalières échappent à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant et aux cotisations de sécurité sociale, mais elles sont soumises à la CSG (au taux réduit de 6,2 %) et à la CRDS (0,5 %).
Le salarié peut aussi prétendre au maintien de son salaire (l'employeur percevant alors les indemnités journalières à sa place) ou au paiement par ce dernier d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières. Pour avoir droit à cette indemnisation, il faut remplir les mêmes conditions qu'en cas de maladie non professionnelle, sous réserve d'adaptations de la convention collective.
A noter que la durée de l'arrêt de travail doit être prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté dans l'entreprise : prime d'ancienneté, participation, indemnité de licenciement, etc. (C. trav. art. L 1226-7).
Il est en principe interdit à l'employeur de rompre le contrat d'un salarié victime d'un accident du travail (mais pas celui victime d'un accident de trajet) pendant toute la durée de l'arrêt de travail (C. trav. art. L 1226-9). Cette interdiction joue non seulement pour le licenciement, mais aussi pour la rupture durant la période d'essai, la rupture anticipée de contrat à durée déterminée ou le non-renouvellement d'un tel contrat si ce dernier contient une clause précise de renouvellement (C. trav. art. L 1226-18 s.).
Par exception, la rupture du contrat de travail est autorisée pour un motif non lié à l'accident (par exemple, en cas de faute grave du salarié ou en raison d'une fin de chantier). Une rupture conventionnelle peut également être conclue (Cass. soc. 30-9-2014 no 13-16.297 : RJS 12/14 no 855).
Si l'employeur méconnaît cette interdiction, la rupture est nulle (C. trav. art. L 1226-13). Le salarié peut réclamer sa réintégration. S'il ne souhaite pas être réintégré, le salarié a droit :
- s'il bénéficiait d'un CDI, aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis), ainsi qu'à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ;
- s'il était en CDD, à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, ainsi qu'aux indemnités de fin de contrat et de congés payés.
Le médecin du travail reçoit, pour une visite de reprise, tous les salariés qui ont été en arrêt au moins 30 jours et ceux qu'il estime nécessaire de voir.
Si le salarié est déclaré apte, il doit retrouver son emploi ou, si ce dernier a été supprimé ou n'est plus disponible, un emploi similaire avec une rémunération équivalente (C. trav. art. L 1226-8). L'employeur qui refuse de réintégrer le salarié et le licencie peut être condamné à lui verser, outre les indemnités de licenciement et de préavis, une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire (C. trav. art. L 1226-15).
Lorsque l'avis d'aptitude comporte des réserves ou des recommandations, l'employeur est obligé de s'y conformer (Cass. soc. 26-9-2012 no 11-14.742 : RJS12/12 no 939).
Si le salarié est déclaré inapte à son précédent emploi, l'employeur doit lui proposer un autre poste approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des différents établissements de l'entreprise, voire dans une autre entreprise du groupe (C. trav. art. L 1226-10). Le projet de loi Rebsamen prévoit toutefois que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement lorsque le médecin précise dans son avis que le maintien du salarié dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé (Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 2-6-2015). En principe, l'emploi de reclassement doit être comparable au précédent et n'entraîner aucune modification du contrat de travail. Si le seul poste disponible comporte une telle modification, il doit être proposé au salarié, mais celui-ci est en droit de le refuser.
En cas de licenciement d'un salarié inapte dont le reclassement n'est pas impossible ou refusé par l'intéressé, celui-ci bénéficiera, à défaut de réintégration, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement (voir ci-dessous), ainsi que de dommages et intérêts correspondant à au moins 12 mois de salaire.
En cas d'impossibilité de reclassement, soit parce qu'il n'y a aucun poste adapté, soit parce que le salarié a refusé le poste proposé, l'employeur peut licencier le salarié. En cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement ou, si elle lui est supérieure, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité spéciale n'est pas due si l'employeur établit que le refus du salarié du reclassement proposé est abusif (l'indemnité de licenciement est alors due au taux normal). A défaut de licenciement dans le délai d'un mois, l'employeur doit reprendre le versement du salaire (C. trav. art. L 1226-11).
Le salarié déclaré inapte à toute activité salariée peut, dans l'attente de son reclassement ou de son licenciement, bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude dont le montant est égal à celui de l'indemnité journalière perçue durant la période de suspension de son contrat de travail. Cette indemnité est versée à compter du jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude jusqu'au jour où le salarié est licencié ou reclassé, dans la limite d'un mois (en l'absence de licenciement ou de reclassement au bout d'un mois, l'employeur doit en effet reprendre le paiement du salaire). Pour en bénéficier, le salarié doit adresser à la CPAM dont il relève un formulaire qui lui est remis par le médecin du travail. Un volet du formulaire doit être transmis à l'employeur.
Lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente de travail, la victime a droit à une rente forfaitaire à partir du lendemain de la date de consolidation de sa blessure, c'est-à-dire du moment où sa lésion s'est stabilisée définitivement, sous réserve d'une rechute. Elle est due jusqu'au décès de la victime, sauf si celle-ci a demandé à la caisse (par un imprimé spécial) sa conversion en capital ou en rente réversible au bénéfice de son conjoint. Par exception, l'indemnité est versée en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 10 %.
Le montant de la rente est calculé en fonction du taux d'incapacité et du salaire perçu par la victime pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (le salaire pris en compte est plafonné à 146 108,32 € en 2015). C'est la caisse primaire d'assurance maladie qui se prononce sur l'existence de l'incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente.
Lorsque l'intéressé est atteint d'une incapacité au moins égale à 80 % et est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Son montant mensuel en 2015 varie de 551,55 € à 1 654,63 € en fonction du nombre d'actes nécessitant une assistance. Les personnes qui percevaient avant le 28 février 2013 la majoration de 40 % pour recours à assistance d'une tierce personne ont pu choisir de conserver cette majoration ou adopter la prestation complémentaire.
Lorsqu'un salarié décède des suites de l'accident, ses proches ont droit à une rente, calculée sur la base du salaire annuel de la victime (plafonné à 146 108,32 € en 2015), selon un taux variable selon le lien de parenté avec le défunt.
Peuvent prétendre à la rente :
- le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs : il perçoit 40 % du salaire annuel de la victime (taux porté à 60 % pour le conjoint à partir de 55 ans ou s'il est atteint d'une incapacité de travail d'au moins 50 %) ;
- les enfants : ils ont droit à une rente collective jusqu'à l'âge de 20 ans, fixée à 25 % pour un enfant, 50 % pour deux enfants, chaque enfant supplémentaire donnant droit à une majoration de 20 %. Les orphelins de père et de mère ont droit à un complément de rente de 30 % ;
- les ascendants : ils perçoivent une rente de 10 % (l'ensemble des rentes versées aux ascendants étant limité à 30 %), mais seulement si la victime n'avait ni conjoint ni enfant ou, dans le cas contraire, s'ils prouvent qu'ils étaient à la charge de la victime au moment du décès.
L'ensemble des rentes versées aux différents ayants droit ne peut pas dépasser 85 % du salaire annuel de base de la victime. En cas de dépassement, chaque rente est réduite proportionnellement.
A la rente d'ayants droit viennent éventuellement s'ajouter un capital décès versé par la sécurité sociale, le remboursement d'une partie des frais funéraires et, lorsque l'accident mortel s'est produit au cours d'un déplacement professionnel en France, les frais de transport du corps jusqu'au lieu de sépulture si le défunt est également inhumé en France.
Tout assuré social du fait de sa propre activité professionnelle peut bénéficier des prestations en nature, c'est-à-dire de la prise en charge de ses dépenses de santé. C'est également le cas de ceux qui perçoivent une allocation ou rente accident du travail et maladie professionnelle, une pension ou rente de vieillesse, une pension de réversion ou d'invalidité, ainsi que des chômeurs et handicapés.
A noter que les étudiants doivent s'affilier à une mutuelle étudiante au moment de leur inscription dans l'enseignement supérieur pour pouvoir bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. L'affiliation est payante pour les étudiants atteignant l'âge de 20 ans pendant l'année universitaire, sauf pour les boursiers.
Les prestations en nature couvrent les frais médicaux de l'assuré social, mais aussi de certains de ses proches qui ne sont pas assurés sociaux eux-mêmes et qu'on appelle les ayants droit. Il s'agit du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs, des enfants jusqu'à 16 ans (jusqu'à 20 ans s'ils poursuivent des études ou sont atteints d'une maladie ou d'un handicap les empêchant de travailler), des parents, beaux-parents, frères, soeurs, s'ils sont à sa charge, ainsi que de la personne vivant à la charge de l'assuré depuis au moins 12 mois.
Si les deux parents sont assurés sociaux, les enfants peuvent être rattachés comme ayants droit à leur père, à leur mère ou à chacun des parents. Dans ce dernier cas, les prestations sont versées à celui des deux parents qui effectue le premier la demande de remboursement.
Pour avoir droit au remboursement des frais de maladie (ou donner ce droit à un proche), il faut avoir suffisamment cotisé à la sécurité sociale ou, à défaut, avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période dite « de référence ». Les droits sont ouverts pendant la période suivant immédiatement la période de référence.
Depuis le 30 décembre 2013, l'assuré doit :
- soit avoir au cours de l'année civile travaillé au moins 400 heures ou cotisé sur au moins 400 fois le Smic horaire (valeur au 1er janvier de l'année de référence) ;
- soit avoir travaillé au moins 120 heures ou cotisé sur 120 fois le Smic horaire (valeur au premier jour de la période) sur une période de trois mois civils ou de trois mois de date à date ;
- soit avoir travaillé au moins 60 heures ou cotisé sur au moins 60 fois le Smic horaire (valeur au premier jour de la période) au cours d'un mois civil ou d'une période de 30 jours.
Le droit au remboursement est acquis pour une durée de deux ans (CSS art. R 313-2).
Les personnes ne remplissant plus les conditions pour être prises en charge en raison, par exemple, d'une cessation d'activité ou de la fin de l'indemnisation du chômage bénéficient du maintien des prestations en nature pendant un an. Il en est de même des ayants droit d'un assuré en cas de décès de celui-ci, de divorce ou de séparation, si l'ayant droit ne bénéficie pas des prestations à un autre titre.
Par dérogation, le maintien des prestations en nature est accordé au-delà d'un an :
- aux personnes en situation de maintien de droits au 29 décembre 2013, pour une année supplémentaire (Décret 2013-1260 du 27-12-2013) ; par exemple, un assuré dont le maintien des droits était prévu jusqu'au 29 novembre 2014 a droit à être remboursé de ses frais médicaux jusqu'au 29 novembre 2015 ;
- à l'ex-conjoint séparé, divorcé ou veuf, jusqu'aux trois ans du dernier enfant à charge ;
- à l'assuré ayant ou ayant eu au moins trois enfants à charge, sans limitation de durée.
La CMU de base permet à toutes les personnes qui résident en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois et qui ne relèvent d'aucun régime de protection sociale de bénéficier de la prise en charge de leurs frais médicaux et de ceux engagés pour leurs proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, enfants et parents à charge, etc.).
Pour obtenir la CMU de base, il faut remplir un dossier de demande (téléchargeable sur le site www.ameli.fr rubrique formulaires) et l'adresser à la CPAM de son domicile. L'affiliation est automatique et immédiate : le bénéfice des prestations en nature est ouvert dès le dépôt de la demande, pour une durée d'un an renouvelable.
La CMU est accordée gratuitement si vos ressources ne dépassent pas un certain montant (jusqu'au 31 décembre 2015, les revenus du foyer en 2013 doivent être inférieurs à 9 601 €). Si elles sont supérieures à ce montant, vous devrez acquitter une cotisation de 8 % sur la partie des revenus dépassant ce plafond.
Il s'agit d'une complémentaire santé gratuite qui peut vous être accordée si vos ressources annuelles ne dépassent pas les plafonds suivants (chiffres au 1er juillet 2015) : 8 645 € pour une personne seule ; 12 967 € pour deux personnes ; 15 560 € pour trois personnes ; 18 153 € pour quatre personnes, plus 3 457,81 € par personne supplémentaire. Il faut comme pour la CMU de base résider en France de manière stable et régulière depuis plus de trois mois. A noter que même si vous bénéficiez de la CMU de base mais que vos ressources sont supérieures à ces plafonds, vous ne pouvez pas bénéficier de la CMU complémentaire.
La CMU complémentaire vous donne droit à la dispense d'avance des frais, dans la limite des tarifs de responsabilité, à la prise en charge du ticket modérateur et des participations forfaitaires visées no 59125 ainsi que, dans certaines limites, à celle des frais de soins dentaires, de lunettes et de prothèses auditives.
Pour en bénéficier, il faut adresser à la CPAM un dossier de demande (téléchargeable sur le site www.ameli.fr rubrique formulaires) en indiquant l'organisme de prévoyance choisi (CPAM, mutuelle, compagnie d'assurance ou institution de prévoyance). La CPAM dispose d'un délai maximum de deux mois pour répondre, son silence valant acceptation. Le droit à la CMU complémentaire prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse.
Sont pris en charge par l'assurance maladie les frais suivants :
- frais de médecine générale et spéciale ;
- frais de soins et de prothèses dentaires ;
- frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoire ;
- frais d'appareillage ;
- frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure et frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
- frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle ;
- frais d'intervention chirurgicale ;
- frais de transport ;
- frais de déplacement des médecins généralistes en cas de consultation à domicile médicalement justifiée (personnes dépendantes, malades atteints d'affections graves, personnes résidant dans une zone géographique où il est difficile d'accéder aux soins de premiers secours) ;
- frais liés à certaines vaccinations.
Dans les hôpitaux publics et la plupart des cliniques conventionnées, les frais d'hospitalisation sont pris en charge selon la règle du tiers payant qui dispense l'assuré de faire l'avance des frais remboursables.
Ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale les actes effectués en dehors de toute justification médicale (obtention d'un certificat médical pour une licence sportive, un brevet de pilote, etc.).
En principe, l'assuré ou son ayant droit paie directement les soins reçus puis se fait rembourser par sa caisse primaire d'assurance maladie. Pour cela, il lui suffit de présenter sa carte Vitale au moment de la consultation. La feuille de soins établie par le praticien est transmise directement à la caisse primaire par informatique : les remboursements sont effectués automatiquement.
Si le professionnel de la santé consulté n'est pas équipé pour l'utilisation de la carte Vitale, il faut envoyer les feuilles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie.
Si l'assuré bénéficie du tiers payant, il est dispensé de faire l'avance des frais remboursables, la caisse payant directement le praticien ou l'établissement de soins. Sont à ce jour concernés notamment les bénéficiaires de la CMU-C et de l'aide à la complémentaire santé (no 59200). Mais le tiers payant pourrait être progressivement étendu, entre 2016 et 2017, à tous les patients pour leurs consultations médicales (Projet de loi de modernisation du système de santé, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14-4-2015).
Certains actes ne sont remboursés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable de la CPAM : on parle d'« entente préalable ». C'est notamment le cas de l'orthodontie, de l'orthophonie ou de la kinésithérapie au-delà de certains seuils, des transports sanitaires en série ou pour une distance de plus de 150 km.
Avant l'exécution de l'acte ou des soins, l'assuré doit adresser à la caisse une demande sur un imprimé spécial rempli et signé par le praticien qui doit exécuter l'acte. La caisse dispose d'un délai de 15 jours pour notifier son éventuel refus. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la prise en charge (Circ. Cnamts 17 du 17-1-2002).
Lorsqu'elle est prévue, cette formalité est obligatoire. Le défaut de demande ou une demande tardive fait perdre à l'assuré ses droits à remboursement, tout comme la demande effectuée sur papier libre et non au moyen de l'imprimé spécial (Cass. 2e civ. 9-10-2014 no 13-23.920 : BDP 2/14 inf. 72).
Dans certains cas d'urgence, le praticien peut dispenser immédiatement les soins sans l'accord préalable de la CPAM. Pour obtenir le remboursement, l'assuré doit envoyer avec la feuille de soins l'imprimé de demande d'entente préalable, avec la mention « acte d'urgence ».
En règle générale, le remboursement de la sécurité sociale n'est que partiel. Pour les médecins conventionnés, il est effectué sur la base de tarifs conventionnels, également appelés tarifs de responsabilité, qui constituent les limites de remboursement de la sécurité sociale.
Les médecins conventionnés relevant du secteur 1 sont les médecins généralistes et spécialistes qui se sont engagés auprès de l'assurance maladie à appliquer les tarifs officiels. Ils ne peuvent facturer de dépassements d'honoraires qu'à titre exceptionnel (par exemple, pour une visite à domicile à la demande du patient sans que l'état de celui-ci justifie le déplacement ou pour une consultation hors du parcours de soins).
Les médecins conventionnés de secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires (sauf urgence ou s'ils interviennent pour un patient bénéficiaire de la CMU ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé). Les patients ne sont remboursés que sur la base du tarif conventionnel. Parmi les médecins du secteur 2, il est prévu que ceux ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ne peuvent fixer des honoraires dépassant de plus de 100 % le tarif de la sécurité sociale, leurs patients bénéficiant d'un remboursement plus avantageux (Arrêté du 26-11-2013 : JO 30 p. 19439).
Si le médecin est non conventionné, il fixe librement le montant de ses honoraires et le remboursement de ses actes se fera sur la base d'un tarif, dit d'autorité, qui est très faible. Il en va de même des frais d'hospitalisation en clinique non conventionnée.
Dans tous les cas, les honoraires qui dépassent les tarifs conventionnels doivent être fixés avec « tact et mesure ». Le respect de cette exigence est apprécié notamment en fonction de la situation financière du patient, de la notoriété du praticien, de la complexité de l'acte réalisé, du temps consacré et du service rendu au patient. Le praticien qui ne respecterait pas cette exigence s'expose à une pénalité financière égale au plus au double du dépassement pratiqué.
Tous les professionnels de santé doivent afficher dans leur salle d'attente, de façon visible et lisible, les tarifs ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie de leurs prestations les plus courantes (CSP art. L 1111-3). Cet affichage doit également expliquer au patient la situation du professionnel compte tenu de sa sectorisation, notamment en ce qui concerne les dépassements d'honoraires. A défaut d'un tel affichage, le praticien s'expose à diverses sanctions pouvant aller jusqu'à une pénalité financière de 3 000 € (Décret 2009-152 du 10-2-2009).
Les professionnels de santé doivent aussi remettre à leurs patients une information écrite préalable si, lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont d'au moins 70 € (Arrêté du 2-10-2008 : JO 11 p. 15687). L'information doit préciser le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé. A défaut d'une telle information, le praticien s'expose à une pénalité financière égale au montant du dépassement facturé.
De son côté, l'assurance maladie a mis en place un annuaire qui permet à tout assuré de connaître via son site www.ameli-direct.ameli.fr ou par téléphone au 36 46 les coordonnées de chaque médecin libéral en France, de savoir s'il accepte ou non la carte Vitale, s'il est ou non conventionné et, dans le premier cas, s'il est en secteur 1 (tarifs de la sécurité sociale) ou 2 (honoraires libres). Pour les praticiens de secteur 2, l'information prend la forme d'une fourchette des honoraires habituellement pratiqués. Cet annuaire inclut aussi les actes techniques effectués par les professionnels de santé : radios, scanners, échographies, etc.
Même si la dépense ne dépasse pas le tarif conventionnel de sécurité sociale, une partie reste en principe à la charge de l'assuré : c'est ce qu'on appelle le « ticket modérateur ». Si le parcours de soins est respecté, cette participation est fixée dans les limites suivantes (CSS art. R 322-1) :
- 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation, les honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ainsi que les frais d'analyses et de laboratoire afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation ;
- 25 à 35 % pour les autres frais d'honoraires des praticiens ;
- 35 à 45 % pour les honoraires des auxiliaires médicaux, ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoire liés aux soins dispensés hors hospitalisation ;
- 70 à 90 % pour les médicaments dits de confort et pour l'homéopathie ;
- 30 à 50 % pour les autres frais, y compris les frais de transport.
Dans certains cas, l'assuré est dispensé de ticket modérateur : il est pris en charge à 100 %. C'est notamment le cas s'il est atteint d'une maladie inscrite sur la liste des affections longues et coûteuses, pour les frais liés à cette maladie. Sont également remboursés à 100 %, sur la base des tarifs de la sécurité sociale : les interventions chirurgicales d'une certaine gravité, les frais d'hospitalisation à compter du 31e jour consécutif d'hospitalisation, certains médicaments irremplaçables et particulièrement coûteux, les interruptions volontaires de grossesse, etc.
La décision de prise en charge à 100 % est notifiée directement à l'assuré. L'intéressé peut également en faire lui-même la demande à la caisse. Il aura la réponse dans un délai d'un mois, l'absence de réponse valant refus.
Le ticket modérateur est remplacé par un forfait de 18 € pour certains actes médicaux lourds (actes dont le tarif est égal ou supérieur à 120 € ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 60) ; si plusieurs de ces actes sont effectués au cours d'une même hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique) ou au cours d'une même consultation, le forfait n'est appliqué qu'une fois. Certains assurés sont exonérés du paiement du forfait : il s'agit notamment de ceux qui bénéficient d'une dispense de ticket modérateur, des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse, des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Au ticket modérateur s'ajoutent plusieurs participations forfaitaires qui sont déduites automatiquement des remboursements effectués par la CPAM ou sont recouvrées directement auprès de l'assuré par cette dernière :
- un forfait de 1 € pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin et pour tout acte de radiologie ou de biologie médicale (scanners, analyses sanguines, etc.), dans la limite globale de 50 € par an ; si au cours de la même journée vous consultez plusieurs fois le même médecin ou si vous bénéficiez de plusieurs actes effectués par le même professionnel, le forfait sera appliqué dans la limite de 4 € par jour et par médecin ;
- une franchise médicale de 0,50 € par boîte de médicament et par acte paramédical (intervention d'un infirmier ou d'un kinésithérapeute par exemple) et de 2 € par transport sanitaire, dans la limite globale de 50 € par an ; si au cours d'une même journée vous effectuez plusieurs transports sanitaires, le montant de la franchise est plafonné à 4 € par jour et par transporteur ; il est limité à 2 € par acte et par intervenant si vous bénéficiez au cours de la même journée de plusieurs actes paramédicaux ;
- en cas d'hospitalisation, un forfait hospitalier fixé à 18 € par jour (13,50 € pour une hospitalisation en psychiatrie) ; le patient hospitalisé est en revanche dispensé des trois franchises précédentes.
Les participations forfaitaires ne sont pas dues par certains assurés ou ayants droit d'assurés : notamment, les moins de 18 ans, les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse et les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'aide à la complémentaire santé (ACS).
Tout patient âgé d'au moins 16 ans doit respecter un parcours de soins, c'est-à-dire choisir un médecin traitant et le consulter en priorité, y compris avant d'aller chez un spécialiste (le médecin consulté en second, selon le cas un généraliste ou un spécialiste, est appelé médecin correspondant). Les enfants ne sont aujourd'hui pas concernés. Cependant, le suivi médical des moins de 16 ans par un médecin traitant pourrait être prochainement instauré, tout en restant facultatif (Projet de loi de modernisation du système de santé, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14-4-2015).
Par exception, la consultation préalable du médecin traitant n'est pas obligatoire en cas de protocole de soins particuliers, de vacances ou de déplacement du patient, d'urgence médicale ou d'absence du médecin traitant. Il en va de même, notamment pour :
- les consultations de certains spécialistes : ophtalmologues (pour la prescription et le renouvellement de lunettes, les actes de dépistage et de suivi du glaucome), gynécologues (pour les examens cliniques gynécologiques périodiques, y compris les actes de dépistage, la prescription et le suivi d'une contraception, le suivi des grossesses, l'IVG médicamenteuse), psychiatres ou neuropsychiatres (si le patient est âgé de 16 à 25 ans), stomatologues (sauf pour des actes chirurgicaux lourds) ;
- la consultation d'un médecin exerçant dans le même cabinet que le médecin traitant ;
- les consultations à l'hôpital de tabacologie, d'alcoologie et de lutte contre les toxicomanies.
En cas de non-respect du parcours de soins, le taux de remboursement de la consultation sera de 30 % du tarif conventionnel au lieu de 70 %. Par exemple, la consultation d'un médecin généraliste de secteur 1 ou 2 sera remboursée 5,90 € (30 % de 23 € - participation forfaitaire de 1 €) au lieu de 15,10 €. Le non-respect du parcours de soins peut également justifier une augmentation du prix de la consultation, limitée à 17,5 % du tarif conventionnel. A noter que le tarif conventionnel de consultation d'un médecin généraliste est de 23 € au 1er juillet 2015. Le patient qui n'a pas désigné de médecin traitant se voit appliquer ce taux réduit de remboursement même s'il a consulté un spécialiste dont l'accès direct est autorisé (CE 12-2-2014 no 354505 : RJS 5/14 no 432).
Cela dit, une lettre d'introduction du médecin traitant n'est pas indispensable pour aller consulter un spécialiste. La déclaration du patient selon laquelle il vient de la part de son médecin traitant suffit en pratique.
Qui peut-on choisir comme médecin traitant ? Un généraliste ou un spécialiste, exerçant en cabinet, à l'hôpital ou dans un centre de santé. Il n'y a aucune contrainte géographique : on peut choisir un médecin qui exerce loin de son domicile. L'accord du médecin est nécessaire. S'il refuse, il faut se mettre en quête d'un autre médecin traitant ou en aviser la caisse primaire d'assurance maladie ; cette dernière doit trouver une solution.
Pour notifier son choix à la caisse primaire d'assurance maladie dont on dépend, il faut lui adresser un formulaire spécifique appelé « déclaration de choix du médecin traitant » indiquant le nom du médecin choisi, signé par lui et par le patient (ou par l'un de ses parents si le patient a entre 16 et 18 ans). Les formulaires sont disponibles auprès des caisses ou téléchargeables sur Internet (www.ameli.fr, rubrique formulaires).
Peut-on changer de médecin traitant ? Oui, et à tout moment. Il suffit de remplir et de signer, avec le médecin choisi comme nouveau médecin traitant, une nouvelle « déclaration de choix du médecin traitant » et de l'adresser à sa caisse d'assurance maladie. Cette déclaration annule la précédente.
Tout dépend du pays dans lequel on se fait soigner.
Dans les pays membres de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse, en cas de maladie ou d'accident pendant un séjour, on peut bénéficier d'une prise en charge sur place des dépenses de santé si l'on a pris le soin de se procurer avant le départ auprès de la CPAM la carte européenne d'assurance maladie. Dans le cas contraire, il faut faire l'avance des frais et présenter au retour en France les factures acquittées à la caisse pour être remboursé.
Dans les autres pays, en l'absence de convention de sécurité sociale avec la France, aucune prise en charge sur place des frais médicaux n'est prévue. On peut toutefois tenter de se faire rembourser lors du retour en France, les caisses acceptant dans certains cas une prise en charge des frais dans la limite des tarifs forfaitaires français.
L'adhésion à une complémentaire santé privée, souvent dénommée mutuelle, permet de compléter la prise en charge des dépenses médicales par la sécurité sociale. Il existe différentes formules, collectives ou individuelles.
Un employeur peut souscrire, pour l'ensemble de son personnel, une complémentaire santé dite collective. Il prend alors en charge une partie de son coût, le reste étant assumé par les salariés. Selon les cas, soit ces derniers bénéficient d'une couverture pour eux et leurs ayants droit, soit ils peuvent choisir entre une couverture personnelle ou familiale à des tarifs différents.
En principe, l'adhésion à la mutuelle d'entreprise est obligatoire dès l'embauche. Mais il y a des exceptions, notamment pour les salariés déjà présents dans l'entreprise au moment où l'employeur met en place la mutuelle par une décision unilatérale et non par un accord collectif (CSS art. R 242-1-6 modifié par le décret 2014-786 du 8-7-2014). D'autres cas de dispense sont possibles, à condition d'être prévus par l'acte juridique instituant la couverture santé. C'est le cas lorsque la mutuelle est mise en place à la suite d'une négociation collective après l'embauche du salarié ou encore lorsque le salarié (ou l'apprenti) :
- est embauché en CDD inférieur à un an ;
- est embauché en CDD d'un an ou plus, à condition de justifier d'une autre couverture santé ;
- travaille à temps partiel, si sa cotisation à la mutuelle est égale ou supérieure à 10 % de son salaire ;
- bénéficie de la CMUC ou de l'ACS ;
- est couvert par une mutuelle souscrite à titre individuel avant son embauche (la dispense tombant à l'arrivée de l'échéance de ce contrat individuel) ;
- bénéficie déjà d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayant droit, à condition d'en justifier chaque année.
Dans tous les cas, la dispense d'adhésion doit être demandée par un écrit, rédigé par exemple de la façon suivante : « Je souhaite être dispensé d'adhérer à la complémentaire santé obligatoire dans l'entreprise. Je dispose déjà d'une couverture pour mes frais de santé en tant qu'ayant droit de mon conjoint, ainsi qu'en atteste le document ci-joint. Cette demande tient compte de l'information que vous m'avez préalablement délivrée sur les conséquences de ce choix sur ma couverture santé. »
Toutes les entreprises, même les plus petites, devront adhérer à une complémentaire santé couvrant l'ensemble de leurs salariés. L'employeur devra prendre en charge au moins la moitié de la cotisation totale. Le contrat collectif choisi par l'employeur devra proposer des remboursements au moins égaux à ceux d'un « panier de soins » prévu par un décret (CSS art. D 911-1). Les salariés nouvellement couverts par une mutuelle collective auront le droit de résilier leur mutuelle individuelle sans attendre la date anniversaire de leur contrat. On peut envoyer une lettre en LRAR rédigée de la façon suivante : « Mon employeur a souscrit, à compter du 1er janvier 2016, un contrat d'assurance santé collectif et obligatoire comme l'y oblige le nouvel article L 911-7 du Code de la sécurité sociale. Couvert par cette nouvelle complémentaire santé, je vous demande de bien vouloir résilier la mutuelle souscrite auprès de votre organisme à partir de cette date. Vous trouverez ci-joint une attestation de mon employeur certifiant mon adhésion à ce contrat collectif. Je vous demande également le remboursement de mes cotisations correspondant à la période postérieure à cette résiliation.
Que se passe-t-il lorsque le salarié quitte son entreprise ?
S'il touche des indemnités chômage et n'a pas été licencié pour faute lourde, il bénéficie gratuitement de la mutuelle de son ancienne entreprise, de même que ses ayants droit. L'employeur informe l'organisme de mutuelle, le salarié devant ensuite justifier de sa qualité de chômeur durant la période de maintien des garanties (CSS art. L 911-8). La durée de cette portabilité est limitée : elle ne peut excéder ni la durée du dernier contrat de travail du salarié ni un maximum de 12 mois.
Quant aux retraités, aux invalides ou aux ayants droit d'un salarié décédé, l'organisme doit proposer le maintien de leurs garanties sans limitation de durée dans les deux mois suivant la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire a six mois pour faire sa demande. Un tel maintien est cependant rarement avantageux pour les particuliers, puisqu'il faut s'acquitter de la partie de la cotisation incombant auparavant à son employeur, et que la cotisation totale peut augmenter (50 % au maximum).
Elle est souscrite directement par un particulier auprès d'une société d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle. Le tarif varie en fonction des prestations offertes et de la situation personnelle de l'adhérent (âge, lieu de vie, etc.).
Si l'adhésion est renouvelée automatiquement, l'organisme doit adresser chaque année un avis d'échéance indiquant le montant des cotisations et la date limite de résiliation du contrat. A défaut, celle-ci peut intervenir à tout moment. Elle est aussi admise en cas de changement de la situation personnelle du particulier, par exemple un changement de profession (C. assur. art. R 242-1-6).
Les foyers modestes souscrivant une mutuelle à titre individuel peuvent bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Elle se traduit par le versement d'un chèque santé - de 100 à 550 € selon l'âge du bénéficiaire - à faire valoir auprès de la mutuelle choisie, à condition de souscrire un contrat « responsable » (voir ci-après). L'ACS est accordée aux personnes dont les ressources ne dépassent pas de plus de 35 % (soit 11 670 € en 2015 pour une personne seule) les plafonds fixés pour bénéficier de la CMU complémentaire. Pour obtenir l'ACS, il faut remplir chaque année le même formulaire que pour une demande de CMU complémentaire ou un formulaire spécifique. Le silence de la CPAM pendant plus de deux mois vaut refus de la demande.
Il existe aussi des contrats dits de « surcomplémentaire santé » : ils complètent les remboursements de la mutuelle principale sur toutes les prestations ou sur certaines seulement. La formule est utile lorsque la mutuelle d'entreprise offre des remboursements limités ou pour les particuliers souhaitant être mieux couverts dans certains secteurs (médecines douces, optique, etc.).
Une très grande majorité de mutuelles entre dans la catégorie des contrats dits responsables. Ces contrats doivent respecter l'obligation de suivi du parcours de soins, ne pas rembourser les franchises imposées par la sécurité sociale ni les dépassements d'honoraires au-délà de 125 % de la base de remboursement de la sécurité sociale. Ils doivent désormais offrir des garanties minimales et maximales (Décret 2014-1374 du 18-11-2014). A titre d'exemple : remboursement intégral du ticket modérateur et du forfait hospitalier, remboursement des lunettes compris entre 50 et 470 € tous les deux ans pour des verres simples (dont 150 € au maximum pour la monture). A noter qu'une période transitoire est accordée aux mutuelles d'entreprise pour se conformer à ces nouvelles règles de garanties, qui seront obligatoires pour tous au plus tard le 31-12-2017.
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante n'est possible que dans un but thérapeutique.
Un majeur peut donner un de ses organes uniquement à son conjoint, son père, sa mère, ses enfants, ses frères et soeurs, ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines germains, ses beaux-fils ou belles-filles. Il peut également donner un organe à toute personne dont il partage la vie depuis au moins deux ans ou à toute personne avec laquelle il entretient des liens affectifs étroits et stables depuis au moins deux ans.
En cas d'incompatibilité entre le donneur et le receveur rendant impossible la greffe, les intéressés peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur à bénéficier du don d'un autre donneur incompatible avec son propre receveur, ce dernier bénéficiant alors du don du premier donneur.
Le donneur doit être informé des risques encourus et des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé. Il doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tous moyens par le procureur de la République. Le consentement est révocable à tout moment par n'importe quel moyen (un simple refus verbal suffit).
Les frais de santé occasionnés par le prélèvement et, sur présentation de justificatifs, certains frais engagés par le donneur sont pris en charge et remboursés par l'établissement de santé qui réalise le prélèvement (frais de transport, frais d'hébergement hors hospitalisation dans la limite de 180 € par jour, frais d'hospitalisation - y compris le forfait hospitalier -, d'examen et de traitements prescrits en vue du prélèvement, frais de suivi et de soins du donneur, indemnité journalière éventuelle pour perte de rémunération, limitée à 4 fois l'indemnité journalière maximale du régime général d'assurance maladie). Les dépenses de l'accompagnateur d'un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers peuvent être prises en charge dans les mêmes conditions.
Sauf exception, aucun prélèvement d'organe ne peut être effectué sur un mineur ou un majeur protégé.
Les prélèvements d'organes ne sont effectués que sur des personnes dont la mort cérébrale a été constatée. Le don d'organe est gratuit et anonyme.
Le corps médical est seul juge de la nécessité de prélever un organe, quel que soit l'âge du donneur. Le prélèvement est soumis à des règles de sécurité sanitaire : tests de dépistage des maladies transmissibles en particulier.
La famille du donneur ne supporte aucuns frais de prélèvement, notamment en ce qui concerne le transport du corps et le retour du corps après le prélèvement.
Le corps du défunt est ensuite remis à sa famille pour les funérailles. Les frais d'obsèques restent à la charge de la famille.
Le consentement d'une personne majeure à un éventuel prélèvement d'organe après son décès est présumé sauf si elle s'est opposée à un tel prélèvement de son vivant. Si la personne décédée est un mineur ou un majeur protégé, le prélèvement ne peut être effectué sans le consentement écrit de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal.
S'opposer à un prélèvement d'organe
Le refus peut porter sur tout prélèvement ou être limité à certaines catégories. Il existe trois sortes de prélèvements d'organes :
- pour soigner les malades (greffe) ;
- pour rechercher la cause médicale du décès (autopsie) ;
- pour aider la recherche scientifique.
Si vous êtes opposé à un éventuel prélèvement après votre décès, vous pouvez vous faire inscrire au Registre national des refus des prélèvements (RNR) géré par l'Agence de la biomédecine. Toute personne de plus de 13 ans peut s'inscrire en adressant un courrier au RNR, Agence de la biomédecine, 1, avenue du Stade-de-France, 93212 Saint-Denis-La-Plaine Cedex. Un imprimé est mis à la disposition du public sur le site Internet www.dondorganes.fr de l'Agence de la biomédecine et dans certaines pharmacies.
La demande d'inscription doit être datée et signée et être accompagnée d'un justificatif d'identité : copie de la carte d'identité, passeport même périmé, permis de conduire, titre de séjour, etc. Joignez une enveloppe timbrée à vos nom et adresse si vous souhaitez recevoir confirmation de votre inscription.
Vous pouvez révoquer votre refus de prélèvement à tout moment par simple courrier. Joignez un justificatif d'identité. Une attestation de radiation vous sera adressée.
Pour vous opposer à un éventuel prélèvement, vous pouvez également :
- inscrire votre refus sur papier libre. Conservez ce document dans votre portefeuille ;
- informer vos proches de votre opposition ;
- mentionner votre refus dans le registre de l'hôpital si vous avez été admis dans un établissement hospitalier autorisé à effectuer des prélèvements après décès.
Avant de procéder à tout prélèvement, le médecin doit s'efforcer de rechercher la volonté du défunt en consultant les différents registres ou en interrogeant sa famille.
Le projet de loi Touraine (qui soulève de vifs débats) prévoit de renforcer la présomption de consentement aux dons. Au plus tard le 1er janvier 2017, le prélèvement pourra être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Les modalités selon lesquelles le refus pourra être exprimé (aujourd'hui il peut l'être par tout moyen) et révoqué seront fixées par décret. Les proches du défunt seront informés, avant le prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité (Projet de loi de modernisation de notre système de santé tel qu'adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 11-4-2015).
Accepter expressément un prélèvement d'organe
S'il n'est fait aucune mention de votre refus, votre accord pour un prélèvement est présumé. Mais vous pouvez manifester votre accord formel à un éventuel prélèvement en informant vos proches ou en portant en permanence sur vous une lettre ou une carte de donneur d'organes. Un enfant peut porter une carte cosignée par lui-même et ses parents.
Il n'existe pas de carte officielle de donneur d'organes. Vous pouvez obtenir un modèle de carte auprès de l'Agence de la biomédecine en vous connectant sur son site Internet www.dondorganes.fr. La Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains propose également une carte sur son site www.france-adot.org.
Si vous souhaitez léguer votre corps à la médecine afin d'aider la recherche ou l'enseignement médical, faites une demande écrite, datée et signée de votre main, à la faculté de médecine de votre choix (le plus souvent celle la plus proche de votre domicile). Les dons provenant de mineurs ou majeurs sous tutelle sont interdits.
Bien que ce soit en principe une démarche gratuite, de nombreuses facultés de médecine demandent une participation aux frais de fonctionnement du service qui varie selon vos facultés. Une carte de donateur vous sera adressée après paiement des éventuels frais de participation. Votre carte comportera le numéro de téléphone du service qui, sur simple appel de votre famille, lui fournira des indications concernant le mode de transport du corps.
Informez votre famille de votre volonté car c'est elle qui préviendra la faculté de médecine à votre décès et qui s'acquittera des frais éventuels de transport du corps et d'obsèques.
Vous pouvez annuler à tout moment le don de votre corps à la science en déchirant votre carte de donateur.
Les personnes présentes au moment du décès doivent s'assurer que le défunt possède l'original de la carte de donateur et faire délivrer, par le médecin venu constater le décès, un certificat attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal déclarant que le défunt n'était atteint d'aucune maladie contagieuse en évolution (CGCT art. R 2213-13).
Le transport du corps doit être effectué très rapidement (dans les 48 heures après le décès). A défaut le don sera refusé.
Sauf exception, le défunt ne pourra pas être enterré dans le caveau familial car c'est la faculté de médecine qui décide s'il sera inhumé ou incinéré et où il reposera. Le donateur est informé de ce lieu lorsqu'il fait sa demande de carte. Certaines facultés de médecine acceptent de restituer les cendres.
Attention, bien que les établissements de santé doivent assurer à leurs frais l'inhumation ou la crémation du corps (CGCT art. R 2213-13), certaines facultés de médecine demandent aux familles une participation aux frais de fonctionnement du centre auquel le don est fait (par exemple 900 € pour le laboratoire d'anatomie de Nantes en 2014), d'autres la prise en charge des frais d'urne en cas de restitution des cendres.
Le médecin doit prodiguer des soins consciencieux, dévoués et conformes aux connaissances médicales (CSP art. R 4127-32). Le médecin qui accepte de soigner un patient est lié par cet engagement, le contrat de soins. Cela dit, si le médecin doit donner les meilleurs soins possible à son patient, il n'est pas obligé de le guérir.
Ces règles sont applicables aux membres des autres professions médicales, telles que les sages-femmes et les dentistes, ainsi qu'aux auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures.
La responsabilité du médecin peut être engagée s'il commet une faute technique. Par exemple, le médecin qui, lors d'un accouchement, choisit d'utiliser le forceps au lieu de pratiquer une césarienne et fait ainsi courir des risques graves et injustifiés à l'enfant est responsable du décès de celui-ci (CE 30-3-2011 no 338566).
La faute technique peut prendre la forme d'une erreur de traitement. A par exemple été retenue la faute d'un médecin qui avait prescrit des doses de médicaments très supérieures à celles qu'un homme peut supporter. Dans cette affaire, l'infirmière qui avait injecté le médicament a également été déclarée responsable : elle aurait dû vérifier la conformité de la prescription avec le mode d'emploi du produit. Ajoutons qu'en tout état de cause le médecin doit interroger son patient avant d'effectuer la prescription et vérifier qu'il n'existe pas de contre-indication au traitement. Il doit également assurer le suivi de ses propres prescriptions et ce, même si plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement du patient (Cass. 1e civ. 16-5-2013 no 12-21.338 ; Cass. 1e civ. 15-5-2015 no 14-16.100).
L'erreur de diagnostic ne constitue une faute que si les moyens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic exact n'ont pas été mis en oeuvre ou s'il s'agit d'une erreur grossière. Par exemple, engage sa responsabilité le médecin qui n'interroge pas un patient sur ses antécédents médicaux et ne procède pas à son examen complet alors que le patient lui est inconnu, qu'il se plaint de douleurs thoraciques diffuses et qu'il présente des difficultés pour s'exprimer (Cass. crim. 18-10-2011 no 11-80.653). En revanche, ne commet pas une faute engageant sa responsabilité le médecin qui établit un mauvais diagnostic et prescrit un mauvais traitement après avoir procédé à un examen attentif de son client. Par ailleurs, un médecin devant exercer sa profession en toute indépendance, il n'est pas lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère ; il doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science (Cass. 1e civ. 30-4-2014 no 13-14.288).
AttentionUn médecin salarié qui agit dans le cadre de ses fonctions n'engage pas sa responsabilité civile même s'il a commis une faute. Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime doit engager la responsabilité de l'employeur du médecin fautif (hôpital, clinique, etc.). Toutefois, si le professionnel possède une assurance de responsabilité civile professionnelle (cas des médecins exerçant à la fois en qualité de salarié et à titre libéral), la victime peut agir contre l'assureur du médecin alors même qu'elle ne peut pas agir contre le médecin lui-même (Cass. 1e civ. 12-7-2007 no 06-12.624 et Cass. 1e civ.06-13.790 : Bull. civ. I no 270).
Peuvent être retenus à l'encontre du médecin :
- la négligence manifeste. Par exemple est d'une négligence fautive le chirurgien qui n'examine pas lui-même son patient ou ne délègue pas cette mission à un médecin présent sur place, pour traiter la complication post-opératoire dont il a connaissance (Cass. crim. 11-9-2012 no 11-88.269) ;
- un manquement à l'une des obligations définies par le Code de la sécurité sociale ou celui de la santé publique. Commet une faute le médecin qui ne remet pas de feuilles de soins à son patient, qui ne respecte pas ses tarifs de consultation ou qui viole le secret médical auquel il est soumis. Est également fautif le professionnel de santé qui prodigue des soins non conformes aux connaissances médicales ; tel est le cas du dentiste qui pose une prothèse mobile à la place d'une prothèse fixe au motif que son patient n'a pas les moyens de payer une telle prothèse (Cass. 1e civ. 19-12-2000 no 99-12403 : Bull. civ. I no 331).
Pour obtenir des dommages-intérêts, la victime doit bien sûr prouver qu'elle a subi un préjudice. Elle doit également prouver la faute du médecin et le lien de cause à effet entre cette faute et le dommage qu'elle a subi.
Pour prouver la faute, tous les moyens de preuve sont possibles : témoignages, photos, expertises médicales, etc. La preuve de la faute est parfois facile à rapporter (par exemple, le médecin a appliqué un tarif de nuit alors qu'il a consulté en pleine journée). Plus souvent, il est nécessaire de procéder à plusieurs expertises pour déterminer les causes exactes du dommage.
SavoirDe plus en plus fréquemment, les tribunaux dispensent les victimes d'apporter la preuve d'une faute. La simple constatation qu'un dommage anormal s'est produit suffit à établir la faute du praticien. Par exemple, l'extraction d'une dent n'impliquant pas la lésion du nerf sublingual, le simple fait qu'un tel traumatisme se soit produit fait présumer que le médecin a commis une faute. Il s'agit toutefois d'une simple présomption ; le médecin peut échapper à sa responsabilité en démontrant que l'atteinte de l'organe était inévitable, par exemple parce que le nerf présentait une anomalie (Cass. 1e civ. 23-5-2000 no 98-20.440 : Bull. civ. I no 153).
Le médecin peut voir sa responsabilité engagée même en l'absence de faute directe. Il en est ainsi principalement :
- en cas d'utilisation d'un produit de santé défectueux (produits sanguins, médicaments, etc.) ;
- lorsque le dommage est dû au matériel utilisé. Par exemple, si la table d'auscultation se casse et provoque la chute du patient, le médecin est tenu de réparer le préjudice ;
- si le dommage a été causé par un des salariés du praticien, par exemple l'assistante du dentiste.
Les établissements de santé sont responsables en cas d'infections nosocomiales (maladies contractées à l'hôpital ou à la clinique et sans aucun lien avec l'affection initiale du patient). Pour pouvoir être indemnisé, le patient doit prouver le caractère nosocomial de la maladie, c'est-à-dire qu'elle a été contractée à l'hôpital (Cass. 1e civ. 30-10-2008 no 07-13.791 : Bull. civ. I no 245).
En cas de décès de la victime ou si elle présente un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, l'indemnisation est prise en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (CSP art. L 1142-1-1). Si le taux d'incapacité est inférieur à 25 %, l'indemnisation est prise en charge par l'assurance de l'établissement de santé.
En cas de préjudice peu important ou facilement réparable, la victime peut essayer de résoudre le différend à l'amiable en s'adressant directement au professionnel de santé. Il suffit souvent d'une lettre ou d'une visite au praticien pour obtenir la rectification d'une note d'honoraires erronée ou la réfection d'un pivot dentaire mal posé.
Si le préjudice est plus important ou à défaut d'avoir pu obtenir satisfaction à l'amiable, la victime peut s'adresser à l'assureur de responsabilité civile professionnelle du praticien ou saisir les tribunaux. Elle peut également, dans certains cas, saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes (maladies provoquées par un médicament) et des affections nosocomiales.
SavoirLes professionnels de santé exerçant en libéral et les établissements de santé doivent posséder une assurance de responsabilité civile et cotiser au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé. Par dérogation, certains établissements publics de santé disposant de ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance peuvent être dispensés de l'obligation d'assurance. Dans ce cas, ils prennent directement en charge l'indemnisation des victimes (C. ass. art. L 251-1).
Un patient peut saisir la commission d'une demande de conciliation dans les cas suivants (CSP art. L 1142-4 s. et CSPR 1142-13 s.) :
- il n'est pas satisfait des soins qui lui ont été dispensés ;
- il est en désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de santé ;
- il a été victime d'un dommage dont la gravité n'est pas suffisante pour relever de la commission d'indemnisation.
La commission compétente est celle de la région dans laquelle a été effectué l'acte de soins. Elle demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont impliqués dans le dommage de la victime.
Le patient saisit la commission par courrier recommandé avec avis de réception en indiquant les motifs de sa demande ainsi que ses coordonnées et celles du professionnel et/ou de l'établissement de santé concernés.
Le patient et le professionnel de santé concerné sont entendus par la commission.
Le résultat de la conciliation est consigné dans un document signé par le patient et le professionnel de santé.
Pour les accidents médicaux présentant une certaine gravité, la victime peut saisir la commission du lieu de réalisation du préjudice (CSP art. L 1142-4 s. et CSPR 1142-13 s.).
Un accident médical est considéré comme grave lorsqu'il entraîne pour le patient une atteinte permanente à son intégrité physique supérieure à 24 % ou un arrêt de ses activités professionnelles ou encore un déficit fonctionnel d'au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut également être reconnu :
- lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident médical ;
- ou lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Pour apprécier si les dommages présentent un caractère de gravité suffisant, la commission peut demander l'avis d'un expert.
Les services fournis par la commission, y compris les expertises, sont gratuits.
Le fait d'engager une procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'empêche pas le patient de demander réparation directement au professionnel de santé, à son assureur ou de saisir les tribunaux.
La victime doit établir sa demande d'indemnisation sur le formulaire Cerfa no 12245*03 téléchargeable sur le site www.formulaires.gouv.fr ou sur le site www.oniam.fr. Une fiche pratique jointe au formulaire indique notamment l'adresse du secrétariat de la commission auquel doit être envoyée la demande, adresse qui varie en fonction du lieu du soin. Elle précise également la liste des pièces justificatives à joindre à la demande.
Dans les six mois de sa saisine, la commission donne son avis sur les causes, la nature et l'étendue des dommages, et indique s'il existe ou non un responsable.
Si la commission estime que les dommages ne présentent pas une gravité suffisante, elle se déclare incompétente et en informe la victime par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque les dommages présentent un caractère de gravité suffisant, deux situations peuvent se présenter :
- la commission estime que le dommage engage la responsabilité du médecin ou de l'hôpital. L'assureur de ces derniers doit, dans les quatre mois de la réception de l'avis de la commission, faire une offre d'indemnisation au patient dans la limite du plafond de garantie inscrit au contrat d'assurance. Si le patient accepte l'offre, l'assureur doit l'indemniser dans le mois qui suit. Le patient peut décliner l'offre, par exemple parce qu'il l'estime insuffisante, et saisir les tribunaux ;
- la commission estime que la responsabilité du médecin ou de l'hôpital n'est pas engagée, voir ci-après.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux se substitue à l'assureur si ce dernier n'a pas fait d'offre d'indemnisation à la victime dans les délais. L'office a quatre mois à compter de la demande d'indemnisation pour lui faire une offre. La demande est faite par la victime ou ses ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception.
L'office est également compétent si le montant des dommages est supérieur au plafond de garantie inscrit dans le contrat d'assurance du responsable du préjudice.
Le patient ne peut pas toujours engager la responsabilité du médecin ou de l'hôpital. C'est le cas notamment si le médecin n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses actes (réaction allergique du patient à l'anesthésie alors que le praticien a pris toutes les précautions nécessaires par exemple). On parle d'« aléa thérapeutique ». Le patient peut être indemnisé si son préjudice :
- est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé ;
- présente une certaine gravité, appréciée au regard de la perte de ses capacités fonctionnelles et des conséquences sur sa vie privée et professionnelle.
Pour obtenir réparation, le patient doit saisir la commission de conciliation et d'indemnisation selon la procédure exposée no 59521 s.
Si la commission estime qu'il n'existe pas de responsable, elle transmet son avis à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam). L'Oniam n'est pas tenu de suivre cet avis et peut refuser d'indemniser une victime malgré l'avis favorable de la commission.
Dans les quatre mois, l'Oniam doit faire une offre d'indemnisation à la victime. L'Oniam a établi un référentiel indicatif d'indemnisation (consultable sur le site www.oniam.fr) qui présente les différents préjudices indemnisables et les barèmes d'indemnisation.
Si le patient accepte l'offre, l'Oniam doit l'indemniser dans le mois qui suit l'acceptation.
Si l'indemnisation lui paraît insuffisante, la victime peut décliner l'offre et saisir les tribunaux.
Le patient peut saisir les tribunaux pour obtenir réparation dans les cas suivants :
- il n'arrive pas à se faire indemniser par le médecin, par son assureur ou par l'Oniam ;
- l'indemnisation proposée par l'assureur ou l'Oniam lui semble insuffisante ;
- la commission régionale de conciliation et d'indemnisation s'est déclarée incompétente parce qu'elle estime que le dommage n'est pas suffisamment grave.
La victime peut saisir la justice même si elle a, au préalable, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation. Elle a pour seule obligation d'informer le tribunal et la commission des différentes procédures qu'elle a engagées. Si le patient accepte l'offre d'indemnisation de l'assureur ou du fonds d'indemnisation, il doit renoncer à son action devant le tribunal.
L'action est exercée devant les tribunaux civils.
Par exception, ce sont en principe les tribunaux administratifs qui seront compétents si le dommage s'est produit dans un hôpital public.
Si la faute du médecin constitue une infraction pénale (violation du secret médical, exercice illégal de la médecine, homicide involontaire, etc.), la victime ou ses héritiers peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales et demander des dommages-intérêts.
- Les actions en responsabilité contre des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés pour les dommages causés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins doivent être intentées dans un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage.
- A l'instar des actions de groupe en matière de consommation, les associations d'usagers du système de santé agréées pourront agir en justice pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des patients résultant du manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de produits de santé, ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles. L'action ne pourra porter que sur la réparation des dommages corporels subis par les patients (Projet de loi de modernisation de notre système de santé, dit projet de loi Touraine, tel qu'adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 11-4-2015).
L'obligation d'informer incombe aux médecins, y compris s'ils exercent à l'hôpital. Elle pèse non seulement sur le médecin qui prescrit l'acte, mais aussi sur celui qui l'accomplit. C'est une obligation personnelle. Le médecin ne peut s'en décharger en demandant à un collaborateur d'informer le patient.
L'information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel. A l'exception des recherches biomédicales, il n'existe aucune disposition légale imposant une information écrite. Aussi, sauf circonstance exceptionnelle (le patient est sourd par exemple), le patient peut valablement recevoir une information orale. Le recours à l'écrit présente cependant certains avantages : il permet de prouver plus facilement l'existence et le contenu de l'information, et il assure une plus grande clarté. Cependant, l'information écrite doit être commentée par le médecin : celui-ci doit personnaliser l'information et la rendre intelligible. Il ne peut se contenter de délivrer un « prospectus » préétabli. Le praticien doit également répondre aux questions du malade.
C'est bien évidemment le patient qui doit être informé en priorité. Il existe toutefois des situations où le patient n'est pas capable de recevoir ces informations (il est dans le coma, il est trop jeune, etc.). Dans ces hypothèses, le médecin devra, sauf urgence, informer la ou les personnes habilitées à consentir aux soins proposés (titulaires de l'autorité parentale, tuteur, personne de confiance auparavant désignée par le patient, etc.). Précisons toutefois qu'un mineur peut, lorsqu'il doit recevoir un traitement indispensable pour sauvegarder sa santé, s'opposer à ce que le ou les titulaires de l'autorité parentale soient informés de son état de santé (CSP art. L 1111-2 et CSPL 1111-5).
L'information doit porter sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés au patient, leur utilité, leur urgence éventuelle, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que les autres solutions possibles (CSP art. L 1111-2). Par exemple, manque à son devoir d'information le radiologue qui rédige un compte rendu peu explicite utilisant le conditionnel alors que l'extension de la lésion de la patiente aurait dû le conduire à alerter le médecin traitant et à informer sa patiente des risques possibles d'évolution (CA Grenoble 9-10-2012 no 10/02151). Le médecin doit également exposer au patient les conséquences possibles d'un refus des soins proposés. Le fait qu'une intervention chirurgicale soit indispensable n'exonère pas le médecin de remplir son devoir d'information (Cass. 1e civ. 26-1-2012 no 10-26.705).
Si, après les soins, de nouveaux risques sont identifiés, le professionnel de santé devra en informer le patient, sauf s'il lui est impossible de le retrouver.
Avant une opération, le patient doit être informé des conditions de l'intervention, des risques, des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l'intervention. Ce délai ne peut en aucun cas être réduit, même à la demande du patient. Pendant cette période, le médecin ne peut demander au patient que le paiement des consultations préalables à l'intervention (CSP art. L 6322-2 et CSPD 6322-30).
Cette dernière doit être pratiquée par le chirurgien qui a rencontré le patient (sauf mention contraire sur le devis).
La loi prévoit certaines limites au devoir d'information du médecin. Ainsi en est-il lorsque l'information est impossible du fait de l'urgence de l'intervention médicale ou de l'impossibilité pour le patient de recevoir l'information (le patient n'est pas conscient, il n'est pas en possession de toutes ses facultés mentales, etc.).
Par ailleurs, le médecin doit respecter la volonté du patient de rester dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic (CSP art. L 1111-2). Il existe toutefois une restriction importante au droit du praticien de ne pas dire la vérité à son patient : le professionnel de santé doit informer le malade si ce dernier risque de contaminer des tiers (le patient est atteint du Sida par exemple).
Avant de pratiquer une intervention chirurgicale, un examen ou tout autre acte médical, le médecin doit obtenir le consentement de son patient ou du représentant légal de celui-ci. Cette exigence découle du droit de chacun au respect de son intégrité physique.
Pour être valable, le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire que le patient doit avoir reçu toutes les informations nécessaires lui permettant d'accepter ou de refuser les soins proposés.
Le patient est libre d'accepter ou de refuser les soins qui lui sont proposés. Si la volonté du malade de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables. Mais après l'avoir informé des conséquences de ses choix, le médecin doit respecter la décision du patient. Il a toutefois été jugé que les médecins peuvent passer outre au refus de soins à la triple condition que le patient se trouve dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital, que les médecins aient mis tout en oeuvre pour le convaincre et que l'acte médical soit indispensable à sa survie (CE 26-10-2001 no 198546 rendu à propos d'un Témoin de Jéhovah ayant refusé une transfusion sanguine).
Le patient peut retirer son consentement à tout moment.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin doit recueillir le consentement d'un membre de sa famille, d'un proche ou d'une personne de confiance désignée préalablement par le patient.
Le professionnel de santé doit chaque fois que possible rechercher le consentement des mineurs et des majeurs sous tutelle, et il doit recueillir celui de leur représentant légal. Lorsque le refus du traitement par une personne titulaire de l'autorité parentale ou par un tuteur peut avoir des conséquences graves pour le mineur ou le majeur sous tutelle, le médecin doit donner les soins indispensables.
Précisons que le médecin peut se dispenser du consentement des parents lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s'est opposé à ce que ses parents soient informés de son état de santé (l'enfant est toxicomane, il est atteint du Sida, par exemple).
(CSP art. L 1111-5 s.)
- Toute personne majeure peut, dans un document écrit, daté et signé de sa main et indiquant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, rédiger des directives pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté : souhaits concernant la fin de sa vie et conditions de la limitation ou d'arrêt des traitements.
Si elle n'est pas capable d'écrire et de signer elle-même le document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document rédigé par un tiers est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Les deux témoins indiquent leur nom et leur qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Les directives sont révocables ou modifiables à tout moment sans formalité.
Les directives peuvent être conservées par la personne les ayant rédigées ou être remises à un membre de sa famille, à un proche ou à un médecin. L'existence de ces directives et les coordonnées de la personne qui les détient doivent être mentionnées dans le dossier médical du patient.
Tant que la personne est consciente et en état d'exprimer sa volonté, elle doit, tous les trois ans, renouveler ses directives par simple confirmation signée sur le document initial. A défaut de renouvellement, ses directives ne pourront pas être prises en compte par le médecin. Ce dernier doit vérifier avant d'appliquer les directives que moins de trois ans se sont écoulés entre le moment où le patient les a rédigées et celui où il est devenu inconscient ou hors d'état de les renouveler.
- Lorsqu'un patient en fin de vie décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin doit respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. La décision du malade doit être inscrite dans son dossier médical. Si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, le médecin peut décider, dans le cadre d'une procédure collégiale, de limiter ou d'arrêter le traitement. Il doit au préalable consulter la personne de confiance éventuellement désignée par le malade, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives laissées par le malade. Si le malade a désigné une personne de confiance, son avis prévaut sur tout autre avis non médical même si celui-ci est émis par la famille du malade.
- Lorsque le traitement appliqué pour soulager les souffrances d'un patient risque d'abréger sa vie le médecin doit en informer le patient, la personne de confiance éventuellement désignée par le malade, la famille ou, à, défaut, un de ses proches.
La proposition de loi Cleys-Leonetti (qui suscite de vifs débats) vise à renforcer les droits des malades en fin de vie. Sans autoriser l'euthanasie, elle prévoit en particulier la possibilité pour les patients atteints d'une maladie incurable et dont le pronostic est engagé de demander une sédation profonde jusqu'au décès et l'arrêt des traitements de maintien en vie (Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie adoptée en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 17-3-2015)
Dès lors que le médecin a accompli son devoir d'information, il n'est pas responsable des choix de son patient. Il n'est pas tenu de le convaincre du bien-fondé des soins proposés.
En revanche, si le médecin n'a pas rempli son devoir d'information, le patient ou ses ayants droit (conjoint survivant et enfants, notamment) peuvent engager la responsabilité du médecin. La Cour de cassation estime en effet que le non-respect par le médecin de son devoir d'information cause au patient un préjudice qui doit être réparé (Cass. 1e civ. 3-6-2010 no 09-13.591 : Bull. civ. I no 128), cette réparation prenant la forme de dommages-intérêts. Si le médecin est salarié d'un établissement de santé, le patient doit se retourner contre l'établissement qui l'emploie, sans pouvoir en principe engager la responsabilité personnelle du praticien.
C'est au médecin d'apporter la preuve que l'information a été donnée sous une forme suffisante. Cette preuve peut être faite par tout moyen (écrit, témoignage, etc.).
Il s'agit notamment des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation ou d'intervention, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, des feuilles de surveillance, des correspondances entre professionnels de santé, etc.
A l'hôpital, le dossier doit en outre comporter la lettre du médecin à l'origine de l'admission, les motifs de l'hospitalisation, la recherche d'antécédents et de facteurs de risque, le type de prise en charge prévu, la nature des soins dispensés, les dossiers d'anesthésie et de soins infirmiers, les comptes rendus opératoires, les transfusions sanguines, etc.
Peuvent également être mentionnés dans le dossier (liste non exhaustive) :
- le refus du patient que ses proches soient informés de son état de santé ;
- son refus que soient communiquées à ses ayants droit certaines informations après son décès ;
- l'identité de la personne de confiance désignée par le malade.
Seuls peuvent accéder au dossier médical le patient ou ses ayants droit (conjoint survivant, enfants majeurs) en cas de décès du malade sauf si le patient s'y est opposé avant sa mort.
Les ayants droit doivent indiquer dans la demande les motifs pour lesquels ils ont besoin de ces informations.
Si le patient est mineur, le droit d'accès est exercé par son père et/ou sa mère sous réserve qu'il exerce l'autorité parentale et que le mineur ne s'y soit pas opposé ; pour les majeurs sous tutelle, par le tuteur.
Dans ses relations avec son médecin, le patient a droit au respect de sa vie privée et au secret. C'est ce que l'on appelle le secret médical. Il couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé, du personnel des établissements de soins ou de la sécurité sociale (CSP art. L 1110-4). Le Code de déontologie médicale précise que le secret médical couvre non seulement ce qui a été confié au médecin, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris (CSP art. R 4127-4).
Sauf opposition du patient, deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent échanger des informations afin d'assurer la continuité des soins ou déterminer la meilleure prise en charge possible (transmission des informations entre le médecin prescripteur et l'infirmière ; prise en charge du patient par l'ensemble d'une équipe de soins, etc.). Afin de favoriser la prise en charge globale des patients, le projet de loi Touraine prévoit d'étendre aux professionnels et établissements du secteur médico-social ou social la possibilité d'échange des informations ; l'échange d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins sera soumis à l'accord préalable du patient (Projet de loi de modernisation de notre système de santé adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 11-4-2015)
Toujours en l'absence d'opposition du patient, le médecin peut, en cas de diagnostic grave, donner à sa famille ou à ses proches les informations leur permettant de lui apporter aide et soutien.
De même, sauf volonté contraire du malade exprimée avant son décès, le médecin peut donner à ses ayants droit (conjoint survivant et enfants majeurs, notamment) les informations leur permettant de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.
Le professionnel de santé qui enfreint ces règles engage sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale. La violation du secret médical est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (C. pén. art. 226-13).
Précisons toutefois que, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, le professionnel de santé a l'obligation de révéler le secret. Par exemple, le médecin doit déclarer les naissances, les décès, certaines maladies contagieuses. Dans d'autres cas, il est autorisé à le faire ; par exemple, le médecin peut avertir les autorités compétentes (police, procureur de la République, etc.) et témoigner en justice lorsqu'il a connaissance de mauvais traitements à un enfant ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, notamment en raison de son âge ou de ses facultés mentales (C. pén. art. 226-14).
Le patient peut accéder à son dossier directement ou par l'intermédiaire d'un médecin.
La demande est adressée directement à celui qui détient les informations (professionnel de santé, hébergeur de données de santé agréé ou, dans le cas des établissements de soins, au responsable de l'établissement ou à la personne que ce dernier a désignée). Il faut joindre un justificatif d'identité à sa demande, le destinataire devant s'assurer de l'identité du demandeur avant de communiquer le dossier.
Le médecin peut recommander au patient de se faire accompagner par un tiers lors de la consultation de son dossier, par exemple en cas de pronostic grave mentionné dans le dossier. Si le patient refuse de se faire accompagner, le médecin doit lui communiquer son dossier.
Le médecin ou le responsable de l'établissement de santé doit communiquer au patient son dossier dans un délai de huit jours à compter de la demande (deux mois si les informations datent de plus de cinq ans).
La consultation sur place est gratuite. Si le patient demande des copies de certaines pièces, il doit s'acquitter des frais correspondants. Lorsque le patient demande que les pièces de son dossier lui soient envoyées, il doit payer les frais d'envoi et de copie.
Prenant acte de l'échec du déploiement du dossier médical personnel (DMP) lancé en 2004 (moins de 500 000 patients possèdent un DMP sur les 5 millions escomptés), le projet de loi Touraine prévoit la création du dossier médical partagé. Ce dossier ne pourra être créé qu'avec le consentement exprès du patient ou de son représentant légal. Il visera à favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Chaque professionnel de santé devra y reporter les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins. En cas d'hospitalisation, le dossier contiendra également les principaux éléments relatifs au séjour du patient dans l'établissement.
Le patient pourra demander à ce que certaines informations contenues dans son dossier soient inaccessibles. Seul le médecin traitant bénéficiera d'une dérogation lui permettant d'accéder à toutes les données.
Le patient pourra accéder à toutes les données contenues dans son dossier. Il pourra également connaître la liste des professionnels qui ont accès aux informations le concernant et ceux qui y ont accédé.
Un décret en Conseil d'Etat devra notamment préciser les conditions de création et de fermeture du dossier, les conditions de recueil du consentement, la nature et le contenu des informations qui pourront y figurer et les modalités d'exercice des droits des patients sur les informations figurant dans leur dossier.
Enfin, le dossier médical partagé comportera un volet concernant les dons d'organes et les directives anticipées de fin de vie (Projet de loi de modernisation de notre système de santé adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 11-4-2015).
Dans tous les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif. L'interdiction concerne notamment (CSP art. R 3511 s.) :
- les locaux de travail, y compris les bureaux individuels ;
- les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, etc.) ; dans les chambres, en cas de court ou moyen séjour, l'interdiction peut être exceptionnellement levée compte tenu de la pathologie prise en charge et des risques générés par le sevrage ; en cas de long séjour, la chambre est assimilée à un espace privatif et il est possible d'y fumer, sauf si elle est également occupée par un non-fumeur ;
- les établissements scolaires, publics et privés (écoles, collèges, lycées, universités, etc.) ; l'interdiction s'applique également aux espaces découverts ;
- les moyens de transport (métro, RER, trains, cars, avions, bateaux, etc.) ; l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux ponts à l'air libre des bateaux, navires et bacs ; les halls et les quais de gare, même ouverts, sont en revanche concernés par l'interdiction.
- les cafés, débits de tabac, discothèques, hôtels, restaurants, casinos et autres lieux dits « de convivialité ».
Il pourrait être interdit de fumer également dans les véhicules en présence de mineurs (Projet de loi de modernisation de notre système de santé tel qu'adopté en 1e lecture par l'Assemblée nationale le 11-4-2015). Le projet de loi prévoit également d'interdire de vapoter dans les établissements scolaires ou accueillant des mineurs, dans les moyens de transport collectifs fermés et dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Sauf dans les établissements de santé, les établissements d'enseignement et ceux utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, il est possible de prévoir dans les lieux où l'interdiction s'applique des espaces réservés aux fumeurs. Il doit s'agir de locaux fermés ne constituant pas un lieu de passage, devant respecter des normes de ventilation strictes et être dotés de fermetures automatiques ne pouvant s'ouvrir involontairement.
Le salarié peut se plaindre à son employeur. Tenu d'une obligation de sécurité de résultat dans la protection de ses salariés contre le tabac, l'employeur doit faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux de travail. S'il manque à ses obligations, il court le risque de voir le salarié quitter l'entreprise en « prenant acte » de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc. 29-6-2005 no 03-44.412) alors même que sa santé n'est pas compromise (Cass. soc. 6-10-2010 no 09-65.103 : RJS 10/05 no 940). Alternative moins radicale face à l'inertie de l'employeur : le salarié peut faire appel aux institutions représentatives du personnel ou à l'inspection du travail, voire à une association de lutte contre le tabagisme.
Le fumeur est passible d'une amende forfaitaire de 68 €. Si l'infraction est constatée sur le lieu de travail, il risque aussi une sanction disciplinaire qui doit toutefois être proportionnée à la faute.
Le responsable des locaux risque une amende maximale de 750 €, forfaitisée dans certains cas à 135 € (CSP art. R 3512-1 s.).
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site Internet www.tabac.gouv.fr.
La société civile de patrimoine est une société créée par au moins deux personnes (conjoints, concubins, parents, amis) qui décident de mettre en commun un ou plusieurs biens. Dotée d'une existence juridique distincte de celle de ses associés, la société possède un patrimoine qui lui est propre.
La société civile de patrimoine a pour objet la détention et l'administration des biens et droits qui composent son patrimoine : patrimoine immobilier pour la société civile immobilière (SCI), portefeuille de valeurs mobilières pour la société civile de portefeuille.
Lorsqu'elle gère un patrimoine immobilier, la société civile de patrimoine peut détenir un ou plusieurs immeubles qu'elle met à disposition de ses associés ou qu'elle donne en location à des tiers. La SCI ne peut pas avoir pour objet l'achat de biens immeubles en vue de leur revente : elle peut certes être amenée à céder une partie de son patrimoine, mais cela doit rester exceptionnel.
Lorsqu'elle gère un portefeuille de valeurs mobilières, la société civile de patrimoine peut bien sûr être amenée à vendre certains titres pour en acheter d'autres : cette gestion active du portefeuille n'ôte pas en principe son caractère civil à l'activité.
La création d'une société civile de patrimoine peut présenter des intérêts tant patrimoniaux que fiscaux. Comme on va le voir, la société civile peut se révéler un outil particulièrement efficace de stratégie matrimoniale, de transmission anticipée du patrimoine familial ou de transmission successorale. Plus généralement, le recours à la société civile est fréquemment préconisé comme moyen d'éviter l'indivision et les inconvénients qui s'y attachent.
En tout état de cause, la décision de créer une telle société doit résulter d'un examen précis et exhaustif de la situation des futurs associés (importance et composition de leur patrimoine, âge, situation matrimoniale, présence ou non d'héritiers), de leurs objectifs en termes de stratégie patrimoniale (préservation du patrimoine familial dans son unité et sa durée ou valorisation d'un patrimoine de rapport, cession envisagée ou pas) ainsi que de leurs contraintes respectives (sources de revenus, charge fiscale, etc.).
La décision de créer une société civile de patrimoine ne doit pas être prise à la légère. Selon les situations, elle présente des avantages et des inconvénients. Dès lors, la consultation d'un notaire ou d'un avocat est fortement recommandée.
Dans l'indivision, les décisions dépassant ce qui est nécessaire à la conservation des biens doivent en principe être prises à la majorité des 2/3 des droits indivis, voire à l'unanimité des indivisaires (C. civ. art. 815-3). Ces règles peuvent être source de blocages. Certes, les coïndivisaires peuvent décider de conclure entre eux une convention d'indivision prévoyant la nomination d'un gérant auquel certains pouvoirs sont confiés : le gérant peut dès lors, dans la limite de ces pouvoirs, agir sans demander l'accord des membres de l'indivision. Il reste que cette convention, conclue en principe pour une durée maximale de cinq ans, n'a ni la souplesse ni la pérennité d'un contrat de société.
Dans une société civile, le gérant peut en principe accomplir tous les actes qui entrent dans l'objet social et sont dans l'intérêt de la société. Les statuts peuvent cependant prévoir des limites à ces pouvoirs et imposer une autorisation préalable de la collectivité des associés pour la conclusion de certains contrats ou la réalisation d'opérations importantes. Les décisions les plus importantes sont alors prises par les associés en assemblée selon les règles de majorité librement fixées par les statuts. Ceux-ci peuvent prévoir différentes majorités selon les types de décisions : majorité simple (50 % des parts plus une) pour les actes les plus courants, majorité renforcée (par exemple, des 2/3) pour les actes plus lourds de conséquences.
On connaît la règle : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué » (C. civ. art. 815). Tout indivisaire peut, à tout moment et pour tout motif (sauf si une convention d'indivision d'une durée maximale de cinq ans a été conclue), vouloir sortir de l'indivision et récupérer sa mise. Lorsque les autres indivisaires veulent maintenir l'indivision entre eux, ils peuvent racheter sa part au coïndivisaire qui désire sortir. Mais ils n'en ont pas toujours les moyens. En cas de blocage, c'est le tribunal qui tranche : il peut alors ordonner le partage judiciaire ou la poursuite de l'indivision pendant cinq ans maximum. On voit la précarité qui pèse sur l'état d'indivision.
Dans une société civile, le risque de dissolution judiciaire existe aussi, mais uniquement pour « justes motifs » (C. civ. art. 1844-7, 5o ). En d'autres termes, l'associé qui demande la dissolution doit convaincre le juge que le motif invoqué à l'appui de sa demande présente un caractère de gravité suffisant pour justifier qu'il soit mis fin à la société. En pratique, la dissolution ne sera prononcée par le juge que s'il constate une véritable paralysie du fonctionnement de la société.
Jugé que la mésentente ancienne entre associés d'une SCI propriétaire d'une maison justifie le prononcé de la dissolution car, outre leur incapacité à s'entendre sur la répartition des périodes d'occupation et sur l'entretien de la maison, les associés minoritaires votent systématiquement contre les résolutions d'assemblée et refusent le rachat de leurs parts sociales ou celui des parts de l'associé majoritaire, leur attitude conduisant à une paralysie du fonctionnement de la société (Cass. 3e civ. 8-9-2010 no 09-15.585 : RJDA 12/10 no 1157). Jugé de même que le désaccord entre associés ainsi que l'attitude d'opposition systématique de l'un d'eux qui refuse de participer à la vie sociale et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence bloquent définitivement le fonctionnement de la société et justifient sa dissolution (Cass. com. 21-6-2011 no 10-21.928 : BRDA 13/11 no 1).
Il n'y a en revanche pas lieu de prononcer la dissolution lorsque le désaccord entre les associés n'a pas pour effet de paralyser le fonctionnement de la société (Cass. com. 21-10-1997 no 2182 : RJDA 1/98 no 60 ; Cass. 3e civ. 16-3-2011 no 10-15.459 : RJDA 6/11 no 541) ou que la paralysie n'est qu'hypothétique (Cass. com. 13-7-2010 no 09-16.103 : RJDA 11/10 no 1090) Jugé que la mésentente entre deux ex-époux associés résultant de l'occupation à titre gratuit et sans autorisation d'un immeuble social par l'un d'eux est impropre à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société (Cass. com. 24-6-2014 no 13-20.044 : RJDA 10/14 no 768).
Deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes, être associés d'une société civile (C. civ. art. 1832-1). La constitution d'une société civile peut être envisagée entre époux comme moyen de modifier le régime applicable aux biens qu'ils possèdent, sans avoir pour autant à changer de régime matrimonial.
Par exemple, vous souhaitez gérer avec votre conjoint un bien dont vous êtes seul propriétaire. Tel peut être le cas si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens (les biens de chacun restant des biens personnels) ou, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, pour un bien qui vous est propre. L'apport en société civile de ce bien permet d'en soumettre la gestion aux règles que vous décidez vous-même de fixer. Après l'apport, le bien appartient à la société que vous avez constituée et dont vous avez rédigé les statuts. Vous et votre conjoint pouvez être associés à parts quasi égales dans la société (par exemple, 51 % pour vous et 49 % pour votre conjoint) ou selon toute autre proportion en fonction des apports que chacun peut effectuer (60 % et 40 %, 75 % et 25 %, etc.). Vous et votre conjoint pouvez également être désignés cogérants de la société.
Inversement, des époux mariés sous le régime de la communauté peuvent souhaiter attribuer à un seul des deux les pouvoirs de gestion sur tel ou tel bien commun (à l'exception du logement familial). La mise en société de ce bien et la désignation de l'époux concerné comme seul gérant lui permettent de disposer seul de ces pouvoirs.
AttentionLa mise en société du logement des époux ne doit être envisagée qu'avec la plus grande prudence. A notre avis, cette mise en société a pour effet, lors du décès d'un des époux, de priver le survivant des droits que la loi lui accorde sur sa résidence principale. Il ne pourra donc prétendre ni à la jouissance gratuite du logement pendant l'année du veuvage (sauf si les époux étaient locataires de la SCI), ni aux droits viagers d'habitation et d'usage sur le mobilier ensuite. Autre inconvénient de la mise en société du logement : si les époux sont soumis à l'ISF, l'abattement de 30 % sur la résidence principale ne s'applique pas aux parts de sociétés civiles.
La création d'une société civile peut s'avérer un outil judicieux pour l'acquisition en couple, notamment pour l'achat de leur résidence par des concubins non pacsés. Lorsque des concubins achètent en direct leur logement, ils le font généralement en indivision. Au décès de l'un d'eux, le survivant se retrouve en indivision avec les héritiers du premier. Si, par testament, le concubin décédé a légué au survivant ses droits dans l'indivision (legs qui risque d'être réduit en présence d'enfants... ou d'un conjoint), les droits de succession sur la part transmise seront dus au taux de 60 %, après application d'un abattement égal à 1 594 €. Le schéma qui consiste à faire acquérir le logement par une société civile immobilière et à organiser un démembrement croisé de propriété des parts de la société permet d'assurer, lors du décès du premier concubin, le maintien dans les lieux du survivant, jusqu'à son propre décès, et ce sans subir de prohibitifs droits de succession.
Pour les partenaires d'un Pacs, qui bénéficient d'une exonération totale des droits de succession sur la part transmise par le partenaire décédé, la mise en société est d'un moindre intérêt, d'autant qu'elle a pour effet de priver le partenaire survivant du droit à la jouissance gratuite du logement pendant l'année suivant le décès. L'acquisition en tontine paraît alors préférable : la résidence revient au survivant en franchise d'impôt.
La détention d'un patrimoine, immobilier notamment, à travers une société civile permet en de nombreuses circonstances d'optimiser de son vivant la transmission de son patrimoine à ses descendants. Dans ce schéma, ce sont les parts de la société qui font l'objet d'une donation des parents à leurs enfants et/ou petits-enfants.
La constitution d'une société civile présente un intérêt particulier pour des parents qui souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants tout en conservant la gestion de ce patrimoine. S'il s'agit d'un patrimoine immobilier, ils constituent une SCI à laquelle ils apportent leurs immeubles, puis donnent à leurs enfants les parts de la SCI. Les parents, ou l'un d'eux, sont nommés gérants de la société, les enfants n'ayant de droit de regard sur leur gestion qu'en tant qu'associés. La société se présente alors comme un moyen de dissocier habilement la propriété de l'immeuble du pouvoir de le gérer.
La constitution d'une société est particulièrement recommandée quand, parmi les enfants, se trouvent des mineurs ou des majeurs protégés (majeur sous tutelle, par exemple). La transmission en direct d'un patrimoine est en pareil cas source de difficultés de gestion, liées à la nécessaire intervention des autorités de protection. La solution consistant à apporter ce patrimoine en société puis à transmettre les parts de la société, même à des enfants mineurs ou frappés d'incapacité, permet de ne pas gêner la gestion active de ce patrimoine par le gérant de la société.
Outre le pouvoir de gestion, les parents souhaitent fréquemment conserver les revenus du patrimoine transmis à leurs enfants, de façon à s'assurer un certain niveau de ressources leur vie durant. La création d'une société civile peut alors être avantageusement combinée avec la technique du démembrement de propriété.
Deux schémas sont envisageables.
Dans un premier schéma, les parents apportent la nue-propriété de tout ou partie de leur patrimoine immobilier à une SCI constituée avec leurs enfants, en se réservant l'usufruit des immeubles. Dès lors, ils ont seuls droit aux revenus des immeubles (les loyers), même s'ils transmettent, par donation, la totalité des parts de la société à leurs enfants.
Dans un deuxième schéma, les parents apportent à la SCI qu'ils ont constituée la propriété de leurs immeubles, puis donnent à leurs enfants la nue-propriété des parts sociales. Ce schéma offre une grande souplesse d'adaptation : les parents peuvent en effet, selon leurs souhaits, aménager largement dans les statuts les pouvoirs et droits respectifs des usufruitiers et des nus-propriétaires des parts sociales et ainsi s'assurer une totale maîtrise de la gestion et des revenus de la société.
De façon générale, la création d'une société civile permet, si tel est le souhait des parents, d'associer progressivement leurs enfants à la gestion du patrimoine familial, en profitant de la souplesse qu'offre le cadre de la société (pour la nomination du gérant, la définition et la limitation de ses pouvoirs, la définition des pouvoirs de l'assemblée des associés, etc.).
Le simple fait qu'un patrimoine, immobilier notamment, soit détenu à travers une société permet d'opérer une décote sur la valeur de ce patrimoine. La valeur vénale des parts est toujours inférieure à la valeur vénale de l'immeuble divisée par le nombre de parts.
Dans les sociétés à caractère familial, une décote d'au minimum 10 % peut généralement être pratiquée pour tenir compte de l'absence de marché et de l'existence de clauses d'agrément qui limitent la liberté de cession. Le caractère minoritaire d'une participation pourra justifier une décote plus importante (Cass. com. 6-5-2003 no 748 F-D : RJF 8-9/03 no 1056, ayant admis une décote de 15 % ; Cass. com. 23-11-2010 no 09-17.295 : RJF 3/11 no 382, ayant admis une décote de 20 %).
Dans les sociétés qui comportent de nombreux associés, et dans lesquelles les cessions de parts sont fréquentes, la valeur vénale est fixée par le prix moyen auquel s'effectuent les transactions sur les parts. Ce prix de marché, très fortement influencé par la valeur de rendement des parts, est souvent sans grand rapport avec la valeur des immeubles possédés par la société, la décote pouvant, semble-t-il, dépasser 80 %.
La décote sur la valeur du patrimoine détenu par l'intermédiaire d'une société joue également en matière de droits de succession et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour déterminer la valeur des parts de la société transmises par décès ou détenues au 1er janvier de chaque année.
La transmission des parts de la société civile par donations réalisées tous les 15 ans permet de profiter au mieux des abattements prévus en faveur des donations aux enfants et petits-enfants. Il est en effet plus aisé de respecter les plafonds d'abattements (100 000 € par enfant et 31 865 € pour chacun des petits-enfants) lorsque les biens transmis sont des parts de société que lorsqu'il s'agit d'un patrimoine immobilier, par nature difficilement divisible.
M. Lepère, veuf, souhaite transmettre à ses deux enfants en mai 2015 un appartement qu'il possède à Paris, évalué à 400 000 €. S'il donne directement l'appartement, chaque enfant se voit attribuer la moitié de la valeur du bien, soit 200 000 €. Sur ces 200 000 €, un abattement de 100 000 € est pratiqué, ramenant la base taxable à 100 000 € par enfant.
Supposons maintenant qu'une SCI a été constituée pour détenir l'immeuble (la société n'a pas d'autre actif et n'a aucun passif). La valeur de chaque part sociale, en admettant que le capital soit divisé en 300 parts et en retenant une décote de 10 % par rapport à la valeur de l'immeuble, est de 1 200 € (400 000 €/300 × 90 %). Dans ce cas, M. Lepère peut décider de donner 83 parts à chacun de ses enfants dans un premier temps et de leur transmettre le solde plus tard. La donation des 83 parts par enfant sera évaluée à 99 600 € (83 × 1 200 €). La base taxable est ramenée à zéro par le jeu de l'abattement. Quinze ans plus tard, la donation des 134 parts sociales restantes (soit 67 parts par enfant) se fera à nouveau en franchise fiscale, par le jeu de l'abattement.
La donation des parts d'une société, immédiatement suivie de la vente de ces parts par les bénéficiaires de la donation, peut dans certaines situations permettre de substantielles économies d'impôt.
Prenons l'exemple de deux associés détenteurs de la totalité des parts d'une société civile de portefeuille. Ces associés envisagent de céder leurs droits dans la société. Par hypothèse, la plus-value potentielle sur les titres est élevée. Si, plutôt que de vendre leurs parts, les associés en font donation à leurs enfants, il n'y a pas de plus-value imposable (l'opération étant bien sûr soumise aux droits de donation dans les conditions habituelles). En effet, seules les ventes ou opérations assimilées, tels les apports, sont considérées comme des opérations taxables. La vente ultérieure des titres par les enfants constituera bien une opération taxable, mais la plus-value imposable sera calculée à partir d'un prix d'acquisition correspondant à la valeur des parts au jour de la donation, soit une valeur proche du prix de vente si les opérations sont réalisées à bref délai. Au final, la cession aura pu être réalisée sans qu'aucune plus-value ne soit taxée.
Ce type d'opération relève-t-il de l'habileté ou de l'abus de droit ? La distinction est cruciale puisque si un abus de droit est établi, l'impôt esquivé sur la plus-value est rappelé avec une pénalité pouvant aller jusqu'à 80 %, qui s'ajoute à l'intérêt de retard.
Pour que la donation ne puisse pas être remise en question, les donateurs ne doivent en aucun cas être considérés comme ayant conservé les sommes issues de la vente des titres : l'abus de droit serait caractérisé si les bénéficiaires de la donation reversaient aux donateurs tout ou partie du prix de cession des parts sociales (en ce sens, par exemple, CE 14-11-2014 no 361482 : RJF 2/15 no 140, dans une affaire où le donateur avait transféré le produit de la vente des titres donnés sur des comptes dont il avait, directement ou indirectement, seul le contrôle, excédant ainsi les droits conférés par ses qualités d'usufruitier d'une partie des titres et d'administrateur légal des biens de son fils mineur, donataire). En l'absence de réappropriation du prix de vente, ni la rapidité avec laquelle l'opération est réalisée ni l'existence de clauses restreignant les droits des bénéficiaires de la donation mais ne remettant pas en cause le dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs (par exemple, interdiction de vendre les parts données, obligation de les apporter à une société civile familiale constituée avec les donateurs) ne sont de nature à rendre la donation fictive (CE 30-12-2011 no 330940 : RJF 3/12 no 278 ; dans le même sens, CE 9-4-2014 no 353822 : RJF 7/14 no 708).
Il faut toutefois veiller à la chronologie des opérations : pour échapper à l'imposition de la plus-value, il faut que la donation ait précédé la vente (celle-ci étant réalisée par le bénéficiaire de la donation). Si un protocole de vente des parts a été conclu entre les donateurs et l'acquéreur final, la donation des parts doit intervenir avant que la vente soit devenue parfaite, c'est-à-dire avant l'accord définitif sur le nombre de parts cédées et leur prix (pour une illustration dans un cas où la promesse de cession des titres était assortie d'une condition suspensive, voir CE 28-5-2014 no 359911 : RJF 8-9/14 no 802). Sinon, la plus-value de cession des parts est imposable au nom des donateurs, dans les conditions de droit commun : l'impôt peut leur être réclamé avec l'intérêt de retard, mais sans la pénalité de l'abus de droit.
La création d'une société civile pour la détention d'un patrimoine, immobilier notamment, offre des avantages en termes de transmission successorale. Elle permet ainsi d'assurer la préservation de l'unité du patrimoine familial, par rapport aux risques que ferait courir une indivision entre héritiers.
Elle facilite le partage, dans la mesure où il est évidemment plus facile de partager des parts de société qu'un immeuble, ou même plusieurs immeubles de valeur souvent inégale.
La création d'une société civile présente également plusieurs avantages en matière de droits de succession :
- elle permet de diminuer la valeur taxable des biens transmis par le jeu d'une décote (voir ci-avant no 61032) ;
- elle permet d'éviter la présomption de propriété de l'usufruitier ;
- elle permet de préserver le différé de paiement des droits de succession.
L'interposition d'une société civile permet de combattre la présomption de propriété de l'usufruitier prévue, en matière de droits de succession, pour éviter certains abus liés à un démembrement de propriété.
En principe, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété par décès de l'usufruitier n'emporte aucun droit de succession (CGI art. 1133). Pour éviter les abus, la loi prévoit que lorsque la nue-propriété est détenue par l'un des héritiers présomptifs de l'usufruitier (ses enfants notamment), l'usufruitier peut être considéré, sur le plan fiscal, comme ayant conservé la pleine propriété du bien ayant fait l'objet du démembrement (CGI art. 751). Il en résulte notamment que si l'usufruitier qui a donné à ses enfants la nue-propriété d'un bien décède dans les trois mois de la donation, les enfants devront - sauf à apporter la preuve que le décès prématuré du donateur était imprévisible au moment de la donation - payer les droits de succession sur la valeur de la pleine propriété du bien (déduction faite des droits payés lors de la donation).
Cette présomption de propriété de l'usufruitier ne s'applique pas lorsque la nue-propriété du bien appartient à une société civile, même lorsque les parts de la société sont détenues par un héritier présomptif de l'usufruitier. Cette solution vise non seulement le cas où la nue-propriété a été apportée à la société, l'apporteur se réservant l'usufruit, mais aussi celui où le bien a été acquis pour l'usufruit par les parents et en nue-propriété par une société civile constituée entre les enfants (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 no 250).
M. Lesage, veuf âgé de 95 ans, est propriétaire d'un immeuble dont il souhaite transmettre la nue-propriété à ses deux enfants Laure et Louis, en se réservant l'usufruit.
1e hypothèse : M. Lesage effectue une donation de la nue-propriété de l'immeuble à ses deux enfants le 2 mai 2015. Il décède le 20 juin. La présomption de propriété de l'usufruitier joue et Laure et Louis devront régler les droits de succession sur la valeur de la pleine propriété de l'immeuble (les droits payés lors de la donation étant déduits de la facture).
2e hypothèse : Le 2 mai 2015, M. Lesage apporte la nue-propriété de l'immeuble à une société civile constituée entre lui et ses enfants, puis leur donne la quasi-totalité de ses parts. Il décède le 20 juin. Dans ce cas, sauf si l'administration prouve un abus de droit, la présomption de propriété ne joue pas : Laure et Louis n'acquitteront les droits de succession que sur la valeur des parts sociales que leur père avait conservées avant son décès.
Lorsque les enfants héritent en nue-propriété (le conjoint survivant recevant l'usufruit), ils peuvent demander un différé de paiement des droits de succession (CGI ann. III art. 397 et CGI404 B). Moyennant le versement d'intérêts (calculés au taux de 2,2 % pour les demandes effectuées en 2015), les droits ne sont à payer que six mois après le décès de l'usufruitier ou, en cas de vente de la nue-propriété intervenant avant le décès de l'usufruitier, six mois après cette vente.
L'héritier qui a directement reçu la nue-propriété d'un immeuble perd le bénéfice du différé de paiement des droits de succession si l'immeuble est vendu avant le décès de l'usufruitier : dans les six mois de la vente, il devra payer les droits en suspens. S'il a hérité de la nue-propriété des parts de la société qui détient l'immeuble, il ne devient imposable que s'il vend les parts : même si la société vend l'immeuble, l'héritier qui conserve la nue-propriété de ses parts n'est pas déchu du différé de paiement obtenu.
Dans le cas d'un portefeuille de valeurs mobilières transmis en nue-propriété par succession, l'administration admet que les héritiers nus-propriétaires continuent à bénéficier du différé de paiement des droits de succession si l'usufruitier vend des titres, mais à condition que l'intégralité du produit de ces ventes serve à l'achat de nouvelles valeurs dans le cadre du portefeuille (BOI-ENR-DG-50-20-30 no 260). Le problème ne se pose pas lorsque le portefeuille appartient à une société civile. Dans ce cas, en effet, ce sont les parts de la société qui sont transmises et démembrées par succession. Celui qui hérite de la nue-propriété bénéficie du paiement différé au titre de la transmission de ces parts. Le portefeuille appartenant à la société civile peut dès lors faire l'objet de ventes (totales ou partielles) sans remettre en cause ce différé de paiement, à la seule condition que les parts de la société civile ne soient pas cédées du vivant de l'usufruitier.
Le contrat de société doit être établi par écrit (C. civ. art. 1835). Cet écrit, qui constate le pacte social, correspond aux statuts de la société.
En principe, les statuts peuvent être établis par acte sous signature privée ou par acte notarié.
En pratique, l'intervention d'un notaire apparaît indispensable dans un certain nombre de cas.
Elle est obligatoire lorsque les statuts constatent l'apport d'un immeuble ou d'un droit au bail sur un immeuble d'une durée supérieure à 12 ans et, d'une manière générale, chaque fois qu'il y a lieu à publicité foncière (C. civ. art. 710-1).
Lorsque de futurs héritiers de l'un des fondateurs participent à la constitution de la société, la rédaction des statuts par acte notarié est fortement conseillée pour écarter toute suspicion de libéralité chez les autres héritiers. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'une société est constituée entre des parents et certains seulement de leurs enfants. En effet, si cet avantage était prouvé, les bénéfices retirés par l'héritier de son association avec le défunt seraient considérés comme une donation indirecte faite du vivant du donateur ; ils devraient alors être rapportés à la masse successorale et pris en compte pour la détermination de la part revenant à chaque héritier. Attention toutefois : même si les statuts sont rédigés par acte notarié, le rapport à la masse successorale sera dû s'il apparaît que la société a été constituée avec l'intention de porter atteinte aux droits des héritiers qui ne sont pas associés (par exemple, une répartition des bénéfices non proportionnelle aux apports et qui avantagerait les héritiers associés).
Lorsque le recours à l'acte notarié n'est pas obligatoire, les statuts peuvent être établis sur papier libre. Ils peuvent être écrits à la main, dactylographiés ou imprimés. Il faut laisser un espace suffisant (par une marge à gauche ou en bas) pour permettre, le cas échéant, aux associés de faire des renvois si une erreur a été commise. Chaque page est numérotée et revêtue de la signature abrégée (paraphe) de chacun des associés. Chaque original doit être signé par les associés (ou leurs mandataires).
Il doit être dressé autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un original au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Le dépôt d'un original des statuts en annexe au registre du commerce et des sociétés lors de l'immatriculation de la société n'est pas nécessaire lorsque la société demande son immatriculation par voie électronique : les statuts peuvent alors être fournis en copie (C. com. art. R 123-77 al. 1). Il suffit donc en principe aux associés de signer un original, des originaux supplémentaires devant toutefois être prévus lorsque l'accomplissement d'autres formalités le nécessite (notamment, en cas d'apport d'immeuble ou de droits sociaux).
Le gérant doit remettre une copie certifiée conforme des statuts à chaque associé.
Doivent être indiqués dans les statuts : la forme de la société, son objet, sa dénomination, sa durée, le siège social, le capital social, les apports de chaque associé et les modalités de fonctionnement de la société (C. civ. art. 1835).
Un modèle de statuts est donné en annexe no 61190.
C'est celle de la société civile régie par les dispositions des articles 1845 et suivants du Code civil.
La détermination de l'objet social revêt une très grande importance, car c'est à partir de l'objet fixé dans les statuts que s'apprécieront notamment l'étendue des pouvoirs du gérant à l'égard des tiers et la nécessité d'une modification statutaire en cas de changement d'activité. Toute l'habileté consiste à trouver une formulation qui ne soit ni trop large ni trop restrictive. En réalité, la détermination de l'objet dépendra de la volonté des associés et du but assigné à la société. S'agit-il de gérer et préserver tel immeuble qui doit absolument rester dans la famille ? Alors l'objet visera précisément cet immeuble. S'agit-il de mettre en place une structure efficace de gestion d'un patrimoine à la composition duquel les associés ne sont pas attachés ? Alors l'objet pourra viser l'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers (ou mobiliers). S'agit-il de créer la structure la plus active possible ? Alors l'objet social pourra être très large et défini sur le modèle donné au no 61190 (art. 2).
Elle peut être directement tirée de l'objet social (« Société civile immobilière du 4 rue Hector Talvart »), comporter le nom des associés ou être purement fantaisiste, pourvu qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Les fondateurs ont intérêt à vérifier auprès de l'Inpi que le nom choisi n'est pas déjà pris.
La durée maximale de la société est de 99 ans (C. civ. art. 1838). C'est la durée généralement retenue dans les statuts. La durée choisie pourra être prolongée, avant la date d'expiration fixée, par une décision des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Le plus souvent, il est fixé au lieu de l'immeuble dont la société a la jouissance privative en tant que propriétaire ou locataire. S'il s'agit d'un local d'habitation, il convient de s'assurer que la possibilité d'y installer le siège social n'est pas limitée ou interdite (par le contrat de bail ou le règlement de copropriété de l'immeuble notamment) et de tenir compte, le cas échéant, de certaines prescriptions administratives en matière d'urbanisme et de logement (autorisation préalable requise dans certaines communes).
Le siège social peut également être fixé au domicile du gérant. Si une disposition légale ou une stipulation contractuelle l'interdit (par exemple, une clause du bail ou du règlement de copropriété), le gérant est quand même autorisé à installer le siège social à son domicile, mais seulement à titre provisoire, pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Avant de demander cette immatriculation, le gérant doit notifier par écrit à son bailleur ou au syndic de copropriété son intention de fixer provisoirement le siège social à son domicile.
Le siège social peut enfin être installé dans des locaux occupés en commun avec d'autres sociétés (moyennant un contrat de domiciliation qui doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés), mais il ne doit pas s'agir d'une simple boîte aux lettres.
Le capital social est composé des apports en nature et des apports en numéraire que les associés promettent d'effectuer. Aucun capital minimum n'est exigé par la loi. Les statuts fixent donc librement son montant et les conditions de sa libération. Très souvent, les statuts laissent à la gérance le soin de fixer elle-même les dates et les montants des versements en fonction des besoins de la société.
Le capital social doit être divisé en parts sociales égales, c'est-à-dire de même valeur nominale (C. civ. art. 1845-1, al. 1). Aucun minimum ou maximum n'est fixé pour cette valeur nominale. Le plus simple est de retenir une valeur de 100 € par part.
Chaque associé doit faire un apport, c'est-à-dire transférer la propriété ou la jouissance d'un ou plusieurs biens en contrepartie duquel ou desquels il reçoit des parts de la société. Il n'est bien sûr pas nécessaire que les apports soient d'égale importance ou de même nature. Un associé peut apporter des biens de nature différente (immeuble et numéraire, par exemple).
L'apport de parts de sociétés en nom collectif à une société civile est à déconseiller car il ferait perdre à la société sa nature civile et la rendrait commerciale (quels que soient l'importance de la participation dans la société en nom collectif et l'objet de celle-ci), ce qui aurait pour effet de rendre les associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société sur leur patrimoine propre (les créanciers sociaux pourraient poursuivre un seul associé pour la totalité de la créance en saisissant ses biens personnels, sans avoir à diviser les recours entre chacun des associés).
Un époux peut librement devenir membre d'une société civile, en apportant des biens dont son régime matrimonial lui permet de disposer. Une telle décision ne doit cependant pas mettre en péril les intérêts de la famille : si tel était le cas, le juge aux affaires familiales, saisi par le conjoint, pourrait s'opposer à l'apport de certains biens à la société (C. civ. art. 220-1).
L'époux marié sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts reste propriétaire de ses biens personnels. Il est libre d'en disposer et peut donc les apporter à la société dont il devient associé. Toutefois, il ne peut pas, sans l'accord de son conjoint, apporter les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, c'est-à-dire le droit de propriété ou le droit au bail sur la résidence principale ou encore, des parts ou actions donnant droit à l'utilisation ou à la propriété de la résidence principale (C. civ. art. 215, al. 3).
L'époux marié sous un régime de communauté peut apporter sans l'accord de son conjoint les biens qui lui sont propres, c'est-à-dire, pour l'essentiel : les biens dont il était propriétaire avant le mariage ; les biens reçus par héritage, donation ou testament, sauf si la donation ou le testament a prévu que le bien serait commun (clause dite d'entrée en communauté) ; les biens qui se rattachent à des biens propres (par exemple, constructions faites sur un terrain détenu en propre) ; les biens acquis pendant le mariage et dont le prix a été en majeure partie financé avec de l'argent personnel, à condition que l'acte d'achat comporte une déclaration d'emploi (bien directement acheté avec de l'argent personnel) ou de remploi (bien acheté avec le produit de la vente d'un bien propre). Par exception, l'époux ne peut pas, sans l'accord de son conjoint, apporter les droits par lesquels est assuré le logement de la famille.
L'époux marié sous un régime de communauté qui souhaite apporter en société un bien commun doit en informer son conjoint et justifier de cette information dans l'acte d'apport (C. civ. art 1832-2). A cette occasion, le conjoint peut, s'il le souhaite, revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites. Ce droit de revendication peut être exercé jusqu'à la dissolution de la communauté. En cas de divorce, il peut être exercé jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée et donc, même après la date à laquelle le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens (Cass. com. 14-5-2013 no 12-18.103 : BPAT 4/13 inf. 153). Si les statuts de la société prévoient un agrément pour l'entrée des nouveaux associés, la revendication lors de l'apport dispense le conjoint exerçant ce droit de demander un agrément, l'agrément de l'un des époux valant pour les deux. En revanche, l'agrément du conjoint sera nécessaire si sa revendication a lieu ultérieurement. Si le conjoint dûment informé déclare par écrit qu'il ne revendique pas la qualité d'associé, sa renonciation est définitive et il ne peut ensuite se rétracter.
Enfin, dans certains cas, l'information du conjoint n'est pas suffisante et il faut aussi son accord. Il en est ainsi notamment pour l'apport des biens de communauté suivants :
- immeubles ou droits sociaux non négociables : parts de sociétés civiles ou de SARL, notamment (C. civ. art. 1424) ;
- droits par lesquels est assuré le logement familial (C. civ. art. 215, al. 3) ;
- biens quelconques lorsque le contrat de mariage contient une clause d'administration conjointe (C. civ. art. 1503).
Les statuts fixent les pouvoirs du ou des gérants (qui peuvent d'ailleurs être désignés statutairement), les modalités de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité aux assemblées, les conditions d'agrément de nouveaux membres en cas de cession de parts, les modalités d'exercice du droit de retrait et d'exclusion des associés. Une grande liberté est laissée en la matière aux associés.
Sur ces questions, voir nos 61120 s.
Depuis le 1er juillet 2015, l'obligation d'enregistrer les statuts auprès du service des impôts dans le mois suivant leur rédaction est supprimée. Autrement dit, les actes constatant la création d'une société ne sont plus soumis à la formalité de l'enregistrement (CGI art. 635, 1-5o modifié par la loi 2014-1545 du 20-12-2014 art. 24, II).
Lorsque l'acte constitutif de la société constate des apports immobiliers, il est soumis à la formalité de publicité foncière.
Après la signature des statuts, il faut procéder aux formalités de publicité suivantes :
- insertion d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales ;
- dépôt du dossier d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt est effectué auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) créé par le greffe du tribunal de commerce ou de grande instance dont dépend le siège social. Le CFE permet à la société de souscrire en un lieu unique et au moyen d'un seul document les diverses déclarations administratives auxquelles elle est tenue à sa création. La déclaration au centre vaut notamment déclaration d'existence au service des impôts. Elle peut être effectuée par voie électronique auprès du guichet unique de création d'entreprise (accessible sur le site www.guichet-entreprises.fr) ou sur le site Internet du centre compétent si celui-ci s'est doté des équipements techniques permettant la transmission électronique des données (par exemple, www.cfe.ccip.fr pour le CFE tenu par la chambre de commerce de Paris).
Une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) est également requise mais elle est à la charge du greffier du tribunal auquel le CFE transmet le dossier.
La plupart des journaux d'annonces légales disposent de collaborateurs spécialisés qui peuvent accomplir pour votre compte l'ensemble des formalités pour un coût relativement modéré (comptez généralement entre 500 € et 800 €).
Aucun délai n'est prescrit pour la réalisation de ces formalités (la déclaration d'existence au service des impôts doit toutefois être souscrite dans le délai de trois mois à compter de la constitution de la société si celle-ci relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dans le délai d'un mois si elle opte pour l'impôt sur les sociétés). Mais comme la société n'acquerra la personnalité morale - et ne sera donc en état de fonctionner régulièrement - qu'à dater de son immatriculation, il convient de les effectuer le plus rapidement possible.
Le montant des droits d'enregistrement exigibles varie selon que les apports sont purs et simples, à titre onéreux ou mixtes.
Les apports purs et simples sont ceux en contrepartie desquels l'apporteur reçoit des droits sociaux (parts sociales).
Les apports sont dits à titre onéreux lorsqu'ils sont rémunérés par un équivalent ferme et actuel, définitivement acquis à l'apporteur et par conséquent soustrait aux risques sociaux (par exemple : remise d'espèces ou prise en charge par la société d'un passif incombant à l'apporteur). Dans ce cas, l'associé ne fait pas une véritable mise sociale : son apport a le caractère d'une vente faite à la société.
Un apport est mixte lorsqu'il est rémunéré, partie au moyen de la remise de parts sociales (apport pur et simple), partie par un avantage soustrait aux aléas sociaux (apport à titre onéreux).
Sont exonérés de droits les actes constatant les apports purs et simples réalisés à l'occasion de la constitution d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés (ce qui est généralement le cas des sociétés civiles de patrimoine), quels que soient les biens apportés : espèces, immeubles, droits immobiliers, droits sociaux, valeurs mobilières, créances, etc. (CGI art. 810 bis).
Les apports purs et simples consentis par une personne physique à une société passible de l'impôt sur les sociétés sont exonérés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur des espèces, des créances, des valeurs mobilières ou des droits sociaux. Ils sont assujettis à un droit de mutation au taux global de 5 % lorsqu'ils portent sur un immeuble, sur des biens assimilés (actions ou parts d'une société immobilière transparente ou conférant à leur possesseur le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles), ou sur des droits immobiliers : usufruit, nue-propriété, droits d'usage et d'habitation, servitudes réelles (CGI art. 809, I-3o et CGI810, III).
Leur régime fiscal diffère selon qu'ils ont pour objet des immeubles ou d'autres biens. En revanche, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la société bénéficiaire de l'apport est ou non passible de l'impôt sur les sociétés.
Les apports d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumis à une taxation spécifique au taux global de 5 % (CGI art. 683 bis).
Les apports ayant pour objet des biens autres que des immeubles sont soumis aux droits de mutation ordinaires selon la nature des biens apportés. Ainsi, les apports d'actions sont en principe taxés au taux de 0,1 %, sans abattement (CGI art. 726, I-1o ), tandis que les apports de parts sociales (titres détenus dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions) sont taxés au taux de 3 %, après application d'un abattement égal pour chaque part apportée au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société (CGI art. 726, I-1o bis). Par exemple, si un associé apporte 200 parts d'une société dont le capital est divisé en 500 parts sociales pour une valeur d'apport de 20 000 €, les droits seront calculés sur la base de : 20 000 € - (23 000 € × 200/500) = 10 800 €. Lorsque les titres apportés (qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales) sont ceux d'une société à prépondérance immobilière non cotée, l'apport est taxé à un droit de 5 % sans abattement (CGI art. 726, I-2o ).
Les apports d'espèces et de créances ne sont pas taxés.
Les apports mixtes sont soumis :
- au régime des apports purs et simples, pour la partie rémunérée par des parts de la société bénéficiaire des apports ;
- au régime des apports à titre onéreux pour la partie rémunérée par une contrepartie soustraite aux risques sociaux.
Les parties sont libres de déclarer quels sont, parmi les biens apportés, ceux qui constituent un apport pur et simple et ceux qui doivent être considérés comme apportés à titre onéreux (BOI-ENR-AVS-10-30 no 20). Elles ont tout intérêt à utiliser cette faculté, en rangeant dans la seconde catégorie les biens dont la vente est la moins lourdement taxée. A défaut, l'administration procéderait (ce qui serait plus coûteux) à une imputation proportionnelle sur les biens de chaque nature apportés par l'intéressé.
Deux associés A et B constituent une SCI non passible de l'impôt sur les sociétés.
A apporte des espèces pour 30 000 € : il s'agit d'un apport pur et simple exonéré de droits.
B apporte un immeuble d'une valeur de 100 000 € et des créances pour 20 000 €, à charge pour la société de payer un passif (contracté pour l'acquisition de l'immeuble) de 15 000 €. Il s'agit d'un apport mixte : à titre pur et simple pour 105 000 € et à titre onéreux pour 15 000 €.
Hypothèse 1 : imputation des apports à titre onéreux réglée par les parties
Dès lors que l'acte précise que le passif s'impute en priorité sur les créances, les apports de l'associé B sont considérés comme faits :
- à titre onéreux à concurrence d'une partie des créances, soit 15 000 € (exonération de droit) ;
- à titre pur et simple pour le surplus de la valeur des créances (5 000 €) et pour la valeur de l'immeuble (100 000 €) (exonération de droit).
Hypothèse 2 : application de la règle de l'imputation proportionnelle (en l'absence de précision portée dans l'acte)
Dans ce cas, le passif de 15 000 € est imputé à hauteur de 20/120e (2 500 €) sur les créances et de 100/120e (12 500 €) sur l'immeuble. Dès lors, les apports de B sont considérés comme faits :
- à titre onéreux à concurrence d'une partie des créances, soit 2 500 € (exonération de droit) et sur l'immeuble à hauteur de 12 500 € (taxation au taux de 5 %, soit 625 €) ;
- à titre pur et simple pour le surplus de la valeur de l'immeuble (87 500 €) et le surplus de la valeur des créances (17 500 €) (exonération de droit).
Les apports en nature étant fiscalement assimilés à une cession, qu'ils soient purs et simples ou à titre onéreux, ils peuvent entraîner, comme une vente ordinaire, la taxation d'une plus-value égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle des droits sociaux remis en contrepartie du bien apporté, éventuellement majorée des espèces reçues ou du passif transmis à la société, et, d'autre part, la valeur pour laquelle le bien est entré dans le patrimoine de l'apporteur (prix d'acquisition du bien ou valeur vénale de ce bien au jour de la mutation à titre gratuit en cas d'acquisition par voie de succession ou de donation).
La plus-value consécutive à un apport en société de biens ou de droits immobiliers est en principe déterminée et imposée - ou exonérée - selon les règles des plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 U s.).
La plus-value est exonérée notamment lorsque l'opération porte sur la résidence principale de l'apporteur ou que l'immeuble a été détenu pendant un certain délai avant d'être apporté à la société : par le jeu de l'abattement prévu à l'article 150 VC, I du CGI, la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu lorsque l'apporteur détient l'immeuble depuis plus de 22 ans (l'exonération des prélèvements sociaux n'est, elle, acquise qu'après 30 ans de détention).
Lorsque la plus-value ne bénéficie d'aucune exonération, l'opération d'apport présente l'inconvénient de déclencher une imposition qui peut être substantielle alors que l'apporteur n'en aura retiré aucune liquidité. L'imposition est établie au taux proportionnel de 19 %. A cette imposition s'ajoute, pour les plus-values supérieures à 50 000 €, une taxe comprise entre 2 % et 6 % en fonction du montant de la plus-value imposable (CGI art. 1609 nonies G). Compte tenu des prélèvements sociaux (15,5 %), le taux d'imposition global s'échelonne de 34,5 % à 40,5 %.
Lorsque l'apport porte sur des valeurs mobilières cotées ou non cotées, des titres assimilés ou des droits sociaux, ce sont en principe les règles d'imposition des plus-values boursières qui s'appliquent (CGI art. 150-0A s.).
La plus-value réalisée est imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'un abattement pour durée de détention lorsque les titres apportés ont été détenus pendant un certain délai avant l'opération (CGI art. 150-0 D, 1 ter et 1 quater). A l'impôt sur le revenu s'ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 15,5 %). Lorsque l'apport porte sur des titres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés représentatifs d'une participation supérieure à 25 %, l'administration fiscale considère que la plus-value ne peut pas bénéficier de l'abattement « renforcé » prévu pour les cessions à l'intérieur du groupe familial, même si la société bénéficiaire de l'apport est une société civile de « famille » (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20 no 70).
A noter qu'un mécanisme de report d'imposition existe pour les opérations d'apport de tels biens en société, mais uniquement si la société civile a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI art. 150-0 B ter).
Il est important de savoir, dans la perspective de constitution d'une société civile de patrimoine, que l'acquisition d'un logement dans le cadre d'une SCI ne permet pas aux associés de bénéficier des droits à prêts acquis personnellement dans un plan d'épargne logement.
Par ailleurs, l'associé ne bénéficie pas de la protection offerte par la loi aux particuliers qui acquièrent en direct un logement. Ainsi, les règles qui protègent l'emprunteur non professionnel qui sollicite un prêt pour financer l'achat d'un immeuble d'habitation ne s'appliquent pas en cas d'acquisition du logement par une société dont l'objet social est de procurer des immeubles ou fractions d'immeubles, en propriété ou en jouissance (Cass. 1e civ. 11-10-1994 no 92-20.563 : Bull. civ. I no 285). Jugé également que l'achat d'un immeuble à usage d'habitation par une SCI agissant dans le cadre de son objet social d'acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers n'ouvre pas droit au délai de réflexion et de rétractation accordé par la loi aux particuliers qui s'engagent dans l'achat d'un bien immobilier (Cass. 3e civ. 24-10-2012 no 11-18.774 : RJDA 1/13 no 26 ; Cass. 3e civ. 16-9-2014 no 13-20.002 : BRDA 19/14 no 13).
La réalisation d'un investissement locatif par l'intermédiaire d'une société civile qui achète (ou à laquelle est apporté) l'immeuble donné en location peut présenter des rigidités, en termes notamment de durée des baux et de droit à reprise du logement, qui ne doivent pas être négligées. Il en est ainsi lorsque les associés de la société ne sont pas tous parents ou alliés, ou le sont mais à un degré éloigné (au-delà des cousins germains). Dans ce cas en effet, la durée du bail conclu avec le locataire devra être d'au moins six ans et aucun congé pour reprise pour habiter ne pourra être donné (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 10, al. 1 et art. 13).
Lorsque la société est une société civile de famille constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus (c'est-à-dire jusqu'aux cousins germains), le bail conclu avec le locataire doit avoir une durée d'au moins trois ans (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 10, al. 1 et art. 13). La société peut proposer un contrat d'une durée inférieure (mais d'au moins un an) si un événement précis justifie qu'elle reprenne le logement pour des raisons professionnelles ou familiales affectant l'un des associés ; le contrat doit alors indiquer l'événement et les raisons dont il s'agit, par exemple la reprise pour habiter d'un associé lors de son départ en retraite. Dans ce cas, deux mois avant le terme du bail, le gérant de la société doit confirmer la réalisation de l'événement (le bail prend alors fin à la date fixée) ou proposer le report du terme si cette réalisation est différée. Un seul report est possible. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'a pas été confirmé, le bail est réputé être de trois ans.
Lorsque le logement est la propriété d'une société civile de famille constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, la société peut, au terme du bail, reprendre le logement pour y loger un de ses associés (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 13). En revanche, elle ne peut pas reprendre le logement pour y loger les proches des associés, notamment leurs enfants si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes associés (Cass. 3e civ. 19-1-2005 no 03-15.922 : RJDA 4/05 no 365).
- Une SCI constituée entre conjoints peut conclure un bail d'habitation de trois ans avec les locataires des immeubles dont elle est propriétaire. Une SCI constituée entre concubins, même partenaires d'un Pacs, ne peut pas conclure de bail d'habitation d'une durée inférieure à six ans avec ses locataires.
- La durée minimale du contrat de bail est déterminée par la qualité du bailleur lors de l'entrée dans les lieux du locataire ou du renouvellement du contrat. Un changement parmi les associés de la SCI en cours de bail n'a pas d'effet sur la durée du bail ; il ne produira d'effet que lors de son renouvellement.
Lorsqu'un immeuble est apporté en société, la commune peut exercer son droit de préemption au moment de l'apport, tout comme elle est autorisée à le faire en cas de vente. Ainsi, sous peine de nullité, l'apport doit être précédé de l'envoi au maire de la commune concernée d'une déclaration d'intention d'aliéner.
A la constitution, les associés ont apporté à la société soit des espèces, soit des biens en nature (des immeubles dans le cas des sociétés civiles immobilières, des titres et valeurs mobilières dans le cas des sociétés civiles de portefeuille). Les associés ont alors reçu des parts sociales émises par la société, en proportion de leurs apports.
Les parts sociales donnent droit à des prérogatives pécuniaires (droit aux bénéfices et au boni de liquidation notamment) et à des attributs de participation à la vie sociale (droit d'information sur les affaires sociales, droit de participer aux décisions collectives, droit de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, droit au maintien dans la société, etc.).
En revanche, les parts sociales ne confèrent aux associés aucun droit de propriété sur les biens apportés ou acquis par la société, l'actif social appartenant exclusivement à la société.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844, al. 1). Aucune clause statutaire ou contractuelle ne peut limiter ce droit.
La consultation des associés est obligatoire dans quatre cas : pour statuer sur les comptes annuels ; pour décider une modification statutaire ; pour prendre une décision qui dépasse la compétence du gérant ; pour révoquer le gérant.
En principe, les décisions collectives sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite (C. civ. art. 1853). Ce procédé permet de consulter les associés dont l'éloignement rend difficile la participation aux réunions. En revanche, comparativement à l'assemblée, il présente l'inconvénient de ne pas donner lieu à un échange de vues entre les associés au moment où ils doivent statuer sur les résolutions qui leur sont proposées. Les statuts peuvent limiter la possibilité de consultation par correspondance à certaines décisions (par exemple, toutes les décisions n'entraînant pas modification des statuts autres que l'approbation annuelle des comptes) ou prévoir le principe de la consultation écrite en laissant à la gérance, lors de chaque décision à prendre, le soin de choisir entre cette procédure et la réunion d'une assemblée.
Les décisions collectives peuvent aussi être prises par acte signé par tous les associés (C. civ. art. 1854). Ce procédé est d'ailleurs fréquemment employé dans les sociétés qui comptent peu d'associés. Il permet, en effet, de prendre une décision sans délai dès lors que tous les associés sont d'accord. Alors que la procédure de consultation écrite ne peut être utilisée que si elle est prévue par les statuts, la constatation des décisions collectives dans un acte signé par tous les associés est possible même en l'absence de toute disposition statutaire le permettant.
La tenue des assemblées suppose le respect d'un certain formalisme.
Une convocation doit en principe être adressée, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée à chacun des associés (Décret 78-704 art. 40, al. 1). La convocation peut toutefois être verbale, et même sans délai, pourvu que tous les associés soient présents ou représentés lors de la réunion (CA Paris 23-6-1998 no 97-15221 : RJDA 4/99 no 434).
La lettre de convocation doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour. Les questions inscrites à l'ordre du jour doivent être libellées de telle sorte que leur portée et leur contenu apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Si l'ordre du jour n'est pas explicite, les délibérations prises par l'assemblée peuvent être annulées à la demande d'un associé. Ainsi jugé dans un cas où la convocation faisait état d'une modification des statuts, mais ne donnait pas la teneur de la modification proposée (CA Versailles 25-1-2002 no 00-4715 : RJDA 11/02 no 1158).
Les associés disposent, avant toute assemblée, d'un droit de communication sur les documents nécessaires à leur information, droit dont le non-respect est susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée.
Les consultations d'associés doivent faire l'objet de procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège de la société (Décret 78-704 art. 44 et 45).
SavoirAucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la validité des assemblées à la présence d'associés possédant un nombre minimal de parts. Les associés peuvent néanmoins convenir, dans les statuts, de la nécessité d'un quorum et, dans ce cas, ils l'organisent comme ils l'entendent : quorum pour toutes les assemblées ou seulement certaines d'entre elles (par exemple, celles appelées à modifier les statuts), calcul du quorum en capital ou par tête, etc.
Le droit de vote est strictement personnel. Seul l'époux qui a la qualité d'associé participe au vote, que les parts sociales constituent des biens communs ou des biens propres ou personnels. Les associés peuvent toutefois se faire représenter par un mandataire si les statuts le permettent. La représentation d'un associé par son conjoint non associé est, en principe, soumise aux mêmes règles que la représentation par un tiers. Toutefois, de nombreux statuts, qui excluent le recours à un tiers non associé comme mandataire, accordent au conjoint un régime particulier et permettent qu'il soit choisi comme mandataire mais seulement par son époux ; il ne saurait donc être habilité à recevoir les pouvoirs d'autres associés.
Les associés fixent librement dans les statuts les règles de majorité applicables aux décisions collectives. Elles peuvent être les mêmes dans tous les cas ou différer selon la nature ou l'importance des décisions à prendre : par exemple, majorité simple pour les décisions ordinaires (50 % des voix plus une) et majorité renforcée pour celles qui entraînent une modification des statuts (par exemple 60 % ou 75 % des voix). Le calcul de la majorité peut s'effectuer en capital, en nombre d'associés (par tête), ou à la fois en nombre et en capital. Les statuts doivent aussi préciser si la majorité doit être appréciée en fonction de la totalité des associés ou en ne tenant compte que des associés présents (ou, si les statuts le permettent, représentés), ou même simplement par rapport aux voix exprimées.
En l'absence de clause particulière dans les statuts, les décisions sont prises à l'unanimité (C. civ. art. 1852), à l'exception de celles relatives à la nomination ou à la révocation du gérant, prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En tout état de cause, aucune décision augmentant les engagements d'un associé ne peut être prise sans le consentement de celui-ci (C. civ. art. 1836, al. 2).
SavoirLe plus souvent, le vote a lieu à main levée, en comptabilisant d'abord les abstentions, puis les votes « contre ». Mais le vote peut aussi être effectué au scrutin secret lorsqu'il est prévu par les statuts ou, en l'absence de clause statutaire, lorsqu'il en est décidé ainsi par l'assemblée. Il est d'ailleurs recommandé, afin d'éviter les tensions et de ménager les susceptibilités, de prévoir que les décisions qui touchent aux personnes (agrément, retrait, exclusion des associés, etc.) seront prises au scrutin secret.
Chaque associé a vocation aux bénéfices réalisés par la société.
La part de chaque associé dans les bénéfices sociaux est fixée par les statuts. A défaut d'indication statutaire, elle est proportionnelle à sa part dans le capital social. Ainsi, l'associé qui détient 20 % du capital a vocation à 20 % des bénéfices, etc.
La décision d'affectation des bénéfices est prise par l'assemblée des associés. Juridiquement, le droit des associés aux dividendes ne prend naissance que le jour où l'assemblée décide leur mise en distribution, même si, fiscalement, les bénéfices réalisés par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérés comme acquis par les associés à la clôture de l'exercice (Cass. com. 14-12-2010 no 09-72.267 : RJDA 2/11 no 147).
Jugé qu'en participant à la décision collective de modifier temporairement la répartition statutaire des droits aux bénéfices entre associés, les parents qui ont accepté que leur part soit réduite, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants n'ont pas consenti à ces derniers une donation indirecte : les bénéfices réalisés par la société ne participant de la nature de fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes et les dividendes n'ayant pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, les époux n'étaient titulaires d'aucun droit sur les dividendes attribués à leurs enfants et n'avaient pu consentir aucune donation de ceux-ci (Cass. com. 18-12-2012 no 11-27.745 : BRDA 1/13 no 3).
Toute personne régulièrement entrée dans la société a droit à la qualité d'associé et au maintien de cette qualité jusqu'à sa mort ou son retrait par cession ou rachat de ses parts sociales.
Toutefois, un associé peut être exclu de la société pour les causes et selon les modalités fixées par une clause des statuts à laquelle tous les associés ont adhéré. L'efficacité d'une clause statutaire d'exclusion dépend, pour une large part, du soin apporté à sa rédaction. Les associés doivent déterminer avec précision :
- les motifs d'exclusion (par exemple, l'inexécution de l'obligation d'apport) ;
- l'organe social habilité à statuer sur l'exclusion (le choix de l'assemblée générale extraordinaire est conseillé en raison de la gravité de la décision à prendre) ;
- la procédure à suivre (comment l'associé visé sera informé de la mesure envisagée contre lui, le délai dont il disposera pour préparer sa défense, les conditions dans lesquelles il pourra présenter ses explications, les modalités du vote, les formes et délai de notification à l'intéressé de la décision prise par l'assemblée) ;
- les conditions de remboursement des parts sociales de l'associé exclu. En pratique, le rachat devra être fait, soit par les autres associés, soit par un tiers agréé, soit, cas le plus fréquent, par la société elle-même au moyen d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat sera, à défaut d'accord entre les parties et s'il n'est pas déterminé ou déterminable au regard des statuts, fixé par un expert (C. civ. art 1843-4, II issu de l'ord. 2014-863 du 31-7-2014 art. 37).
Les statuts peuvent fixer les conditions d'exercice du droit de retrait des associés. Ils peuvent prévoir que le retrait ne pourra intervenir qu'après un certain délai de présence dans la société (ce délai ne doit pas être tel qu'il aboutisse à une interdiction de retrait).
En l'absence de clause statutaire, le retrait d'un associé ne peut intervenir que s'il a été autorisé par une décision unanime des autres associés ou par une décision de justice (l'associé qui souhaite se retirer doit alors convaincre le juge qu'il a de « justes motifs » de vouloir quitter la société).
Le retrait s'effectue sous la forme d'une réduction du capital social réalisée par annulation des parts de l'associé qui se retire. Celui-ci a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et le prix de rachat des parts doit lui être payé comptant. En cas de contestation sur la valeur des parts, celle-ci est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal.
Il est possible aussi de procéder à une attribution en nature, l'associé qui se retire pouvant, en échange de ses droits, soit reprendre ses apports, soit se faire attribuer d'autres biens sociaux.
Le refus systématique, par les associés majoritaires d'une société civile de participations, de distribuer des dividendes alors que rien ne justifie un tel refus constitue un juste motif de retrait des associés minoritaires (Cass. 1e civ. 13-4-1983 no 285 : BRDA 11/83 p. 12).
De même, constituent un juste motif de retrait d'un associé de société civile la privation de son droit de vote et l'absence de communication des informations auxquelles il a droit (CA Rouen 20-6-2001 no 99-4551 : RJDA 8-9/02 no 904).
Un associé égalitaire d'une société civile ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un immeuble a été autorisé à se retirer dans un cas où, d'une part, la société, créée vingt ans auparavant, avait remboursé l'intégralité des sommes empruntées pour l'achat de l'immeuble, n'avait pas d'autre passif et avait pour seule activité la gestion du bail des locaux qui venait d'être renouvelé pour neuf ans et, d'autre part, l'intéressé, associé depuis la création de la société, était âgé de 67 ans et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, était titulaire d'une pension de retraite modeste et n'avait pu retirer aucun revenu de son investissement dans la société, les bénéfices étant systématiquement mis en réserves (CA Paris 29-5-2007 no 06-4408 : RJDA 2/08 no 164).
Doit être accueillie la demande de retrait de deux associés d'une SCI familiale lorsque, depuis le décès du père fondateur de la société, aucune assemblée générale n'a été tenue et aucun acte de gestion n'a été accompli, aucune entente n'existant plus entre les associés sur les décisions à prendre en vue de l'administration ou même de l'entretien courant de la propriété constituant l'unique actif de la SCI, cette situation caractérisant la perte de tout affectio societatis (Cass. 3e civ. 28-3-2012 no 10-26.531 : RJDA 7/12 no 691).
Un associé qui avait constitué avec son épouse - et les parents de celle-ci - une SCI pour détenir leur logement a été autorisé à se retirer de la société après leur divorce, l'ex-époux ayant perdu tout affectio societatis et n'ayant plus d'intérêt à demeurer dans la SCI dont le seul actif était occupé par son ex-épouse, sans que cette occupation ne soit génératrice d'aucun revenu pour la société qui devait en supporter les charges de propriété et sans que cette situation puisse évoluer dès lors que l'ex-époux était associé minoritaire (Cass. 3e civ. 11-2-2014 no 13-11.197 : BRDA 6/14 inf. 3).
Les cessions de parts sociales peuvent en principe intervenir dès l'immatriculation de la société. Lorsqu'une clause d'inaliénabilité temporaire est prévue dans les statuts, le titulaire des parts ne peut les céder qu'après l'expiration d'un certain délai après son entrée dans la société.
Si les parts constituent des biens de communauté, l'époux qui en est titulaire ne peut pas les vendre sans le consentement de son conjoint (C. civ. art. 1424), même si celui-ci n'a pas revendiqué la qualité d'associé lors de l'achat ou de la souscription des parts (Cass. 1e civ. 9-11-2011 no 10-12.123 : RJDA 2/12 no 142). La cession opérée sans le consentement du conjoint est nulle, même à l'égard d'un acquéreur de bonne foi. L'époux peut néanmoins être autorisé en justice à conclure seul la vente si son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (C. civ. art. 217).
Si les parts sont des biens propres ou personnels, l'époux associé peut les vendre librement, sauf si la société est propriétaire du logement familial. En effet, aux termes de l'article 215, al. 3 du Code civil, « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ». La cession d'une participation dans la société civile constituée pour détenir ce logement exige donc le consentement du conjoint, à tout le moins lorsqu'elle est de nature à donner aux acquéreurs la majorité des droits dans la société (ou même une minorité de blocage). Dans ce cas en effet, une mésentente entre associés pourrait, à terme, aboutir à priver la famille de son logement, ce que visent à prévenir les dispositions précitées.
En principe, toute cession de parts, même entre associés ou conjoints, est soumise à agrément, à l'exception des cessions entre ascendants et descendants qui n'ont pas à être agréées (C. civ. art. 1861, al. 1 et 2).
Mais les statuts peuvent aménager cette règle. Ils peuvent écarter la libre cessibilité des parts entre ascendants et descendants en prévoyant que de telles cessions seront soumises à agrément. Les statuts peuvent par ailleurs dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou à leurs conjoints. En revanche, les statuts ne sauraient écarter l'agrément pour des personnes autres que les associés ou les conjoints de ceux-ci.
Dans le silence des statuts, l'agrément requiert l'unanimité des associés, et le cédant participe au vote. Mais les statuts peuvent définir d'autres règles et prévoir que l'agrément sera donné à la majorité qu'ils déterminent. Les statuts peuvent également confier au gérant le soin de statuer sur l'agrément, ce qui lui confère le pouvoir de décider seul de l'opportunité de faire entrer de nouveaux associés dans la société. Dans un tel cas, le gérant peut valablement agréer la cession de ses propres parts, aucune disposition légale ou statutaire ne lui imposant de soumettre cette cession à l'agrément de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 17-1-1996 no 76 : RJDA 6/96 no 797).
Bien rédigée, la clause d'agrément est un verrou efficace pour empêcher l'entrée d'indésirables dans la société.
Elle pourra par exemple être libellée comme suit : « Toute cession entre vifs, comme toute transmission de parts sociales pour cause de décès ou pour cause de fusion, scission ou apport partiel d'actif, doit être préalablement agréée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales effectivement souscrites, déduction faite des reprises d'apports. »
Autre exemple : « Les parts sociales ne sont librement cessibles qu'entre associés et au profit du conjoint, des ascendants et descendants de l'associé cédant ; elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres personnes qu'avec le consentement de la gérance. »
Si la clause d'agrément permet d'écarter tout nouvel associé, elle ne peut pas rendre les associés d'origine prisonniers de la société. Lorsqu'un associé qui désire se retirer de la société a trouvé un acquéreur intéressé par le rachat de ses parts et que cet acquéreur n'a pas été agréé par les coassociés, ces derniers ont l'obligation de racheter ou faire racheter, par un tiers ou par la société, les parts considérées.
La responsabilité des associés à l'égard des tiers est illimitée : les associés répondent indéfiniment des dettes sociales (C. civ. art. 1857). A condition d'avoir d'abord vainement poursuivi la société, les créanciers sociaux pourront saisir les biens personnels des associés. Cependant, ils devront diviser leurs poursuites : chaque associé n'est responsable qu'en proportion des droits qu'il détient dans le capital de la société. Par exemple, le créancier d'une société civile constituée entre trois associés à parts égales ne pourra poursuivre chaque associé que pour un tiers de sa créance.
L'associé qui se retire de la société reste tenu vis-à-vis des tiers des dettes sociales devenues exigibles avant son retrait.
En cas de décès d'un associé, ses héritiers devenus associés ne sont tenus indéfiniment à l'égard des tiers des dettes de la société que dans la double proportion de leur part dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession (Cass. 1e civ. 1-7-2003 no 882 : RJDA 11/03 no 1086). Par exemple, si un des trois associés ayant constitué la société civile vient à décéder, laissant deux héritiers se partageant la moitié de ses parts, un créancier social pourra poursuivre chacun des deux associés initiaux au paiement du tiers de sa créance et chacun des héritiers pour la moitié du tiers restant, soit pour 1/6e de sa créance.
La gestion du patrimoine de la société est assurée par le gérant, qui en est le représentant légal, sous le contrôle de l'assemblée générale des associés. Le gérant peut être un tiers mais, le plus souvent, il est choisi parmi les associés de la société.
La gérance peut être assurée par plusieurs personnes, le nombre des gérants étant fixé librement dans les statuts.
Quel que soit leur régime matrimonial, des époux peuvent, ensemble ou séparément, être gérants d'une société civile.
Le gérant peut être nommé dans les statuts ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (C. civ. art. 1846, al. 3). Les statuts peuvent aussi fixer des règles de majorité plus importantes pour la désignation du gérant : par exemple, 2/3, 3/4, voire l'unanimité.
La durée des fonctions du gérant est librement fixée par les associés, soit dans les statuts, soit lors de la nomination de l'intéressé. A défaut, le gérant est réputé nommé pour la durée de la société (C. civ. art. 1846, al. 4).
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant peut être révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (C. civ. art. 1851, al. 1). Le gérant, s'il est associé, peut participer au vote de la résolution concernant sa révocation ; il s'ensuit que s'il dispose de la majorité requise, ou même d'une simple minorité de blocage, il sera assuré de conserver ses fonctions, sauf pour les autres associés à demander sa révocation judiciaire (demande qui n'est recevable que si elle est fondée sur une cause légitime). Lorsque la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu au versement de dommages-intérêts.
Les fonctions de gérant peuvent être exercées gratuitement ou, si les statuts le prévoient, être rémunérées.
Le gérant peut en principe accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (C. civ. art. 1848, al. 1). Par « actes de gestion », on entend non seulement les actes d'administration mais aussi les actes de disposition dans la mesure où ceux-ci concernent l'exploitation de la société (par exemple, la vente d'actifs sociaux réalisée dans l'intérêt de la société et ne l'empêchant pas de poursuivre son activité telle que définie par l'objet social).
Les statuts peuvent prévoir des limites aux pouvoirs du gérant et imposer une autorisation préalable de la collectivité des associés pour la conclusion de certains contrats ou la réalisation d'opérations jugées trop importantes pour être laissées à sa seule initiative (emprunts autres que les crédits en banque, hypothèque sur les immeubles sociaux, vente de certains éléments de l'actif, engagements excédant une somme fixée dans les statuts, etc.). Lorsque de telles clauses existent, les statuts déterminent généralement les conditions d'habilitation du gérant à passer ces actes. S'ils ne le font pas, il faudra le consentement de tous les associés (C. civ. art. 1852).
Si le gérant viole une clause restreignant ses pouvoirs ou agit au détriment de la société, les associés pourront lui demander réparation du préjudice subi de ce fait ; ils pourront aussi le révoquer et prétendre valablement que la méconnaissance des statuts constitue un juste motif le privant de tout droit à dommages-intérêts. En revanche, à l'égard des tiers, l'acte sera valable et pourra être opposé à la société dès lors qu'il entre dans son objet.
A l'égard des tiers, le gérant engage la société par tous les actes entrant dans l'objet social. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers (C. civ. art. 1849, al. 1 et 3). Mais même lorsqu'elle entre dans l'objet social, une sûreté accordée au nom de la société en garantie d'une dette d'un associé n'est pas valable si elle est contraire à l'intérêt de la société (Cass. com. 23-9-2014 no 13-17.347).
Les actes conclus par le gérant qui n'entrent pas dans l'objet social n'engagent pas la société et celle-ci peut en demander la nullité (sauf lorsque ces actes ont été consentis avec l'accord unanime des associés : à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'intérêt de la société, ils engagent alors valablement celle-ci).
L'interprétation de la clause statutaire définissant l'objet de la société donne parfois lieu à des analyses divergentes. En pratique, les rédacteurs des statuts devront veiller à définir le plus précisément possible l'objet social afin d'éviter toute ambiguïté sur l'étendue des pouvoirs du gérant et l'incertitude qui en résulte en cas de litige entre ce dernier et les associés.
Le gérant d'une société civile immobilière peut-il vendre un immeuble appartenant à la société ? Il a été jugé qu'avait le pouvoir de vendre le seul immeuble de la société le gérant d'une SCI dont l'objet était « la propriété, l'exploitation par bail ou location et la gestion de tous immeubles » (Cass. 3e civ. 18-12-2001 no 1822 : RJDA 4/04 no 436) ou encore « la propriété de tous biens immobiliers situés en France, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles d'en favoriser le développement immobilier » (Cass. com. 26-2-2008 no 06-21.744 : BPAT 3/08 inf. 108). Jugé à l'inverse que n'avait pas ce pouvoir le gérant d'une société dont l'objet était « la propriété, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles » (Cass. 3e civ. 31-3-1999 no 644 : RJDA 6/99 no 674) ou encore « l'acquisition, la propriété, l'administration, la mise en location, la gestion et l'exploitation de tous immeubles (...) et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et toutes opérations immobilières quelconques concernant tous autres immeubles pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère de la société » (Cass. 3e civ. 6-9-2011 no 10-21.815 : RJDA 1/12 no 66). La troisième chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt d'appel qui, pour juger que la vente d'un immeuble décidée par le seul gérant n'excédait pas l'objet social, avait retenu que celui-ci visait l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire ainsi que l'emprunt des fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, les associés n'ayant pas entendu donner une définition restrictive à cet objet et l'achat d'un immeuble par la société lui en conférant la propriété avec tous ses attributs, dont celui d'aliéner le bien : la Cour de cassation a au contraire jugé que la clause claire et précise définissant l'objet de la société n'englobait pas la vente des actifs sociaux (Cass. 3e civ. 23-10-2013 no 12-22.720 : BPAT 1/14 inf. 34).
Au vu de ces divergences d'interprétation, les rédacteurs des statuts auront intérêt à préciser clairement dans l'objet social que celui-ci inclut (ou non) et sous quelles conditions l'aliénation des immeubles.
Les sociétés civiles de patrimoine relèvent en général du régime dit des sociétés de personnes : les résultats réalisés par la société sont imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques, chacun en proportion de ses droits dans la société, même si ces résultats ne sont pas effectivement distribués (CGI art. 8).
Exceptionnellement, les sociétés civiles de patrimoine sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. C'est le cas, soit de façon obligatoire si la société exerce une activité réputée commerciale sur le plan fiscal (comme la location meublée ou l'activité de marchand de biens), soit sur option de la société (CGI art. 206, 2 et 3).
Sauf assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce sont celles applicables au type d'activité exercé par la société : règles des revenus fonciers et des plus-values immobilières pour les sociétés civiles immobilières, règles des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values boursières pour les sociétés civiles de portefeuille.
En règle générale, la détention d'un patrimoine à travers une société civile créée pour le gérer ne modifie pas les règles applicables à la détermination des revenus et des charges afférents à ce patrimoine. Il en résulte, par exemple, que la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières à travers une société ne permet pas de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de ces valeurs mobilières. En revanche, les frais de garde des titres en portefeuille sont déductibles dans les conditions de droit commun.
De la même façon, une SCI constituée pour gérer un patrimoine immobilier ne peut déduire que les charges qu'un propriétaire direct serait lui-même autorisé à déduire. Si elle donne en location un immeuble dont elle est propriétaire, la société peut déduire les charges de nature foncière correspondantes (intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou les travaux effectués sur la propriété, dépenses d'entretien et de réparation, dépenses d'amélioration, primes d'assurances, frais de gestion, taxes foncières et taxes annexes, etc.). La réalisation d'un investissement immobilier en SCI peut bénéficier des dispositifs spéciaux prévus en faveur des logements donnés en location sous certaines conditions, tel le régime Duflot-Pinel. Enfin, les associés de la SCI peuvent bénéficier du régime du micro-foncier, à condition d'être par ailleurs directement propriétaires d'immeubles donnés en location nue, lorsque le montant total de leurs revenus fonciers bruts, incluant la quote-part leur revenant dans les revenus de la société civile, ne dépasse pas 15 000 € par an (CGI art. 32).
Lorsque la SCI ne perçoit aucun revenu (par exemple, société constituée pour détenir la résidence principale ou secondaire de ses associés), aucune charge n'est déductible. Le fait que le logement appartienne à une société civile ne fait cependant pas obstacle au bénéfice des crédits d'impôt pour dépenses liées à l'habitation principale (dépenses pour la transition énergétique de l'habitation principale notamment) pour l'associé qui occupe le logement et paie effectivement de telles dépenses.
Les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si cet immeuble rapporte des revenus fonciers, c'est-à-dire des loyers. Il pourrait dès lors être tentant de créer une SCI à laquelle serait apporté l'immeuble occupé par ses propriétaires (à titre de résidence principale ou secondaire), puis de conclure un bail entre la SCI et les associés occupants, moyennant un petit loyer. La SCI déclarerait les loyers perçus comme revenus fonciers et pourrait déduire l'ensemble des charges foncières attachées à l'immeuble (intérêts d'emprunt, travaux d'entretien et de réparation, etc.). Le déficit foncier en résultant pourrait remonter à ses associés qui réaliseraient à cette occasion une substantielle économie d'impôt sur le revenu.
Oui, mais voilà : un tel schéma ne manquerait pas d'être remis en cause par l'administration fiscale, qui n'hésite pas en de pareilles circonstances à utiliser l'arme de l'abus de droit (arme particulièrement efficace puisqu'elle permet à l'administration, non seulement de calculer les droits comme si les actes litigieux n'avaient pas été passés, mais encore d'assortir les redressements d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 80 % des droits rappelés, qui s'ajoute à l'intérêt de retard).
A plusieurs reprises, la jurisprudence a donné raison à l'administration sur ce terrain, en jugeant que de tels schémas n'étaient mis en oeuvre que pour des raisons fiscales. Les éléments suivants peuvent être retenus comme indices d'un abus de droit :
- le contrôle exclusif ou quasi exclusif de la société par les occupants du logement ;
- le fait que le patrimoine de la société soit exclusivement composé de ce logement ;
- le fait que la société n'ait aucune autre activité ;
- le fait que la société ait été constituée juste avant l'acquisition du logement ou juste avant la réalisation d'importants travaux sur ce logement ;
- la circonstance que les charges imputées soient régulièrement très supérieures aux loyers encaissés par la société ;
- l'existence de relations financières anormales entre la société et ses associés (loyer dérisoire, échéances non réglées, confusion des trésoreries).
La société doit en principe souscrire chaque année la déclaration de ses résultats, sur des imprimés appropriés : no 2072 pour les revenus fonciers, no 2561, 2561 bis, 2561 ter et 2561 quater pour les revenus mobiliers et cessions de valeurs mobilières, no 2074 et 2075 pour les cessions de titres et droits sociaux, no 2777 pour les produits soumis à prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux.
Lorsque le résultat dégagé par la société est un bénéfice, chaque associé en déclare sa quote-part dans le cadre de sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu (imprimé no 2042). De même lorsqu'il s'agit d'un déficit : chaque associé impute sa quote-part sur sa déclaration personnelle, dans les mêmes conditions que s'il avait constaté ce déficit en direct.
Les sociétés immobilières qui mettent leurs immeubles à la disposition gratuite de leurs associés ne sont tenues de souscrire une déclaration qu'au titre de l'année de leur constitution. Elles en sont dispensées au titre des années suivantes sous trois conditions (BOI-RFPI-CHAMP-30-20 no 240) :
- aucune modification ne doit intervenir dans la répartition du capital, la liste des immeubles dont la société est propriétaire et leurs conditions d'occupation ;
- la société ne perçoit aucun revenu, y compris des produits financiers ;
- aucune rémunération n'est versée aux associés, que ce soit en contrepartie d'un dépôt en compte courant ou d'une activité (gérance, notamment).
La réalisation par une société civile immobilière d'une plus-value sur cession d'immeuble entraîne des obligations particulières. Une déclaration no 2048 IMM doit en effet être souscrite par le gérant de la société ou par son mandataire. Cette déclaration doit être déposée, en simple exemplaire, au service de la publicité foncière à l'appui de la demande de publication, dans le mois qui suit la date de l'acte notarié constatant la vente. Elle mentionne le nom de tous les associés présents à la date de la vente et la quote-part leur revenant.
La déclaration doit être accompagnée du paiement de l'impôt : l'impôt est donc acquitté par la société elle-même, ce paiement étant libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés. En d'autres termes, il est demandé à la société de faire l'avance de l'impôt dont la charge incombe à ses membres. En pratique, le notaire chargé de la vente effectue généralement la déclaration et le paiement de l'impôt pour le compte de la société.
Lorsqu'une société civile a été créée pour détenir un immeuble, deux modalités de cession peuvent être envisagées : la vente de l'immeuble par la société ou la vente par les associés de leurs parts dans la société.
Au regard des droits d'enregistrement, les deux opérations sont soumises à un régime similaire : la vente de l'immeuble rend exigible, selon les départements, un droit de 5,09006 % à 5,80665 % tandis que la vente des parts est normalement assujettie à un droit de 5 % (s'agissant de parts d'une société à prépondérance immobilière). Dans les deux cas, le droit est à la charge de l'acquéreur.
Au regard des plus-values, les deux opérations peuvent en revanche avoir des résultats très différents, bien que toutes deux relèvent en principe du régime des plus-values immobilières (cas général d'une SCI non soumise à l'IS) et soient imposables au même taux de 19 % (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux et, pour les plus-values supérieures à 50 000 €, une taxe comprise entre 2 % et 6 % en fonction du montant de la plus-value), l'impôt devant être payé dans le mois de la vente en même temps que doit être déposée la déclaration de plus-value (no 2048 IMM pour la vente de l'immeuble, no 2048 M pour la vente des parts).
Lorsqu'une société civile immobilière vend un immeuble dont elle est propriétaire, la plus-value est déterminée au niveau de la société à partir du prix d'acquisition de l'immeuble, qui correspond, lorsque celui-ci lui a été apporté par ses associés, à sa valeur d'apport. Le prix d'acquisition est majoré des frais d'acquisition, qui peuvent être évalués forfaitairement à 7,5 %.
Lorsque la vente porte sur un immeuble détenu depuis plus de cinq ans, la plus-value est réduite d'un abattement pour durée de détention (CGI art. 150 VC, I). Par le jeu de l'abattement, la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu au-delà d'un délai de 22 ans (l'exonération des prélèvements sociaux n'étant, elle, acquise qu'après 30 ans de détention). Mais attention : en toute hypothèse, le délai de détention court à compter de la date d'acquisition de l'immeuble par la société. Si l'immeuble lui a été apporté, c'est la date d'apport qui est retenue, et non la date à laquelle les associés avaient eux-mêmes acquis l'immeuble avant de l'apporter.
Les plus-values de cession d'immeubles destinés à être démolis puis reconstruits en logements situés dans des zones urbaines denses réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 sont réduites d'un abattement exceptionnel (de 25 % ou 30 % selon leur date de réalisation) qui s'applique, le cas échéant, après l'abattement pour durée de détention (BOI-RFPI-PVI-20-20 nos 190 s.). Quant à celles réalisées lors de la cession de terrains à bâtir, elles peuvent bénéficier d'un abattement exceptionnel de 30 % sous réserve, notamment, que la cession ait été précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 (BOI-RFPI-PVI-20-20 nos 390 s.).
Outre l'exonération résultant du jeu de l'abattement pour durée de détention, la plus-value réalisée peut en principe bénéficier des autres exonérations applicables en matière immobilière. Notamment, lorsque l'immeuble est mis gratuitement à la disposition d'un ou de plusieurs associés qui l'occupent à titre de résidence principale, ceux-ci bénéficient de l'exonération prévue en faveur des cessions de telles résidences. L'exonération prévue en faveur de la première cession d'un logement autre que la résidence principale s'applique aux associés qui en remplissent les conditions (la circonstance que l'un des associés ne remplirait pas l'une des conditions pour bénéficier du dispositif, ou n'en demanderait pas le bénéfice, est sans incidence sur la situation des autres associés) ; s'agissant du remploi du prix de cession, il peut être réalisé soit par chaque associé à titre individuel, soit par la société qui acquiert ou construit la résidence principale des associés qui demandent le bénéfice de l'exonération (BOI-RFPI-PVI-10-40-30 no 390). Est également susceptible de bénéficier aux associés l'exonération des cessions inférieures ou égales à 15 000 €, lorsque le prix de vente du bien par la société n'excède pas ce montant (ce peut être le cas d'un parking). En revanche, selon l'administration, l'exonération générale des plus-values réalisées par les retraités ou invalides de condition modeste ne bénéficie pas à l'associé d'une SCI, dès lors que la plus-value imposée à son nom est réalisée non par lui-même personnellement, mais par la société propriétaire des immeubles cédés (BOI-RFPI-PVI-10-40-90 no 60).
Lorsque les associés vendent leurs parts dans la société, la plus-value est égale à la différence entre le prix de vente des parts et leur prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition. Les frais d'acquisition doivent être retenus pour leur montant réel et justifié, le forfait de 7,5 % n'étant pas applicable aux titres. Dans certains cas, le prix d'acquisition doit être corrigé. Notamment, lorsque des bénéfices ont été imposés au nom de l'associé cédant sans lui être distribués, le prix d'acquisition des parts à retenir pour le calcul de la plus-value doit être augmenté du montant de ces bénéfices, ce qui diminue d'autant le montant de la plus-value (CE 9-3-2005 no 248825 : RJF 6/05 no 564). Si la société a réalisé des plus-values sous un régime d'exonération, la quote-part de plus-values exonérées correspondant aux droits de l'associé vient également augmenter le prix d'acquisition de ses parts (CAA Nancy 8-12-2011 no 10NC01337 : RJF 3/12 no 252). Inversement, si un déficit a été déduit par l'associé, le montant de ce déficit vient minorer le prix d'acquisition de ses parts (ce qui majore la plus-value), sauf cas rare où il a dû effectivement combler des pertes.
Lorsque les parts cédées ont été détenues pendant plus de cinq ans, la plus-value réalisée par l'associé cédant est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC, I du CGI. Le point de départ du délai de détention est la date d'acquisition ou de souscription des parts par l'associé et non la date d'acquisition de l'immeuble par la société, ce qui peut s'avérer très favorable si la société a été constituée avant l'acquisition ou encore dans l'hypothèse d'acquisitions échelonnées dans le temps par la société.
La cession de parts de SCI n'ouvre en revanche pas droit aux abattements exceptionnels de 25 % ou 30 % prévus en faveur de certaines cessions d'immeubles destinés à être démolis puis reconstruits ou de terrains à bâtir (BOI-RFPI-SPI-20 no 1).
Le seul dispositif d'exonération applicable (outre l'exonération résultant du jeu de l'abattement pour durée de détention) est celui dont bénéficie l'associé qui occupe le logement à titre de résidence principale, à condition que cette occupation soit gratuite : la plus-value qu'il réalise en vendant ses parts est exonérée à concurrence de la valeur du logement par rapport à la valeur globale de l'actif de la société. Les autres exonérations existant en matière de plus-values immobilières ne sont pas applicables aux cessions des parts de la SCI.
Les sociétés civiles de patrimoine sont autorisées à opter pour l'impôt sur les sociétés (IS). Cette option doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l'IS. Une fois exercée, l'option est irrévocable, aussi la décision d'opter doit-elle être bien pesée.
Dans le cadre de l'IS, les revenus imposables correspondent aux revenus acquis, qu'ils aient ou non été encaissés ; de façon symétrique, les charges déductibles correspondent aux charges engagées, qu'elles aient ou non été payées.
La société soumise à l'IS peut, en principe, déduire l'ensemble des intérêts des emprunts contractés dans le cadre de son activité. Elle peut déduire des amortissements sur les biens qui font partie de son actif immobilisé (immeubles, notamment). L'option pour l'IS permet également à la société de constituer, le cas échéant, des provisions pour dépréciation (dépréciation des immeubles ou des titres qu'elle détient) et des provisions pour charges (provisions pour travaux notamment). La société assujettie à l'IS peut enfin déduire les rémunérations versées à son gérant, même s'il est associé, pour autant que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées (en contrepartie, le gérant associé est imposable sur cette rémunération, en principe dans la catégorie prévue à l'article 62 du CGI).
Le résultat ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 % lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- le chiffre d'affaires annuel de la société n'excède pas 7 630 000 € ;
- le capital de la société est entièrement libéré ;
- le bénéfice imposable n'excède pas 38 120 €.
La fraction de bénéfice imposable supérieure à 38 120 € est imposée au taux normal de l'IS, soit 33,1/3 %.
Tant que la société ne distribue pas son résultat à ses associés, ceux-ci ne subissent aucune imposition à leur niveau. L'option pour l'IS peut ainsi être particulièrement avantageuse en cas de réinvestissement des bénéfices dans la société, puisque ceux-ci ne supportent alors qu'un impôt à 15 % (33,1/3 % au maximum) alors que s'ils étaient imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, leur taux d'imposition pourrait atteindre 45 % (taux actuellement le plus élevé du barème progressif), voire 48 % ou 49 % si on inclut la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auquel s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux. Inversement, lorsque la société constate des déficits, ceux-ci restent bloqués à son niveau et ne pourront être utilisés que pour compenser des bénéfices ultérieurs de la société, sans pouvoir remonter aux associés.
Les bénéfices distribués par la société soumise à l'IS sont imposés entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (avec le bénéfice de l'abattement de 40 %).
L'option pour l'IS produit d'autres conséquences qui ne doivent pas être négligées. Ainsi, toute plus-value réalisée par la société lors de la cession d'un élément de son actif est imposable selon le régime des plus-values professionnelles. Les exonérations qui existent en matière de plus-values privées (immobilières notamment) ne sont pas applicables, ce qui peut s'avérer particulièrement désavantageux. Des droits d'enregistrement sont par ailleurs exigibles sur les apports d'immeubles et de droits immobiliers consentis à la société (no 61099).
L'option pour l'impôt sur les sociétés est susceptible de modifier la fiscalité applicable à la cession des parts par l'associé de la société : alors que la cession des parts d'une société civile immobilière relève normalement des règles des plus-values immobilières, la cession des droits dans une société ayant opté pour l'IS relève des règles des plus-values boursières.
L'assujettissement à l'IS d'une SCI entraîne son assujettissement à la contribution sur les revenus locatifs (CRL). Cette contribution, qui frappe les produits des locations portant sur des immeubles achevés depuis au moins 15 ans, est égale à 2,5 % des recettes nettes de la location perçues au cours de la période d'imposition (recettes retenues comme en matière de revenus fonciers).
AttentionLorsqu'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés met un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite d'un ou plusieurs associés, cette mise à disposition entraîne la taxation à l'IS du loyer théorique que l'immeuble aurait rapporté s'il avait été loué à un tiers (en contrepartie, la SCI peut déduire les charges qu'elle expose sur l'immeuble). En outre, l'avantage en nature qui correspond à la mise à disposition gratuite du logement constitue, pour l'associé qui en bénéficie, un revenu réputé distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (sans abattement).
Alors que les sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont tenues aux mêmes obligations comptables que les entreprises industrielles et commerciales, les sociétés civiles relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne sont en principe tenues à aucune obligation comptable particulière.
Toutefois, la plupart des statuts de sociétés civiles imposent la tenue d'une comptabilité. Par ailleurs, la tenue d'un minimum de comptabilité résulte des obligations envers les associés et l'administration fiscale.
Ainsi, le gérant doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l'année, au moyen d'un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année écoulée comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (C. civ. art. 1856). De même, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d'un mois (C. civ. art. 1855). Seule la tenue d'une comptabilité fiable permet par ailleurs de suivre les droits de chacun des associés dans l'actif net de la société ainsi que les créances ou dettes de chacun envers la société, notamment en cas de cession de parts, de retrait ou de décès d'un associé.
Enfin, en matière fiscale, le résultat déclaré par la société civile doit pouvoir être justifié par la présentation de tous documents appuyés de pièces justificatives.
En pratique, la tenue d'une comptabilité de caisse (avec enregistrement journalier des recettes encaissées et des dépenses payées) est privilégiée dans les petites sociétés familiales réalisant peu d'opérations : elle est moins lourde à gérer et permet de passer rapidement du résultat comptable au résultat fiscal.
Les règles générales de détermination des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers sont en effet fondées sur les principes de la comptabilité d'encaissement : déclaration des recettes perçues et des dépenses payées. Pour passer du résultat net encaissé au résultat fiscal, il convient simplement, à la fin de l'année, de réintégrer certaines dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes mais que la loi fiscale n'admet pas en déduction. Ainsi en est-il :
- des dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissements des immeubles ;
- des taxes d'urbanisme ;
- des droits d'enregistrement ;
- des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de valeurs mobilières, des frais de courtage, des frais d'abonnement à des revues financières.
Le prix d'achat des immeubles et des titres et valeurs du portefeuille ne peut pas non plus être déduit.
Même si elle n'y est pas obligée, rien n'empêche la société civile d'établir un compte de résultat et un bilan selon les règles de la comptabilité commerciale. Cela peut s'avérer très utile dans certaines circonstances, notamment en cas de recours à l'emprunt, pour rassurer les banques, mais aussi pour optimiser une transmission, en utilisant certaines options comptables telles que la pratique d'amortissements (non déductibles des revenus fonciers) ou la mise en réserve du résultat comptable.
M. Lecompte constitue avec ses enfants une SCI à laquelle il apporte un immeuble d'une valeur de 500 000 €, puis donne à ses enfants la nue-propriété des parts sociales dont il conserve l'usufruit. Chaque année, les revenus de l'immeuble (loyers) s'élèvent à 25 000 € et les charges (hors amortissements) à environ 10 000 €. Le résultat annuel de la société, qui revient en principe à M. Lecompte, est donc de 15 000 €. Sur ces 15 000 €, M. Lecompte n'a besoin que de 5 000 € : restent 10 000 €, laissés chaque année sur son compte courant dans la société. Au décès de leur père, les enfants seront taxés sur les sommes inscrites à ce compte qui fera partie de la succession. La comptabilisation d'un amortissement de 10 000 € par an (en retenant un taux d'amortissement de 2 % : 500 000 € × 2 % = 10 000 €) permet précisément d'éviter la constitution de ce compte courant et la taxation au décès.
Un résultat similaire peut être obtenu avec la mise en réserve, chaque année, des 10 000 € dont M. Lecompte n'a pas la nécessité : les sommes portées à un compte de réserve ouvert au passif du bilan de la société (qui viennent augmenter ses capitaux propres) seront transmises aux enfants nus-propriétaires des parts sans coût fiscal au décès de leur père usufruitier.
Les principales causes de dissolution d'une société civile de patrimoine sont :
- l'arrivée du terme fixé par les statuts (sauf décision de prorogation) ;
- l'extinction de l'objet social : par exemple, une SCI ayant pour unique objet la détention d'un immeuble déterminé est automatiquement dissoute à la vente de cet immeuble. En revanche, lorsqu'une société civile de portefeuille ayant pour seul actif des actions apportées par ses associés a pour objet « l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés », la cession de ces actions par la société n'a pas pour conséquence d'éteindre son objet et n'implique donc pas sa dissolution (Cass. com. 7-10-2008 no 07-18.635 : RJDA 1/09 no 29) ;
- l'accord des associés pour une dissolution amiable anticipée (notamment, lorsque les associés ne sont pas en mesure de racheter ou de faire racheter les parts d'un associé dont le successeur n'a pas été agréé, ils peuvent écarter l'entrée de ce successeur dans la société en décidant de dissoudre celle-ci). La dissolution décidée par les associés ne doit toutefois pas être animée par une intention frauduleuse ou constituer un abus de droit, à peine de nullité ou de dommages-intérêts. Ainsi, il y a abus de majorité lorsque la décision de l'associé majoritaire de dissoudre est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique but de se soustraire à son engagement de racheter les parts sociales d'un associé minoritaire (Cass. com. 8-2-2011 no 10-11.788 : RJDA 5/11 no 427) ;
- la dissolution judiciaire prononcée pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la société (no 61015).
Une société civile n'est pas dissoute du seul fait qu'elle n'a plus qu'un seul associé (par exemple, à la suite d'une cession de parts). Cependant, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander en justice la dissolution.
La dissolution d'une société civile entraîne un certain nombre de formalités de publicité : insertion dans un journal d'annonces légales, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'acte portant dissolution doit être soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date. Lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucune transmission de biens meubles ou immeubles, la dissolution est enregistrée moyennant le paiement d'un droit fixe de 375 € lorsque la société a un capital social de moins de 225 000 € et de 500 € lorsque le capital social est au moins égal à ce montant (CGI art. 811, 2o ).
La dissolution de la société entraîne sa liquidation. Ainsi désigne-t-on l'ensemble des opérations qui ont pour objet la réalisation des éléments d'actif et le paiement des créanciers sociaux en vue de déterminer l'actif net de la société. Les opérations de liquidation sont effectuées par le ou les liquidateurs. Ces derniers, choisis ou non parmi les associés, peuvent être désignés dans les statuts, nommés par les associés ou désignés en justice.
La clôture de la liquidation est un fait générateur de plus-value : les plus-values sur les éléments de l'actif social qui subsistent à la clôture de la liquidation deviennent immédiatement imposables.
La plus-value imposable est normalement égale à la différence entre la valeur réelle des biens à la date de la clôture de la liquidation et leur valeur d'acquisition par la société (prix d'achat ou valeur d'apport). Cependant, afin d'éviter une double taxation partielle de la plus-value pour les associés de SCI non soumises à l'impôt sur les sociétés ayant acheté leurs parts en cours de société, la fraction de plus-value imposable en leur nom est calculée par rapport à la valeur qu'avaient les biens au jour de l'acquisition des parts (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 no 420).
La SCI « Bel Immeuble » a été constituée le 1er janvier 2010 entre deux associés : A (60 % des parts) et B (40 %). Cette société dont le capital est divisé en 1 000 parts de 100 € chacune a acquis en 2011 un immeuble d'habitation pour le prix de 150 000 €.
En 2013, un nouvel associé C acquiert 200 parts de A et 100 parts de B. A cette date, l'immeuble est estimé à 200 000 €.
Début 2015, la société est dissoute. On suppose que l'immeuble vaut à la dissolution 300 000 €.
En principe, la plus-value devrait être calculée de la manière suivante, au niveau de la société (compte tenu du forfait de 7,5 % pour frais d'acquisition) : 300 000 - (150 000 × 107,5 %) = 138 750 €.
Cette plus-value devrait ensuite être répartie entre les associés pour être imposée à leur nom dans les conditions suivantes :
A : 40 % soit 55 500 €
B : 30 % soit 41 625 €
C : 30 % soit 41 625 €.
Mais l'associé C peut demander que la plus-value imposable à son nom soit limitée à celle acquise depuis son entrée dans la société. Ce calcul s'effectuera de la manière suivante :
300 000 - (200 000 × 107,5 %) × 30 % = 25 500 €.
C sera donc imposé sur une plus-value de 25 500 €, au lieu de 41 625 €.
La plus-value imposable au nom des deux autres associés n'est pas modifiée : 55 500 € pour A et 41 625 € pour B.
Après la clôture de la liquidation peut intervenir le partage qui fixe la part de chaque associé sur l'actif restant, en nature ou en espèces, après extinction du passif social. Les associés (ou certains d'entre eux) peuvent toutefois ne pas provoquer le partage et décider de demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux (C. civ. art. 1844-9, al. 4).
Le partage est en principe amiable et il n'est judiciaire que si les associés ne s'entendent pas. Même si, en principe, le partage se fait en espèces, chacun des associés a le droit de recevoir sa part en nature des biens formant l'actif net social. Certains associés peuvent bénéficier de l'attribution préférentielle de biens qui se retrouvent en nature dans la masse à partager : une telle attribution peut être prévue dans les statuts ou résulter de la loi (reprise des apports effectués par l'associé apporteur, reprise de la propriété qui sert d'habitation à l'associé ayant participé à la mise en valeur du bien). Elle peut aussi résulter d'une décision prise par les associés à l'unanimité (Cass. com. 30-5-2007 no 05-13.851 : RJDA 12/07 no 1239).
L'acte de partage doit être soumis à la formalité de l'enregistrement. S'il n'y a que des biens meubles, l'enregistrement a lieu dans le délai d'un mois auprès du service des impôts : celui du lieu de résidence du notaire si le partage est fait par acte notarié, celui du domicile de l'une des parties si le partage est fait sous signature privée. Lorsque les biens à partager comprennent des immeubles, l'acte de partage (qui doit revêtir la forme authentique) fait l'objet de la formalité fusionnée, exécutée au service chargé de la publicité foncière dans le mois suivant la date de l'acte (CGI art. 647, III).
Les droits dus dépendent du régime fiscal de la société civile.
Le partage d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes donne ouverture :
- au droit de partage de 2,50 % sur les acquêts sociaux répartis entre les associés. Sont considérés comme des acquêts sociaux non seulement les biens qui ont été acquis ou créés par la société, mais encore les choses fongibles qui lui ont été apportées (notamment le numéraire), ainsi que les biens de toute nature ayant fait l'objet d'un apport à titre onéreux ;
- au droit de vente lorsqu'un bien constitutif d'un corps certain ayant été apporté à titre pur et simple à la société est attribué, lors du partage, à un associé autre que l'apporteur (ou ses héritiers ou donataires). L'administration admet cependant de faire bénéficier l'opération du droit de partage lorsque le bien se trouvait, lors de l'apport, en indivision successorale entre les cohéritiers qui ont constitué la société (BOI-ENR-AVS-30-20-20 nos 230 et 240).
Lorsqu'un bien constitutif d'un corps certain apporté à titre pur et simple à la société est attribué dans le cadre du partage à l'associé apporteur (ou à un héritier ou donataire de l'apporteur), celui-ci est censé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire et aucune imposition n'est encourue. Toutefois, la reprise par l'apporteur d'un immeuble entraîne la perception de la taxe de publicité foncière au taux global de 0,71498 %, à laquelle s'ajoute la contribution de sécurité immobilière.
Le partage d'une société passible de l'impôt sur les sociétés est soumis à un régime différent selon le régime fiscal appliqué lors de l'apport aux biens composant l'actif social :
- lorsque les biens ont été exonérés de droits lors de leur apport (ou soumis au droit fixe), leur attribution, lors du partage, à un associé autre que l'apporteur donne ouverture aux droits de vente. S'ils sont attribués à l'apporteur, aucun droit n'est dû, sous réserve de la taxe de publicité foncière et de la contribution de sécurité immobilière s'il s'agit d'immeubles ;
- le partage de biens dont l'apport a été soumis aux droits de mutation donne lieu en principe au droit de partage de 2,50 %, exigible sur l'intégralité de l'actif net partagé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la personne de l'attributaire (apporteur ou autre associé).
Le partage des biens acquis ou créés par la société est également soumis au droit de partage.
Le modèle qui suit est donné à titre indicatif en vue de faciliter la rédaction des statuts de la société civile. On y trouvera les clauses les plus usuelles.
(Dénomination sociale)
Société civile au capital de ... €
Siège social : ...
Les soussignés : M. ..., M. ..., ...
ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société civile qu'ils sont convenus de constituer.
Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une Société civile régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.
La Société a pour objet :
- l'acquisition de tous terrains ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains ;
- l'acquisition, l'aménagement, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
- l'acquisition et la gestion de tous droits immobiliers ;
- éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de ceux de ces immeubles et/ou droits immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ;
- l'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion des parts de sociétés en nom collectif ;
- et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère exclusivement civil de la société.
La Société prend la dénomination ...
La durée de la Société est fixée à ... années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le siège social est fixé à ...
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision de la gérance et partout ailleurs en France en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.
1. Apports en numéraire :
M. ... apporte à la Société la somme de ... €.
M. ... étant marié sous le régime de la communauté des biens, son épouse, Mme ..., est intervenue aux présentes. Elle déclare avoir été informée de la souscription par son conjoint de parts sociales au moyen de fonds dépendant de la communauté existant entre eux et ne pas revendiquer la qualité d'associée.
Le montant total des apports en numéraire s'élève à ... €. Sur cette somme, il a été déposé à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque ..., agence de ..., ainsi que l'atteste un certificat de ladite banque en date du ..., la somme de ... € représentant ... % des apports de chacun des associés. Le solde des apports sera versé à la Société, ainsi que les apporteurs s'y obligent, en fonction des besoins de la Société, ... jours après la demande qui leur en sera faite par lettre recommandée AR de la gérance. A défaut de versement dans ce délai, les sommes appelées seront productives d'intérêts au taux de ... % l'an.
2. Apports en nature :
M. ... apporte à la Société le bien désigné ci-après : ...
Ce bien, dont l'apport est consenti net de tout passif, est évalué à ... €.
3. Récapitulation des apports :
Le total des apports consenti à la Société s'élève à la somme de ... €.
Le capital social est fixé à ... € ; il est divisé en ... parts sociales de ... € chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, savoir :
M. ... à concurrence de ... parts, en rémunération de son apport en numéraire,
M. ... à concurrence de ... parts, en rémunération de son apport en nature,
Soit au total ... parts.
1. Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits des associés résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifiés par la gérance, pourront être délivrés à chaque associé sur sa demande et à ses frais.
2. Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.
3. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
4. Lorsque des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il est exercé par l'usufruitier. Dans tous les cas, le nu-propriétaire dispose du droit de participer aux décisions collectives.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l'associé cédant. Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de tous les associés. A cet effet, toute cession, alors même qu'elle aurait lieu par voie d'apport en société, de fusion, de scission, de confusion de patrimoines, ou qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise aux règles suivantes.
L'associé qui veut céder ses parts en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée AR, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le prix et le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les ... jours de cette notification, chacun des associés fera connaître au cédant sa décision par lettre recommandée AR. La décision prise n'a pas à être motivée. Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai prévu ci-avant ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé et à défaut de renonciation du cédant à son projet, les dispositions des articles 1862Code civil et 1863 du Code civil s'appliquent.
En cas de décès d'un associé, ses héritiers, ses légataires ou son conjoint survivant deviennent de plein droit associés, sans qu'il soit besoin d'agrément.
1. La Société est gérée et administrée par un gérant unique, personne physique, nommé par décision ordinaire des associés et choisi parmi eux.
2. Le premier gérant de la Société, pour une durée indéterminée, est M. ..., demeurant ..., qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.
3. Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en vue de la réalisation de l'objet social. Toutefois, à titre de règlement intérieur, le gérant ne pourra, sans l'autorisation préalable des associés statuant à la majorité prévue ci-après à l'article 15, effectuer l'une des opérations suivantes : ...
4. La démission du gérant n'a pas à être motivée mais il doit en informer chaque associé trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée AR.
5. Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
1. Les décisions excédant les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés et résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés.
2. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre des parts qu'il possède ou qu'il représente, sans limitation.
1. Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins ... % du capital social peuvent par lettre recommandée AR demander à la gérance la convocation d'une assemblée générale.
2. Les convocations à l'assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée AR adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l'ordre du jour. La convocation peut être verbale et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
3. Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
4. L'assemblée générale est présidée par le gérant.
Si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance. Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée AR, le texte des résolutions proposées accompagné de tous renseignements utiles. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit. Leur réponse est adressée au siège social par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai est considéré comme s'étant abstenu. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de majorité prévues pour les assemblées générales.
1. L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de comptes, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.
2. Elle nomme et remplace le gérant. Elle délibère sur toute question inscrite à l'ordre du jour qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
3. Les décisions de l'assemblée générale ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
1. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toute modification qu'elle juge utile, sans exception ni réserve.
2. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société jusqu'au 31 décembre ...
Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
A la clôture de chaque exercice, il est dressé par la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat. Ces documents accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la Société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminués des pertes antérieures et des sommes éventuellement portées en réserve et augmentés de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Les pertes, s'il en existe, sont reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.
Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation est annexé aux présents statuts.
Les associés donnent tous pouvoirs à ... à l'effet d'accomplir pour le compte de la Société les actes suivants : ...
L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise de ces actes et des engagements qui en résulteront par la Société.
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi.
Fait à ..., le ..., en ... exemplaires.
L'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (C. civ. art. 578). L'usufruitier a un droit à la jouissance et aux fruits du bien (C. civ. art. 582) : il a le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus (loyers, dividendes, etc.).
Ce droit est toujours temporaire, le nu-propriétaire ayant vocation à détenir la pleine propriété du bien à l'extinction de l'usufruit.
L'usufruitier dispose d'un droit réel, c'est-à-dire d'un droit direct et immédiat sur la chose. Il est dans une situation radicalement différente de celle du locataire, qui n'a qu'un droit de créance à l'égard du bailleur.
SavoirUsus, fructus et abusus, tels sont les pouvoirs du propriétaire. Lorsqu'il y a usufruit, ces pouvoirs sont partagés entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, d'où l'expression « démembrement de propriété ».
Comme son nom l'indique, l'usufruitier a l'usus (le droit d'utiliser le bien) et le fructus (le droit d'en percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus).
L'abusus, qui est le droit de disposer du bien (le vendre ou le donner, par exemple), appartient au nu-propriétaire. Il ne peut bien sûr donner ou vendre que la nue-propriété, mais l'acheteur ou le donataire aura la pleine propriété du bien au terme de l'usufruit, soit le plus souvent au décès de l'usufruitier.
L'usufruit est le plus souvent viager : il dure toute la vie de l'usufruitier et s'éteint à son décès. Tel est le cas, notamment, de l'usufruit du conjoint survivant qui, en présence d'enfants tous issus des deux époux et à défaut de disposition contraire, recueille à son choix toute la succession en usufruit ou le quart en pleine propriété (C. civ. art. 757).
L'usufruit peut également être prévu pour une durée fixe (5 ans, 10 ans, etc.), sous deux réserves :
- si l'usufruitier meurt avant l'arrivée du terme prévu, l'usufruit s'éteint et le nu-propriétaire devient immédiatement plein propriétaire du bien ;
- si c'est une société ou une association qui est usufruitière, l'usufruit ne peut avoir une durée supérieure à 30 ans (C. civ. art. 619).
A la fin de l'usufruit, le bien devra être restitué à son propriétaire par l'usufruitier. Il en résulte pour ce dernier l'obligation de conserver la substance du bien dont il a l'usufruit (C. civ. art. 578). A défaut, le nu-propriétaire pourrait demander des dommages-intérêts, contraindre l'usufruitier à réparer le dommage causé au bien, voire demander la déchéance de l'usufruit.
On verra plus loin que l'obligation de conserver la substance du bien varie selon la nature des biens soumis à usufruit : immeuble, titres de sociétés, etc. Précisons que, si l'usufruit porte sur des biens qui s'abîment par l'usage (des meubles, par exemple), l'usufruitier doit seulement les rendre dans l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit, aucune indemnisation n'étant due au nu-propriétaire pour l'usure normale des biens (C. civ. art. 589).
La loi impose à l'usufruitier de faire dresser au moment où s'ouvre l'usufruit un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles (C. civ. art. 600). Ces documents, qui doivent en principe être établis en présence du nu-propriétaire, permettront à ce dernier de vérifier à la fin de l'usufruit que la consistance des biens n'a pas varié. Si ces documents n'ont pas été établis, le nu-propriétaire pourra prouver par tous moyens quelle était au départ la consistance des biens soumis à l'usufruit.
Enfin, l'usufruitier doit en principe donner caution (ou une autre garantie, par exemple, une hypothèque) d'utiliser les biens « raisonnablement » (C. civ. art. 601). S'il ne fournit pas cette garantie, le nu-propriétaire pourra notamment lui imposer le placement des sommes d'argent soumises à usufruit, l'usufruitier ne percevant alors que les intérêts des sommes placées (C. civ. art. 602).
L'obligation de fournir caution supporte des exceptions : d'une part, elle ne s'impose pas à celui qui donne ou vend un bien avec réserve d'usufruit ; d'autre part et surtout, le nu-propriétaire peut en dispenser l'usufruitier, ce qui est très fréquent lorsque l'usufruitier est le conjoint survivant.
Pour évaluer l'usufruit et la nue-propriété, il existe deux méthodes, l'une fiscale et l'autre économique.
C'est la plus connue et la plus simple des méthodes d'évaluation. Elle consiste à appliquer à la valeur du bien en pleine propriété un barème fixé par la loi (CGI art. 669). Son champ d'application est le suivant. Le barème fiscal est obligatoire pour le calcul des droits d'enregistrement, qu'il s'agisse d'une donation, d'une succession, d'une vente, d'un apport en société, etc. Mais il ne s'impose pas aux intéressés dans leurs relations entre eux. Par exemple, la veuve usufruitière et les enfants nus-propriétaires peuvent évaluer leurs droits respectifs sur l'héritage de leur mari et père en fonction de la valeur économique de ces droits, plutôt que par référence au barème fiscal (ce dernier s'appliquant seulement pour le calcul des droits de succession).
La méthode fiscale ne s'applique pas non plus au calcul des plus-values. Cela dit, elle a des conséquences indirectes chaque fois que le barème est retenu pour la détermination du prix de revient du bien vendu, ce qui est souvent le cas, comme on le verra plus loin.
Lorsque l'usufruit est viager, le barème fiscal dépend de l'âge de l'usufruitier (CGI art. 669, I). Cet âge est apprécié au jour de la transmission (au jour du décès, de la donation, de la vente, etc.). Pour l'ISF, dans les rares cas où l'imposition est répartie entre usufruitier et nu-propriétaire (par exemple, conjoint survivant devenu veuf avant le 1er juillet 2002 et usufruitier du quart de la succession), l'âge de l'usufruitier s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.
|
Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
|
Moins de 21 ans révolus |
90 % |
10 % |
|
De 21 à 30 ans |
80 % |
20 % |
|
De 31 à 40 ans |
70 % |
30 % |
|
De 41 à 50 ans |
60 % |
40 % |
|
De 51 à 60 ans |
50 % |
50 % |
|
De 61 à 70 ans |
40 % |
60 % |
|
De 71 à 80 ans |
30 % |
70 % |
|
De 81 à 90 ans |
20 % |
80 % |
|
Plus de 90 ans |
10 % |
90 % |
Par exemple, en cas de donation avec réserve d'usufruit d'un appartement d'une valeur de 500 000 € par son propriétaire âgé de 70 ans, les droits de donation seront calculés sur 300 000 € (60 % de la valeur de la pleine propriété de l'appartement).
La valeur d'un usufruit à durée fixe est en principe de 23 % de la valeur de la pleine propriété du bien par période de dix ans, sans fractionnement (CGI art. 669, II). Il faut cependant tenir compte de l'âge de l'usufruitier, la valeur d'un usufruit à durée fixe ne pouvant pas excéder celle d'un usufruit viager (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 no 70).
Par exemple, un usufruit donné pour 13 ans et qui porte sur un studio d'une valeur de 100 000 € en pleine propriété vaut fiscalement 46 000 € (100 000 € × 23 % × 2). Cependant, si l'usufruitier a plus de 60 ans, la valeur fiscale de cet usufruit est plafonnée (à 40 000 € s'il a de 61 à 70 ans, à 30 000 € s'il a de 71 à 80 ans, etc.).
Elle consiste à estimer l'usufruit en fonction des flux de revenus qui seront perçus pendant la durée de l'usufruit. Par exemple, pour un usufruit viager portant sur un immeuble de rapport, il faut :
- déterminer l'espérance de vie de l'usufruitier, à partir de tables de mortalité (celles utilisées par les assureurs, par exemple) dont les données peuvent bien sûr être corrigées pour tenir compte de l'état de santé réel de l'usufruitier ;
- et estimer le rendement attendu de la location de l'immeuble.
L'évaluation économique de l'usufruit n'est évidemment pas une science exacte. Cela dit, il est possible d'utiliser les formules de calcul élaborées par les praticiens. Il en existe de multiples, plus ou moins complexes.
L'évaluation économique peut naturellement être en écart avec le résultat obtenu par application du barème fiscal : ce sera le cas notamment chaque fois que le taux de rendement du bien objet de l'usufruit est supérieur à 3 %.
Un usufruit peut, par convention, être établi successivement au profit de deux personnes différentes. C'est très fréquent dans les donations en nue-propriété : celui qui donne un bien s'en réserve l'usufruit sa vie durant et, à son décès, cet usufruit bénéficiera à une autre personne (son conjoint, le plus souvent) si elle est toujours en vie. Ce n'est qu'à l'expiration de ces usufruits successifs que le nu-propriétaire deviendra plein propriétaire.
La réversion d'usufruit constitue une donation et il s'agit donc en principe d'une opération irrévocable. Par exception, elle reste toujours librement révocable lorsque le bénéficiaire de la réversion est le conjoint survivant.
Les droits dus au moment de la donation de la nue-propriété sont calculés en fonction de l'âge du donateur, comme dans une donation avec réserve d'usufruit classique (CGI art. 669, I, al. 2).
Quand le donateur premier usufruitier meurt et que s'ouvre l'usufruit du second bénéficiaire, ce dernier acquitte les droits de succession dans les conditions ordinaires (CGI art. 796 0-quater). Si le second bénéficiaire est exonéré de droits de succession (cas notamment du conjoint survivant), il n'y a aucun droit à payer.
Si le second bénéficiaire est plus jeune que le premier, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une partie des droits de donation acquittés par lui : celle qu'il aurait payée en moins si ces droits avaient été calculés en fonction de l'âge du second usufruitier (CGI art. 1965 B). Dans le cas inverse où le second usufruitier est plus âgé que le premier, le nu-propriétaire n'a pas à acquitter un complément de droits.
M. Leblanc, 82 ans, est propriétaire d'un appartement d'une valeur de 500 000 € qu'il donne en mai 2015 à son fils avec réserve d'usufruit et réversion d'usufruit au profit de sa femme, âgée de 80 ans. C'est la première donation que le père consent à son fils.
Compte tenu de l'âge de M. Leblanc, les droits de donation sont dus sur 80 % de la valeur de l'immeuble, soit sur 400 000 €. Après application de l'abattement de 100 000 € et du tarif des droits en ligne directe, l'impôt dû s'élève à 58 194 €.
M. Leblanc meurt trois ans plus tard et le second usufruit s'ouvre au profit de sa veuve, qui n'a aucun droit de succession à acquitter.
Leur fils a payé 58 194 € de droits sur la donation. Si sa mère avait été immédiatement usufruitière du bien, il n'aurait acquitté que 48 194 € (il aurait été imposable sur 350 000 €, et non sur 400 000 €). Il peut demander le remboursement de 10 000 €.
L'usufruitier peut donner ou vendre son droit. Il peut aussi y renoncer, ce qui bénéficie naturellement au nu-propriétaire qui recouvre la pleine propriété du bien plus tôt que prévu.
La renonciation emporte donation indirecte, et donc taxation aux droits de donation sur la valeur de l'usufruit, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- la renonciation est faite dans une intention libérale à l'égard du nu-propriétaire. Pour déterminer s'il y a ou non donation, les juges prennent en compte l'ensemble des éléments de fait : liens de parenté ou d'affection entre usufruitier et nu-propriétaire, âge de l'usufruitier, charges de l'usufruit, etc. ;
- le nu-propriétaire entre en jouissance des droits délaissés par l'usufruitier : il perçoit les loyers, conclut ou résilie le bail du locataire, vend des titres du portefeuille, déclare le bien dans sa base taxable à l'ISF, etc. (en ce sens, notamment, Cass. com. 2-12-1997 no 2441 P : RJF 4/98 no 480 ; Cass. com. 21-6-2011 no 10-20.461 : RJF 11/11 no 1240).
Lorsque la renonciation à l'usufruit ne constitue pas une donation, elle n'est pas imposable aux droits de donation. Elle est soumise :
- au droit fixe de 125 € si l'usufruit porte sur un bien autre qu'un immeuble (portefeuille de titres, par exemple) ;
- à la taxe de publicité foncière au taux global de 0,71498 %, à laquelle il convient d'ajouter la contribution de sécurité immobilière de 0,1 % et les frais de notaire, si l'usufruit porte sur un immeuble.
Le barème fiscal qui s'applique depuis le 1er janvier 2004 (fixé à l'article 669 du CGI) donne à l'usufruit une valeur nettement supérieure à celle qui résultait du barème antérieur (celui de l'ancien article 762 du CGI) : 40 % par exemple de la valeur du bien pour un usufruitier âgé de 70 ans, contre 10 % sous l'ancien barème.
Cette réévaluation peut avoir pour conséquence une surtaxation en cas de renonciation à l'usufruit d'un bien dont la nue-propriété a été transmise avant 2004. Pour éviter cette surtaxation, l'administration fiscale admet de plafonner la valeur de l'usufruit déterminée en application du barème de l'article 669 du CGI de telle sorte que la quote-part de la pleine propriété taxée lors de cette deuxième transmission, augmentée de celle ayant servi d'assiette aux droits dus lors de la donation de la nue-propriété, n'excède pas 100 % (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 no 20).
Prenons l'exemple d'un père qui a, en 2003, donné à son fils la nue-propriété d'un bien valant 100 000 € en pleine propriété. Le père était alors âgé de 58 ans. Compte tenu du barème de l'article 762 du CGI alors applicable, les droits de donation ont été calculés sur une base de 100 000 € × 70 % = 70 000 €. En 2015, le père, qui a 70 ans, renonce à l'usufruit au profit de son fils nu-propriétaire. En supposant que la valeur du bien en pleine propriété est alors de 250 000 €, l'assiette des droits s'élève à 250 000 € × 30 % = 75 000 €. Sans le bénéfice de la mesure de correction, l'impôt aurait été calculé, en vertu du nouveau barème, sur une base de 40 % de la valeur en pleine propriété, soit 250 000 € × 40 % = 100 000 €.
La mesure de faveur prévue par l'administration ne s'applique que s'il y a identité de donateur pour la donation de la nue-propriété et pour celle de l'usufruit. Tel n'est pas le cas lorsqu'une veuve renonce à l'usufruit des biens propres de son époux, qui lui avait été réservé par les actes de donation de la nue-propriété de ces biens aux enfants du couple. Dès lors qu'il n'y a pas identité de donateur pour la donation de la nue-propriété (effectuée par l'époux décédé) et pour celle de l'usufruit (consentie par sa veuve), les droits de donation dus sur l'usufruit doivent être calculés en fonction de l'âge de la veuve usufruitière, sans le bénéfice de la mesure administrative de plafonnement (CA Rouen 6-10-2010 no 09-4999 : RJF 2/11 no 243).
Certains biens ne peuvent pas être utilisés sans disparaître : l'argent, une récolte, etc. Sur ces biens, dits « consomptibles » parce que consommés dès leur premier usage, l'usufruitier a des pouvoirs particuliers : il a le droit d'en disposer, à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des biens semblables, soit leur valeur en argent estimée à la date de la restitution (C. civ. art. 587). On parle alors de quasi-usufruit.
Par exemple, la veuve héritière en usufruit peut dépenser comme elle l'entend l'argent qui se trouve dans la succession de son époux (sous la réserve indiquée no 65006). Elle aura en contrepartie l'obligation de restituer une somme équivalente à l'extinction du quasi-usufruit, c'est-à-dire qu'à son décès les enfants nus-propriétaires auront une créance contre sa succession.
Le Code civil n'envisage le quasi-usufruit que pour des biens consomptibles par nature. Mais certains praticiens l'utilisent également pour d'autres biens (dits « non consomptibles »), notamment des parts de société, dans le but d'offrir plus de pouvoirs à l'usufruitier. C'est alors le contrat passé entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui qualifie de consomptibles les parts sociales et organise la répartition des pouvoirs et les modalités de restitution en fin d'usufruit.
Sur le plan fiscal, le quasi-usufruit est assimilé à un usufruit :
- le barème de l'usufruit s'applique au calcul des droits de donation (cas, par exemple, d'une donation de titres avec réserve de quasi-usufruit) ;
- le quasi-usufruitier est imposable à l'ISF sur la valeur de la pleine propriété du bien.
C'est un droit proche de l'usufruit, mais qui donne moins de pouvoirs à son titulaire : celui qui a un droit d'usage et d'habitation peut habiter le logement, seul ou avec sa famille proche, mais pas avec d'autres personnes. Il ne peut pas donner le logement en location. Il ne peut pas non plus vendre ou donner son droit. Un droit d'usage et d'habitation sur le logement de la famille peut par exemple être attribué à titre de prestation compensatoire lors du divorce.
Sur le plan fiscal, le droit d'usage et d'habitation est assimilé à un usufruit pour l'ISF ; le titulaire du droit est donc taxable sur la valeur de la pleine propriété du bien (CGI art. 885 G).
Pour les droits de donation et de succession, l'administration admet une décote de 40 % sur le barème de l'usufruit (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 no 90). Par exemple, si un donataire âgé de 35 ans reçoit les droits viagers d'usage et d'habitation d'un immeuble, ces droits seront évalués à 42 % de la valeur de l'immeuble en pleine propriété.
Pour le calcul des droits d'enregistrement dus en cas d'attribution d'un droit d'usage et d'habitation à titre de prestation compensatoire (droit de partage s'il s'agit d'un bien commun ou indivis entre les ex-époux, taxe de publicité foncière s'il s'agit d'un immeuble propre ou personnel de l'ex-époux débiteur), la décote admise par rapport au barème fiscal de l'usufruit n'est que de 20 % (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-20 no 210). Par exemple, si l'ex-épouse de 45 ans reçoit les droits viagers d'usage et d'habitation du logement familial, ces droits seront évalués à 48 % de la valeur du logement en pleine propriété.
L'usufruitier peut bien sûr librement utiliser le logement pour son propre usage, en tant qu'habitation principale ou résidence secondaire. Mais il ne doit pas porter atteinte à la substance de l'immeuble. L'accord du nu-propriétaire sera par exemple nécessaire pour transformer partiellement le logement en local commercial ou pour réaliser des travaux importants, tel le percement d'un mur porteur.
L'usufruitier peut donner le logement en location à usage d'habitation et percevoir les loyers correspondants. Sauf convention contraire entre les intéressés, le nu-propriétaire n'a pas à donner son accord pour la conclusion d'un bail d'habitation et ne peut pas s'opposer à la location.
Cependant, si le bail consenti par le seul usufruitier est d'une durée supérieure à neuf ans, il est, en cas de cessation de l'usufruit, inopposable au nu-propriétaire pour la durée supérieure à neuf ans (C. civ. art. 595, al. 2). En d'autres termes, le locataire ne pourra pas rester dans les lieux au-delà de neuf ans si le nu-propriétaire souhaite mettre fin au bail.
SavoirLa loi confère au locataire d'habitation des droits très importants (droit de préemption en cas de vente, augmentation limitée du loyer, etc.) qui peuvent se révéler un handicap lorsque le nu-propriétaire deviendra pleinement propriétaire. Il peut dès lors être envisagé de déroger aux règles légales et de prévoir que l'usufruitier ne pourra passer des baux d'habitation qu'avec l'accord préalable du nu-propriétaire, qui sera associé au choix du locataire et à la négociation du bail. Cette dérogation conventionnelle est possible soit au moment de l'acte constitutif du démembrement, soit après, par exemple par le biais d'un mandat.
Sauf s'il en a été convenu autrement avec le nu-propriétaire, c'est l'usufruitier qui doit entretenir le logement (C. civ. art. 605) et s'acquitter des charges annuelles qui, dans l'usage, sont censées constituer les charges des fruits (C. civ. art. 608). Il doit ainsi payer l'entretien de la chaudière, la réfection des peintures, le ravalement, la taxe foncière, etc.
S'il a donné le logement en location, c'est bien sûr le locataire qui s'acquittera des réparations locatives.
La jurisprudence définit les grosses réparations comme celles qui touchent à la structure et à la solidité générale de l'immeuble (Cass. 3e civ. 13-7-2005 no 04-13.764 : BPAT 6/05 inf. 188). Il s'agit par exemple de la réparation des murs porteurs ou de la réfection complète de la toiture.
La loi prévoit que, sauf si elles ont été rendues nécessaires par un défaut d'entretien de l'usufruitier, les grosses réparations incombent au nu-propriétaire (C. civ. art. 605). Mais cette obligation est purement théorique : sauf s'il en a été convenu autrement, le nu-propriétaire n'est pas obligé d'effectuer les travaux et l'usufruitier n'a aucun moyen de l'y contraindre (en ce sens, par exemple : Cass. 1e civ. 28-10-2009 no 07-12.488 : BPAT 6/09 inf. 237 ; Cass. 1e civ. 18-12-2013 no 12-18.537 : BPAT 1/14 inf. 27). L'absence d'obligation pour le nu-propriétaire, sauf convention contraire, d'effectuer les grosses réparations est bien entendu préjudiciable à la bonne conservation de l'immeuble, mais s'explique aussi par le fait que le nu-propriétaire ne touche pas de revenus et peut se trouver dans l'impossibilité de financer ces travaux.
Du fait de l'absence d'obligation à la charge du nu-propriétaire, c'est souvent l'usufruitier qui prend à sa charge les grosses réparations, soit de sa propre initiative, soit parce qu'il a loué le logement et qu'il y est tenu vis-à-vis de son locataire. A l'expiration de l'usufruit, l'usufruitier (en pratique, sa succession) aura une créance contre le nu-propriétaire, qui devra l'indemniser si les travaux effectués ont apporté une plus-value à l'immeuble.
SavoirLes travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés par l'usufruitier d'une propriété ne correspondent pas à des grosses réparations incombant au nu-propriétaire, mais à des dépenses d'amélioration, lesquelles restent à la charge de l'usufruitier qui les a librement décidées (Cass. com. 12-6-2012 no 11-11.424 : BPAT 5/12 inf. 263).
Les solutions légales exposées ci-avant ne sont souvent pas satisfaisantes et peuvent être source de conflits. Il peut dès lors être envisagé de définir conventionnellement la répartition des charges entre les titulaires des droits démembrés.
On peut aussi prévoir, y compris dans l'acte constitutif d'usufruit, que le nu-propriétaire sera obligé d'effectuer un certain nombre de travaux. Est par exemple valable la clause de la donation d'un immeuble avec réserve d'usufruit qui contraint le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations nécessaires (Cass. 1e civ. 23-1-2007 no 06-16.062 : RJDA 8-9/07 no 914). Encore faut-il que la clause ne se contente pas de stipuler que les grosses réparations restent « à la charge » du nu-propriétaire, ce qui ne ferait que reprendre les dispositions légales, mais fasse clairement apparaître l'obligation imposée au nu-propriétaire de procéder au financement des réparations dès qu'elles sont nécessaires sous peine de révocation de la donation ou du droit que se réserve l'usufruitier de le contraindre à s'exécuter.
Il est également possible de mettre les grosses réparations à la charge de l'usufruitier, en prévoyant les modalités d'indemnisation de l'usufruitier par le nu-propriétaire au terme de l'usufruit selon des modalités plus favorables ou non à celles prévues par la loi.
L'usufruitier et le nu-propriétaire sont représentés aux assemblées de copropriétaires par un mandataire commun qui reçoit la convocation et a seul le pouvoir de voter. Ce mandataire peut être l'un d'eux ou un tiers. Il est désigné soit par le règlement de copropriété, soit d'un commun accord par les intéressés, soit par le tribunal.
Le nu-propriétaire n'étant tenu que des dépenses de grosses réparations, c'est l'usufruitier qui doit l'essentiel des charges de copropriété : frais d'ascenseur, eau, chauffage, entretien courant... Certains règlements de copropriété prévoient que l'usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus solidairement de l'ensemble des charges de la copropriété, mais la validité de ce type de clause est discutée.
Lorsque le logement est loué, les loyers reviennent à l'usufruitier, qui est imposable sur les revenus fonciers effectivement encaissés au cours de l'année civile.
L'usufruitier peut déduire des loyers qu'il perçoit l'ensemble des charges foncières qu'il a effectivement payées, qu'il s'agisse de dépenses d'entretien, d'intérêts d'emprunt ou de grosses réparations effectuées sur le logement. Si les charges sont supérieures aux revenus, le déficit foncier constaté est déductible dans les conditions de droit commun : imputation sur le revenu global à hauteur de 10 700 € ; pour le surplus, ainsi que pour la part du déficit relative aux intérêts d'emprunt, imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
AttentionL'administration fiscale considère que l'abandon des loyers par l'usufruitier au nu-propriétaire est sans incidence sur l'imposition de l'usufruitier, qui reste taxable au titre des revenus fonciers, tandis que le nu-propriétaire est imposable sur les mêmes sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-RFPI-BASE-10-10 no 80). Bien que cette solution paraisse discutable en ce qu'elle aboutit à une double taxation des loyers, un tribunal a jugé dans le même sens (TA Strasbourg 2-7-2009 no 06-1713 : RJF 4/10 no 360).
Alors même qu'il n'est pas imposé sur les loyers du logement (et même dans le cas où il est lui-même le locataire de ce logement), le nu-propriétaire peut déduire des revenus fonciers dont il dispose par ailleurs l'ensemble des dépenses foncières qu'il a effectivement supportées au titre du logement loué. S'il ne dispose pas de revenus fonciers, ou si ces derniers sont insuffisants, il constate un déficit foncier déductible dans les conditions de droit commun.
Par dérogation, le nu-propriétaire est autorisé à déduire directement de son revenu global, dans la limite annuelle de 25 000 €, les dépenses de grosses réparations exposées sur le logement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies (CGI art. 156, II, 2o quater) :
- le démembrement porte directement sur l'immeuble, et non sur les parts d'une société qui serait propriétaire du bien ;
- le logement a été démembré à la suite d'une succession ou d'une donation effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (ou entre époux ou partenaires de Pacs). Par exemple, le démembrement résulte d'une donation avec réserve d'usufruit consentie par un père à sa fille, ou d'une succession dans laquelle le conjoint survivant est usufruitier et les enfants nus-propriétaires.
La fraction des dépenses de grosses réparations qui excède 25 000 € peut être déduite du revenu global des dix années suivantes. Par exemple, un nu-propriétaire qui supporte 100 000 € de dépenses au cours d'une année pourra les déduire sur quatre ans (l'année de la dépense et les trois années suivantes) à raison de 25 000 € par an.
Les dépenses supportées par le nu-propriétaire qui n'ont pas le caractère de grosses réparations ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire. Il en est ainsi notamment pour les intérêts d'emprunt (y compris ceux contractés pour financer les dépenses de grosses réparations), qui ne peuvent donc être déduits que dans les conditions de droit commun.
SavoirLe régime dérogatoire de déduction du revenu global des dépenses de grosses réparations exposées par le nu-propriétaire s'applique même si l'immeuble n'est pas loué (logement occupé gratuitement par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire lui-même, notamment).
Lorsque le logement est loué, le nu-propriétaire doit choisir entre les règles de droit commun des revenus fonciers et le régime dérogatoire de déduction du revenu global. L'option pour le régime dérogatoire est irrévocable et entraîne renonciation définitive à la prise en compte des dépenses de grosses réparations pour la détermination des revenus fonciers.
Ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire n'a le pouvoir de vendre seul le logement. Chacun peut seulement céder son propre droit, l'usufruit pour l'usufruitier, la nue-propriété pour le nu-propriétaire. Le juge lui-même n'a pas le pouvoir d'ordonner la vente du bien sans l'accord de l'usufruitier (C. civ. art. 815-5, al. 2).
Lorsque le droit cédé a été acquis isolément, la plus-value correspond à la différence entre le prix de vente du droit et son prix d'acquisition ou, s'il a été acquis à titre gratuit (par donation ou succession), la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Cependant, si le démembrement a pour origine une succession ouverte avant le 1er janvier 2004, la valeur d'acquisition du droit cédé est retraitée à l'aide du barème de l'article 669 du CGI, en retenant l'âge de l'usufruitier au jour de la cession (CGI art. 150 VB, I). Cette règle est destinée à éviter que la réévaluation du barème opérée en 2004 augmente fictivement la plus-value en cas de cession d'usufruit et la minore ou crée une moins-value en cas de cession de la nue-propriété.
Lorsque le bien dont la nue-propriété ou l'usufruit est cédé a été acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix de vente du droit cédé et, d'autre part, de la fraction de la valeur d'acquisition de la pleine propriété afférente à ce droit. Cette fraction est appréciée au jour de la vente à partir du barème de l'article 669 du CGI (CGI ann. II art. 74 SE). La ventilation de l'article 669 du CGI s'impose, que l'acquisition soit intervenue avant ou après le 1er janvier 2004 (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 no 200). Pour l'application du barème, l'âge de l'usufruitier à prendre en compte est celui du vendeur si le droit cédé est la nue-propriété (avec réserve d'un usufruit viager). Ce devrait être celui de l'acquéreur dans le cas, plus rare, où c'est l'usufruit viager qui est cédé.
Le logement peut être vendu conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire à un acheteur qui acquiert ainsi la pleine propriété de l'immeuble. Dans ce cas, et sauf convention contraire, le prix de vente est partagé entre les intéressés au prorata de la valeur de leurs droits respectifs (C. civ. art. 621, al. 1).
Pour le calcul de la plus-value réalisée par chacun des titulaires de droits démembrés, la ventilation du prix de vente peut être effectuée soit en fonction de la valeur réelle des droits cédés par chacun, soit en fonction du barème de l'article 669 du CGI, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente (BOI-RFPI-PVI-20-10-10 no 320). Il est donc possible d'optimiser le calcul en fonction de la situation fiscale de chacun des vendeurs (par exemple, en retenant la ventilation qui accroît la part de l'usufruitier lorsque celui-ci bénéficie de l'exonération attachée à la résidence principale). Quant au prix d'acquisition à retenir, il est déterminé comme indiqué ci-avant no 65065.
La vente du logement peut également intervenir après l'extinction de l'usufruit. Les règles de calcul de la plus-value dépendent alors de la façon dont les droits d'usufruit et de nue-propriété ont été acquis (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 nos 220 et 350). Dans l'hypothèse la plus courante où la nue-propriété a été reçue par donation ou héritage et l'usufruit au décès de l'usufruitier, ces règles sont les suivantes :
- le prix de revient à retenir est la somme des valeurs déclarées de l'usufruit et de la nue-propriété dans l'acte de donation (ou dans la déclaration de succession). Bien que l'usufruit ait en fait été acquis pour une valeur nulle (puisque la réunion de l'usufruit à la nue-propriété s'opère en franchise d'impôt), tout se passe comme si la donation ou l'héritage avait porté sur un bien en pleine propriété. Cette solution est favorable au contribuable puisque, en majorant le prix de revient du bien, elle minore la plus-value réalisée ;
- pour l'application de l'abattement dont bénéficient les biens immobiliers détenus depuis plus de cinq ans (CGI art. 150 VC), le délai de détention est décompté à partir de l'acquisition de la nue-propriété, ce qui est là encore favorable.
En mars 2007, M. Leblanc, alors âgé de 74 ans, a donné à son fils un appartement d'une valeur de 600 000 €, en s'en réservant l'usufruit. Les droits de donation ont été calculés sur la valeur fiscale de la nue-propriété, soit sur 600 000 € × 70 % = 420 000 €.
M. Leblanc est décédé en juillet 2010.
Le fils vend l'appartement en mai 2015 pour 800 000 €.
Calcul de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu :
- prix de vente : 800 000 €
- prix de revient : 600 000 €
- frais d'acquisition (droits de donation, honoraires du notaire et frais d'acte), par hypothèse : 75 000 €
- majoration du prix de revient pour travaux (forfait de 15 %) : 90 000 €
- prix de revient corrigé : 765 000 €
- plus-value brute : 35 000 €
- abattement pour durée de détention au-delà de 5 ans (35 000 € × 3 × 6 %) : 6 300 €
- plus-value imposable : 28 700 €
L'enjeu de la question est important, parce que la qualité d'associé conditionne un certain nombre de droits et d'obligations, par exemple le droit de demander la nomination ou la révocation d'un commissaire aux comptes, de désigner un expert de gestion ou un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.
Il ne fait aucun doute que le nu-propriétaire a la qualité d'associé. La situation de l'usufruitier est en revanche incertaine. La majorité des auteurs estime que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, mais la Cour de cassation n'a jamais vraiment tranché cette question.
La répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire se fait en principe de la façon suivante :
- dans les sociétés par actions (société anonyme, notamment), l'usufruitier a le droit de vote dans les assemblées générales ordinaires et le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires (C. com. art. L 225-110). L'usufruitier aura par exemple qualité pour approuver les comptes de l'exercice, tandis que le nu-propriétaire sera compétent pour se prononcer sur la modification des statuts ;
- dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales (par exemple, société en nom collectif ou société à responsabilité limitée), le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions (C. civ. art. 1844, al. 3).
Les statuts de la société peuvent modifier ces règles pour étendre ou restreindre les droits de vote de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Mais la liberté n'est pas totale.
Il n'est pas possible d'attribuer au nu-propriétaire tous les droits de vote : cela reviendrait à priver l'usufruit de sa substance, puisque l'usufruitier ne pourrait pas voter les décisions concernant l'affectation des bénéfices (Cass. com. 31-3-2004 no 624 FS-PB : RJDA 6/04 no 711).
A l'inverse, les statuts peuvent donner tous les droits de vote à l'usufruitier. Il faut seulement que le nu-propriétaire soit convoqué à toutes les assemblées, même s'il ne vote pas (en ce sens, notamment : Cass. com. 4-1-1994 no 31 : RJDA 5/94 no 526 ; Cass. com. 2-12-2008 no 08-13.185 : RJDA 3/09 no 231). A défaut, les délibérations adoptées seraient nulles.
Les statuts prévoient très souvent la possibilité de se faire représenter aux assemblées par un autre associé (mandat de vote).
L'usufruitier peut toujours donner un tel mandat au nu-propriétaire, qui votera à sa place.
Il est en revanche douteux que le nu-propriétaire puisse donner un mandat de vote à l'usufruitier. D'abord, parce que le nu-propriétaire doit pouvoir participer à toutes les décisions collectives : a ainsi été déclarée nulle la clause des statuts d'une société prévoyant que l'usufruitier représente le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales, en ce qu'elle prive ce dernier de ses droits fondamentaux d'associé (Cass. 2e civ. 13-7-2005 no 1252 FS-PB : RJDA 11/05 no 1224). Ensuite, parce que si l'on adhère à la thèse majoritaire selon laquelle l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, il ne pourra pas recevoir un mandat de vote si ce mandat ne peut être exercé que par un associé. Cette difficulté sera toutefois résolue si l'usufruitier détient au moins une action ou part sociale en pleine propriété, puisqu'il sera alors également associé.
L'usufruitier a droit aux bénéfices distribués de l'exercice, quelle que soit leur origine (résultat d'exploitation ou produits d'opérations exceptionnelles). Il n'a en revanche aucun droit sur les bénéfices encore en instance d'affectation ou sur ceux qui ont été mis en réserve. Si des bénéfices mis en réserve sont ensuite distribués, cette distribution revient en principe au nu-propriétaire, qui doit toutefois permettre à l'usufruitier d'exercer son droit de jouissance. Lorsque la distribution est réalisée, comme c'est généralement le cas, par le versement d'une somme d'argent, l'usufruitier dispose d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée, à charge pour lui (ou ses héritiers) de restituer un montant équivalent à l'expiration de l'usufruit (en ce sens, Cass. com. 27-5-2015 no 14-16.246 : BDP 6/15 inf. 202).
En tout état de cause, les statuts peuvent déroger à ces règles, par exemple pour attribuer au nu-propriétaire les distributions prélevées sur des profits exceptionnels ou prévoir qu'en cas d'utilisation de réserves pour maintenir le niveau d'un dividende les sommes distribuées reviennent au seul usufruitier.
En matière d'impôt sur le revenu, l'usufruitier est imposable sur les dividendes qu'il perçoit lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Il y a dans cette hypothèse corrélation entre les droits aux bénéfices de l'usufruitier et l'impôt auquel il est soumis. L'impôt est établi dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon les règles de droit commun applicables à tout détenteur d'actions (avec notamment le bénéfice de l'abattement de 40 % sur le montant brut des dividendes perçus).
La situation est très différente lorsque la société n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés (société soumise au régime fiscal dit « des sociétés de personnes » ; c'est par exemple le cas d'une société en nom collectif qui n'a pas exercé l'option pour l'impôt sur les sociétés). Dans cette hypothèse :
- l'impôt est dû même si le bénéfice n'est pas effectivement distribué. Sur le plan fiscal, la part de bénéfices devant revenir à chacun est en effet considérée comme acquise dès la clôture de l'exercice ;
- l'usufruitier est imposé sur les résultats courants, tandis que le nu-propriétaire est imposé sur les résultats exceptionnels (plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé notamment). L'impôt est établi dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité exercée par la société (bénéfices industriels et commerciaux, par exemple) ;
- s'il y a un déficit, celui-ci « revient » au nu-propriétaire, et non à l'usufruitier. Telle est du moins l'analyse de l'administration (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 no 150), qui reste à confirmer par les tribunaux.
Il n'est pas possible d'éviter la taxation des bénéfices non distribués réalisés par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Mais il est possible, et même souhaitable, d'organiser la répartition du résultat (et/ou des pertes) entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Cette répartition peut être prévue par les statuts de la société ou par une convention conclue entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Si cette convention est passée avant la clôture de l'exercice, elle sera opposable à l'administration fiscale et la répartition de l'impôt sera donc effectuée sur la base retenue par les intéressés (par exemple, imposition de l'usufruitier sur tous les éléments du bénéfice, y compris les plus-values). Pour éviter les difficultés avec l'administration, il est conseillé de passer la convention par acte notarié ou de la faire enregistrer au service des impôts, même si la jurisprudence admet que la preuve de la date de conclusion de la convention peut être apportée par tous moyens, par exemple par des attestations et documents produits par l'associé (CE 18-12-2002 no 230605 : RJF 3/03 no 328), mais non par de simples lettres dépourvues de date certaine (CE 17-4-2008 no 279274 : RJF 8-9/08 no 977).
Ni l'usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut vendre seul la pleine propriété des titres. Chacun peut seulement céder son propre droit, l'usufruit pour l'usufruitier, la nue-propriété pour le nu-propriétaire.
Lorsque le droit cédé a été acquis isolément, la plus-value correspond à la différence entre le prix de vente du droit et son prix d'acquisition ou, s'il a été acquis à titre gratuit (par donation ou succession), la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (valeur déterminée en fonction du barème fiscal de l'usufruit applicable lors de la mutation).
Lorsque le cédant a détenu la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d'acquisition du droit cédé peut être déterminé, au choix du contribuable, par valorisation économique ou en appliquant le barème fiscal prévu à l'article 669 du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 80). Le calcul est établi en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres et non au jour de l'acquisition des titres par le cédant.
SavoirLorsque la loi ou les statuts imposent l'agrément des associés, il ne fait aucun doute que les opérations portant sur la nue-propriété des titres doivent être agréées : céder la nue-propriété de parts sociales à un tiers revient en effet à lui transférer la qualité d'associé, ce qui justifie le contrôle des autres associés. Dès lors en revanche que l'on considère que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, les clauses d'agrément traditionnelles ne devraient pas s'appliquer à la cession isolée d'un droit d'usufruit. Les équilibres de la société pourraient en être affectés : en effet, les droits de vote de l'usufruitier prévus légalement ou statutairement peuvent être significatifs. Dans les sociétés où domine l'« intuitu personae » (société civile ou société en nom collectif, par exemple), il paraît possible de distinguer l'acquisition de la qualité d'usufruitier (incluant notamment le droit de recevoir le dividende) qui, sauf clause spéciale, ne devrait pas requérir l'agrément, de la possibilité pour l'usufruitier de participer aux décisions collectives qui serait subordonnée à l'agrément des autres associés. Pour éviter toute incertitude, la solution la plus adaptée consiste à prévoir (ou à écarter) l'agrément des usufruitiers par une disposition expresse des statuts.
L'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent procéder à la vente conjointe de leurs droits respectifs à un acheteur unique qui va ainsi acquérir la pleine propriété des titres.
Dans ce cas, et sauf accord contraire des intéressés, le prix de vente est réparti entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, et chacun est imposable séparément sur la plus-value qu'il réalise. Par exemple, si les titres ont été reçus par la veuve en usufruit et par le fils en nue-propriété au décès de leur mari et père, la plus-value réalisée par chacun est calculée par différence entre la fraction du prix de vente qu'il reçoit et la valeur qui a été prise en compte pour le calcul des droits de succession (majorée des frais de succession : droits de succession, honoraires du notaire, frais d'acte et de déclaration).
Une convention entre l'usufruitier et le nu-propriétaire peut prévoir que le prix de la vente conjointe de leurs droits ne sera pas réparti entre eux, mais servira à acquérir d'autres titres sur lesquels l'usufruit sera reporté. Dans ce cas, c'est le nu-propriétaire seul qui sera imposable (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 100). Précisons que le seul fait de déposer le prix de vente sur un compte ouvert au nom de l'usufruitier et des nus-propriétaires n'établit pas le report du démembrement, en l'absence d'acte ayant date certaine le corroborant (CE 30-12-2009 no 307165 : RJF 3/10 no 226). En pratique, pour éviter tout risque de redressement fiscal, l'acquisition des nouveaux titres devra être constatée par un acte notarié qui mentionnera l'origine des fonds et le report du démembrement.
Toujours par convention, il est possible de prévoir que seul l'usufruitier touchera le prix de vente dans le cadre d'un quasi-usufruit. Dans ce cas, c'est l'usufruitier qui sera seul imposable.
Lorsque l'imposition est ainsi établie au nom du seul nu-propriétaire ou du seul usufruitier, il n'est bien sûr calculé qu'une seule plus-value. Lorsque les titres ont été reçus par l'usufruitier et le nu-propriétaire suite au décès de leur titulaire, cette plus-value est égale à la différence entre le prix de vente et la valeur globale des titres retenue pour le calcul des droits de succession, majorée des frais de succession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 120).
Si le nu-propriétaire ou l'usufruitier au nom duquel la plus-value est imposable a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix de revient à retenir est le prix ou la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété des titres, majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date d'acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission du droit (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 150). Si c'est la nue-propriété qui a été transmise lors du démembrement, le prix de revient est égal au prix ou à la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété (PP), majoré de l'accroissement de la valeur de la nue-propriété (NP) constaté entre la date de l'acquisition initiale de la pleine propriété (PP) et la date de transmission de la nue-propriété (NP). Si l'usufruit a été transmis lors du démembrement, le prix de revient est égal au prix ou à la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété (PP), majoré de l'accroissement de la valeur de l'usufruit (US) constaté entre la date de l'acquisition initiale de la pleine propriété (PP) et la date de transmission de l'usufruit (US).
En 2006, M. Lenoir acquiert des titres d'une société pour un prix de 100. En 2012, alors que les titres valent 300, il en donne la nue-propriété à son fils. En 2015, les titres sont cédés à un tiers pour 400. M. Lenoir en perçoit le prix dans le cadre d'un quasi-usufruit. On suppose que M. Lenoir est âgé de 75 ans au moment de la cession (valeur de l'usufruit déterminée par application du barème de l'article 669 du CGI = 30 %).
M. Lenoir est seul imposable sur la plus-value. Celle-ci est calculée de la façon suivante :
Prix de cession de la pleine propriété : 400.
Prix d'acquisition revalorisé : 240, soit 100 valeur de la pleine propriété originelle + 140 correspondant à la revalorisation de la nue-propriété entre la date d'acquisition (70) et la date de la donation (210).
Plus-value (avant abattement pour durée de détention) : 160.
La vente des titres peut également intervenir après l'extinction de l'usufruit. Les règles de calcul de la plus-value dépendent alors de la façon dont les droits d'usufruit et de nue-propriété ont été acquis. Dans l'hypothèse la plus courante où la nue-propriété a été reçue par donation (ou par succession) et l'usufruit au décès de l'usufruitier, il est en principe fait abstraction de la valeur de l'usufruit, celui-ci ayant été reçu pour une valeur nulle. Le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value correspond donc à la valeur de la nue-propriété retenue lors de la donation (ou succession), majorée des droits de donation ou de succession eux-mêmes, des honoraires du notaire et des frais d'acte et de déclaration (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 200).
Par exception, lorsque l'usufruit qui s'éteint avait été transmis à l'usufruitier par donation ou succession en même temps que la nue-propriété au nu-propriétaire, le prix de revient des titres est calculé à partir de la somme des valeurs déclarées pour chacun des droits lors de la donation (ou succession) qui est à l'origine du démembrement de propriété (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 210).
M. Lecoeur décède, laissant notamment des titres dont la valeur en pleine propriété est de 30 000 €. Son épouse, Sophie, âgée de 66 ans, en reçoit l'usufruit (valeur fiscale : 12 000 €) ; sa fille Luce, la nue-propriété (valeur fiscale : 18 000 €). Trois ans plus tard, Sophie décède. Son usufruit rejoint la nue-propriété détenue par Luce. Deux ans plus tard, les titres sont vendus par Luce pour 50 000 €.
La plus-value imposable (avant abattement pour durée de détention) est égale à : 50 000 € (prix de vente de la pleine propriété des titres) - [30 000 € (soit 12 000 € + 18 000 €) + 2 000 € (frais de succession, par hypothèse)] = 18 000 €.
La particularité du portefeuille de titres, souvent hérité en usufruit par le conjoint survivant, est d'être composé de très nombreuses valeurs.
S'agissant des actions, les participations sont souvent infimes et la question du vote aux assemblées et, plus largement, celle du pouvoir dans la société ne se posent pas. Ce qui importe, en dehors bien sûr de la perception des dividendes (qui reviennent à l'usufruitier), c'est la gestion du portefeuille, gestion qui implique des arbitrages et donc la possibilité de vendre et d'acheter des titres. Pour éviter que cette gestion soit paralysée par la nécessité d'une intervention conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier, la Cour de cassation reconnaît à l'usufruitier du portefeuille, et à lui seul, le pouvoir de vendre des titres (Cass. 1e civ. 12-11-1998 no 96-18.041 : Bull. civ. I no 315). Mais ce pouvoir, qui excède très largement ceux d'un usufruitier classique, ne s'exerce pas sans limites.
D'abord, l'usufruitier ne peut pas disposer librement du prix de cession : il a l'obligation de réinvestir cet argent dans le portefeuille. Si l'usufruitier consomme tout ou partie du prix de vente des titres, il commet un abus de jouissance qui peut être sanctionné par la déchéance conformément à l'article 618 du Code civil. A l'extinction de l'usufruit, l'usufruitier ayant l'obligation de restituer le portefeuille, il devra, s'il en a dissipé une partie par sa consommation, restituer non pas le montant des sommes consommées mais la valeur qu'aurait eue le portefeuille en l'absence de ces prélèvements (Cass. 1e civ. 16-6-2011 no 10-17.898 : BRDA 14/11 no 2).
Ensuite, l'usufruitier a l'obligation de conserver la substance du portefeuille. Aucune décision de jurisprudence n'a encore défini cette obligation, mais elle pourrait bien signifier que l'usufruitier doit conserver le profil de gestion initialement choisi pour le portefeuille (sécurité/risque, actions/obligations, etc.).
Enfin, l'usufruitier a l'obligation d'informer le nu-propriétaire : il n'a pas à obtenir son accord pour vendre, mais il doit l'informer des mouvements opérés. Pour éviter les difficultés, il est souhaitable qu'usufruitier et nu-propriétaire prévoient par convention les modalités de cette information (spontanée ou à la demande du nu-propriétaire, régularité, documents à fournir, etc.).
Bien que seul l'usufruitier ait le pouvoir de vendre les titres du portefeuille et que lui seul en perçoive le prix, la personne imposable est normalement le nu-propriétaire.
Par exception, l'administration admet que les plus-values soient taxées au nom de l'usufruitier si ce dernier et le nu-propriétaire ont adressé à la banque une option expresse et irrévocable en ce sens (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 no 180). Cette option pour l'imposition de l'usufruitier n'est cependant possible que lorsque c'est à la suite d'une succession que les titres se sont trouvés démembrés, et uniquement pour les successions ouvertes depuis le 3 juillet 2001.
Quant au calcul de la plus-value, il dépend de la façon dont l'usufruit et la nue-propriété ont été acquis. Lorsque les enfants ont reçu la nue-propriété du portefeuille au décès d'un de leurs parents, le survivant en ayant reçu l'usufruit, le calcul de la plus-value se fait par différence entre le prix de vente et la valeur globale des titres, telle qu'elle a été retenue pour le calcul des droits de succession, majorée des droits de succession eux-mêmes, des honoraires du notaire et des frais d'acte et de déclaration.
Mme Lejeune hérite de l'usufruit du portefeuille de titres de son mari, sa fille Jeanne en recevant la nue-propriété. Le portefeuille comprend des actions de la société Z d'une valeur de 15 000 € au décès, que Mme Lejeune revend 20 000 € quelques années plus tard. Les frais de succession (droits de succession et frais de notaire) correspondant aux titres de la société Z se sont élevés à 1 000 €. La plus-value, qui est imposable au nom de Jeanne sauf option contraire adressée à la banque, est de 20 000 € - (15 000 € + 1 000 €) = 4 000 €.
Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis : le décès d'un conjoint rend le veuf (ou la veuve) usufruitier de la succession, tandis que les enfants reçoivent la nue-propriété.
L'usufruit peut pourtant être volontairement créé dans un but d'optimisation patrimoniale. L'exemple le plus connu est la donation avec réserve d'usufruit, qui permet d'anticiper la transmission du patrimoine avec une fiscalité avantageuse. D'usage moins fréquent, la donation temporaire d'usufruit aux enfants présente également de sérieux atouts fiscaux.
Seule la nue-propriété (évaluée par application du barème fiscal en fonction de l'âge de l'usufruitier) est imposée aux droits de donation. Cette réduction de l'assiette des droits de donation permet de réaliser une économie d'impôt qui est définitive puisque, au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du bien en franchise de droits : il n'est pas taxé sur la valeur de l'usufruit (CGI art. 1133). Il n'en va autrement qu'en cas d'application de la présomption de propriété de l'article 751 du CGI : si celui qui a donné la nue-propriété du bien en s'en réservant l'usufruit meurt dans les trois mois de la donation, le bénéficiaire devra, sauf s'il apporte la preuve que le décès prématuré du donateur était imprévisible au moment de la donation, acquitter les droits de succession sur la valeur de la pleine propriété des biens, comme si la donation n'avait pas eu lieu (les droits payés sur la donation étant quand même déduits de la facture...).
Le 1er février 2015, Mme Lerouge, âgée de 75 ans, consent à son fils Arthur une donation avec réserve d'usufruit portant sur des titres d'une société civile familiale d'une valeur de 260 000 € en pleine propriété. C'est la première donation que la mère fait à son fils.
Compte tenu de l'âge de Mme Lerouge, la nue-propriété donnée est évaluée à 70 % de la valeur des titres, soit 182 000 €. Après abattement de 100 000 € applicable entre parents et enfants, les droits sont dus sur 82 000 €.
Droits dus : 14 594 €.
Au décès de Mme Lerouge (intervenant par hypothèse plus de trois mois après la donation), l'usufruit s'éteint et son fils Arthur récupère la pleine propriété des titres en franchise d'impôt.
Soit un taux global d'imposition de 5,6 % (14 594 € ÷ 260 000 €), alors qu'une donation en pleine propriété aurait rendu exigibles des droits de 30 194 €, soit un taux d'imposition de 11,6 %.
Lorsque la transmission porte sur les parts d'une société qui réalise des bénéfices, la donation avec réserve d'usufruit peut avantageusement être combinée avec la mise en réserve des bénéfices sociaux.
Reprenons l'exemple précédent (no 65203) en supposant que la société civile familiale réalise chaque année 10 000 € de bénéfices. Chaque année, Mme Lerouge, devenue usufruitière, vote l'affectation de ces bénéfices en réserve. Au décès de Mme Lerouge, son fils Arthur récupérera en franchise d'impôt la pleine propriété de titres dont la valeur se sera accrue du montant des réserves. Ainsi, si le décès de Mme Lerouge intervient dix ans après la donation, la valeur des titres aura augmenté de 100 000 € et le taux global d'imposition de la transmission se trouvera réduit à 4 % (14 594 € ÷ 360 000 €).
Précisons que si l'administration fiscale tente parfois de requalifier en donation indirecte - taxable aux droits de donation - la mise en réserve des bénéfices, cette position est clairement condamnée par la Cour de cassation. Jugé que les bénéfices réalisés par la société n'ayant la nature de fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé, il s'ensuit qu'avant cette attribution l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve il ne consent aucune donation au nu-propriétaire (Cass. com. 10-2-2009 no 07-21.806 : RJF 5/09 no 514 ; Cass. com. 31-3-2009 no 08-14.053 : RJF 7/09 no 698).
L'allongement de la durée des études supérieures et l'arrivée de plus en plus tardive des étudiants sur le marché du travail conduisent fréquemment les parents à apporter une aide financière à leurs enfants majeurs.
Le plus souvent, cette aide revêt la forme d'une pension alimentaire. Selon les cas, les parents auront intérêt à rattacher l'enfant à leur foyer fiscal (s'il est rattachable, par exemple parce qu'il poursuit des études et a moins de 25 ans), ou au contraire à le détacher et à déduire la pension de leurs revenus imposables en contrepartie de la perte de la majoration du quotient familial.
Une technique plus sophistiquée, plus lourde aussi de conséquences, mais nettement plus avantageuse au plan fiscal, a été imaginée par la pratique : la donation d'usufruit temporaire d'un bien de rapport. Plutôt que de verser une pension, les parents transfèrent à leurs enfants le droit aux revenus produits par le bien le temps qu'ils terminent leurs études et s'installent dans la vie professionnelle.
Sur un plan patrimonial, la donation temporaire d'usufruit permet bien sûr une plus grande autonomie financière et une responsabilisation des enfants bénéficiaires de la donation. Mais son principal avantage est de permettre aux parents de réaliser de substantielles économies d'impôt.
On rappelle qu'en matière d'ISF c'est en principe l'usufruitier qui est imposable sur la valeur du bien en toute propriété (CGI art. 885 G). Corrélativement, le nu-propriétaire n'a rien à déclarer au titre de l'ISF (BOI-PAT-ISF-30-20-20 no 10).
Dès lors, la donation de l'usufruit d'un bien à des enfants majeurs a pour effet de diminuer la valeur taxable du patrimoine des parents, et donc l'impôt dû par eux (cet effet « en base » peut se doubler d'un effet « plafonnement » lorsque la réduction des revenus des parents leur permet d'actionner le mécanisme du plafonnement de l'ISF prévu à l'article 885 V bis du CGI).
Quant aux enfants, ils ne seront pas soumis à l'ISF si la valeur des biens dont l'usufruit leur est transmis, ajoutée à celle des biens déjà possédés par eux, est inférieure au seuil d'imposition.
M. Lenoir est à la tête d'un patrimoine d'une valeur nette globale de 2 000 000 €, incluant un immeuble d'une valeur de 250 000 € qui rapporte 15 000 € de revenus bruts fonciers par an. La donation temporaire de l'usufruit de cet immeuble à son fils majeur permettra à M. Lenoir de réaliser chaque année une économie d'ISF de : 250 000 € × 0,70 % = 1 750 €, voire une économie supérieure si la baisse de ses revenus fonciers lui permet de bénéficier du plafonnement de son ISF.
S'agissant de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, les enfants deviennent personnellement imposables à raison des revenus du bien transmis en usufruit, à condition qu'ils aient été préalablement détachés du foyer fiscal du donateur. Les parents perdent évidemment la majoration du quotient familial, mais voient en contrepartie leurs revenus imposables diminuer. Or, en raison, d'une part, du plafonnement des effets du quotient familial et, d'autre part, du fait que les donataires sont, par hypothèse, imposés dans une tranche d'imposition plus faible que leurs parents, la charge fiscale s'en trouve allégée pour le groupe familial. Il y aura également économie fiscale lorsque la donation temporaire viendra prendre le relais du versement à un enfant majeur d'une pension alimentaire excédant le plafond de déduction fiscale, si les revenus du bien dont l'usufruit est donné excèdent ce plafond.
Reprise de l'exemple précédent (no 65211), en supposant que M. Lenoir est imposable au taux marginal de 41 % et que les revenus fonciers qu'il tire de l'immeuble sont soumis au régime du micro-foncier. Il est fait abstraction dans l'exemple des prélèvements sociaux.
Si M. Lenoir affecte ses 15 000 € de revenus bruts fonciers au versement d'une pension alimentaire à son enfant majeur, il sera imposé sur 10 500 € (après l'abattement forfaitaire de 30 %) et pourra déduire au titre de la pension alimentaire une somme plafonnée à 5 726 €. Coût fiscal : 41 % × (10 500 € - 5 726 €) = 1 957 €.
La donation temporaire de l'usufruit de l'immeuble permettra à M. Lenoir d'économiser ces 1 957 €.
Quant à l'enfant bénéficiaire de la donation d'usufruit, il sera imposable sur 10 500 € (après l'abattement de 30 %), au lieu de 5 153 € (montant déductible de la pension, diminué de la déduction de 10 %). Mais s'il n'a pas d'autres revenus, son impôt restera égal à zéro.
La donation temporaire d'usufruit est peu coûteuse en termes de droits de donation. Lorsque le démembrement est organisé pour dix ans ou moins, la donation faite par chaque parent à chaque enfant peut porter sur des biens d'une valeur en pleine propriété allant jusqu'à 434 782 € en franchise de droits, compte tenu du barème de l'usufruit à durée fixe (23 % de la pleine propriété pour chaque période de dix ans) et de l'abattement de 100 000 € en ligne directe (car 434 782 × 23 % - 100 000 = 0), pour autant bien sûr que cet abattement n'ait pas déjà été utilisé au cours des quinze dernières années.
Ajoutons cependant que, lorsque l'usufruit porte sur un immeuble, la donation devra être publiée au service de la publicité foncière. La taxe de publicité foncière sera due sur la valeur de l'usufruit transféré, ainsi que la contribution de sécurité immobilière et les frais de notaire.
Reprise de l'exemple précédent (no 65211). La donation temporaire d'usufruit est effectuée en mai 2015 pour une durée de 8 ans.
Valeur de l'usufruit : 57 500 € (soit 250 000 € × 23 %).
Base taxable : 0 € (après application de l'abattement).
Droits dus : 0 €.
Frais (taxe de publicité foncière, contribution de sécurité immobilière et émoluments du notaire) : environ 2 000 €.
Compte tenu de son intérêt fiscal, l'administration voit la donation temporaire d'usufruit d'un mauvais oeil. Lorsqu'elle estime que la transmission est fictive ou a pour but exclusif d'éluder l'impôt, notamment dans l'hypothèse d'une transmission au profit de descendants, elle se réserve le droit de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit pour restituer à l'opération son véritable caractère (LPF art. L 64).
Toutefois, les risques de remise en cause sur ce fondement d'une donation temporaire d'usufruit portant sur un bien productif de revenus nous paraissent limités.
Sur le terrain de la fictivité, on voit mal comment l'administration pourrait contester le transfert de revenus organisé par la donation d'usufruit, à condition bien sûr que les parents ne se réapproprient pas (directement ou indirectement) lesdits revenus. Comme pour toute donation, il faut que l'intention libérale existe et que le dépouillement du donateur soit irrévocable.
Le souhait des parents de responsabiliser leurs enfants majeurs en leur attribuant une source autonome de revenus susceptible d'assurer leur logement et/ou leur entretien courant constitue par ailleurs selon nous un argument suffisant pour écarter le critère de l'exclusivisme fiscal.
L'administration a précisé qu'une transmission temporaire d'usufruit n'est pas susceptible de donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit lorsqu'elle est opérée au profit d'un organisme d'intérêt général (association reconnue d'utilité publique, notamment) et satisfait à certaines conditions cumulatives (BOI-PAT-ISF-30-20-20 no 200). Par précaution, il peut être utile de suivre les « recommandations » exprimées par cette doctrine (ne sont bien sûr retenues ici que celles qui sont transposables aux donations temporaires d'usufruit de parents à enfants) :
- passer la donation par acte notarié (forme qui s'impose en tout état de cause si la donation porte sur l'usufruit d'un immeuble, et qui est fortement recommandée dans les autres cas) ;
- effectuer la donation pour une durée d'au moins trois ans ;
- ne pas priver l'enfant usufruitier de ses droits. En particulier, tous les revenus du bien doivent lui être attribués. Pour ce qui est de ses pouvoirs sur le bien, l'administration admet qu'il ne les exerce pas tous (gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, signature des baux, etc.). Il doit alors donner pouvoir spécial à un mandataire (qui peut être le donateur nu-propriétaire) pour les exercer en son nom. Ce mandataire doit lui rendre compte chaque année (nature et justifications des arbitrages auxquels a donné lieu le portefeuille de valeurs considéré, évolution des loyers, etc.).
La donation peut porter sur toute espèce de bien productif de revenus. Le plus souvent, il s'agira d'un immeuble de rapport, qui présente l'avantage de produire des revenus réguliers.
La donation temporaire de l'usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières, notamment d'actions cotées (ou de Sicav actions), peut également être envisagée. Si les parents ne souhaitent pas abandonner aux enfants la gestion du portefeuille (laquelle revient de droit à l'usufruitier), la donation peut être subordonnée à la conclusion d'un mandat de gestion au profit du donateur ou d'un professionnel. Pour plus de sécurité, il sera prévu dans l'acte que la donation sera rétroactivement annulée en cas de révocation du mandat par les enfants. Pour limiter le risque de remise en cause de la donation sur le terrain de l'abus de droit, le nu-propriétaire devra rendre compte chaque année de sa gestion.
Tout enfant né depuis le 1er janvier 2005 peut recevoir, au choix de ses parents, le nom de son père, celui de sa mère ou les noms de ses deux parents accolés dans l'ordre retenu par eux (C. civ. art. 311-21). Deux réserves toutefois :
- en cas de choix des deux noms accolés, lorsque le père (ou la mère) a lui-même un nom composé (Rougon-Macquart, par exemple), il ne peut transmettre qu'un seul nom (Rougon ou Macquart, dans notre exemple). L'objectif est d'éviter les noms à rallonge ;
- le nom choisi pour le premier enfant devra être donné aux autres enfants communs du couple, tous les enfants d'une même fratrie devant porter le même nom de famille.
Lorsque les parents choisissent de donner à leur enfant leurs deux noms accolés, les noms sont séparés par un simple espace dans les actes d'état civil et dans le livret de famille. Pour les distinguer des noms composés, les deux parties du nom sont indiquées entre parenthèses. Par exemple, dans l'acte de naissance de l'enfant qui porte le double nom Dupont Durand, il est indiqué : « nom de famille : Dupont Durand (1e partie : Dupont, 2de partie : Durand) ».
En cas de filiation par le sang, le choix du nom des enfants de parents mariés se fait à la mairie, par déclaration conjointe remise à l'officier de l'état civil chargé de la déclaration de naissance (imprimé cerfa no 15286*01). Cette déclaration écrite comporte les prénoms, nom, date et lieu de naissance et domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi pour l'enfant, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance. En l'absence de déclaration, l'enfant porte le nom de son seul père. En cas de désaccord des parents sur le choix du nom, signalé par l'un ou l'autre des parents à l'officier d'état civil au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement de la filiation, l'enfant se voit attribuer leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique (C. civ. art. 311-21).
Les mêmes règles sont applicables aux enfants de parents non mariés lorsque les deux parents ont reconnu l'enfant en même temps. Si l'un des parents a reconnu l'enfant en premier, il donne son nom à l'enfant, sauf désaccord exprimé par l'autre parent auprès de l'officier d'état civil au plus tard le jour de la déclaration de naissance, auquel cas l'enfant porte les deux noms accolés des parents selon l'ordre alphabétique.
Si seul l'un des parents a reconnu l'enfant, celui-ci porte son nom (C. civ. art. 311-23). En l'absence de reconnaissance prénatale, l'enfant porte le nom de son père si celui-ci le reconnaît lors de la déclaration de naissance (y compris selon nous si la mère est désignée dans l'acte de naissance) ; dans le cas contraire, c'est le nom de sa mère qui lui est transmis puisque la seule mention de son nom sur l'acte de naissance de l'enfant vaut reconnaissance.
Si pendant sa minorité l'enfant est ensuite reconnu par l'autre parent, le père et la mère peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, substituer au nom de l'enfant celui du parent qui l'a reconnu en second ou accoler leurs deux noms dans l'ordre qu'ils ont choisi. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement (Décret 2004-1159 du 29-10-2004 art. 10, al. 3). Tous les enfants nés du même lit devant porter le même nom, le refus de l'enfant interdit à notre avis aux parents de changer le nom de leurs autres enfants, même s'ils ont moins de 13 ans.
L'adoption plénière (prononcée depuis le 1er janvier 2005) confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les parents adoptifs choisissent, par déclaration conjointe, le nom que portera l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils définissent, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Lorsque les adoptants ou l'un d'eux portent un double nom, ils peuvent, par déclaration conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté (C. civ. art. 357). En l'absence de déclaration conjointe ou en cas de désaccord, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique.
En cas d'adoption plénière par un seul époux, l'enfant porte le nom de cet époux (C. civ. art. 357).
En cas d'adoption simple (prononcée depuis le 1er janvier 2005) par une seule personne, le nom de l'adoptant est en principe ajouté à celui de l'adopté, qu'il peut précéder ou suivre (C. civ. art. 363 et Cass. 1e civ. 6-10-2010 no 09-15.092 : BPAT 6/10 inf. 330). L'ensemble ainsi formé constitue un nom composé, donc insécable à la génération suivante (Circ. 29-5-2013 JUSC1312445C : BOMJ 2013-05 du 31-5-2013 art. 4.2.2.2). Si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. A défaut, il conserve son nom.
Lorsque l'adopté et l'adoptant ou l'un d'eux portent un nom double, l'adoptant choisit lequel de ses deux noms il ajoute à celui de l'adopté et/ou celui des noms de l'adopté qu'il conserve ainsi que l'ordre des noms. Ce choix est subordonné à l'accord de l'adopté s'il a plus de 13 ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l'adopté est constitué du premier nom de l'adopté suivi du premier nom de l'adoptant. L'adoptant peut demander au tribunal une substitution pure et simple de son nom à celui de l'adopté, sous réserve de l'accord de ce dernier s'il a plus de 13 ans.
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, l'adoptant peut demander que l'adopté conserve son nom d'origine.
Si l'adoption simple est faite par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un seul nom. Si l'adopté porte un double nom, il n'en conserve qu'un. Le choix du nom conservé ainsi que l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, avec le consentement de l'adopté s'il a plus de 13 ans. A défaut d'accord, le nom de l'adopté est constitué de son premier nom suivi de celui du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique. Les adoptants peuvent demander au tribunal que soit substitué au nom de l'adopté soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le consentement de l'adopté est requis s'il a plus de 13 ans (C. civ. art. 363).
Chacun d'entre nous a pour seul nom légal son nom de famille. Il est cependant possible de porter un nom d'usage :
- toute personne mariée peut substituer ou ajouter à son propre nom (dans l'ordre qu'elle choisit) celui de son conjoint (C. civ. art. 225-1) ;
- toute personne peut ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis (Loi 85-1372 du 23-12-1985 art. 43) ; le plus souvent, ce sera celui de sa mère. A l'égard des enfants mineurs, l'adjonction du nom d'usage suppose un accord des parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. A défaut d'accord, seul le juge peut autoriser l'adjonction.
Le nom d'usage peut être mentionné sur les documents administratifs tels que la carte d'identité ou le passeport. Pour cela, l'intéressé doit produire les justificatifs suivants :
- un extrait d'acte de naissance avec filiation pour l'usage du nom de son parent ;
- un extrait d'acte de naissance portant indication du mariage ou le livret de famille pour l'usage du nom de son conjoint.
En revanche, le nom d'usage ne peut ni figurer sur les actes d'état civil ni être transmis comme nom de famille.
En principe, non. Sauf modification de sa situation familiale (par exemple, en cas d'adoption), il n'est pas possible de changer de nom de famille. Ce principe n'est cependant pas absolu et il existe trois procédures destinées à permettre de changer de nom.
Il est possible de faire « rectifier son état civil » s'il y a eu une erreur de transcription sur les registres (nom mal orthographié, lettres manquantes, etc.). Certaines personnes tentent - le plus souvent en vain - d'obtenir par cette voie la restitution de particules familiales qui n'ont plus été utilisées depuis la Révolution.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (C. civ. art. 61). En pratique, les principaux motifs admis pour changer de nom sont :
- l'abandon d'un nom grotesque ou ridicule. Par exemple : Cocu, Crétin, Cochon, Pucelle, Saligaut, ou encore Barjot pour un psychiatre ou Cimetière pour un employé des pompes funèbres ;
- l'abandon d'un nom odieux ou déshonoré (Hitler, Landru...), ou encore à consonance étrangère ;
- la volonté de faire consacrer un pseudonyme sous lequel une certaine notoriété a été acquise (ainsi l'écrivain Jules Romains, de son vrai nom Louis Farigoule) ;
- le désir de porter un nom auquel on est attaché affectivement (ce peut être le cas d'une personne ayant été élevée par un parent dont elle ne porte pas le nom) ;
- le fait de pouvoir justifier d'une possession constante du nom que l'on souhaite adopter, surtout quand cette possession remonte à une époque antérieure à la Révolution française. Les tribunaux exigent que la possession soit paisible, publique, non équivoque et loyale. S'agissant des Orléans, les juges ont refusé au fils aîné du comte de Paris la possibilité de prendre le nom de Bourbon car le choix inverse avait été fait par le fils cadet de Louis XIII, choix confirmé par Louis-Philippe lorsqu'il accéda au trône.
Ne constitue pas un intérêt légitime justifiant un changement de nom :
- une demande fondée sur la seule vanité (ce qui est souvent le cas des « chasseurs de particule ») ;
- le souhait de dissimuler un passé criminel.
La procédure à suivre pour demander à changer de nom est la suivante (Décret 94-52 du 20-1-1994). Le candidat au changement de nom doit d'abord procéder à la publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales d'une annonce comportant son identité, son adresse, celles de ses enfants mineurs s'ils sont concernés et le ou les noms demandés.
Ensuite, l'intéressé adresse sa demande au ministre de la justice. La demande doit indiquer les motifs justifiant le changement, le nom sollicité (il ne peut pas s'agir de celui du conjoint) et, si plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence.
Si le changement de nom est accordé, il donne lieu à la publication d'un décret au Journal officiel. Cette publication fait courir un délai de deux mois pendant lequel toute personne intéressée (notamment celui ou celle qui porterait le même nom que celui attribué par le décret) peut notifier au Conseil d'Etat son opposition au changement de nom.
A l'expiration du délai de deux mois et en l'absence d'opposition (ou, s'il y a eu opposition, en cas de rejet de celle-ci), le décret devient définitif. Le procureur de la République du lieu de naissance de l'intéressé, à la demande de ce dernier ou du service du Sceau (ministère de la justice), procède alors aux rectifications nécessaires sur les actes d'état civil (naissance, mariage) du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs. Le changement de nom bénéficie automatiquement aux enfants du demandeur ayant moins de 13 ans (C. civ. art. 61-2). Si les enfants mineurs ont plus de 13 ans, ils doivent donner leur accord au changement de nom pour pouvoir en bénéficier (C. civ. art. 61-3). Quant aux enfants majeurs, ils sont en principe exclus du bénéfice du changement s'ils ne l'ont pas eux-mêmes demandé.
En cas d'opposition au changement de nom, le Conseil d'Etat apprécie les intérêts en cause. Ainsi, à propos de l'attribution du nom « d'Artagnan », le Conseil d'Etat a rejeté l'opposition formée par M. de Montesquiou Fezensac appartenant à la famille Montesquiou Fezensac d'Artagnan Montluc au motif que le changement de nom ne lui causait aucun préjudice commercial et surtout que le patronyme avait été porté par la grand-mère maternelle du requérant.
Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom (Loi 72-964 du 25-10-1972 art. 1). Seule condition : que ce nom, par son apparence, sa consonance ou son caractère étranger soit susceptible de gêner l'intégration de l'intéressé dans la communauté française.
Concrètement, le nom d'origine est soit traduit en français, soit modifié de telle manière qu'il perde son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Par exemple, « Alademiroglu » a été modifié en « Admir » ou « Jeyakumar » en « Jacmart ».
La requête peut être présentée soit en même temps que la demande de nationalité française (naturalisation, réintégration ou déclaration d'acquisition), soit dans l'année de son attribution (Loi 72-964 du 25-10-1972 art. 8). Si la demande est accordée, elle fait l'objet d'un décret publié au Journal officiel.
Le décret ne devient définitif qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa publication en l'absence d'opposition effectuée dans ce délai ou, si une telle opposition a été formée, après son rejet.
C'est à la demande du procureur de la République du domicile du demandeur que les actes d'état civil de ce dernier seront modifiés en conséquence.
Il s'agit d'assurer la survie du nom de famille (on parle de « relèvement » de nom) d'une victime civile ou militaire de la guerre, décédée sans enfant et qui était le dernier représentant d'une famille dans l'ordre de la descendance (peu importe que la victime laisse un parent, un grand-parent ou un oncle ; en revanche, l'existence d'un cousin germain ou d'un neveu portant le même nom empêchera cette procédure).
Le droit de relever le nom n'appartient qu'aux héritiers jusqu'au 6e degré, déjà conçus (c'est-à-dire nés ou en gestation) au décès de la victime (Loi du 2-7-1923 art. 1). L'un d'eux peut avoir été désigné par le testament du défunt (Loi du 2-7-1923 art. 4). En l'absence de testament, la demande doit émaner du plus proche des successibles du défunt. Si plusieurs parents du même degré demandent à relever le nom, le juge choisira l'un d'eux.
SavoirLa demande en relèvement de nom doit être faite auprès du tribunal de grande instance du lieu où était domicilié le défunt, dans les cinq années suivant l'acte de décès. Si elle est accordée, l'intéressé est autorisé à ajouter le nom du défunt à son nom d'origine mais pas à le substituer.
Les parents doivent indiquer le ou les prénoms choisis pour leur enfant au moment où ils déclarent la naissance. L'officier d'état civil les inscrit dans l'acte de naissance.
Le prénom d'usage de l'enfant n'est pas forcément le premier déclaré.
En principe, les parents sont libres de choisir n'importe quel prénom (C. civ. art. 57, al. 2). L'officier d'état civil ne peut pas refuser d'inscrire le ou les prénoms choisis. Cependant, si l'un d'eux, seul ou associé au nom, paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil en informe sans délai le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom est, par exemple, ridicule, il ordonne qu'il soit supprimé. Peu importe qu'il ait déjà été porté par d'autres enfants (Cass. 1e civ. 15-2-2012 nos 10-27.512 et Cass. 1e civ.11-19.963 : Bull. civ. I no 32). Il en va de même si le prénom porte atteinte aux droits des tiers, par exemple s'il reprend une marque connue. Les parents doivent alors choisir un autre prénom. A défaut, c'est le juge lui-même qui en choisit un (C. civ. art. 57, al. 4).
Il entre évidemment une certaine subjectivité dans l'appréciation par les juges des prénoms qui pourront être admis ou refusés. Ont par exemple été admis Soleil, Tokalie ou Zébulon, mais non Titeuf, Babar (pour une petite fille) ni MJ (pour un petit garçon). Cerise est un classique mais Fraise a été refusé...
A condition de justifier d'un intérêt légitime, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en changement, adjonction, suppression ou modification de l'ordre de ses prénoms (C. civ. art. 60).
Ont par exemple été admis :
- l'adjonction de Karim à Nicolas pour que l'enfant s'intègre facilement dans son environnement familial ;
- la suppression de Georgette au profit de Lydia, ce prénom ayant toujours été le seul utilisé par les proches de l'intéressée depuis son enfance ;
- le changement de Brigitte en Lethicia, au motif qu'une décision du ministère de l'intérieur israélien avait autorisé la jeune femme (qui avait la double nationalité française et israélienne) à changer de prénom.
Ont en revanche été refusés :
- le changement de Grâce Marie en Miriam, demandé pour des raisons religieuses. Les juges ont estimé que, contrairement à ce que soutenait la jeune femme, le port d'un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion hébraïque, ni de revenir à ses racines ;
- la reprise par une femme de son prénom d'origine Malika alors qu'elle avait accepté de franciser celui-ci en Louise cinq mois plus tôt dans le cadre de la procédure l'ayant naturalisée française ; les juges ont considéré que l'usage de son prénom français ne l'avait ni coupée de sa famille ni empêchée de pratiquer sa religion.
L'enfant mineur dispose de certains droits. Il peut par exemple hériter, recevoir une donation, être indemnisé si un tiers lui cause un préjudice, etc.
Mais en principe, sauf s'il a été émancipé, le mineur ne peut pas agir seul (C. civ. art. 1124). Il lui faut être représenté par ses parents ou par l'un d'entre eux, ou exceptionnellement par un tiers. Ce sont les représentants du mineur qui doivent agir en son nom. Un mineur ne peut donc pas accepter lui-même une succession ou une donation (cette acceptation serait nulle), souscrire un contrat de téléphonie mobile (le contrat serait nul) ou attaquer en justice le tiers qui lui a causé un préjudice (la demande serait irrecevable).
Par exception, un mineur d'au moins 16 ans peut être autorisé par ses parents à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou d'une société unipersonnelle (C. civ. art. 389-8 et C. civ.401, der. al.). En outre, en fonction de l'âge du mineur, de la nature de l'acte et des montants en jeu, il existe des tolérances. On imagine mal un commerçant refuser de vendre de la nourriture, des DVD ou des livres à un jeune non accompagné de ses parents !
Dans tout procès qui le concerne, un mineur capable de discernement peut, quel que soit son âge, être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Celui-ci peut aussi demander à bénéficier d'un avocat à titre personnel.
Un mineur peut ouvrir seul un livret (livret de caisse d'épargne, par exemple). S'il a moins de 16 ans, il ne peut effectuer aucun retrait sans l'accord de son représentant légal (un seul de ses parents suffit). A partir de 16 ans, il peut retirer seul de l'argent, sauf opposition de son représentant (C. mon. fin. art. L 221-3).
L'ouverture d'un compte bancaire (compte courant, compte-titres, etc.) au nom de l'enfant ne peut en principe être faite que par son représentant légal. Ce dernier peut également autoriser qu'il lui soit délivré une carte de retrait (mais non une carte de paiement). Il pourra par conséquent retirer de l'argent dans les distributeurs de sa banque, dans la limite du solde positif de son compte et du montant autorisé par son représentant légal.
Dès 14 ans, les enfants peuvent :
- effectuer des stages d'observation, d'information ou de découverte. Une convention de stage doit être passée entre l'établissement scolaire et l'entreprise d'accueil ;
- occuper un emploi salarié pendant les vacances scolaires sous certaines conditions. Notamment, les vacances doivent être d'une durée d'au moins deux semaines ; l'emploi ne doit pas durer plus de la moitié des congés ; l'accord écrit des parents est nécessaire.
A l'âge de 15 ans, ils peuvent entrer en apprentissage.
A partir de 16 ans, âge à partir duquel la scolarité n'est plus obligatoire, les enfants peuvent travailler, sous réserve de l'accord écrit de leurs parents.
Les jeunes sont rémunérés au minimum sur la base du Smic minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. L'abattement est supprimé pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. En principe, ils ne peuvent pas percevoir leurs salaires sans autorisation de leurs parents. En pratique, on admet que le défaut d'opposition formelle vaut acceptation.
Sauf dérogation pour des besoins de formation, il est interdit d'affecter des adolescents à des travaux dangereux ou pénibles.
En matière d'impôt sur le revenu, l'enfant mineur est en principe rattaché au foyer fiscal de ses parents. S'il gagne sa vie, il est cependant possible de demander son imposition distincte.
Sur les modalités d'imposition des salaires perçus par l'enfant au titre des emplois occupés pendant les vacances scolaires ou l'année scolaire ou universitaire, voir no 67189.
Le recensement est obligatoire pour les garçons comme pour les filles. Il doit en principe être effectué dans les trois mois du jour où le jeune atteint 16 ans. Si ce délai est dépassé, il est toutefois possible de procéder à cette formalité jusqu'à 25 ans (C. du service national art. L 113-1, C. du service nationalL 113-4, C. du service nationalR 111-1).
Dans certaines communes, le recensement peut être effectué par Internet. A défaut, le jeune doit se présenter à la mairie de son domicile (au consulat ou à l'ambassade de France s'il réside à l'étranger) muni d'une pièce d'identité, du livret de famille et, le cas échéant, d'un document prouvant sa nationalité française.
Le maire délivre alors une attestation de recensement indispensable pour présenter un concours ou un examen soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat, etc.) avant l'âge de 25 ans. Si le recensement est fait par Internet, soit l'attestation se trouve dans le porte-document du compte personnel sur mon.service-public.fr. (elle peut alors être imprimée autant de fois que nécessaire), soit elle est envoyée par courrier.
En cas de perte ou de vol de l'attestation, la mairie ne délivre pas de duplicata, mais il est possible d'obtenir un justificatif de recensement auprès du bureau du service national dont dépend l'intéressé.
Après le recensement et jusqu'à 25 ans, le jeune doit signaler au bureau du service national dont il dépend tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois, de situation familiale ou professionnelle (C. du service national art. L 113-7).
Sur le plan civil, l'enfant mineur n'est en pratique pas responsable de ses actes. Ce sont ses parents qui doivent en assumer les conséquences. Ainsi ces derniers seront-ils tenus d'indemniser le camarade malencontreusement blessé par leur fils ou de payer la note de téléphone qui a doublé depuis que leur fille appelle son petit ami en Angleterre.
Titulaires de l'autorité parentale, les parents ont l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité de leurs enfants mineurs. Ils sont aussi tenus de pourvoir à leur entretien et à leur éducation (C. civ. art. 385). A ce titre, les parents doivent subvenir à tous les besoins de leurs enfants : nourriture, habillement, logement, frais médicaux, frais de scolarité, dépenses liées aux loisirs et aux activités sportives, vacances, etc. On verra plus loin que l'obligation d'entretien ne s'arrête pas avec les 18 ans de l'enfant.
Les parents disposent de certains droits. Ils décident de l'orientation scolaire de leurs enfants, de leur lieu de vie, de leurs activités extra-scolaires, de leur éducation religieuse, etc. Ils autorisent ou non leur sortie du territoire français, la mise en place de traitements médicaux, etc.
Les parents disposent d'un droit de jouissance légale sur le patrimoine de leur enfant âgé de moins de 16 ans (C. civ. art. 382 à C. civ.387). Ce droit leur permet d'utiliser librement les biens de leur enfant (ils peuvent par exemple habiter gratuitement dans un appartement ou une maison lui appartenant) et de dépenser les revenus de ces biens (loyers, intérêts des comptes bancaires, dividendes, etc.). Les biens financés par les salaires de l'enfant échappent en revanche au droit de jouissance légale de ses parents (des règles particulières s'appliquant en outre à la rémunération des enfants du spectacle).
Si l'un des parents décède, le survivant ne pourra continuer à exercer son droit de jouissance légale qu'à la condition de faire faire un inventaire des biens de l'enfant.
Le droit de jouissance légale cesse dès que l'enfant a 16 ans. Il prend fin également en cas d'abus de jouissance des parents (par exemple, s'ils laissent dépérir l'immeuble de leur enfant par manque d'entretien) ou de perte du bien.
Elle est accordée aux familles résidant en France et comptant au minimum trois enfants de moins de 18 ans. La carte est personnelle : chaque membre de la famille (même les enfants) doit avoir sa carte pour bénéficier de ses avantages.
S'agissant des familles recomposées, trois enfants ou plus vivant sous le même toit constituent une famille nombreuse. Par exemple, si une femme ayant la garde de deux enfants et un homme ayant la garde d'un enfant se marient, vivent en concubinage ou concluent un Pacs, ils peuvent demander la carte famille nombreuse. L'important est qu'ils justifient d'un jugement (de divorce par exemple) fixant la résidence des enfants chez eux. En cas de résidence alternée des enfants, le parent qui perçoit tout ou partie des allocations familiales peut se prévaloir de la résidence des enfants pour obtenir la carte famille nombreuse. En cas de partage des allocations familiales, les deux parents peuvent compter l'enfant à charge pour la carte famille nombreuse.
La carte famille nombreuse permet de bénéficier de réductions sur le prix des billets SNCF. Elle est utilisable pour voyager en 1e comme en 2e classe, sachant que la réduction est toujours calculée sur la base du tarif de 2e classe, hors réservation et supplément.
Chaque titulaire de la carte bénéficie sur le réseau SNCF d'une réduction de :
- 30 % si vous avez 3 enfants ;
- 40 % si vous avez 4 enfants ;
- 50 % si vous avez 5 enfants ;
- 75 % si vous avez 6 enfants ou plus.
Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient en plus d'une réduction de 50 %. Pour eux, il faut donc appliquer une première réduction en fonction du barème précédemment indiqué puis diviser le prix obtenu par deux. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement sans place distincte ; ils peuvent disposer d'une place assise en souscrivant le « forfait bambin » (9 €).
En région parisienne, les titulaires de la carte ont, dans tous les cas, 50 % de réduction sur le réseau RER et RATP.
Si vous n'avez plus qu'un ou deux enfants mineurs, vous conservez, ainsi que votre conjoint et votre (ou vos) dernier(s) enfant(s) mineur(s), 30 % de réduction à la SNCF mais vous ne bénéficiez plus des réductions sur le métro.
Si tous vos enfants sont devenus majeurs, vous n'avez plus droit à la carte famille nombreuse. Toutefois, les parents qui ont au moins 5 enfants conservent à vie 30 % de réduction sur le réseau SNCF et 50 % sur celui de la RATP.
La carte famille nombreuse ouvre également droit à des réductions de prix dans de nombreux musées et chez certains commerçants ou chaînes de magasins. La liste des enseignes partenaires et le détail des réductions accordées sont consultables sur le site www.social-sante.gouv.fr/famille/dossiers/soutien à la parentalité/carte familles nombreuses/la liste des partenaires.
Comment obtenir la carte ? Vous devez remplir un imprimé disponible sur le site www.voyages-sncf.com puis l'envoyer à la SNCF (Centre de traitement familles nombreuses, BP 20077, 31839 Plaisance du Touch Cedex) accompagné d'une photographie d'identité par carte demandée et des photocopies de diverses pièces justifiant de votre identité, de votre situation familiale et de votre domicile.
Le prix est de 19 € quel que soit le nombre de cartes demandé. Vous devez renouveler la carte tous les trois ans (six ans si vous avez élevé cinq enfants ou plus).
En cas de perte, vous pouvez demander un duplicata qui coûte lui aussi 19 €.
La carte enfant famille a été supprimée le 29 août 2014. Néanmoins, les personnes ayant déposé avant cette date une demande en ligne de création ou de renouvellement en fournissant les pièces nécessaires dans les deux mois, ont pu obtenir une nouvelle carte valable trois ans. Cette carte délivrée sous conditions de ressources aux familles comprenant un ou deux enfants de moins de 18 ans donne droit à des réductions de tarifs à la SNCF : de 25 % à 50 % sur les trains à réservation obligatoire (TGV, intercités). Les enfants ont droit au tarif réduit, qu'ils voyagent seuls ou accompagnés : les enfants âgés de 4 ans à moins de 12 ans paient la moitié du billet adulte après réduction et les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement et bénéficient d'une place assise distincte. Les parents ne bénéficient du tarif réduit que s'ils voyagent avec leurs enfants.
Les porteurs de cartes enfant famille en cours de validité à la date du 29 août 2014 continuent de bénéficier des avantages tarifaires jusqu'à l'expiration de la date de validité de leur carte.
Un enfant mineur peut se trouver à la tête d'un patrimoine. Le plus souvent, c'est à la suite du décès de l'un de ses parents (ou des deux), dont il a hérité. Plus rarement, il arrive qu'un enfant reçoive du vivant de ses parents une donation ou un héritage. Enfin, certains mineurs gagnent leur vie et disposent ainsi de salaires et, le cas échéant, de biens acquis avec ces salaires.
Quelle que soit l'origine de son patrimoine, l'enfant mineur non émancipé n'a pas le pouvoir de le gérer lui-même.
Au représentant légal du mineur. Il s'agit en principe de ses deux parents, qui gèrent ensemble ses biens selon les règles de l'administration légale dite pure et simple (C. civ. art. 389-1). Si l'un d'eux décède (ou est privé de l'autorité parentale), la gestion est normalement assurée par l'autre parent sous la surveillance du juge des tutelles (fonction exercée par le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal de grande instance). On parle alors d'« administration légale sous contrôle judiciaire » (C. civ. art. 389-2).
Si les parents sont tous deux décédés (ou privés de l'autorité parentale), une tutelle s'ouvre. La gestion des biens de l'enfant est confiée à un tuteur. Sauf disposition contraire prise par les parents de leur vivant (nos 67142 s.), le tuteur est désigné par le conseil de famille (organe collégial composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur, choisis par le juge dans la famille de l'enfant ou parmi les proches).
Un tiers de confiance peut se voir confier, par une donation ou un testament, la gestion des biens transmis à l'enfant par cette donation ou ce testament (C. civ. art. 389-3, al. 3). Les biens en question échappent alors à l'administration du représentant légal de l'enfant, y compris ceux légués au titre de la part de réserve dont l'enfant ne peut être privé (Cass. 1e civ. 6-3-2013 no 11-26.728 : Bull. civ. I no 36, BPAT 2/13 inf. 50). Allant plus loin, la Cour de cassation a même admis qu'un père pouvait, par une simple déclaration faite dans son testament, s'opposer à ce que son ex-épouse gère et administre les biens revenant à ses enfants dans sa succession par l'effet de la loi (Cass. 1e civ. 11-2-2015 no 13-27.27.586). La Cour a considéré que la clause testamentaire qui emporte privation de la jouissance légale de la mère avait pour effet d'augmenter les droits des enfants dans la succession et constituait donc un legs.
Le gestionnaire choisi peut être un proche, membre de la famille ou non, ou un professionnel. Ce choix ne peut pas être écarté par le juge au motif qu'il est contraire aux intérêts du mineur (Cass. 1e civ. 26-6-2013 no 11-25.946 : Bull. civ. I no 137, BPAT 5/13 inf. 172, désignation d'un administrateur autre que le père).
Les pouvoirs de l'administrateur sur les biens donnés ou légués sont déterminés par l'acte de donation ou le testament. Si rien n'est indiqué dans l'acte, le tiers de confiance peut accomplir seul les actes d'administration courante, l'autorisation du juge étant nécessaire pour les actes plus graves (notamment les ventes).
Lorsque l'enfant et son représentant (administrateur, tuteur ou tiers de confiance) ont des intérêts opposés (c'est notamment le cas quand ils participent tous les deux à un même acte), le juge désigne un administrateur spécifique dit « ad hoc ». Ce dernier est alors chargé de représenter l'enfant à l'occasion de l'opération concernée.
Ce sont ceux qui peuvent être accomplis par un seul des parents ou par le tuteur seul (C. civ. art. 389-4).
Il s'agit, au premier chef, des dépenses de la vie de tous les jours, y compris celles liées à l'éducation de l'enfant (vêtements, nourriture, frais de scolarité, etc.).
Si l'enfant possède un immeuble, sont par exemple considérés comme relevant de la gestion courante : les réparations d'entretien ; la souscription d'une assurance contre le vol, l'incendie ou le dégât des eaux ; la conclusion d'un bail d'une durée maximale de neuf ans (sachant que le locataire ne pourra pas exiger de rester dans les lieux au terme de la location si, entre-temps, l'enfant est devenu majeur ou a été émancipé) ; la participation et le vote aux assemblées de copropriété.
Ils nécessitent l'intervention conjointe des deux parents qui devront, en cas de désaccord, obtenir l'autorisation du juge des tutelles. Cette autorisation du juge sera également nécessaire si la gestion est aux mains d'un seul des parents (administration légale sous contrôle judiciaire). Si l'enfant est sous tutelle, le tuteur ne pourra pas agir sans l'autorisation du conseil de famille (C. civ. art. 389-5, al. 1, C. civ.389-6, al. 1 et C. civ.505, al. 1).
Entrent dans cette catégorie d'actes toutes les opérations de placement des capitaux revenant à l'enfant (sachant que ce placement est obligatoire), les locations consenties pour une durée supérieure à neuf ans, la gestion d'un portefeuille de titres (même si celle-ci est confiée à un professionnel), l'acceptation pure et simple d'une succession ou encore la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce aux enchères.
Pour certains actes encore plus graves, la loi prévoit que les parents devront, même s'ils sont d'accord, obtenir l'autorisation du juge (C. civ. art. 389-5, al. 3). C'est le cas de la souscription d'un emprunt, de la renonciation à un droit (héritage, par exemple), de la participation à un acte de partage amiable et, pour les immeubles et fonds de commerce, de leur vente de gré à gré ou de leur apport en société.
Quelles que soient les règles applicables à la gestion des biens du mineur (administration légale ou tutelle), certains actes sont strictement interdits. C'est le cas, notamment, de la donation d'un bien appartenant à l'enfant.
Le législateur a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 17 octobre 2015, des mesures pour limiter l'autorisation du juge des tutelles aux seuls actes pouvant affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur, en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire (Loi 2015-177 du 16-2-2015 art. 1).
Lorsque les deux parents d'un enfant mineur décèdent, un tuteur est désigné à l'enfant (C. civ. art. 390). Cette désignation n'est faite par le conseil de famille qu'à titre subsidiaire, lorsque les parents n'ont pas eux-mêmes de leur vivant choisi de tuteur pour leur enfant. Tout parent peut en effet désigner par avance un tuteur à ses enfants, pour le cas où il mourrait avant que ses enfants soient majeurs (C. civ. art. 403). Seul le choix effectué par le survivant des parents sera évidemment pris en compte, mais il n'est pas nécessaire d'attendre le décès de son conjoint ou concubin (ou ex-conjoint ou concubin) pour agir.
La tutelle testamentaire permet ainsi de désigner la personne qui veillera à l'éducation et à l'entretien des enfants et qui sera chargée de gérer leur patrimoine. Le choix s'imposera au conseil de famille, sauf si le juge estime qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Le tuteur aura la garde des enfants, ceux-ci étant domiciliés chez lui. On signalera toutefois que la mission du tuteur s'exerce sous le contrôle du conseil de famille et que ce dernier pourrait décider, par exemple, de fixer la résidence des enfants chez un tiers (y compris à l'étranger) si les circonstances le justifiaient.
La désignation d'un tuteur par les parents doit être faite par testament ou par déclaration spéciale devant un notaire.
Le choix du tuteur par les parents est libre : il n'est pas obligatoire de désigner un membre de sa famille ou de sa belle-famille.
Le moment venu, le tuteur aura la possibilité de refuser la mission qui lui a été confiée. Il est donc conseillé de désigner un tuteur supplémentaire, voire plusieurs. Si le tuteur désigné en premier rang est défaillant (prédécès ou refus), le suivant le remplace, à défaut le troisième et ainsi de suite.
Quant aux pouvoirs du tuteur, ce sont ceux de tout tuteur légal, les parents n'ayant en aucun cas la faculté de les moduler.
Ceci est mon testament.
Je soussigné (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse),
Conformément aux dispositions de l'article 403 du Code civil, je choisis pour tuteur à mes enfants ci-après nommés, pour le cas où ceux-ci seraient encore mineurs au jour de mon décès, M. X (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse) et, à défaut, M. Y (prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse),
Mes enfants :
Paul né à ... le ...,
Camille née à ... le ...,
Issus de mon union avec Mme (prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance), mon épouse.
Fait à ... le ...
Signature
L'émancipation a pour effet de permettre au mineur de faire seul tous les actes de la vie civile, comme s'il était déjà majeur (C. civ. art. 413-6) : il peut vendre ses biens, agir en justice, choisir son domicile, etc. En contrepartie, le mineur émancipé doit assumer à titre personnel les éventuelles conséquences dommageables de ses actes.
L'assimilation du mineur émancipé à un majeur n'est pas totale. Par exemple, le mineur émancipé ne peut pas voter, ni se faire adopter sans le consentement de ses parents.
Rare en pratique, l'émancipation concerne surtout des jeunes qui ont déjà une vie professionnelle et/ou familiale autonome.
Sauf en cas de mariage du mineur (hypothèse exceptionnelle), où elle est automatique, l'émancipation est prononcée par le juge des tutelles, à la demande des parents ou de l'un d'eux. La demande ne peut concerner que les enfants qui ont au moins 16 ans. Si l'enfant est orphelin de père et de mère, la demande est formulée par le conseil de famille (C. civ. art. 413-3).
La requête est présentée, sous forme de simple lettre, au juge dont relève le domicile du jeune. Le juge entend celui-ci et, le cas échéant, le parent qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
Il statue en fonction de l'intérêt du mineur. Il s'assure notamment que la demande n'est pas un moyen pour les parents de se décharger de leur responsabilité envers leur enfant.
Le jour de ses 18 ans, le jeune devient majeur. Il peut dès lors librement accomplir tous les actes de la vie privée : se marier, partir vivre à l'étranger, gérer et disposer de ses biens, souscrire un emprunt, etc. Il peut également voter, à condition d'être inscrit sur les listes électorales.
Il peut encore entrer de plain-pied dans la vie professionnelle. Il est libre d'exercer la profession de son choix, de devenir commerçant, de signer, sans le consentement de ses parents, un contrat de travail, etc.
Le jeune majeur devient pleinement responsable de ses actes : s'il cause un accident, il doit indemniser les victimes ; s'il a un découvert sur son compte, il est tenu de le combler au risque d'être interdit bancaire ; s'il s'achète une voiture, il doit l'assurer, etc. Les parents d'un jeune de 18 ans ne sont plus tenus d'assumer les conséquences de ses actes. Il n'en va autrement que s'ils se sont portés garants, par exemple en signant un acte de caution pour le paiement de ses loyers.
Les parents ont tout intérêt à vérifier que leur assurance de responsabilité civile couvre la responsabilité de leurs enfants majeurs tant qu'ils vivent chez eux et restent à leur charge (étudiant non salarié ou jeune à la recherche d'un emploi). Si ce n'est pas le cas, l'enfant devra s'assurer.
Les stages se définissent comme des périodes de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification (C. éduc. art. L 124-1 s. et C. éduc.D 124-1 s.).
Ils doivent être intégrés dans un cursus pédagogique. A défaut, ils constituent de véritables contrats de travail ouvrant droit à un salaire.
Les stages donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'entreprise. La convention précise notamment les dates de début et de fin du stage, les compétences à acquérir ou à développer et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation, les activités confiées au stagiaire, qui doivent être conformes au projet pédagogique, le montant et les modalités de paiement de la gratification, le régime de protection sociale applicable. En cas de stage à l'étranger, les modalités de son déroulement et de son encadrement font l'objet d'un échange entre les trois parties prenantes et une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et devoirs du stagiaire doit être annexée à la convention. Au terme du stage, l'entreprise délivre une attestation de fin de stage.
Pour que le suivi pédagogique soit réel, le jeune bénéficie d'un enseignant référent au sein de l'établissement d'enseignement et d'un tuteur au sein de l'entreprise, ceux-ci étant signataires de la convention et devant être en contact pour veiller conjointement au bon déroulement du stage. Les enseignants comme les tuteurs ne peuvent suivre simultanément qu'un nombre limité de stagiaires (16 pour les enseignants, maxima pas encore fixé pour les tuteurs).
Afin d'éviter le recours abusif aux stages, plusieurs restrictions sont prévues :
- la durée du ou des stages dans une entreprise ne peut excéder six mois par stagiaire et par année d'enseignement, sauf dérogations pour certaines formations ;
- l'accueil successif de stagiaires sur un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent, sauf si ce dernier a été interrompu avant son terme par le stagiaire ;
- il est interdit de faire appel à un stagiaire pour pourvoir un poste permanent ou un CDD (accroissement temporaire d'activité, emploi saisonnier ou remplacement d'un salarié absent) ;
- une entreprise ne peut accueillir simultanément qu'un nombre maximum de stagiaires, ce nombre étant fixé en fonction des effectifs (plafond non encore fixé).
En cas d'embauche dans les trois mois suivant le stage de dernière année d'étude, la durée du stage s'impute sur la période d'essai, sans réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable. Toutefois, si l'emploi correspond aux activités confiées durant le stage, la durée de celui-ci est intégralement déduite de la période d'essai (C. trav. art. L 1221-24).
En cas d'embauche à l'issue d'un stage de plus de deux mois, cette durée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Une gratification est due, dès le premier mois, pour les stages supérieurs à deux mois consécutifs (ou non consécutifs mais sur la même année scolaire). Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2015, son montant est égal à 3,60 € de l'heure (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale), soit 546 € pour un mois à temps complet (151,67 heures). Il est de 3,30 € de l'heure pour les conventions conclues entre le 1er janvier et le 31 août 2015.
L'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic, soit 17 490 € en 2015 (CGI art. 81 bis). Cette exonération ne devrait s'appliquer qu'aux conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015. Toutefois l'administration admet déjà d'exonérer l'indemnité sous réserve que le stage fasse partie du programme de l'école ou des études, qu'il soit obligatoire et ne dure pas plus de trois mois (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 no 200).
Par ailleurs, le stagiaire dispose des mêmes droits que les salariés s'agissant :
- de l'accès aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
- de l'accès au restaurant d'entreprise ou à des titres-restaurant ;
- de la prise en charge de ses frais de transport ;
- du respect des durées de travail (durées maximales, repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés). L'organisme d'accueil doit d'ailleurs établir un décompte des durées de présence du stagiaire.
L'intéressé est couvert au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. En revanche, le stage n'ouvre pas droit aux prestations sociales maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. Mais le stagiaire peut demander à verser des cotisations en vue de valider 2 trimestres d'assurance retraite.
Les emplois salariés occupés pendant les vacances scolaires doivent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée. Dès lors qu'il a 18 ans, le jeune est rémunéré au minimum sur la base du Smic. Mais il n'a pas droit à l'indemnité de précarité normalement versée à la fin d'un contrat à durée déterminée.
Sur option des bénéficiaires, les salaires perçus sont exonérés d'impôt sur le revenu à concurrence de trois fois le montant mensuel du Smic, soit 4 373 € depuis le 1er janvier 2015, si le jeune a moins de 26 ans (ou fête son 26e anniversaire) le 1er janvier de l'année. Pour les salaires perçus en 2014, l'exonération bénéficie aux jeunes nés depuis le 1er janvier 1988. Au-delà de trois fois le Smic mensuel, ou si le jeune a plus de 26 ans, ses salaires sont imposables dans les conditions de droit commun.
Sauf exceptions, les allocations familiales sont maintenues. En effet, le jeune qui perçoit un salaire reste considéré à charge dès lors que la moyenne de ses salaires nets sur six mois ne dépasse pas 55 % du Smic.
L'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le Smic mensuel s'applique également aux salaires perçus en raison d'emplois occupés pendant l'année scolaire ou universitaire, à l'exception des rémunérations perçues par les agents publics pendant leur formation. Elle peut être cumulée avec celle prévue pour les indemnités de stage.
L'année des 18 ans de leur enfant, les parents ont le choix de le compter à charge ou non. Si l'enfant est compté à charge, ses parents bénéficient de la majoration du quotient familial à laquelle ils avaient droit jusqu'alors. Dans le cas inverse, ils peuvent déduire une pension alimentaire, les deux avantages étant incompatibles.
Les années suivantes et jusqu'à l'année de ses 21 ans (25 ans s'il poursuit des études), l'enfant peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents, à condition qu'il en fasse la demande.
S'il est encore lycéen, l'enfant reste l'ayant droit de ses parents jusqu'à son 20e anniversaire ou, si sa scolarité a été retardée pour raisons médicales, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a 21 ans. Ce rattachement n'empêche pas le lycéen devenu majeur de demander à être personnellement remboursé de ses frais médicaux et de choisir son médecin traitant.
S'il est étudiant dans l'enseignement supérieur (université, IUT, BTS, classe préparatoire), quel que soit son âge, le jeune majeur n'est plus rattaché à ses parents (sauf exceptions, par exemple lorsque les parents sont salariés d'EDF ou de la SNCF). Il dépend du régime étudiant de sécurité sociale. Pour ce faire, il doit s'affilier auprès d'une mutuelle étudiante au moment de son inscription dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur. Cette affiliation est gratuite s'il a moins de 20 ans ou, quel que soit son âge, s'il bénéficie d'une bourse. Elle est payante s'il atteint 20 ans au cours de l'année universitaire (entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante).
S'il a une activité professionnelle, l'enfant majeur bénéficie d'une protection sociale à titre personnel et n'est donc plus rattaché à la sécurité sociale de ses parents.
L'enfant majeur qui ne fait pas d'études et ne travaille pas peut rester rattaché à ses parents en tant que « cohabitant à charge », à condition de vivre chez eux et à leur charge depuis au moins 12 mois. La demande de rattachement peut être renouvelée année après année si aucun changement n'est intervenu.
Un enfant est considéré comme à la charge de ses parents jusqu'à 20 ans, à condition qu'il soit lycéen, étudiant, salarié ou apprenti avec un salaire ne dépassant pas 55 % du Smic ou qu'il soit atteint d'un handicap ou d'une maladie chronique l'empêchant de travailler ou de poursuivre ses études. Dans le cas, rare, où il ne se trouve dans aucune de ces situations, il cesse de donner droit à des prestations familiales dès ses 16 ans.
A partir de 20 ans (plus exactement à partir du mois précédant son 20e anniversaire), quelle que soit sa situation (lycéen, étudiant, sans activité), l'enfant ne donne plus droit aux prestations familiales. Par exception :
- dans les familles nombreuses (trois enfants et plus), pendant toute l'année précédant son 21e anniversaire, l'aîné donne droit à une allocation forfaitaire qui s'ajoute aux allocations familiales versées pour les plus jeunes ;
- pour le complément familial et les aides au logement, l'enfant est considéré à charge jusqu'à son 21e anniversaire.
Le Code civil organise un minimum de solidarité familiale. C'est bien sûr le cas entre époux avec l'obligation de secours et d'assistance, qui prend la forme de la contribution aux charges du mariage. C'est également le cas entre ascendants et descendants :
- les parents ont l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants majeurs. En cas de carence des parents, les grands-parents doivent pourvoir aux besoins essentiels de leurs petits-enfants (Cass. 1e civ. 6-3-1974 no 72-11.070 : Bull. civ. I no 77) ;
- les enfants peuvent être amenés à prendre en charge leurs parents ou grands-parents dans le besoin. Cette obligation pèse également sur les conjoints des enfants.
La loi ne prévoit aucune obligation à caractère alimentaire entre frères et soeurs, oncles et neveux ou concubins non pacsés, pas plus qu'entre enfants et beaux-parents, les beaux-parents étant ici entendus au sens du conjoint de la mère ou du père de l'enfant.
L'obligation d'entretien des parents (C. civ. art. 203) ne cesse pas aux 18 ans de leur enfant. Elle se prolonge en principe aussi longtemps que le jeune majeur :
- poursuit des études. Les parents ne peuvent pas refuser de pourvoir aux besoins de leur enfant parce qu'ils réprouvent le cursus qu'il a choisi. Cela dit, ses études doivent être sérieuses ; l'enfant peut redoubler, mais pas tripler, et il ne doit pas changer de discipline tous les ans. La plupart des tribunaux estiment que le jeune doit tenir ses parents informés du déroulement de sa scolarité et de ses résultats ;
- est à la recherche d'un premier emploi (à condition qu'il cherche effectivement un travail). S'il a déjà travaillé et se retrouve au chômage, l'obligation alimentaire ne renaît pas automatiquement ;
- souffre d'une maladie ou d'un handicap qui l'empêche d'être autonome. Il doit cependant faire le nécessaire pour obtenir les allocations auxquelles il a droit, par exemple l'allocation d'adulte handicapé.
L'obligation d'entretien cesse lorsque le jeune devient financièrement autonome. C'est notamment le cas :
- s'il trouve un emploi. Encore faut-il que cet emploi soit régulier et lui permette de subvenir seul à ses besoins ;
- s'il obtient une bourse ou perçoit des allocations d'un montant suffisant ;
- s'il se marie avec une personne disposant de revenus.
C'est aussi le cas lorsque le jeune a obtenu un diplôme qui lui permet de trouver une situation, les parents n'étant pas tenus d'entretenir indéfiniment leurs enfants. A propos d'un jeune titulaire du diplôme d'ingénieur des Ponts et Chaussées, il a été jugé qu'il ne pouvait pas demander le maintien de la pension alimentaire pour entreprendre de nouvelles études d'un ordre tout différent.
Cela dit, attention : l'obligation d'entretien des parents peut renaître à tout moment si l'enfant, une fois adulte, se retrouve dans le besoin. Ainsi un père retraité a-t-il été condamné à verser une pension à son fils invalide de 43 ans.
Les parents sont déchargés de toute obligation envers leur enfant majeur qui fait preuve d'un comportement indigne à leur égard (C. civ. art. 207, al. 2). Ainsi jugé à propos d'un jeune qui avait exercé à plusieurs reprises des violences sur ses deux parents (Cass. 1e civ. 18-1-2007 no 06-10.833 : Bull. civ. I no 25).
Le plus souvent, les parents exécutent spontanément leur obligation, que ce soit en nature (les enfants continuant par exemple à vivre avec eux), en argent (par le versement d'une rente mensuelle), ou encore en combinant exécution en nature et en espèces (par exemple, mise à disposition gratuite d'un logement et complément en argent).
Il arrive cependant que les parents refusent d'entretenir leur enfant majeur, estimant que celui-ci est en âge de gagner sa vie. L'enfant peut alors agir en justice pour demander une pension alimentaire.
Le jeune doit saisir le juge aux affaires familiales de son domicile ou du domicile du (ou des) parent(s) qu'il fait citer. Pour cela, il peut déposer au greffe du juge (c'est-à-dire au secrétariat) une requête dans laquelle il expose sa situation et ses prétentions. Le greffe se charge alors de convoquer les intéressés à une audience.
Le recours à un avocat n'est pas obligatoire, mais peut être utile... ne serait-ce que pour dépassionner le débat ! Ses honoraires sont susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Avant la date d'audience, parent(s) et enfant doivent se communiquer l'ensemble des pièces qui fondent leurs positions respectives, notamment la preuve de leurs revenus et charges. A l'audience, chacun expose son point de vue. Après avoir entendu les intéressés, le juge fixe la date à laquelle il rendra sa décision.
Il est possible de faire appel de la décision du juge aux affaires familiales. Mais cela ne suspend pas l'exécution de la décision : le parent qui a été condamné à verser une pension alimentaire doit la payer, quitte à en obtenir ensuite le remboursement total ou partiel si la cour d'appel supprime ou diminue la pension initialement ordonnée.
Monsieur Charles Lemercier
Né le 8 janvier 1994 à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
De nationalité française,
8 rue des Iris
69004 Lyon
Tribunal de grande instance de Lyon,
Greffe du juge aux affaires familiales
67 rue Servient
69003 Lyon
A Lyon, le 21 septembre 2015
Monsieur le juge,
Etudiant en informatique, j'entame ma troisième année à l'université.
Je loue une chambre pour 150 €/mois. Mes dépenses courantes (nourriture, habillement, électricité...) s'élèvent à 200 €/mois. Les frais relatifs à mon inscription en faculté, à la souscription d'une mutuelle étudiants, à l'achat de livres et de fournitures scolaires et à un abonnement Internet représentent un montant mensuel de 80 €/mois.
En outre, j'ai dû emprunter une somme de 1 000 € pour l'achat d'un ordinateur et d'une imprimante. Je rembourse 70 €/mois.
Bien que travaillant régulièrement pendant les vacances scolaires, je ne peux pas subvenir entièrement à mes besoins.
J'ai demandé à plusieurs reprises à mon père de bien vouloir m'aider. Mais il refuse.
C'est pourquoi, je vous remercie de bien vouloir :
- convoquer Monsieur Pascal Lemercier, 18 allée des Platanes, 69004 Lyon ;
- le condamner à me verser une pension alimentaire de 500 €/mois ;
- dire que la pension sera revalorisée chaque année en fonction de l'indice Insee de la consommation des ménages.
Signature
PJ : carte d'étudiant, quittances de loyer, factures, contrat de prêt, feuilles de paie...
Il est fixé par le juge en fonction des besoins de l'enfant et des ressources du ou des parents poursuivis (C. civ. art. 208). Ces critères sont appréciés en tenant compte du milieu familial et social, de l'existence ou non d'un projet professionnel, de l'âge de l'enfant et de ses ressources éventuelles.
Si les parents ont des moyens financiers limités, l'enfant ne peut pas se reposer entièrement sur eux et doit contribuer, au moins partiellement, à son entretien. S'il est à même de financer ses études, il ne peut prétendre à aucune aide. Inversement, s'il est dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins, les parents ne peuvent exiger qu'il travaille, même à temps partiel : les juges considèrent que l'exercice d'une activité salariée est incompatible avec la poursuite d'études supérieures.
La pension alimentaire est généralement indexée, c'est-à-dire réévaluée chaque année en application d'un indice précisé dans le jugement (le plus souvent l'indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, France entière).
La pension alimentaire est révisable à tout moment si un élément nouveau le justifie (Cass. 1e civ. 16-6-1993 no 91-19.904 : Bull. civ. I no 216). Le jeune peut par exemple en demander l'augmentation si ses besoins augmentent ; le parent qui verse la pension peut demander sa diminution si ses charges se sont alourdies ou si ses revenus ont diminué.
Si l'enfant est rattaché à leur foyer fiscal, les parents bénéficient d'une majoration de leur quotient familial. En contrepartie, ils ne peuvent rien déduire au titre de leur obligation d'entretien et doivent déclarer avec leurs propres revenus ceux de leur enfant (sauf les salaires mentionnés no 67189).
Lorsque l'enfant déclare ses propres revenus, ses parents n'ont plus droit à une majoration du quotient familial mais ils peuvent déduire les frais qu'ils engagent pour lui. La déduction est possible que l'obligation d'entretien soit exécutée en espèces (pension alimentaire) ou en nature ; les parents dont les enfants vivent toujours avec eux peuvent déduire les dépenses d'hébergement, de nourriture, de vêtements, etc. ; ceux qui payent le loyer et les charges de leur enfant peuvent les déduire de leurs revenus, etc. Dans tous les cas, il faut en principe être en mesure de justifier de la réalité et du montant des dépenses effectuées.
La règle selon laquelle le montant déductible correspond aux frais engagés supporte deux correctifs :
- les pensions versées en application de décisions de justice devenues définitives avant le 1er janvier 2006 sont déductibles pour 125 % de leur montant ;
- il existe un montant maximal de déduction par enfant et par an, qui s'élève à 5 726 € pour l'imposition des revenus de 2014.
Si l'enfant majeur vit avec ses parents sans être rattaché à leur foyer fiscal, les parents peuvent déduire les dépenses d'hébergement et de nourriture pour un montant forfaitaire de 3 403 € par enfant (montant applicable pour l'imposition des revenus de 2014), sans qu'aucune justification puisse être exigée par l'administration. Les autres dépenses sont déductibles pour leur montant réel et justifié, mais dans la limite de 2 323 € (5 726 - 3 403).
Il doit déclarer le montant déduit par ses parents, étant toutefois précisé que dans le cas particulier où la déduction porte sur 125 % des sommes versées, l'imposition est limitée au montant de la pension perçue, sans majoration de 25 %.
La somme déclarée est imposable à l'impôt sur le revenu après déduction d'un abattement de 10 % (avec un minimum de 379 € par bénéficiaire et un maximum de 3 707 € pour l'ensemble de son foyer fiscal, chiffres applicables aux pensions reçues en 2014).
Les enfants sont tenus d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants (C. civ. art. 205) : parents, grands-parents ou arrière-grands-parents qui seraient dans le besoin. Cette obligation a pour seul objet d'assurer aux ascendants l'indispensable : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes telles qu'électricité, eau, etc. Les enfants ne sont pas tenus au-delà et ne peuvent par exemple se voir contraints de prendre en charge les dépenses de loisirs ou de vacances de leurs parents.
L'obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants pèse de la même manière sur les enfants adoptés. Précisons cependant que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple est dans une situation particulière (C. civ. art. 367) : il est tenu d'une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs et envers ses ascendants biologiques (parents, grands-parents... alors que ceux-ci ne doivent des aliments à leur enfant que s'il ne peut les obtenir de ses parents adoptifs). Cependant, l'obligation alimentaire de l'enfant adopté simple à l'égard de ses parents naturels cesse s'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou s'il a fait l'objet d'un placement judiciaire d'au moins 36 mois au cours des 12 premières années de sa vie.
Les gendres et belles-filles sont tenus, comme les enfants, d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs beaux-parents, mais seulement tant que dure le lien d'alliance (C. civ. art. 206 et C. civ.207). En cas de décès de leur conjoint ou de divorce, et à la condition qu'aucun enfant ne soit issu de leur union (ou que ces enfants soient décédés), les gendres et belles-filles n'ont plus l'obligation de subvenir aux besoins de leur ex-beau-père ou belle-mère.
Un parent ne peut exiger l'aide de ses enfants ou beaux-enfants que si son conjoint se trouve dans l'incapacité de la lui fournir. Autrement dit, l'obligation des enfants est subsidiaire à celle que se doivent les époux. Evidemment, le divorce fait disparaître l'obligation de secours et d'assistance entre conjoints (mais non la séparation de corps).
Lorsqu'elle est spontanée, la solidarité familiale peut prendre différentes formes : accueil du parent chez soi, mise à sa disposition gratuite d'un logement, prise en charge des sommes demandées par la maison de retraite, etc.
A défaut d'exécution spontanée, le parent désargenté peut faire citer ses descendants devant le juge pour obtenir une pension alimentaire.
Elle a lieu devant le juge aux affaires familiales, la procédure à suivre étant celle indiquée no 67249.
Le parent qui demande la pension peut librement choisir, parmi ses descendants, celui ou ceux à qui il demande une pension alimentaire. Par exemple, un père peut faire citer tous ses enfants ou seulement l'un d'eux.
Pour simplifier la mise en oeuvre du paiement de la pension, il est préférable de n'avoir qu'un seul débiteur. Encore faut-il que ce débiteur unique dispose de revenus suffisants, car l'enfant cité ne peut être condamné qu'à hauteur de ce que lui permettent ses ressources (voir no 67310). Dans le cas contraire, mieux vaut faire citer tous les enfants.
A titre exceptionnel, lorsque celui qui doit l'aide alimentaire n'a pas les moyens de payer une pension, le juge peut décider qu'il devra exécuter son obligation en nature (C. civ. art. 210). L'enfant doit alors héberger, nourrir et entretenir son parent. C'est au juge d'apprécier si la cohabitation des intéressés est envisageable.
Le parent qui saisit le juge doit être démuni. Il doit se trouver dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins, ce que le juge apprécie en tenant compte non seulement des revenus perçus par l'intéressé (salaires, pensions de retraite, allocations, revenus fonciers, etc.), mais également des revenus qu'il pourrait percevoir. Le juge peut par exemple refuser une pension à celui qui s'abstient volontairement de travailler (il toucherait des salaires s'il cherchait un emploi) ou qui, disposant d'appartements libres, ne se donne pas la peine de les mettre en location. Sous cette réserve, les causes de l'indigence importent peu : qu'elles soient accidentelles (infirmité, chômage de longue durée, maladie) ou fautives (gaspillage, mauvaise gestion de son patrimoine, condamnation pénale, dettes de jeu), elles n'interdisent pas au parent démuni de faire jouer la solidarité familiale.
Il n'est pas nécessaire d'avoir été une bonne mère ou un bon père pour obtenir de ses enfants une pension alimentaire. Néanmoins, le juge peut décharger l'enfant de son obligation alimentaire, en totalité ou en partie, si le parent a fait preuve d'un comportement indigne à son égard.
Ont par exemple été privés de tout droit à pension :
- une mère qui avait abandonné ses enfants, à la fois matériellement et moralement (CA Rennes 28-2-2000 no 98/8189 D : JCP G 2000, I, 332 p. 1276) ;
- une grand-mère qui n'avait pas cherché à obtenir la garde de ses petits-enfants, ni même un simple droit de visite, alors que les enfants étaient confiés à l'aide sociale en raison du décès de leur mère (CA Paris 2-7-1997 no 95/465, 24e ch. : Juris-Data no 1997-022637) ;
- un père n'ayant cessé de perturber la vie quotidienne de ses enfants en rodant autour de leur domicile et en leur laissant des messages téléphoniques humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité (Cass. 1e civ. 21-11-2012 no 11-20.140 : BPAT 1/13 inf. 11).
N'ont eu droit qu'à une pension minorée :
- un père qui, sans avoir abandonné ses enfants, avait manifesté des sentiments haineux et rancuniers à leur égard (CA Versailles 7-7-1982 no 3588, 1e ch. : Juris-Data no 1982-043809) ;
- un couple qui, sans s'être totalement désintéressé de ses enfants, les avait confiés à leurs grands-parents (CA Bordeaux 16-7-1985 no 84-716, 6e ch. : Juris-Data no 1985-042161).
En revanche, est sans incidence sur le droit à pension le fait d'avoir :
- payé irrégulièrement la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son enfant (CA Bordeaux 21-5-1986 no 85/1086, 6e ch. : Juris-Data no 1986-041984) ;
- confié son enfant aux grands-parents dès lors qu'il s'agissait d'un souhait de l'enfant (CA Limoges 28-1-1998 no 87/610, 2e ch. : Juris-Data no 1988-040359) ;
- fait preuve d'un comportement indigne envers une personne autre que l'enfant. Par exemple, l'enfant issu d'un second mariage ne peut pas refuser de payer une pension à son père au motif que ce dernier s'est totalement désintéressé des enfants de son premier mariage.
La mise en oeuvre de la solidarité familiale est en principe réservée aux seuls intéressés. Toutefois, lorsque les établissements publics de santé, hôpitaux et maisons de retraite notamment, accueillent un malade impécunieux, ils peuvent, à condition d'agir de son vivant, recouvrer auprès de ses enfants (sauf circonstances particulières) les frais qu'ils ont engagés (CSP art. L 6145-11). Le juge détermine l'obligation alimentaire en fonction des sommes dues à l'établissement et des possibilités financières des descendants poursuivis.
Les collectivités publiques chargées de l'aide sociale peuvent aussi saisir le juge :
- au nom de la personne qui a demandé à bénéficier de l'aide sociale (CASF art. L 132-7). Le montant de l'aide sociale est en effet fixé en tenant compte des possibilités de l'intéressé d'obtenir une aide alimentaire de sa famille (en prenant en compte non seulement les revenus des enfants de l'intéressé, mais aussi ceux de ses gendres et belles-filles). Si la personne indigente n'agit pas elle-même, le préfet ou le président du conseil départemental peut demander à sa place la condamnation de ses proches à payer une pension alimentaire. Celle-ci est alors versée à l'Etat ou au département, qui la reverse à son bénéficiaire ;
- ou pour leur propre compte. Si une collectivité chargée de l'aide sociale a fait une avance pour répondre à une situation d'urgence, elle peut recouvrer les sommes payées auprès des proches de la personne qui a bénéficié de l'aide sociale sur le fondement de l'article 1251 du Code civil.
Les établissements de santé et les collectivités publiques cherchent parfois à recouvrer les sommes qui leur sont dues sur la base d'un titre établi par leurs propres services, sans l'intervention du juge. Cette pratique est illégale : seul le juge aux affaires familiales est compétent pour décider du montant de l'aide alimentaire. Les enfants peuvent en conséquence faire annuler toute mesure de recouvrement forcé (saisie, par exemple) qui aurait été effectuée sur leurs biens sans une décision du juge aux affaires familiales.
Il est fixé par le juge en fonction des critères suivants :
- besoins du parent nécessiteux, qui sont appréciés selon son âge, son milieu social, son état de santé et ses charges de famille ;
- possibilités du descendant poursuivi, évaluées en prenant en compte l'ensemble de ses charges et revenus. Les revenus du conjoint, du concubin (ou de la concubine) ou du partenaire de Pacs du descendant poursuivi ne doivent pas être ajoutés à ceux du redevable de la pension alimentaire pour apprécier le montant de la pension alimentaire. Ces revenus ne sont pris en compte pour le calcul de la pension que dans la mesure où ils diminuent les charges de celui qui doit la pension (Cass. 1e civ. 11-6-2008 no 07-10.285, à propos de couples mariés ; Cass. 1e civ. 9-1-2008 no 06-21.168, à propos de concubins).
La pension alimentaire est généralement indexée, c'est-à-dire qu'elle est réévaluée automatiquement chaque année en fonction de l'indice indiqué dans le jugement qui la fixe (C. civ. art. 208) ; c'est le plus souvent l'indice Insee des prix à la consommation des ménages qui est retenu.
La pension alimentaire est révisable à tout moment si un élément nouveau modifie la situation des intéressés. Le juge peut donc l'augmenter (par exemple, parce que les problèmes de santé de son bénéficiaire ont accru ses besoins). Il peut également la réduire, voire la supprimer. Ce sera le cas, par exemple :
- si son bénéficiaire dispose de ressources nouvelles, notamment à la suite de la liquidation de ses droits à retraite, ou s'il se remarie (rappelons que l'obligation des enfants est subsidiaire à celle qui existe entre époux), ou encore s'il manifeste un comportement indigne à l'encontre de l'enfant qui subvient à ses besoins ;
- si l'enfant qui verse la pension perd son emploi ou doit faire face à de nouvelles charges de famille.
Le juge aux affaires familiales décide du moment à partir duquel la pension cesse d'être due. Ce peut être à compter :
- de l'événement justifiant la suppression de la pension ;
- ou du jour du dépôt de la demande au tribunal ;
- ou encore du jour où le jugement devient définitif.
Le jugement qui fixe la pension en précise le point de départ. Il peut s'agir du jour où le parent démuni a saisi le juge ou du jour où le jugement devient définitif.
A titre tout à fait exceptionnel, le juge peut décider que la pension sera rétroactivement due à compter du jour où son bénéficiaire s'est trouvé dans le dénuement. Pour cela, ce dernier doit prouver deux choses :
- le moment à partir duquel il s'est trouvé démuni ;
- le fait qu'il n'a jamais entendu renoncer à solliciter une aide pour cette période. Il peut rapporter cette preuve en démontrant, par exemple, qu'il a entrepris des démarches pour obtenir une pension (Cass. 1e civ. 3-4-1990 no 88-18.927 : Bull. civ. I no 77).
En tout état de cause, le bénéficiaire de l'aide ne peut pas demander un arriéré de pension alimentaire au-delà de cinq ans à compter du jour de sa demande en justice (C. civ. art. 2224).
La pension cesse automatiquement avec le décès de son bénéficiaire ou celui de son débiteur. Les héritiers de ce dernier ne sont pas tenus d'en poursuivre le paiement. Deux nuances toutefois. Le bénéficiaire de la pension peut :
- récupérer sur la succession l'arriéré qui lui reste dû, c'est-à-dire les mensualités que le débiteur de la pension ne lui avait pas payées de son vivant ;
- obtenir la condamnation des héritiers à titre personnel si les conditions de l'obligation alimentaire sont remplies à leur égard.
Si tous les enfants ont été cités devant le juge, ce dernier doit individualiser le montant dû par chaque enfant (Cass. 1e civ. 22-11-2005 no 02-11.534 : Bull. civ. I no 419) ; il ne peut pas prononcer une condamnation globale à répartir entre eux.
Si un seul enfant a été mis en cause et s'il en a les moyens, il peut, à notre avis, être condamné à prendre en charge entièrement son parent. C'est pourquoi il a intérêt à faire intervenir ses frères et soeurs dans la procédure, pour que la charge de chacun soit déterminée par le juge. S'il ne le fait pas, il peut agir plus tard à condition d'agir dans les cinq ans de sa condamnation.
Le recours entre frères et soeurs pour la contribution à l'obligation alimentaire ne doit pas être confondu avec le recours de l'enfant qui a hébergé et soigné l'un de ses parents et qui demande à se faire indemniser lors du règlement de la succession.
Qu'elle soit fournie en nature ou en argent, spontanément ou sur décision du juge, l'aide alimentaire apportée par les enfants à leurs parents ou grands-parents dans le besoin est déductible.
Par exemple, l'enfant qui paye les factures de la maison de retraite peut en déduire le montant, celui qui met gratuitement à la disposition de ses parents un logement peut déduire le montant du loyer que lui procurerait ce logement s'il le louait (plus les charges locatives, si c'est lui qui les paye), etc. Si l'enfant verse une pension alimentaire, il peut en déduire le montant, sachant que si la pension a été fixée par une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, les sommes versées sont déductibles pour 125 % de leur montant.
Le montant déductible n'est pas plafonné. Cela dit, seuls sont déductibles les frais qui correspondent à la couverture des besoins fondamentaux des ascendants ; la prise en charge de dépenses d'agrément, par exemple, n'ouvre pas droit à déduction.
En principe, les enfants doivent être en mesure de justifier de la réalité et du montant des dépenses qu'ils ont effectuées.
SavoirL'enfant qui prend en charge le salaire de la femme de ménage ou de la garde qui travaille chez ses parents dans le besoin peut déduire de ses revenus le salaire qu'il lui verse, mais il n'a pas droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, sauf si son père ou sa mère remplit les conditions d'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, il peut bénéficier de la réduction d'impôt, mais doit renoncer à toute déduction au titre de l'obligation alimentaire (CGI art. 199 sexdecies).
L'enfant qui recueille chez lui un de ses ascendants dans le besoin peut rattacher ce dernier à son propre foyer fiscal lorsque l'ascendant est titulaire de la carte d'invalidité. Aucune déduction n'est alors possible au titre de l'obligation alimentaire, mais l'ascendant ouvre droit à une part supplémentaire de quotient familial. Attention toutefois : le choix du rattachement implique de déclarer les revenus perçus par l'ascendant, qui seront imposés avec ceux de l'enfant qui l'a recueilli.
A défaut de rattachement, l'enfant peut déduire les dépenses engagées pour leur montant réel dès lors qu'elles sont justifiées. Par exception, les dépenses de nourriture et d'hébergement sont déductibles pour un montant forfaitaire (3 403 € par parent pour l'imposition des revenus de 2014) lorsque l'ascendant recueilli est sans ressources ou âgé de plus de 75 ans et titulaire d'un revenu imposable en 2014 n'excédant pas 9 600 € pour une personne seule et 14 904 € pour un couple.
Les parents doivent en principe déclarer les sommes déduites par leurs enfants (étant toutefois précisé que dans le cas particulier où la déduction porte sur 125 % des sommes versées, l'imposition est limitée au montant de la pension perçue, sans majoration de 25 %). Ces sommes sont imposables dans la catégorie des pensions, après un abattement de 10 % (avec un minimum de 379 € par bénéficiaire et un maximum de 3 707 € pour l'ensemble de son foyer fiscal, chiffres applicables aux pensions reçues en 2014).
Par exception, lorsque les enfants s'acquittent de leur obligation alimentaire en prenant directement en charge les frais d'hospitalisation de leur ascendant ou ses frais de pension dans une maison de retraite, l'ascendant n'est pas imposable à raison des sommes correspondantes s'il ne dispose que de faibles ressources (par exemple, l'allocation aux vieux travailleurs).
Les prêts familiaux donnent rarement lieu à l'établissement d'un acte écrit. Pourtant, si la somme prêtée est importante, une telle précaution constitue une garantie pour le prêteur.
Si aucun écrit n'a été établi, il y a toujours un risque que l'emprunteur indélicat ou à la mémoire défaillante prétende que l'argent lui a été donné, et non prêté. Il sera alors en position de force : que l'argent lui ait été remis en liquide, par chèque ou par virement, il sera présumé avoir reçu un don manuel et c'est le prêteur qui devra prouver le prêt. Or, si les sommes en jeu excèdent 1 500 €, cette preuve ne peut en principe se faire que par écrit (C. civ. art. 1341 ; Décret 80-533 du 15-7-1980) ; le juge refuserait par exemple de prendre en compte un témoignage. A noter que la preuve de la remise des fonds (par exemple au moyen d'un relevé bancaire) ne suffit pas à prouver l'existence d'un prêt ; elle prouve uniquement qu'il y a eu un mouvement de fonds entre deux personnes et ne permet pas de déterminer la cause de ce mouvement : prêt, don, remboursement...
Lorsque les liens familiaux entre prêteur et emprunteur sont très étroits (parents et enfants, par exemple), les juges admettent généralement - mais pas toujours - qu'il y a eu impossibilité morale d'établir un écrit. Dans ce cas, le prêteur ne sera pas dispensé de prouver le prêt, mais il pourra en rapporter la preuve par tous moyens : témoignages, présomptions, etc. On notera toutefois que, en pratique, les actions judiciaires intentées par les prêteurs ayant négligé de se constituer une preuve écrite du prêt sont rarement couronnées de succès.
Il est évidemment toujours possible de s'adresser à un notaire pour lui faire établir un contrat de prêt (c'est obligatoire si l'on souhaite prendre une hypothèque sur les biens de l'emprunteur pour garantir le remboursement du prêt).
Mais il est plus rapide et surtout plus économique de faire soi-même un acte sous seing privé. On peut alors choisir de rédiger soit un contrat de prêt signé par les deux parties, soit une simple reconnaissance de dette signée par le seul emprunteur. Dans ce dernier cas, il faut indiquer dans l'acte que la reconnaissance de dette est la conséquence du prêt effectué. Pour davantage de sécurité juridique, l'acte sous seing privé peut être contresigné par un avocat. L'emprunteur ne pourra pas contester ultérieurement son engagement.
Que l'acte sous seing privé soit contresigné par avocat ou non, il peut être utile si le prêt est important de procéder à l'enregistrement de l'acte. Moyennant un coût modique (droit fixe de 125 €), le contrat de prêt ou la reconnaissance de dette aura date certaine, ce qui établira sans contestation possible par les tiers - notamment l'administration fiscale - la date à laquelle l'acte a été dressé. L'enregistrement permettra par exemple à l'emprunteur qui ferait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle de justifier de l'origine des sommes portées sur ses comptes et d'échapper à leur taxation à l'impôt sur le revenu. L'enregistrement s'effectue dans n'importe quel service des impôts des entreprises (pôle d'enregistrement).
Je soussigné Joël Martin, né le 15 décembre 1970 à Paris 16e , domicilié 42 rue de Villiers à Levallois-Perret, reconnais devoir à ma soeur Laure Martin, née le 24 mars 1965 à Paris 16e , domiciliée 54 rue du Maréchal Leclerc à Romagnat, la somme de 12 000 € (douze mille euros) qu'elle m'a prêtée le 20 mai 2015 par remise du chèque... (indiquer date, no du chèque et coordonnées de la banque) (ou par virement bancaire ou postal : indiquer date et références de l'opération).
(Le cas échéant : en cas de décès, mes héritiers seront tenus de façon solidaire et indivisible au remboursement de ma dette).
Je m'engage à lui rembourser cette somme au plus tard le 20 mai 2016 (ou selon l'échéancier suivant), le tout sans intérêt (ou bien majorée d'un intérêt au taux de... %).
Fait à Paris, le 20 mai 2015, en un exemplaire (ou en deux exemplaires, dont l'un pour l'enregistrement).
Signature
Après remboursement du prêt (et, le cas échéant, des intérêts), le prêteur remettra à son emprunteur l'original de la reconnaissance de dette ou lui adressera une quittance.
Si l'emprunteur ne rembourse pas, le prêteur devra commencer par lui adresser une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec avis de réception. Si l'emprunteur ne s'exécute toujours pas, le prêteur muni d'un écrit prouvant le prêt pourra obtenir du juge une injonction de payer.
Si le prêt a été consenti avec intérêts, et sauf exception pour certains prêts consentis en 2006 et 2007, les intérêts sont imposables à l'impôt sur le revenu comme des revenus de créances, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au taux forfaitaire de 24 % si le total des produits de placement à revenu fixe (intérêts, obligations, etc.) perçus dans l'année par le foyer fiscal du prêteur ne dépasse pas 2 000 € (CGI art. 125 A). Lors de leur versement, les intérêts sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire au taux de 24 % (auquel s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux), qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 25 000 € (pour les personnes seules) ou 50 000 € (pour les personnes soumises à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement. C'est l'emprunteur qui paie le prélèvement, au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement des intérêts, auprès du service des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand (sauf les versements supérieurs à 1 500 €, qui doivent être virés directement sur le compte du Trésor public à la Banque de France). Ce versement doit être accompagné d'une déclaration no 2777. L'emprunteur doit en principe déclarer les intérêts qu'il a versés, sur un imprimé no 2561 dit IFU, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle du paiement des intérêts.
Si le prêteur est imposable à l'ISF, il reste taxable sur les sommes prêtées (ce sont des créances) ainsi que, le cas échéant, sur les intérêts dus au 1er janvier et qui ne lui auraient pas encore été payés.
En principe, même consentis sans intérêt et qu'il y ait eu ou non rédaction d'un acte, tous les prêts d'un montant supérieur à 760 € doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, sur un imprimé no 2062 que l'emprunteur doit adresser au service des impôts en même temps que sa déclaration de revenus (l'imprimé 2062 est téléchargeable, mais pas télétransmissible). L'amende encourue en cas de non-déclaration est de 150 €.
Si le prêteur décède avant d'avoir été remboursé, la somme qui lui reste due (majorée le cas échéant des intérêts) constitue une créance à porter à l'actif de sa succession. Au terme convenu, ses héritiers seront en droit d'en exiger le remboursement auprès de l'emprunteur. Si l'emprunteur est lui-même un héritier du prêteur, il n'est en principe pas tenu de rembourser effectivement ce qu'il doit : sa dette vient en diminution de sa part dans la succession.
Si c'est l'emprunteur qui décède en cours de prêt, sa dette est portée au passif de sa succession. Attention cependant : si le prêteur est un héritier de l'emprunteur, la somme non remboursée ne sera déductible pour le calcul des droits de succession que s'il a été établi une reconnaissance de dette ou un contrat de prêt et que cet acte a été enregistré avant le décès de l'emprunteur.
La dette est transmise aux héritiers de l'emprunteur, mais le prêteur ne pourra se faire payer pour le tout par un seul d'entre eux que si la reconnaissance de dette ou le contrat de prêt a prévu une clause de solidarité et d'indivisibilité entre les héritiers de l'emprunteur. Si tel n'est pas le cas, le prêteur devra diviser ses poursuites. Par exemple, s'il y a deux enfants, il ne pourra réclamer à chacun que la moitié de son dû.
Mettre gratuitement à la disposition, d'un enfant le plus souvent, un appartement ou une maison dont on est propriétaire est chose courante. Mais l'opération, baptisée par les juristes de « prêt à usage », n'est pas sans risques. Selon que certaines dispositions ou précautions auront ou non été prises, il sera plus ou moins facile pour le prêteur de récupérer son bien et pour le bénéficiaire (ou son ex-conjoint ou concubin, le cas n'est pas rare) de rester dans les lieux.
Formaliser le prêt par un écrit n'est pas obligatoire, mais nous le conseillons. Faire appel à un notaire pour le rédiger (et le faire enregistrer au service des impôts) peut s'avérer judicieux.
Le premier est celui de la durée du prêt. Si le prêt est à durée déterminée (exemples : cinq ans à compter du 1er juillet 2015 ; au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020), l'emprunteur devra restituer le logement mis à sa disposition à l'échéance. Le propriétaire pourra demander au juge qu'il soit mis fin au contrat avant l'échéance mais, pour obtenir gain de cause, il devra démontrer qu'il a un besoin pressant et imprévu du logement (C. civ. art. 1889).
Si aucune durée n'a été fixée, la situation de l'occupant est des plus fragile : le prêteur pourra mettre fin au prêt à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis « raisonnable » (notamment, Cass. 1e civ. 3-6-2010 no 09-14.633). Il n'aura pas à démontrer qu'il a besoin du logement. Une occupante au RSA a ainsi dû restituer à son père, qui ne faisait état d'aucune difficulté financière particulière, l'appartement dont il était propriétaire (Cass. 1e civ. 10-5-2005 no 02-17.256 : Bull. civ. I no 204).
AttentionEn cas de décès du prêteur ou de l'emprunteur, un prêt de logement continue en principe jusqu'à l'échéance prévue (C. civ. art. 1879). Si le prêt est consenti pour une durée assez longue, il est conseillé de prévoir dans la convention qu'elle a été conclue en considération de la personne de l'emprunteur, et que le prêt lui est fait personnellement. En cas de décès de l'emprunteur, le propriétaire pourra ainsi récupérer immédiatement son logement.
Deuxième point à surveiller, les obligations de l'emprunteur. Sauf précision contraire dans la convention, l'emprunteur doit occuper lui-même le logement. Il ne peut pas le louer, ni le transformer en local professionnel.
L'emprunteur doit veiller à la bonne conservation du logement. S'il effectue des dépenses d'entretien ou d'amélioration sur le bien, il ne peut pas en demander le remboursement (seules lui sont remboursables les dépenses tellement urgentes qu'il n'aurait pas pu en prévenir le prêteur, et encore à la condition que ces dépenses soient « extraordinaires et nécessaires ») (C. civ. art. 1890).
L'emprunteur devra restituer le logement en bon état. En cas de dégradation (ou de destruction !), il ne pourra échapper à sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
Généralement, l'emprunteur est également responsable des dommages causés aux tiers (fuites d'eau, incendie propagé aux logements voisins, etc.).
Pour toutes ces raisons, il faut veiller à ce que l'emprunteur soit bien assuré, ce qui ne dispense pas le prêteur de continuer à s'assurer en sa qualité de propriétaire non occupant.
Dernier point d'attention : la prise en compte de l'avantage consenti à l'enfant logé gratuitement lors du règlement de la succession de ses parents. Cet avantage (économie de loyers) ne sera qu'exceptionnellement rapportable à la succession, car la Cour de cassation exige que les frères et soeurs qui demandent que les loyers économisés par celui qui a profité du logement viennent s'imputer sur sa part de succession prouvent l'intention libérale de leurs parents (trois arrêts, Cass. 1e civ. 18-1-2012 nos 10-25.685, Cass. 1e civ.10-27.325 et Cass. 1e civ.11-12.863 : Bull. civ. I nos 7, 8 et 9 ; Cass. 1e civ. 24-9-2014 no 12-27.241). Or, cette preuve est difficile à apporter en pratique. Il a notamment été jugé que l'intention libérale n'est pas établie lorsque la mise à disposition gratuite du logement a eu pour contrepartie la prise en charge par l'enfant de l'ensemble des charges du logement (Cass. 1e civ. 30-1-2013 no 11-25.386).
Pour éviter tout litige à leur décès, les parents ont donc tout intérêt à formaliser dans un acte leurs intentions quant au rapport de l'avantage consenti. Ils peuvent par exemple rédiger un testament dans lequel ils dispenseront expressément leur enfant de son obligation au rapport.
Entre les soussignés :
Monsieur Anatole Commodat, né le 25 janvier 1951 à Paris 15e , domicilié 12 rue Monge à Paris 5e ,
Et Mademoiselle Laure Commodat, née le 24 mars 1987 à Paris 15e , domiciliée à la même adresse,
Il est convenu ce qui suit :
Conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil, monsieur Commodat consent à mettre gratuitement à la disposition de sa fille Laure, qui accepte, un studio situé 36 rue des Bernardins, Paris 5e (appartement no 6, situé au 1er étage gauche, y compris la cave no 22).
Le présent accord est intervenu sous les charges et conditions suivantes que mademoiselle Commodat s'engage à exercer et à accomplir :
Comme condition essentielle et déterminante des présentes, sans laquelle cette convention n'aurait pas été accordée par monsieur Commodat, il est expressément stipulé que l'occupation de ces biens par mademoiselle Commodat aura lieu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 mai 2020 et à titre précaire.
Mademoiselle Commodat n'aura aucun préavis à respecter si elle entend libérer le studio avant cette date.
De son côté, monsieur Commodat pourra reprendre possession à tout moment de son studio, mais il s'engage dans ce cas à prévenir mademoiselle Commodat au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception.
Mademoiselle Commodat reconnaît prendre le studio en bon état d'entretien. Elle s'engage à l'entretenir et à le rendre en bon état en fin d'occupation.
Mademoiselle Commodat devra laisser monsieur Commodat ou les entrepreneurs ou ouvriers entrer dans l'appartement pour l'exécution de travaux ou autre raison (par exemple, visite des lieux par d'éventuels acheteurs, si l'appartement devait être vendu).
Mademoiselle Commodat ne pourra faire aucun percement de mur ni changement quelconque dans la distribution de l'appartement sans l'accord de monsieur Commodat.
(Le cas échéant) Mademoiselle Commodat remboursera à monsieur Commodat la totalité des charges de copropriété (y compris pour la partie afférente aux travaux à réaliser dans l'immeuble).
Mademoiselle Commodat devra acquitter toutes ses contributions personnelles (contrats d'abonnement à l'électricité, au gaz, etc. ; taxe d'habitation), de manière que monsieur Commodat ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
Mademoiselle Commodat ne pourra en aucun cas céder à qui que ce soit les droits qui lui sont accordés à titre tout à fait personnel par la présente convention. Toute cession serait nulle de plein droit. En cas de décès de mademoiselle Commodat, ses héritiers devront restituer immédiatement l'appartement à monsieur Commodat.
Mademoiselle Commodat devra assurer et maintenir assuré l'appartement pendant toute la durée de l'occupation contre tous dommages causés au bien prêté, à des tiers ou à des biens leur appartenant. Elle acquittera les primes et justifiera du tout à toute réquisition et, dans un premier temps, elle remettra une copie de la police d'assurance à monsieur Commodat, dès qu'elle sera en sa possession.
Fait à Paris, le 31 mai 2015
Signatures
Etabli en deux exemplaires (ou en trois exemplaires, dont un pour l'enregistrement).
Le prêt ne procurant aucun revenu au propriétaire, ce dernier ne peut pas déduire les charges afférentes au logement des revenus fonciers qu'il percevrait par ailleurs.
Il reste redevable de la taxe foncière mais ne doit plus la taxe d'habitation, qui est due par celui qui occupe le logement au 1er janvier.
Le propriétaire du bien prêté doit le comprendre dans son patrimoine imposable à l'ISF. Le fait que le logement soit prêté permet-il au propriétaire de minorer la valeur déclarée ? A notre avis oui, avec une décote d'autant plus forte que la perspective de récupération est éloignée.
Toute personne de nationalité française peut demander une carte nationale d'identité. Elle est gratuite. Sa durée de validité est de 15 ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de 10 ans lorsqu'elle concerne un mineur.
La carte d'identité n'est pas obligatoire mais elle permet de justifier de son identité, par exemple lors de l'émission d'un chèque ou d'un contrôle d'identité, ou de voyager dans les pays qui n'exigent pas de passeport.
Les cartes d'identité sécurisées (plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures à la date de leur délivrance restent valides 5 ans après la date d'expiration qu'elles mentionnent. Ainsi, une carte d'identité dont la date de fin de validité est le 20 avril 2014 reste valable jusqu'au 20 avril 2019.
En cas de voyage à l'étranger avec une carte dont la date de validité est expirée depuis moins de 5 ans, il est possible de se munir d'une notice multilingue expliquant la prolongation automatique de la durée de validité de la carte (notice téléchargeable sur le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs » sur la fiche des pays acceptant la carte d'identité). Mais certains pays n'acceptant pas les cartes d'identité dont la validité est prolongée, mieux vaux utiliser un passeport.
Il faut remplir un formulaire de demande de carte d'identité en s'adressant :
- à Paris, à l'antenne de la préfecture de police de l'arrondissement de son choix ou au service central de la préfecture situé 12 quai de Gesvres dans le 4e arrondissement ;
- en province, à la mairie du domicile ou, pour certaines communes, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Attention, dans certaines mairies, le dépôt du dossier se fait uniquement sur rendez-vous. La présence du demandeur est obligatoire pour remplir le formulaire (il faut apposer une empreinte digitale). Celle des enfants est également requise pour l'établissement d'une carte à leur nom. Précisons cependant que certaines mairies dispensent les enfants de moins de 13 ans de se présenter.
Les documents à fournir à l'appui de la demande sont les suivants :
- pour les personnes qui possèdent un passeport sécurisé (électronique ou biométrique) ou récent (valide ou périmé depuis moins de 2 ans) : le passeport, deux photos d'identité et un justificatif de domicile ;
- pour les demandeurs non détenteurs d'un passeport sécurisé ou récent, il faut présenter en plus un acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou copie intégrale) et un justificatif de nationalité française si cet extrait ne permet pas d'établir la nationalité française. Le justificatif de nationalité française peut être, au choix : la déclaration de nationalité française enregistrée, la copie du décret de naturalisation ou de réintégration ou l'exemplaire du Journal officiel dans lequel le décret a été publié, ou deux documents distincts indiquant que le demandeur ou l'un de ses parents a été considéré depuis au moins 10 ans comme Français par les pouvoirs publics.
Pour les enfants mineurs non émancipés, s'ajoute à ces documents un formulaire d'autorisation parentale rempli par l'un des parents investi de l'autorité parentale.
Le délai d'obtention de la carte est variable selon le lieu de la demande. Le demandeur peut savoir où en est sa demande à partir du numéro qui lui est remis lors du dépôt de son dossier (excepté à Paris). Le retrait de la carte s'effectue là où a été déposée la demande. La présence du demandeur est obligatoire, de même que celle des enfants pour lesquels une carte d'identité a été demandée.
Il s'effectue le plus souvent lorsque la carte est périmée, soit 15 ans après sa délivrance pour une personne majeure et 10 ans pour un mineur. Il est également possible de demander le renouvellement d'une carte d'identité en cours de validité en cas de changement d'adresse ou d'état civil. La nouvelle carte indiquera par exemple, en plus du nom de famille, le nom d'usage de son titulaire ou portera la mention « épouse X » (ou supprimera cette mention). Les cartes d'identité des enfants peuvent également être renouvelées pendant leur période de validité, en vue d'en « rajeunir » la photographie : la présence de leur représentant légal est obligatoire.
Il faut remplir le formulaire de demande de carte nationale d'identité et présenter sa carte (faute de quoi le renouvellement est payant : droit de timbre de 25 € en timbre fiscal), deux photos, un justificatif de domicile et, le cas échéant, les pièces justifiant la modification (par exemple, livret de famille). Si la carte d'identité n'est pas sécurisée et est périmée depuis plus de 5 ans, le demandeur doit fournir en plus un passeport sécurisé (biométrique ou électronique) valide ou périmé depuis moins de 5 ans ou un passeport non sécurisé valide ou périmé depuis moins de 2 ans. Si le demandeur n'en a pas, un acte de naissance de moins de 3 mois (extrait avec filiation ou copie intégrale) et, le cas échéant, un justificatif de nationalité française sont exigés.
SavoirLa perte ou le vol de la carte d'identité doivent être déclarés au commissariat de police ou à la gendarmerie du lieu concerné (aux autorités de police locales et au consulat de France le plus proche à l'étranger), ou directement à la mairie si vous demandez une nouvelle carte (uniquement en cas de perte). Les imprimés de déclaration de perte et de demande de renouvellement de la carte d'identité peuvent être préremplis en ligne sur le site www.mon.service-public.fr. Pour l'établissement d'une nouvelle carte, il faut fournir les mêmes documents que pour le renouvellement d'une carte périmée plus la déclaration de vol ou de perte et un timbre fiscal de 25 €.
Pour voter, il faut avoir 18 ans, être Français, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales avant (en principe) le 31 décembre de l'année qui précède le scrutin.
Par exception, les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes à condition (C. élect. art. LO 227-1 et C. élect.LO 227-2 ; Loi 77-729 du 7-7-1977 art. 2-1 et 2-2) :
- d'avoir leur domicile réel en France et d'y résider de façon continue ;
- de ne pas être privés du droit de vote dans leur pays d'origine.
Les jeunes qui atteignent 18 ans entre le 1er mars de l'année en cours et le 28 (ou le 29) février de l'année suivante sont inscrits automatiquement sur les listes électorales. En 2015, sont concernés les jeunes atteignant 18 ans entre le 1er mars 2015 et le 28 février 2016. L'adresse prise en compte pour l'inscription est celle qui a été indiquée lors du recensement (no 67112).
Ceux qui ne bénéficient pas de l'inscription automatique ou les personnes qui ont déménagé depuis leur inscription doivent s'inscrire volontairement sur les listes électorales. L'obligation d'établissement dans la commune n'est subordonnée à aucune condition de durée (Cass. 2e civ. 29-4-2014 no 14-60.489 : Bull. civ. II no 102). Cette démarche peut être effectuée pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre auprès de la mairie :
- soit de la commune de son domicile (ou de sa résidence à condition d'y habiter de manière effective et continue depuis au moins six mois) ;
- soit d'une commune où l'on paye des impôts locaux depuis au moins cinq ans, par exemple celle de sa résidence secondaire.
Bien entendu, on ne peut s'inscrire que dans une seule commune.
Les personnes qui résident à l'étranger peuvent s'inscrire à la mairie de la commune :
- de leur naissance ;
- de leur dernier domicile ;
- dans laquelle elles payent des impôts locaux depuis au moins cinq ans ;
- où est né, est inscrit, ou a été inscrit l'un de leurs ascendants ;
- où est inscrit l'un de leurs parents jusqu'au 4e degré.
Il faut fournir les documents suivants :
- une pièce d'identité valide ou expirée depuis moins d'un an (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) ;
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture EDF, facture de téléphone, etc.) ou un certificat d'inscription au rôle des impôts locaux de la commune. L'enfant domicilié chez ses parents doit fournir une attestation de ses parents certifiant qu'il habite bien avec eux, ainsi qu'un justificatif de leur domicile ;
- le cas échéant, un certificat de nationalité française.
Vous pouvez déposer personnellement ces documents à la mairie, les adresser par courrier (de préférence en recommandé avec avis de réception) ou demander à un tiers de le faire à votre place en lui remettant une procuration sur papier libre. Doit être joint le formulaire cerfa no 12669*01 de demande d'inscription sur les listes électorales (disponible en mairie et sur le site service-public.fr). Dans certaines communes, la demande d'inscription sur les listes électorales peut être effectuée par Internet sur le site mon.service-public.fr.
Elle porte les mentions figurant sur la liste électorale (nom et prénoms, date et lieu de naissance), le numéro d'inscription sur la liste et le bureau de vote. La carte est envoyée automatiquement au domicile de toutes les personnes inscrites sur les listes électorales. Elle est valable jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle carte.
La carte n'est pas indispensable pour voter (la carte d'identité suffit).
C'est possible sous réserve de remplir, le jour du scrutin, une des conditions suivantes (C. élect. art. L 71 à C. élect.L 74) :
- être dans l'impossibilité de se rendre aux urnes en raison d'obligations professionnelles ou de formation ;
- être en vacances loin de son domicile ;
- ne pas pouvoir se déplacer en raison de son état de santé ou de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme ;
- résider dans une commune différente de celle dans laquelle on est inscrit et ne pas pouvoir être présent dans sa commune d'inscription le jour du scrutin.
Le mandataire, c'est-à-dire celui à qui la procuration est donnée, doit jouir de ses droits électoraux. Il doit voter dans la même commune que son mandant (celui qui donne la procuration), mais pas nécessairement dans le même arrondissement ni dans le même bureau de vote. Le mandataire devra se rendre dans le bureau de vote de son mandant pour voter à sa place. Un même mandataire ne peut recevoir qu'une seule procuration (deux si l'une est établie à l'étranger).
Pour établir la procuration, il faut se présenter, selon les communes, soit au tribunal d'instance, soit à la gendarmerie, soit au commissariat de police de son domicile ou de son lieu de travail, muni d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.). Le formulaire de procuration de vote (Cerfa no 14952*01) est disponible sur le site www.service-public.fr. Il peut être rempli depuis son ordinateur, mais certaines rubriques (lieu, date et heure d'établissement de la procuration, identité de l'autorité habilitée, signatures) doivent être remplies de façon manuscrite devant l'autorité habilitée à recevoir la procuration. Une fois rempli, le formulaire doit être imprimé sur deux feuilles (impression recto-verso interdite). Pour ceux qui ne disposent pas d'ordinateur, il est toujours possible d'utiliser les formulaires cartonnés disponibles auprès des autorités compétentes.
Les personnes hors d'état de se déplacer peuvent demander par écrit, en joignant un certificat médical ou un justificatif de leur infirmité, qu'un officier de police judiciaire se déplace à leur domicile pour établir la procuration. Selon les communes, la demande est à adresser au tribunal d'instance, à la gendarmerie ou au commissariat de police.
Attention, bien qu'aucune date limite ne soit prévue pour établir une procuration de vote, il faut prévoir un délai suffisant pour que la procuration puisse parvenir au bureau de vote avant le scrutin. La procuration est adressée au maire de la commune dans laquelle est inscrit celui qui a donné la procuration.
En principe, la validité d'une procuration est limitée à une seule élection (plusieurs si elles se déroulent le même jour). Le mandant indique si la procuration concerne le premier tour, le second ou les deux tours. Par exception, la durée de validité d'une procuration peut être portée à un an si son auteur justifie ne pas pouvoir se rendre dans son bureau de vote de façon prolongée (en raison d'un déplacement professionnel de longue durée, par exemple). Elle peut être portée à trois ans pour les Français résidant à l'étranger.
Une procuration peut être résiliée à tout moment. Il suffit de se présenter à l'endroit où la procuration a été établie et de remplir un formulaire. Il est alors possible de désigner un nouveau mandataire. A défaut de résiliation formelle, il est également possible de se rendre à son bureau de vote pour y voter personnellement (encore faut-il arriver avant son mandataire...).
Pourquoi faut-il conserver certains documents ? Pour disposer d'éléments de preuve et être ainsi en mesure de faire valoir ses droits ou de se défendre. Par exemple, le propriétaire d'une maison peut demander la garantie du constructeur en se fondant sur le contrat d'entreprise ; l'emprunteur peut justifier avoir remboursé ce qu'il devait en fournissant les relevés de son compte bancaire mentionnant les débits correspondant aux remboursements ; le salarié peut prouver la réalité de son activité professionnelle grâce à ses feuilles de paie, etc.
Combien de temps faut-il conserver les documents ? Tout dépend du droit que ces documents établissent et de la prescription applicable en la matière. Le délai de prescription est le temps durant lequel il est possible de former une réclamation. Ainsi, le paiement d'un loyer pouvant être réclamé pendant cinq ans après son échéance, le locataire a tout intérêt à conserver ses quittances (ou tout autre mode de preuve) pendant ce délai.
|
ASSURANCE | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Contrats d'assurance : automobile, multirisques habitation, dommage-ouvrage |
10 ans à compter de la fin du contrat Au-delà si un sinistre reste en cours de règlement |
|
Quittances de paiement des échéances Courriers de résiliation de contrat |
2 ans à compter du paiement ou de la résiliation |
|
Factures des meubles et objets de valeur (bijoux, hi-fi...) |
Tant que les biens assurés sont en votre possession. Les factures permettent de prouver leur existence et leur valeur en cas de vol ou de dégradation. |
|
BANQUE | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Relevés de compte |
En principe 5 ans |
|
Bordereaux de remise de chèques Talons de chèques |
De façon ponctuelle, et à défaut d'autres éléments de preuve, il peut être utile de conserver un relevé de compte ou un bordereau de remise de chèque pendant plus longtemps, par exemple pour faire la preuve d'une donation |
|
Contrats de prêt à la consommation Règlements des mensualités |
2 ans après la dernière échéance |
|
Contrats de prêt immobilier Règlements des mensualités |
2 ans après la dernière échéance |
|
CONSOMMATION | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Factures de gaz et électricité |
5 ans |
|
Factures de téléphone ou d'Internet |
1 an |
|
Factures d'eau |
4 ans si l'eau est distribuée en régie par une commune 2 ans si l'eau est distribuée par une entreprise privée |
|
Factures d'achat ou d'entretien d'objet de valeur modeste (notamment électroménager) |
Le temps de la garantie : en général, entre 1 et 2 ans |
|
FAMILLE | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Livret de famille |
A vie (un duplicata peut être établi en cas de perte) |
|
Contrat de mariage Preuve de l'origine des biens ou des fonds reçus pendant le mariage par donation, testament ou legs |
A vie (au moins jusqu'à la liquidation du régime matrimonial) |
|
Acte de liquidation du régime matrimonial (établi notamment en cas de divorce) |
A vie |
|
Pacs |
A vie |
|
Jugement de divorce, de séparation de corps, d'adoption |
A vie |
|
Justificatifs de versement d'une pension alimentaire |
5 ans après l'échéance |
|
Donation, testament |
A vie |
|
Carnet de santé |
A vie |
|
Dossier médical (radiographies, certificats médicaux, rapports d'expertise, etc.) |
A vie, notamment en cas d'accident ou de problèmes de santé sérieux |
|
IMPOTS | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Déclarations de revenus |
3 ans minimum, délai concernant la déclaration et tous les justificatifs de revenus et de charges (la déclaration des revenus 2014, souscrite en 2015, peut être contrôlée jusqu'au 31 décembre 2017). Ce délai peut être étendu à 10 ans pour certains avoirs à l'étranger. Plus de 3 ans si vous avez bénéficié d'un avantage fiscal lié au respect d'un engagement sur une certaine durée (location pendant 9 ans pour le régime Duflot, etc.) ou lorsque vous reportez des déficits (facture à l'origine d'un déficit foncier, etc.). De plus, il est nécessaire de conserver bien au-delà du délai de 3 ans tous documents de nature à justifier les revenus déclarés, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Par exemple, l'administration vous demande en 2015 de justifier d'une somme importante portée au crédit d'un de vos comptes en 2012. Cette somme correspond au remboursement d'un prêt que vous avez consenti à un ami en 2000. Vous devrez apporter - et donc avoir conservé - toutes justifications de ce prêt. |
|
Déclarations d'ISF |
7 ans, soit l'année de la déclaration et les 6 années suivantes, voire 10 ans pour certains avoirs à l'étranger. Si vous déclarez votre patrimoine directement sur votre déclaration de revenus, 3 ans suffisent à condition que vous répondiez de façon suffisamment précise et détaillée aux éventuelles demandes de l'administration. Attention : si vous ne souscrivez pas de déclaration d'ISF alors que vous êtes proche du seuil d'imposition, gardez pendant 7 ans tous les documents permettant d'évaluer votre patrimoine au 1er janvier. |
|
Déclarations de succession |
7 ans, soit 6 années à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès (pour un décès survenu le 5 janvier 2015, l'administration peut contrôler la déclaration jusqu'au 31 décembre 2021). Ce délai peut être étendu à 10 ans pour certains avoirs à l'étranger. |
|
LOGEMENT | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Acte de propriété |
Au moins jusqu'à la revente du bien |
|
Règlement de copropriété |
Au moins jusqu'à la revente du bien |
|
Procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété |
10 ans à compter du procès-verbal |
|
Décompte de charges et appels de fonds |
10 ans à compter de la mise en recouvrement des charges |
|
Contrat de location et état des lieux |
5 ans après la fin du bail |
|
Quittances de loyer |
5 ans à compter de l'échéance |
|
Devis et factures de travaux immobiliers |
2 ans ou 10 ans à compter de la réception des travaux selon que ceux-ci relèvent de la garantie biennale ou décennale de l'entrepreneur Dans le doute, 10 ans |
|
VIE PROFESSIONNELLE | |
|---|---|
|
Documents à conserver |
Délai de conservation |
|
Diplômes |
A vie |
|
Contrats de travail |
Jusqu'à la retraite |
|
Feuilles de paie |
A vie (les feuilles de paie sont utiles pour reconstituer une carrière et établir ses droits à retraite) |
|
Décomptes de points de retraite |
A vie (par précaution, à conserver même après la liquidation de votre retraite) |
Les temps changent. Le « bon vieux » document papier est remplacé peu à peu par sa forme numérique (e-mails, factures en ligne, photos, etc.) et les cartons d'archives par des supports modernes. Il n'en demeure pas moins que la conservation des documents électroniques n'est pas toujours aussi acquise qu'on le voudrait. Les enregistrer sur son ordinateur n'empêche pas leur disparition définitive en cas de crash du disque dur. Les copies sur CD ou DVD ne sont pas éternelles, leur durée de vie étant limitée à environ 10 ans. Devant ce constat, un support de conservation sécurisée des données : le coffre-fort numérique.
Le coffre-fort numérique personnel est un service hautement sécurisé (adresses https) accessible en ligne via Internet, proposé par des prestataires de plus en plus nombreux (Allianz Protect, E-Coffrefort, Coffre-fort MMA, SécuriBox...) et permettant d'archiver dans un même endroit l'ensemble de ses documents électroniques. Il faut compter entre 3 et 9 € par mois selon la capacité de stockage pour ouvrir un coffre-fort chez un prestataire (certains services sont parfois gratuits mais très limités en taille de stockage). Une fois créé, l'accès à l'espace personnel se fait grâce à un identifiant et un mot de passe qui vous permettent de vous connecter, où que vous soyez, 24 heures sur 24.
Les fichiers sont envoyés directement de l'ordinateur personnel vers le coffre-fort. La rapidité du transfert dépend de la taille des fichiers. Les documents « papier » devront être préalablement scannés (ce service est proposé en plus par certains prestataires). L'ensemble peut ensuite être classé par catégorie : logement, travail, factures, etc. Le prestataire propose en principe un mode de classement par défaut qui peut évidemment être modifié par l'utilisateur.
Tous les prestataires (des petites structures aux grands groupes comme Allianz ou La Poste) proposent une sécurisation optimum, à l'image de celle utilisée dans les banques ou les grandes entreprises. Les documents sont cryptés avant d'être stockés dans deux centres informatiques géographiquement distincts et protégés contre les intrusions ou les incendies. Les serveurs d'hébergement sont régulièrement sauvegardés dans un troisième site.
Il est conseillé de choisir un mot de passe difficile à deviner et différent de ceux utilisés pour d'autres comptes. Il est également recommandé de conserver une copie de ses documents sur son ordinateur.
Posséder un coffre-fort numérique ne dispense surtout pas de conserver certains documents originaux, notamment ceux des papiers signés (contrats de travail ou d'assurance auxquels la signature confère une valeur juridique). Mais il peut être utile d'en faire une copie numérique : en cas de disparition de l'original, la version numérique du document est valable, sauf si son existence ou son contenu sont contestés (par l'employeur pour un contrat de travail, par l'assureur pour un contrat d'assurance). En cas de litige, le juge peut décider de prendre le document numérique en considération ou, au contraire, de le rejeter s'il existe un doute sur son authenticité.
Comme pour tous les services en ligne, la prudence et la vigilance de l'utilisateur sont de mise, la loi ou la technique ne réglant pas tous les problèmes. Cependant, la fiabilité certaine du coffre-fort numérique pousse de plus en plus d'entreprises à faire appel à ce support, par exemple pour déposer les bulletins de paie de leurs salariés. Les administrations, les assureurs devraient suivre. Le coffre-fort numérique semble avoir de beaux jours devant lui.
SavoirUn service de coffre-fort numérique étant un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, il doit être déclaré à la Cnil avant sa mise en oeuvre. En cas de transfert en dehors de l'Union européenne des données stockées par les utilisateurs, le prestataire doit solliciter l'autorisation de la Cnil (Délibération de la Cnil 2013-270 du 19-9-2013). La Cnil recommande aux fournisseurs de service de coffre-fort électronique :
- de mettre en place des mesures de sécurité (chiffrage des données, limitation de l'accès aux documents stockés au seul utilisateur du coffre-fort, impossibilité pour le fournisseur d'accéder aux données ou de les réutiliser) ;
- de s'engager sur la pérennité du stockage (information suffisamment à l'avance de l'utilisateur en cas de fermeture du service, mise en place de garanties pour prévenir toute perte de données). Si l'utilisateur décide de supprimer des documents de son espace personnel, l'opération doit être prise en compte immédiatement et les éventuelles sauvegardes des données ne doivent pas être conservées au-delà d'un mois ;
- d'informer clairement l'utilisateur sur le type d'espace mis à sa disposition et ses conditions d'utilisation, sur l'identité du responsable du service, sur les éventuels transferts de données à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, etc.
L'Etat, les communes, les départements, les régions et tous les établissements publics ou chargés d'une mission de service public doivent permettre un large accès aux documents qu'ils établissent.
Ce droit d'accès est en principe ouvert à tous, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif particulier (Loi 78-753 du 17-7-1978). Toute personne peut par exemple demander à avoir accès à des documents d'urbanisme tels les plans locaux d'urbanisme, aux documents remis par les associations lors de leur déclaration en préfecture, aux délibérations des conseils municipaux, etc.
L'accès aux documents mettant en cause des personnes en particulier est toutefois réservé aux intéressés ou à leur mandataire. C'est le cas par exemple des dossiers des agents publics, des dossiers fiscaux des contribuables ou encore des dossiers médicaux.
Tout simplement en le demandant à l'administration concernée, par courrier recommandé avec avis de réception. L'intéressé doit préciser s'il souhaite consulter le document sur place, en obtenir une copie par courriel et sans frais (possible uniquement si le document est disponible sous forme électronique) ou en obtenir une copie papier, qui sera à ses frais. Lorsqu'elle communique par voie électronique, l'administration n'est pas tenue d'utiliser un logiciel autre que celui qu'elle utilise habituellement. Si le demandeur ne peut pas accéder aux documents transmis faute de disposer d'un équipement informatique compatible, il n'aura d'autre choix que d'en demander une copie papier, à ses frais...
Si l'administration refuse de communiquer le document demandé ou si elle ne répond pas dans le mois qui suit la réception de la demande (ce qui équivaut à un refus tacite), il est possible de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) dans les deux mois du refus par lettre, télécopie ou courriel (Décret 2005-1755 du 30-12-2005 art. 17). Le recours à la Cada est un préalable obligatoire à toute procédure contentieuse. Il est gratuit.
Homère Lerouge
18 rue des Platanes
33000 Bordeaux
Commission d'accès aux documents administratifs
35 rue Saint Dominique
75700 PARIS
A Bordeaux, le 30 juin 2015
Courrier recommandé avec avis de réception
Monsieur le Président,
Le 14 mai 2015, j'ai demandé la communication des délibérations du conseil municipal de Trifouilli-les-Oies en date du 16 mars 2015. Je n'ai reçu aucune réponse à ce jour.
Je saisis par conséquent votre Commission d'une demande d'avis sur le refus opposé par la mairie de Trifouilli-les-Oies.
Dans l'attente de l'avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération.
Signature
PJ : copie de la demande adressée à la mairie et restée sans réponse.
La Cada a en principe un mois à compter de la demande pour faire connaître son avis (en pratique, compter plutôt deux mois). Elle peut :
- rendre un avis favorable à la communication du document demandé. C'est le cas le plus fréquent ;
- rendre un avis défavorable, par exemple si le document n'est pas un document administratif ;
- se déclarer incompétente parce que la demande ne relève pas de ses attributions ;
- considérer que la demande n'est pas recevable, notamment si elle a été présentée hors délai.
Les avis de la Cada ne sont pas contraignants. Même si c'est rare en pratique, l'administration n'est donc pas obligée de s'y conformer. Dans ce cas, une seule solution : saisir le juge administratif.
Célèbre ou inconnue, toute personne a en principe sur son image un droit exclusif et absolu qui lui permet de s'opposer à sa fixation, à sa reproduction et à son utilisation sans son autorisation expresse.
Tous les modes de reproduction et de diffusion de l'image sont concernés : photographies dans la presse ou sur Internet, dessins, films...
La protection de l'image joue non seulement dans les lieux privés, mais également dans les lieux publics. Est par exemple illicite la publication des photographies de deux célébrités prises lors d'un tournoi de tennis, dès lors que les photos ont été faites à l'insu des intéressés et avec un cadrage les isolant du public environnant (Cass. 2e civ. 10-3-2014 no 01-15.322 : Bull. civ. II no 117) ; s'il est possible de photographier une foule, les individus qui la composent ne doivent pas être pris en gros plan.
Pour que l'image soit protégée, il n'est pas nécessaire que le visage soit reconnaissable ; il suffit que la personne soit identifiable. Constitue par exemple une atteinte au droit à l'image le fait de filmer sans leur autorisation des salariés sur leur lieu de travail, même si leur visage est dissimulé, dès lors que la boutique et l'enseigne où ils ont été filmés sont facilement reconnaissables. En revanche, ne constitue pas une atteinte à l'image la reproduction sans autorisation, sur l'emballage de morceaux de sucre, de la photographie d'une personne prise lors d'un spectacle de danse dès lors que la taille de trois millimètres sur deux du visage et la mauvaise définition de l'image rendent impossible l'identification (Cass. 1e civ. 5-4-2012 no 11-15.328 : Bull. civ. I no 86).
Enfin, le droit à l'image protège non seulement contre les prises de vue effectuées sans autorisation mais également contre l'utilisation détournée d'une photographie prise avec le consentement du sujet. Cette utilisation détournée est reconnue chaque fois qu'une photographie est publiée pour un objet autre que celui pour lequel l'autorisation avait été donnée. Peuvent par exemple demander des dommages-intérêts les parents qui ont autorisé que leurs enfants participent à une émission de télévision pour le Téléthon si, deux ans après, un cliché pris pendant cette émission est reproduit dans un manuel scolaire pour illustrer un passage sur le Téléthon et les maladies héréditaires (Cass. 1e civ. 14-6-2007 no 06-13.601 : Bull. civ. I no 236).
Dans le même ordre d'idées, la personne qui donne son accord pour être filmée dans le cadre de son activité professionnelle peut valablement s'opposer à la diffusion des images de l'altercation qui l'oppose à son employeur pour le paiement de commissions, séquence qui relève non plus de la sphère professionnelle mais de la vie privée (Cass. 1e civ. 24-10-2006 no 04-17.560 : Bull. civ. I no 438).
La personne dont l'image a été divulguée sans son autorisation peut saisir le juge des référés. Celui-ci pourra prendre des mesures pour faire cesser l'atteinte portée à sa vie privée et lui accorder des dommages et intérêts. Il pourra également condamner le coupable à une peine pouvant atteindre 45 000 € d'amende et un an d'emprisonnement (C. pén. art. 226-1).
Le droit à l'image cède le pas devant le droit à l'information. Personne ne peut s'opposer à la prise de son image, ni à sa divulgation, lorsque le public a un intérêt légitime à être informé : le droit à l'information autorise la publication sans autorisation de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité.
A par exemple été jugée licite la publication de clichés représentant :
- la veuve d'un policier tué en service pour illustrer un article consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences pour leurs proches (Cass. 1e civ. 7-3-2006 no 05-16.059 : Bull. civ. I no 140) ;
- trois policiers participant à la reconstitution de faits criminels. Parue sous le titre « Les caïds rejouent leur dernier braquage », la photo illustrait un article d'actualité consacré à cette reconstitution (Cass. 1e civ. 10-5-2005 no 02-14.730 : Bull. civ. I no 206) ;
- un couple lors de différentes manifestations publiques, pour accompagner un article annonçant son mariage (Cass. 2e civ. 8-7-2004 no 02-19.440 : Bull. civ. II no 389).
En revanche, porte atteinte au droit à l'image et à la vie privée le fait :
- d'illustrer un article relatant la remise de l'insigne d'officier des Arts et Lettres à une personnalité du monde médiatique par trois clichés de l'enfant d'une présentatrice du journal télévisé qui n'était pas concerné par l'événement (Cass. 1e civ. 12-7-2006 no 05-14.831 : Bull. civ. I no 401) ;
- de laisser, dans un reportage sur le travail policier montrant un contrôle d'identité, apparaître en premier plan et parfaitement reconnaissable un tiers totalement étranger au sujet (Cass. 1e civ. 5-7-2006 no 05-14.738 : Bull. civ. I no 362) ;
- de publier des clichés d'une personnalité pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée, les photos ne visant qu'à divertir un public indiscret et curieux au prétexte d'un débat d'intérêt général inexistant (Cass. 1e civ. 22-5-2008 no 07-13.165).
Le droit à l'information a notamment les limites suivantes : lorsque la personne concernée n'appartient plus à l'actualité, la possibilité d'exploiter les clichés sans son autorisation cesse ; la liberté d'information ne doit jamais porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; les photographies ne doivent pas montrer de scènes dégradantes ou humiliantes et les articles qui les accompagnent ne doivent pas exploiter l'événement de manière scandaleuse.
Second tempérament à la protection de l'image des personnes : les nécessités de police. Les prises de vues servant à des fins de police sont légales. Il en va ainsi des photographies destinées aux documents officiels ou de celles prises par les radars.
Le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci. Autrement dit, il ne peut pas s'opposer à ce qu'une personne photographie son bien et en exploite l'image. Est par exemple licite la reproduction à des fins commerciales, dans un document publicitaire, d'un hôtel particulier sans l'autorisation de son propriétaire (Cass. ass. plén. 7-5-2004 no 02-10.450 : Bull. civ. ass. plén. no 10).
Cependant, tout n'est pas permis et le propriétaire obtiendra réparation s'il démontre que l'utilisation de l'image de son bien lui cause un trouble anormal ou porte atteinte à sa vie privée :
- la révélation d'informations sur une demeure appartenant à une actrice célèbre, accompagnées de photographies de cette maison prises d'hélicoptère sans aucune autorisation, porte atteinte à la vie privée de cette actrice ;
- la publication d'un cliché d'une maison bretonne cause à sa propriétaire un préjudice moral résultant du surcroît de touristes attirés par la campagne de publicité.
Dans le cadre d'une opération de police judiciaire, un contrôle d'identité peut être effectué à l'égard de toute personne soupçonnée (CPP art. 78-2, al. 1 à 6) :
- d'avoir commis une infraction ou tenté de le faire (par exemple, en voyant un policier, un individu change brusquement de direction ou de trottoir) ;
- de se préparer à commettre un crime ou un délit (ainsi d'une personne qui rôde autour de voitures garées dans un parking, dont on peut suspecter qu'elle s'apprête à commettre un larcin...) ;
- d'avoir été témoin d'un crime ou d'un délit et d'être ainsi susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;
- d'être recherchée par la justice.
Le procureur de la République peut décider d'organiser une opération générale de contrôle d'identité, dans un lieu et pour une durée déterminés, en vue de constater certains types d'infractions (il s'agira, par exemple, de contrôler systématiquement l'identité des personnes dans une station de métro à un horaire précis parce que plusieurs agressions y ont été commises récemment).
On peut également faire l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une opération de police dite « administrative », c'est-à-dire d'une opération visant à prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (c'est typiquement le cas du plan Vigipirate). Ce qui distingue ce type de contrôle d'une opération de police judiciaire, c'est qu'il peut être pratiqué à l'encontre de toute personne quel que soit son comportement (CPP art. 78-2, al. 7).
Enfin, on signalera que l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les zones situées à moins de 20 km (ou plus selon les cas) des frontières des pays qui ont signé la convention de Schengen (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse), ainsi que dans les ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international. Précisons toutefois que, dans cette zone, les contrôles ne peuvent être pratiqués dans un même lieu que pendant six heures consécutives maximum et ne doivent pas consister en un contrôle systématique des personnes qui y circulent (CPP art. 78-2, al. 8).
Seuls un officier de police judiciaire (officiers et gradés de la gendarmerie, commissaires de police, notamment) et, sous sa responsabilité, un agent de police judiciaire y compris adjoint (gendarmes, gardiens de la paix, etc.) ont le pouvoir de contrôler l'identité d'une personne. Dans les zones frontalières énoncées plus haut et celles ouvertes au trafic international, les agents des douanes sont également compétents.
Les policiers municipaux et les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP n'ont en aucun cas la faculté de procéder à un contrôle d'identité. Mais ils peuvent effectuer un « relevé d'identité » afin d'établir un procès-verbal lorsque l'intéressé a commis une infraction (par exemple, voyage sans billet). Si ce dernier ne peut justifier de son identité ou refuse d'obtempérer, le policier ou l'agent peut le retenir jusqu'à ce qu'un officier de police judiciaire - qui doit alors être prévenu - arrive.
Un agent de sécurité privé, dans un grand magasin par exemple, n'a ni le pouvoir de contrôler l'identité ni celui d'en faire un simple relevé.
Lorsqu'une personne est contrôlée, elle peut prouver son identité par tout moyen et pas seulement en produisant sa carte nationale d'identité, son passeport ou son permis de conduire.
On a ainsi parfaitement le droit de présenter une carte professionnelle, une carte de sécurité sociale, une carte d'électeur, une carte d'étudiant, etc. (évidemment, il est préférable que le document comporte une photo).
Il est même possible de faire valoir le témoignage d'un accompagnant. Mais le risque est alors de ne pas être très convaincant...
La personne qui refuse de se plier au contrôle d'identité ou qui n'est pas en mesure de justifier de son identité sera conduite au commissariat ou à la gendarmerie afin de subir une vérification d'identité. Elle peut y être retenue pendant quatre heures (CPP art. 78-3). Après ce délai et même si son identité n'a pu être établie, elle doit en principe être relâchée.
L'officier de police judiciaire procède à une vérification sommaire de l'identité de l'intéressé (il s'agit de vérifier les éléments produits par la personne retenue ou, en cas de silence de celle-ci, de s'assurer qu'elle n'est pas recherchée).
Si la vérification d'identité échoue, on a recours aux techniques de l'identité judiciaire, c'est-à-dire essentiellement à la prise de photos et d'empreintes digitales. De telles mesures doivent être autorisées par le procureur de la République et constituer le seul moyen d'identifier la personne contrôlée. Si l'intéressé refuse, il risque 3 mois de prison et 3 750 € d'amende (CPP art. 78-5).
La constitution de fichiers, notamment commerciaux, et le traitement des informations par voie informatique sont de nature à porter atteinte à la vie privée. C'est pourquoi toute personne a le droit de (Loi informatique et libertés 78-17 du 6-1-1978) :
- savoir si elle est fichée et dans quels fichiers elle est recensée. Celui qui crée ou utilise un fichier contenant des données personnelles doit informer les intéressés notamment de leurs droits, de l'objectif du fichier et des destinataires des informations. Ces informations ainsi que les coordonnées du service compétent pour traiter les demandes d'opposition, du droit d'accès ou d'opposition doivent être indiquées sur le support de collecte et, à défaut, sur un document porté préalablement à la connaissance des intéressés ;
- refuser de figurer dans un fichier. Elle peut ainsi refuser de répondre à un sondage commercial, demander à être radiée, sans frais, d'un fichier commercial... ;
- accéder aux informations qui la concernent. Elle peut interroger le responsable d'un fichier pour savoir si elle y est fichée et, dans l'affirmative, obtenir copie des informations enregistrées ;
- faire rectifier ou effacer des informations qui la concernent. Suite à une demande en ce sens, le responsable du fichier doit justifier dans un délai de deux mois, sans frais pour l'intéressé, des corrections apportées. Si des informations ont été communiquées à un tiers, il doit en outre lui transmettre la modification demandée.
Evidemment, certains services tels que la police, la justice ou la Sécurité sociale ne sont pas tenus au respect de ces droits.
Madame Dupas
42 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Société Glou
25 rue du Dindon
92300 Levallois-Perret
Le 9 septembre 2015
Courrier recommandé avec avis de réception
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je vous prie de bien vouloir radier de vos fichiers toute information me concernant, et m'en tenir informée.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Signature
PJ : photocopie d'un document d'identité portant signature du titulaire.
La cession d'un fichier contenant des données personnelles n'est pas interdite à condition que les personnes mentionnées sur ce fichier en aient été averties et qu'elles aient eu la possibilité de s'y opposer.
Par exemple, si vous apprenez que l'association dont vous êtes membre entend céder, louer ou échanger son fichier « adhérents », vous pouvez parfaitement vous y opposer sans avoir à vous justifier. Pour éviter toute discussion quant à la bonne réception de votre courrier par son destinataire, il est préférable d'écrire en recommandé avec avis de réception.
Monsieur le Président,
J'apprends que l'association est sur le point de céder son fichier « adhérents » à la société Finaude.
Vous voudrez bien noter que je m'oppose formellement à ce que tous les renseignements me concernant soient transmis à cette société.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.
Signature
PJ : photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire.
Si vous vous apercevez que vos coordonnées ont été transmises en dépit de votre opposition, vous pouvez non seulement vous faire radier du fichier irrégulièrement constitué mais également saisir la Cnil.
Sachez aussi que si vous avez autorisé la cession de vos données personnelles, par exemple dans le document qui a servi à la constitution du fichier initial (questionnaire commercial, bon de commande, etc.), vous pouvez parfaitement revenir sur votre décision.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 Paris Cedex 02) est un organisme indépendant qui a un rôle d'information, de conseil et de contrôle.
Toute personne peut saisir la Cnil en lui adressant un simple courrier, notamment pour :
- demander un extrait du « fichier des fichiers » (liste établie par la Cnil de tous les fichiers existants) ;
- demander un conseil. Le plus souvent, les demandes émanent des responsables de fichiers et portent sur les formalités préalables à la mise en place d'un fichier ;
- demander l'accès à un fichier ou la radiation d'un fichier ;
- porter plainte en cas de non-respect des droits ci-dessus. La Cnil peut toutefois être saisie en ligne (www.cnil.fr) lorsque la plainte a pour objet d'obtenir la suppression de données personnelles d'Internet, de mettre fin à la réception de publicités, de courriers électroniques non sollicités ou à un démarchage téléphonique non désirés, ou d'obtenir l'accès à des informations personnelles ou à leur mise à jour.
La Cnil dispose de pouvoirs de vérification et d'investigation. Elle peut notamment entendre les personnes concernées. Elle peut aussi adresser des avertissements, faire des injonctions, prononcer des sanctions pécuniaires et dénoncer des affaires à la justice.
Outre le recours à la Cnil, vous pouvez faire respecter vos droits :
- en saisissant le juge des référés qui pourra par exemple ordonner votre radiation d'un fichier ;
- en portant plainte auprès du procureur de la République. En effet, le non-respect de vos droits par les responsables de fichiers est le plus souvent sanctionné pénalement.
Pas moyen d'y échapper si l'enquête a été déclarée obligatoire par le Conseil national de l'information statistique qui relève de l'Insee (Loi 51-711 du 7-6-1951 art. 3).
Les personnes interrogées doivent répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, aux questions posées. A défaut et après mise en demeure, elles peuvent faire l'objet d'une amende administrative dont le montant maximal est de 150 € pour une première fois et 300 € à 2 250 € en cas de récidive dans les trois ans. En outre, le défaut de réponse ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale constitue une contravention de première classe punie d'une amende de 38 € (Loi 51-711 du 7-6-1951 art. 7).
Une discrimination, qui est une inégalité de traitement, est interdite lorsqu'elle est fondée sur un critère prohibé par la loi : l'origine, le sexe (homme ou femme), l'orientation sexuelle (homosexuelle ou bisexuelle), l'identité sexuelle (discrimination en raison d'une apparence physique ne correspondant pas à l'état civil), la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le nom, le lieu de résidence, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales et l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (C. pén. art. 225-1 modifié par la loi 2014-173 du 21-2-2014).
Le principe de non-discrimination fait l'objet d'applications particulières dans la sphère professionnelle, avec notamment la protection de la femme enceinte, le principe « à travail égal, salaire égal » et l'exigence d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il concerne également de nombreux autres domaines : le logement, l'éducation, l'accès aux prestations sociales ou aux avantages retraite, le fonctionnement des services publics, etc.
SavoirLes différences de traitement sont autorisées lorsqu'elles ne sont pas fondées sur l'un des critères prohibés par la loi. Par exemple, un employeur est en droit de préférer recruter des jeunes issus de grandes écoles plutôt que de l'université.
Les discriminations sont également autorisées lorsque, bien que fondées sur un critère interdit par la loi, elles ont un objectif légitime et répondent à une exigence proportionnée. Par exemple, un licenciement pour raison de santé ne constitue pas une discrimination interdite s'il est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée du salarié.
Selon les circonstances, la victime d'un acte discriminatoire peut :
- se prévaloir de la nullité de l'acte en question. Par exemple, celui qui a été licencié pour un motif discriminatoire peut obtenir l'annulation de la sanction et sa réintégration dans l'entreprise ;
- demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 24-4-2013 no 11-15.204 : Bull. civ. V no 116, qui indemnise le préjudice d'absence d'évolution de carrière subi par un salarié homosexuel) ;
- porter plainte, les peines encourues étant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (C. pén. art. 225-2) ;
- saisir le Défenseur des droits des discriminations interdites par la loi ou par un engagement international de la France.
C'est en 1968 que les homosexuels ont commencé à se faire entendre. Il s'agissait alors de combattre l'opprobre qui pesait sur eux... Puis en 2013, le débat s'est porté sur le mariage et l'adoption, consacrés par la loi 2013-404 du 17 mai 2013.
Quelle que soit son orientation sexuelle, toute personne a droit au respect de sa vie privée, de sa dignité et de son intégrité physique. Plusieurs dispositions permettent de garantir l'effectivité de ces droits.
Sur le fondement de la protection de la vie privée, tout(e) intéressé(e) peut obtenir réparation du préjudice qu'il subit du fait de la révélation, sans son autorisation, de son homosexualité réelle ou supposée. Peu importe que l'information ait été relayée par voie de presse, film, blog, etc. La personne citée peut notamment obtenir l'interdiction ou la saisie de la parution contestée et l'allocation de dommages-intérêts (C. civ. art. 9, al. 2). Le droit qu'a toute personne sur son image permet aussi de faire interdire la diffusion d'une photographie ou d'un film constituant une ingérence dans sa sphère intime.
Le non-respect de la vie privée est sanctionné pénalement. Ainsi, celui qui apprend, dans le cadre d'une conversation privée, l'homosexualité de son interlocuteur et qui enregistre ou transmet cette information sans le consentement de l'intéressé est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (C. pén. art. 226-1).
Il est interdit de constituer des fichiers qui font apparaître, directement ou indirectement, l'orientation sexuelle des personnes (Loi Informatique et libertés du 6-1-1978 art. 8). La personne qui découvre l'existence d'un tel fichier peut saisir la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés ; no 67766) et aussi les tribunaux.
Le respect de la dignité de chacun conduit à condamner les faits de diffamations et injures à caractère sexuel. Est diffamatoire toute allégation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Par exemple, faire état de la prétendue homosexualité d'un homme d'Eglise est diffamatoire, traiter quelqu'un de « sale pédé » est une injure. Les deux peuvent donner lieu à des dommages et intérêts ainsi qu'à des sanctions pénales, plus ou moins graves selon que les propos ont été ou non tenus en public.
La discrimination et la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison des orientations sexuelles d'une personne sont également punissables pénalement et ouvrent droit à des dommages-intérêts. C'est par exemple le cas lorsque :
- après avoir donné son accord pour louer un appartement, le bailleur qui a appris l'homosexualité et la séropositivité du candidat à la location lui demande de nouvelles pièces pour compléter le dossier en lui fixant un délai impossible à respecter ;
- une personne se voit refuser l'entrée d'un lieu public, une embauche ou un stage en entreprise en raison de son homosexualité.
Le licenciement d'un salarié sans autre motif que son homosexualité est nul et ouvre droit à la réintégration dans l'entreprise ou à des dommages et intérêts. Un salarié ne peut également pas être licencié, sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité (C. trav. art. L 1132-3-2).
Dans le cadre de son emploi, la personne homosexuelle peut évidemment se prévaloir, comme tout salarié, des différentes dispositions protectrices du droit du travail et notamment des dispositions sanctionnant le harcèlement moral ou sexuel ou protégeant l'égalité salariale entre les salariés.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le fait de verser à un partenaire de vie une pension de retraite complémentaire inférieure à celle octroyée à une personne mariée pouvait constituer une discrimination en raison de l'orientation sexuelle lorsque les situations des couples mariés et des couples liés par un partenariat de vie sont comparables au regard de cette prestation (CJUE 10-5-2011 no C-147/08, Römer). En France, les droits à retraite des assurés, dans les régimes de base ou complémentaires, sont indépendants de leur statut matrimonial et de leur orientation sexuelle.
Les pensions de réversion sont, elles, réservées aux seuls conjoints survivants. Mais d'une part, il importe peu que les époux aient été de même sexe ou non (voir notamment Circ. Agirc-Arrco 9 du 27-6-2013). D'autre part, cette différence de traitement entre les couples mariés et les partenaires de Pacs ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et n'est donc pas contraire à la Constitution (Cons. const. 29-7-2011 no 2011-155 QPC).
Comment le couple homosexuel est-il pris en compte ? Tout dépend du mode de conjugalité choisi par ce dernier. Depuis l'ouverture par la loi 2013-404 du 17 mai 2013 du mariage aux couples de personnes de même sexe, trois possibilités s'offrent à lui : se marier, conclure un Pacs ou vivre en concubinage. Du choix de l'un ou l'autre de ces statuts dépend l'étendue des droits et obligations du couple.
Le couple homosexuel marié bénéficie des mêmes droits et obligations que des époux de sexe différent. La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a en effet consacré un principe d'égalité de traitement de tous les couples mariés, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent (C. civ. art. 6-1). Il en résulte que l'ensemble des règles relatives, notamment, aux droits et obligations découlant du mariage, des régimes matrimoniaux, du divorce et de la séparation de corps ou du statut protecteur du conjoint survivant (les époux sont notamment héritiers l'un de l'autre) s'appliquent de la même manière aux époux homosexuels. Il en va de même des règles relatives au régime fiscal, de la protection sociale ou de la vie professionnelle.
Lorsqu'il n'est pas marié, le couple homosexuel est un couple comme les autres, avec les droits et obligations attachés selon le cas à la qualité de simples concubins ou de partenaires pacsés. Il en est ainsi en matière de logement, de protection sociale ou de fiscalité.
Il en va de même dans la sphère professionnelle. Pour les salariés, par exemple, la démission pour suivre son partenaire est considérée par Pôle emploi comme légitime, un congé de soutien familial peut être demandé pour assister son partenaire ou son concubin, le droit de prendre ensemble ses congés payés est ouvert aux partenaires travaillant dans la même entreprise, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert à la personne pacsée avec la mère ou vivant maritalement avec elle, etc.
Signalons encore la possibilité d'obtenir réparation de son préjudice en cas de décès de son concubin à la suite, par exemple, d'un accident de la circulation.
Quels sont les droits d'un(e) homosexuel(le) à l'égard de ses enfants ?
Lorsque la personne homosexuelle est le parent de l'enfant (biologique ou adoptif), les tribunaux ne peuvent pas la priver de son autorité parentale et de son droit d'accueillir ses enfants chez elle (résidence principale ou alternée, droit de visite et d'hébergement) en se fondant sur des considérations générales relatives à l'homosexualité. Pour restreindre les droits du père ou de la mère, les tribunaux doivent caractériser, comme pour n'importe quel parent, des carences affectives ou éducatives ou encore relever la réalité d'un trouble psychologique chez l'enfant. On signalera qu'il existe des différences d'appréciation notables entre les tribunaux qui statuent au cas par cas.
Une personne homosexuelle peut-elle créer un lien de parenté avec un enfant ? Plusieurs situations sont à envisager.
L'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe par la loi du 17 mai 2013 a eu pour conséquence de permettre aux personnes mariées de même sexe d'adopter (en la forme simple ou plénière) ensemble un enfant, ou à un époux d'adopter l'enfant « naturel » de son conjoint ou l'enfant adopté par ce dernier.
Lorsqu'il n'est pas marié, le couple homosexuel ne peut pas procéder à une adoption plénière, tout comme deux concubins ou deux personnes pacsées (homosexuelles ou non) ne peuvent pas adopter conjointement un enfant. En revanche, l'un des membres du couple peut présenter une demande à titre individuel. Un refus d'agrément à une femme homosexuelle a été jugé discriminatoire pour être fondé sur les orientations sexuelles de la requérante et sur « l'absence de référent paternel », alors que le droit d'adopter est reconnu aux célibataires (CEDH 22-1-2008, affaire E.B. c/ France no 43546/02).
Il a également été jugé qu'une femme ne peut pas procéder à l'adoption simple de l'enfant de sa compagne (hypothèse dans laquelle l'enfant n'a pas de filiation paternelle établie) au motif qu'une telle adoption aurait pour effet de priver la mère biologique de ses droits d'autorité parentale. En effet, en cas d'adoption simple d'un enfant mineur, ces droits sont intégralement transférés à l'adoptant en application de l'article 365 du Code civil, ce que la Cour de cassation juge contraire aux intérêts de l'enfant (Cass. 1e civ. 19-12-2007 no 06-21.369 : Bull. civ. I no 392).
Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, l'impossibilité pour les couples homosexuels non mariés d'avoir accès à l'adoption simple avec partage de l'autorité parentale (à la différence des couples mariés) ne constitue pas un traitement discriminatoire fondé sur leur orientation sexuelle et ne porte pas atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH 15-3-2012 no 2591/07 : BPAT 3/12 inf. 158).
Quant au Conseil constitutionnel, il estime que le droit de mener une vie familiale, tel que garanti par la Constitution, n'ouvre pas droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive entre l'enfant et le partenaire de son parent (Cons. const. 6-10-2010 no 2010-39 QPC).
La loi du 17 mai 2013 a expressément écarté l'application aux couples homosexuels des dispositions relatives à la filiation biologique (C. civ. art. 6-1). Il est donc impossible pour l'épouse d'une femme qui accouche de bénéficier de la « présomption de paternité » et de créer ainsi un lien de parenté avec l'enfant. Un enfant ne peut pas non plus être reconnu par deux parents de même sexe (C. civ. art. 320).
Le concubin ou le partenaire de Pacs homosexuel qui élève l'enfant de sa compagne ou de son compagnon peut-il se voir reconnaître certains droits ?
Il peut obtenir une délégation partielle d'autorité parentale (C. civ. art. 377, al. 1). Ce mécanisme lui permet de se voir accorder certains droits à l'égard de l'enfant, sans lui reconnaître la qualité de parent. La délégation partielle d'autorité parentale est admise à deux conditions : elle ne doit pas être associée à une adoption simple (Cass. 1e civ. 19-12-2007 no 06-21.369 : Bull. civ. I no 392) et il faut que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. 1e civ. 8-7-2010 no 09-12.623 : BPAT 5/10 inf. 270). Par exemple, la Cour de cassation a considéré que ces conditions étaient réunies dans une affaire où elle a constaté que les enfants étaient équilibrés et élevés dans une atmosphère sereine et épanouissante, que la relation entre les deux femmes était stable et harmonieuse et que, en cas d'accident grave de la mère, sa compagne se heurterait à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu auprès des enfants (Cass. 1e civ. 24-2-2006 no 04-17.090 : Bull. civ. I no 101). La délégation partielle d'autorité parentale a également été admise au profit de la compagne de la mère biologique décédée dans un cas où l'autorité parentale était exercée par le père biologique et la compagne de la défunte (Cass. 1e civ. 16-4-2008 no 07-11.273 : Bull. civ. I no 106).
Le concubin ou partenaire qui assume un rôle de « parent social » est considéré par la loi comme un tiers. En cas de séparation conflictuelle, le seul moyen à sa disposition pour maintenir un lien avec l'enfant est de demander au juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite ou d'hébergement. Le juge pourra le lui accorder s'il y va de l'intérêt de l'enfant, en particulier lorsqu'il a résidé de manière stable avec lui, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables (C. civ. art. 371-4)
On signalera pour finir qu'en l'état actuel de notre droit, un couple d'homosexuelles ne peut pas bénéficier de la procréation médicalement assistée avec donneur, ce procédé étant réservé, en France, aux couples composés d'un homme et d'une femme.
Créée par une loi du 19 mai 1802 (29 floréal an X), la Légion d'honneur a depuis Bonaparte accueilli dans ses rangs un million de citoyens.
Le nombre maximum de légionnaires est fixé, tous grades confondus et compte non tenu des nominations et promotions hors contingent, à 125 000. Ils sont aujourd'hui moins de 92 000.
Ouverte aux militaires comme aux civils, aux femmes depuis 1851 (à parité, en principe, avec les hommes depuis 2007), la Légion d'honneur récompense les services exceptionnels ou éminents.
Les mérites éminents sont variables selon les professions et ne répondent à aucune définition précise. En principe, il faut justifier d'au moins 20 ans d'activité ou de services pour être admis au grade de chevalier. Ces services doivent avoir été rendus à la France. Un étranger peut recevoir la Légion d'honneur, mais il ne pourra pas être membre de l'ordre.
Formellement, on ne demande pas la Légion d'honneur. On est proposé par un ministère, par exemple celui de la justice pour un avocat ou un notaire, ou par des proches au nombre de 50 (cette « initiative citoyenne » à transmettre à la Préfecture peut être téléchargée sur www.legiondhonneur.fr). La proposition suit ensuite un véritable parcours du combattant. Sa conclusion : le décret de nomination publié au Journal officiel (3 grandes dates pour les civils : le 1er janvier, Pâques et le 14 juillet).
La légende a la vie dure et pourtant aucun animal n'a jamais eu la Légion d'honneur. Dans le passé, des drapeaux (entre autres, celui du 2e régiment de zouaves en 1859), des écoles (Polytechnique, notamment), des entreprises, des associations ou des villes (par exemple, Oradour-sur-Glane en 1949) ont pu recevoir la Légion d'honneur. De nos jours, seules des personnes peuvent être décorées.
La réception dans l'ordre de la Légion d'honneur est héritée des rites d'adoubement médiévaux. Après un discours fleuri, le parrain choisi par le récipiendaire prononce les paroles suivantes : « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. » Il remet la croix (une étoile à 5 branches suspendue à un ruban rouge) au décoré et lui donne l'accolade. Le nouveau chevalier remercie. La grande chancellerie lui expédiera plus tard un brevet, en prélevant au passage des « droits de chancellerie ».
Le port de la croix obéit à des règles très strictes. Au quotidien, le chevalier porte un ruban rouge, plus ou moins large selon sa modestie, sur sa tenue de ville : veston, robe ou veste de tailleur. Le ruban est cousu par un tailleur ou vendu prêt à poser (ruban amovible). Le porter sur un pardessus n'est pas conforme à l'étiquette (sauf circonstances exceptionnelles : dépôt d'une gerbe au pied d'un monument aux morts par un froid sibérien par exemple).
Plus tard - en cas de promotion - viendront la rosette pour les officiers, puis la rosette sur demi-noeud argent pour le 3e grade, celui de commandeur, sur demi-noeud or et argent pour la dignité de grand officier, sur demi-noeud or pour la dignité de grand-croix.
SavoirDes nominations directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent venir récompenser des carrières « hors du commun ». Ces nominations se font au compte-gouttes : la voie directe pour la dignité de grand officier ne peut ainsi être retenue que pour une personne par an !
La dignité de grand officier est par ailleurs conférée automatiquement aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
La mention de son appartenance à la Légion d'honneur et de son grade peut être précisée, après le nom, dans les actes d'état civil, judiciaires, notariés et même dans les procès-verbaux de police (et va sans dire sur cartes de visite et faire-part).
Seuls les militaires et assimilés peuvent espérer un traitement, de quelques euros par an pour les chevaliers à quelques dizaines d'euros pour les titulaires de la grand-croix. Cette somme est exonérée d'impôt sur le revenu.
Les membres de l'ordre le sont en principe à vie. On ne peut pas démissionner de la Légion d'honneur, mais on peut la refuser plus ou moins discrètement (avec « éclat » si l'on songe à l'économiste Thomas Piketty en janvier 2015). Renvoyer sa croix ou son diplôme peut faire du bruit si l'on est célèbre, mais ne sert à rien.
De son vivant, une seule porte de sortie, mais déshonorante : l'exclusion de l'ordre. Une dizaine de cas par an. Citons Maurice Papon, qui a toutefois emporté sa croix dans sa tombe.
Destiné à récompenser les mérites simplement « distingués » d'une étoile à 6 branches sur ruban bleu, le Mérite national a été créé le 3 décembre 1963.
Comme la Légion d'honneur, c'est un ordre national et les grades et dignités y sont les mêmes. Il compte environ 190 000 membres. Petit détail qui a son importance : si l'on est fait chevalier du Mérite et, quelques années plus tard, chevalier de la Légion d'honneur, on devrait arborer seulement le ruban rouge. A noter que les Premiers ministres obtiennent la grand-croix après six mois de fonction.
La création du Mérite s'est traduite par la mise en sommeil de la plupart des ordres ministériels. On en comptait une vingtaine. Seuls sont encore susceptibles d'être attribués les Palmes académiques (d'un joli violet), le Mérite maritime (marine et vert), le Mérite agricole (vert et rouge) et les Arts et Lettres (vert et blanc).
Réservés aux militaires, en principe aux simples soldats et sous-officiers : la médaille militaire et son ruban jaune (3 000 par an).
La vie en collectivité impose à chacun de supporter les inconvénients normaux du voisinage (bruits, odeurs, vibrations, etc.). En revanche, dès lors que ces derniers deviennent anormaux, il est possible d'agir en justice contre leur auteur afin d'obtenir réparation.
Le caractère normal ou anormal des troubles est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. Il dépend des lieux et des circonstances. Ainsi, les nuisances liées à la présence d'un poulailler peuvent être sanctionnées en ville mais tolérées à la campagne (TI Altkirch 28-6-2007 no 11-05-000296).
Même en zone rurale, les nuisances animales sont parfois jugées anormales. A la recherche d'un équilibre entre nécessités du monde rural et qualité de la vie à laquelle peuvent aspirer les citadins venus s'installer à la campagne, un juge a condamné un éleveur, sous astreinte, à prendre toutes mesures nécessaires afin que ses vaches munies de cloches ne puissent pas s'approcher à moins de 100 mètres de la maison des voisins entre 21 heures et 7 heures du matin (Juge proximité Aix-les-Bains 9-11-2006 no 91-06-000051). En revanche, des voisins ont beau se plaindre des coassements de grenouilles vivant sur la propriété riveraine, leur demande en cessation du trouble est rejetée car il s'agit d'une espèce protégée (CA Paris 8-8-2008 no 08/14542, 1e ch. A).
La victime des nuisances doit contacter son voisin pour l'informer de la gêne subie et essayer de trouver une solution permettant de réduire les troubles occasionnés.
Si, par exemple, le voisin fait trop de bruit, il est légitime de lui demander de ne plus utiliser les appareils électroménagers tard le soir, de prendre un casque pour écouter la musique ou la télévision, de faire les travaux nécessaires pour insonoriser une pièce... La victime des odeurs nauséabondes provenant d'un tas de fumier situé à quelques mètres de sa maison et appartenant à son voisin peut prier ce dernier de le déplacer à un autre endroit de sa propriété. Si l'un des occupants de la copropriété étale régulièrement son linge aux fenêtres pour le désagrément visuel de tous, il peut être utile de lui rappeler que le règlement de copropriété de l'immeuble interdit ce genre de pratique. Un simple rappel à l'ordre peut ainsi suffire à mettre un terme au comportement gênant d'un voisin indélicat.
Si le trouble ne cesse pas, il convient d'adresser au voisin une lettre simple puis au besoin une lettre recommandée rappelant la gêne subie et les différentes démarches déjà accomplies.
La présente correspondance fait suite à... (énoncez ici les précédents courriers adressés au voisin ainsi que les conversations téléphoniques ou les simples discussions que vous avez déjà eues avec lui) concernant votre comportement au sein du voisinage. Je vous ai demandé, à ces multiples occasions, de bien vouloir mettre un terme à... (indiquez ici le type de trouble provoqué : bruit, odeur, fumée, etc.) provenant de... (origine du trouble).
Ces nuisances quotidiennes, de par leur intensité et leur quasi-permanence, dépassent très largement les inconvénients normaux que tout un chacun peut accepter dans le cadre du voisinage. La tranquillité de ma famille en est profondément affectée.
Pour preuve de ce que j'avance, vous voudrez bien trouver ci-joint copie des documents suivants : ... (par exemple : certificat médical attestant des conséquences néfastes des nuisances sur votre santé ou celle de vos proches, constat d'huissier établissant la réalité des faits, etc.).
Je vous demande de faire cesser ces troubles dans les plus brefs délais. A défaut, je saisirai le tribunal compétent et demanderai votre condamnation à des dommages-intérêts (si le trouble de voisinage est pénalement sanctionné, vous pouvez également mentionner votre intention de porter plainte auprès du procureur de la République).
(1) Conservez une copie de vos différents courriers ; ils pourront vous être utiles si vous n'arrivez pas à trouver une solution amiable.
Différentes personnes ou organismes peuvent intervenir pour aider à faire cesser les nuisances de voisinage.
Dans les immeubles en copropriété, il est possible de s'adresser au syndic de l'immeuble pour qu'il fasse respecter le règlement de copropriété qui interdit certainement bon nombre de comportements troublant la tranquillité des occupants de l'immeuble.
Il est également possible de prendre contact avec la mairie (à Paris, le maire n'est compétent que pour les bruits de voisinage, la salubrité publique ainsi que les foires et marchés ; pour le reste, il faut s'adresser à la préfecture de police), qui est tenue d'une manière générale de garantir la tranquillité des habitants de la commune. Concernant les nuisances sonores, les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux particuliers de lutte contre le bruit et interdire, par exemple, l'utilisation de tondeuses à gazon ou d'appareils de bricolage le dimanche.
Il est encore possible de s'adresser à des associations spécialisées dans la défense des consommateurs ou de l'environnement, qui peuvent aider dans certaines démarches, notamment en intervenant à l'amiable auprès du responsable des nuisances.
Enfin, l'intervention d'un médiateur ou d'un conciliateur de justice est souvent une bonne voie de résolution et d'apaisement des conflits entre voisins.
Vous pouvez faire intervenir le bailleur d'un locataire fauteur de troubles. Après mise en demeure dûment motivée, le bailleur doit utiliser tous les moyens dont il dispose (par exemple, agir en résiliation du bail) pour faire cesser les troubles.
Si les nuisances causées constituent une infraction pénale, telles les nuisances sonores causées par une activité professionnelle, il est possible de saisir le juge pénal afin que des sanctions soient infligées au responsable des troubles : amende et/ou prison.
La victime des nuisances peut bien entendu présenter un recours devant les juridictions civiles et engager la responsabilité de l'auteur des nuisances, s'il a commis une faute, selon les règles générales de la responsabilité civile.
Elle peut surtout engager une action pour trouble anormal de voisinage si les nuisances causées excèdent les inconvénients normaux de voisinage. L'originalité de cette procédure réside dans le fait que le voisin n'a pas besoin d'avoir commis une faute pour que la victime puisse demander réparation. Il suffira à la victime de prouver, par tous moyens, qu'il existe un trouble anormal, qu'elle subit un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre le trouble et ce préjudice. Si l'auteur des troubles est locataire, la victime peut aussi agir contre le propriétaire.
SavoirA titre de réparation, le juge peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble et/ou octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il peut même accompagner sa décision d'une mesure d'« astreinte », c'est-à-dire imposer au responsable des troubles de payer une certaine somme d'argent pour chaque jour de retard dans l'exécution des obligations imposées par le jugement.
Si la victime souhaite engager une action en responsabilité contre une autorité administrative, par exemple le maire de la commune car il n'a pas pris les mesures appropriées vis-à-vis des nuisances subies, elle doit s'adresser au juge administratif.
Lorsque les troubles de voisinage (bruit, odeur, fumée, pollution, etc.) proviennent d'une activité professionnelle, vous ne pourrez pas obtenir réparation si vous avez emménagé après le début de l'activité dès lors que les conditions d'exercice de l'activité sont inchangées et que le professionnel respecte la réglementation qui lui est applicable (CCH art. L 112-16).
En revanche, si les troubles sont causés par une activité qui n'est pas de nature professionnelle ou qui n'est pas soumise à une réglementation spécifique (exploitation d'un terrain de golf, par exemple), vous pourrez agir en réparation malgré l'antériorité de l'activité. Un simple particulier dont le comportement est à l'origine de troubles de voisinage n'échappe donc pas à sa responsabilité au seul motif qu'il était là avant vous.
Ce principe dit de la « pré-occupation » a été validé par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 8-4-2011 no 2011-116 QPC). Il est toutefois inapplicable au sein d'un immeuble en copropriété (Cass. 2e civ. 7-2-2008 no 05-22.007). Qu'il s'agisse des rapports des copropriétaires entre eux ou des rapports d'un locataire avec les autres copropriétaires, le voisin, même s'il est arrivé le premier, sera responsable des troubles anormaux qu'il fait subir aux autres. La solution est la même, que l'activité concernée soit professionnelle ou non.
En septembre 2014, plus de huit Français sur dix (82 %) ont indiqué se préoccuper des nuisances sonores (Les Français et les nuisances sonores. Sondage Ifop pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : www.ifop.com).
Peut être sanctionnée toute personne qui, dans un lieu public ou dans un lieu privé, est à l'origine de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité (CSP art. R 1334-31).
La force d'un bruit est mesurée en décibels dB(A). Cette unité de mesure est censée tenir compte de l'intensité du bruit (exprimée en décibels), de sa fréquence (exprimée en hertz) et de la façon dont l'oreille humaine filtre les sons.
On distingue deux grandes catégories de bruits : les bruits domestiques et les bruits liés à une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir.
Sont par exemple des bruits de voisinage domestiques, les bruits provenant (Circulaire du 27-2-1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage) :
- des cris des animaux et plus particulièrement des aboiements ;
- de la télévision ou des appareils de musique ;
- des outils de bricolage ou de jardinage ;
- des appareils électroménagers ;
- des jeux de boules dans un appartement ;
- des fêtes familiales, etc.
Sont des bruits de voisinage liés à une activité professionnelle ou de loisir les bruits provenant d'une discothèque, d'un restaurant, d'un atelier artisanal, d'un cinéma, etc.
Le caractère excessif des bruits domestiques peut être établi à l'oreille. Il peut être constaté par la police ou la gendarmerie, par un huissier ou par des agents communaux assermentés. Lorsque le constat n'est pas possible, notamment lorsqu'il s'agit de bruits intermittents comme les bruits de talons, la preuve des bruits peut se faire par tous moyens, notamment à l'aide de témoignages...
Le bruit excessif lié à une activité professionnelle doit être constaté par un appareil de mesure acoustique. Les services d'hygiène de la mairie ou de l'agence régionale de santé sont équipés pour mesurer le bruit.
S'agissant des bruits domestiques, les nuisances, de jour comme de nuit (on parle de « tapage nocturne » lorsque le bruit a lieu la nuit, c'est-à-dire avant le lever et après le coucher du soleil), sont sanctionnées pénalement. L'auteur des nuisances encourt une contravention de 3e classe, soit une amende de 450 € (CSP art. R 1337-7 ; C. pén. art. 131-13). Mais l'infraction peut relever de la procédure de l'amende forfaitaire. Toute personne verbalisée au titre de cette procédure se verra remettre la lettre-carte et devra payer une amende de 68 €, somme majorée à 180 € lorsque le paiement n'a pas été effectué dans les 45 jours (CPP art. R 48-1).
Lorsque les nuisances sonores proviennent d'une activité professionnelle, culturelle ou sportive, l'auteur du bruit ne peut pas être condamné si le niveau du bruit est inférieur à 25 dB(A) à l'intérieur ou 30 dB(A) à l'extérieur (CSP art. R 1334-32). En cas d'infraction, des sanctions pénales (1 500 € d'amende si le contrevenant est une personne physique, 7 500 € s'il s'agit d'une personne morale, et confiscation de l'objet ayant servi à l'infraction) et administratives (mise en demeure, suspension de l'activité, etc.) peuvent être prononcées. Si la victime des nuisances porte plainte au pénal, le procureur de la République en examinera le bien-fondé et décidera soit de classer l'affaire sans suite (infraction non prouvée, par exemple), soit d'engager des poursuites.
Les nuisances sonores générées par les chantiers de travaux, certaines activités réputées bruyantes (discothèques, sports mécaniques, par exemple) ou les activités industrielles classées sont soumises à des dispositions spécifiques.
SavoirLa victime des bruits peut également saisir les juridictions civiles et réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Elle peut même agir sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, alors que les bruits dénoncés ne violeraient pas la réglementation applicable. Un propriétaire a ainsi été condamné en raison des nuisances sonores nocturnes provoquées par la location de salles de réception, les juges relevant à cette occasion que la notion de trouble anormal du voisinage s'apprécie indépendamment de toute faute ou de toute violation de la réglementation (CA Bordeaux 4-12-2013 no 11/04439, 5e ch. civ.).
Depuis la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat du 9 décembre 1905, c'est le maire qui réglemente les sonneries des cloches d'église, tant religieuses que civiles. En cas de désaccord avec l'autorité cultuelle, c'est le préfet du département qui tranche.
S'agissant des sonneries religieuses, le maire est tenu de concilier l'exercice de son pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905. Il ne peut pas s'opposer à ces sonneries, sauf pour des motifs tenant à l'ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l'usage dangereux pour la sécurité publique (CE 12-2-1909 no 28662, Abbé Rambaud). Dans une affaire où le propriétaire d'une maison située face à l'église demandait au maire d'interdire la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, le juge administratif a considéré que le maire n'avait commis aucune erreur de droit en refusant de faire suite à la demande de l'intéressé. Approuvant ce jugement, le Conseil d'Etat relève que « la sonnerie de l'Angélus a, par son origine, un caractère religieux et, même si la pratique en avait été interrompue pendant de longues années, elle revêt le caractère d'un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés ». La sonnerie n'était donc pas de nature à troubler l'ordre public (CE 11-5-1994 no 137612, Larcena).
Les sonneries civiles, qui ne sont pas directement liées à un office religieux, ne peuvent être employées que dans les cas de péril imminent. Toutefois, lorsque l'édifice cultuel appartient à la collectivité publique ou est attribué à l'association cultuelle, elles peuvent être utilisées si elles sont autorisées par les usages locaux (Loi du 9-12-1905 art. 27 et décret du 16-3-1906 art. 51). Encore faut-il que ces usages soient antérieurs à la loi de 1905 (CAA Lyon 25-3-2010 no 08LY02748, Cne de Saint-Apollinaire) et que les sonneries ne troublent pas l'ordre public (la censure du juge sur ce point est cependant rare).
Faute de démontrer l'existence d'un usage local antérieur à la loi de 1905, un maire s'est ainsi vu imposer par le juge administratif d'interdire, par arrêté, toute sonnerie civile, sauf en cas de péril imminent. L'affaire avait été portée en justice par les propriétaires d'une maison située face à l'église, qui se plaignaient d'entendre sonner les cloches toutes les heures et toutes les demi-heures deux fois de suite, de jour comme de nuit (CAA Paris 5-11-2013 no 10PA04789, Cne de Boissettes).
Tout voisin peut agir en justice contre le responsable de nuisances olfactives dès lors que celles-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, les odeurs de cuisine d'un restaurant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, perceptibles à l'étage en raison du mauvais aménagement du local (filtres de la hotte insuffisants et mal entretenus, ventilation faite à l'envers...) associées à des nuisances sonores, ont entraîné la condamnation d'un restaurateur pour trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ. 11-6-1997 no 95-10.152).
Le juge peut imposer à un restaurateur d'effectuer des travaux afin que les nuisances cessent. Il peut même aller jusqu'à interdire l'utilisation de la cuisine tant que les travaux réalisés ne sont pas suffisants et que le problème n'est pas résolu (Cass. 3e civ. 29-1-1997 no 95-14.316).
Les élevages d'animaux, spécialement de cochons, sont souvent à l'origine d'odeurs pestilentielles et nauséabondes. Mais de telles activités, dès lors qu'elles ont été autorisées par l'administration, ne peuvent pas être interdites par le juge judiciaire. Ce dernier conserve néanmoins le pouvoir d'en ordonner la cessation temporaire jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires à la suppression des odeurs concernées.
L'éleveur ne pourra pas échapper à sa responsabilité en invoquant le principe de la « pré-occupation » (voir no 71027) si le nombre de ses cochons est passé de quelques-uns seulement à l'origine à plusieurs centaines après l'arrivée des voisins (Cass. 2e civ. 7-11-1990 no 89-16.241 : Bull. civ. II no 225). Même chose lorsqu'un élevage est passé de quelques bovins en pâture à l'installation d'une bergerie pouvant accueillir plus de 300 brebis ! (Cass. 3e civ. 11-6-2014 no 12-28.315 : BDP 1/14 inf. 18).
L'utilisation d'un barbecue ne constitue pas un trouble anormal de voisinage lorsqu'elle reste occasionnelle. Les désagréments causés (fumée, odeur de viandes et de poissons grillés) sont épisodiques et dépendent pour l'essentiel des conditions météorologiques (jour de pluie et sens du vent). Mais il ne faut pas abuser de son droit dans le but de nuire à son voisin, par exemple en produisant volontairement de la fumée pendant que le voisin est à table. Le barbecue ne doit pas davantage causer de dommages à la propriété voisine tels que par exemple un noircissement de la façade causé par la fumée ou par la projection de cendres. Attention, le règlement d'une copropriété ou le cahier des charges d'un lotissement peuvent interdire ou encadrer l'utilisation des barbecues. Un arrêté municipal peut fixer des règles contraignantes mais ne saurait interdire l'utilisation des barbecues partout et tout le temps.
En principe, la chute des feuilles mortes d'un arbre situé sur le terrain voisin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, même si les feuilles ont tendance à boucher les gouttières ou les chéneaux (CA Nancy 15-11-2012 no 12/00570, 2e ch. civ.). On doit donc supporter cette gêne sans recours contre son voisin si l'arbre est planté à la distance légale (voir no 72000).
Toutefois, le trouble anormal peut être reconnu si la chute d'une quantité très importante de feuilles associée à une absence d'ensoleillement causée par l'arbre favorise le développement des mousses sur le terrain ou la toiture d'à côté. Un propriétaire a ainsi obtenu la condamnation de son voisin à entretenir ses arbres et à 1 500 € de dommages et intérêts au titre de la remise en état des lieux (CA Dijon 8-12-1999, ch. 1 sect. 1 : Juris-Data no 110 513).
L'édification d'un bâtiment ou la surélévation d'un immeuble existant peut priver de soleil ou de vue une construction. Indépendamment du problème de la régularité administrative de la construction, le voisin peut intenter une action pour trouble anormal de voisinage. En pratique, dans les zones fortement urbanisées la reconnaissance du trouble anormal est relativement rare. L'agrément de profiter d'une vue dégagée ne constitue pas une servitude de vue ni, en milieu urbain, un droit acquis (Cass. 3e civ. 4-11-2014 no 13-19.122 : BDP 2/14 inf. 73).
Ainsi, les propriétaires d'une maison avec piscine dans une zone pavillonnaire ont vu se construire à 6,80 m de la limite séparative un petit immeuble collectif dont les balcons donnaient directement sur leur piscine. Les juges n'ont pas considéré qu'il y avait là trouble anormal (Cass. 3e civ. 4-12-2001 no 00-14.893). Ils ont jugé le contraire s'agissant de la construction d'un immeuble de six étages de l'autre côté d'un passage commun à une villa. Le propriétaire de la villa a obtenu 14 500 € de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal résultant de la perte notable d'ensoleillement, de l'augmentation du nombre de vues directes sur sa terrasse et de l'augmentation du nombre de véhicules empruntant le passage (Cass. 3e civ. 14-1-2004 no 02-18.564 : Bull. civ. III no 9).
Dans une autre affaire, le propriétaire d'une villa se plaignait qu'un hôtel-restaurant situé de l'autre côté de la rue lui cachait la vue sur la mer par l'implantation de tentes et par des haies trop hautes. A été censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter sa demande, a retenu la configuration des lieux et le fait que l'hôtel-restaurant était déjà exploité et les haies plantées lorsque le propriétaire avait emménagé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hôtel n'avait pas, par l'installation d'un chapiteau durant l'été et l'accroissement des haies non taillées, aggravé les troubles antérieurs à l'acquisition de la villa (Cass. 2e civ. 15-3-2007 no 06-11.571).
Même si l'immeuble gênant a été ensuite vendu, celui qui l'a fait construire reste tenu du trouble anormal en résultant pour le voisin (Cass. 2e civ. 28-3-2013 no 12-13.917).
Si, depuis la construction de l'immeuble voisin, vous ne pouvez plus recevoir la télévision, vous avez la possibilité d'engager la responsabilité du propriétaire du bâtiment pour trouble de voisinage.
La loi prévoit en outre que, lorsque le permis de construire de l'immeuble gênant est postérieur au 10 août 1974, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage. Les propriétaires voisins doivent s'adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui recherchera une solution amiable et au besoin mettra en demeure le constructeur de procéder à l'installation du dispositif approprié. En l'absence de réponse du constructeur dans le délai de 3 mois, le CSA portera lui-même l'affaire devant le tribunal de grande instance (CCH art. L 112-12). Cette procédure s'applique que l'immeuble soit en cours de construction ou déjà achevé. Par la suite, le propriétaire de l'immeuble gênant est tenu d'assurer, à ses frais, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de l'installation.
Le propriétaire du terrain situé en contrebas doit recevoir les eaux de ruissellement qui s'écoulent naturellement du ou des terrains supérieurs (C. civ. art. 640). Il s'agit d'un trouble normal du voisinage. Cette servitude dite d'écoulement des eaux ne vaut que pour les eaux de pluie qui s'écoulent selon la pente naturelle du terrain (à l'exclusion des eaux usées et des eaux de vidange d'une piscine ou d'un étang). La main de l'homme ne doit pas avoir contribué à cet écoulement. De plus, le propriétaire du fonds supérieur ne doit pas avoir effectué des travaux de drainage ou de construction aggravant l'écoulement, le propriétaire du dessous ne pouvant de son côté se voir imposer la réalisation d'un ouvrage chez lui afin de remédier à cette aggravation (Cass. 3e civ. 29-9-2010 no 09-69.608 : Bull. civ. III no 177). Hors ces cas, il n'est pas possible de se retourner contre le voisin même si le ruissellement cause des dommages à une maison. Ainsi, il n'est pas possible d'invoquer un trouble anormal de voisinage pour obliger le voisin à réaliser un réseau de drainage en vue d'empêcher le ruissellement.
S'agissant de l'eau qui s'écoule des toits, la loi impose au propriétaire de s'arranger pour que l'eau s'écoule sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut pas la faire se déverser sur le terrain du voisin (C. civ. art. 681).
A-t-on le droit de se plaindre d'un trouble purement esthétique provoqué par un voisin ? Oui, répond la Cour de cassation qui condamne un agriculteur pour avoir déposé de manière prolongée du matériel hors d'usage (machines, caravane, camion...) juste devant le terrain du voisin, provoquant pour ce dernier une gêne esthétique anormale (Cass. 2e civ. 24-2-2005 no 04-10.362 : Bull. civ. II no 50). Cette gêne était d'autant plus injustifiable que, compte tenu de la taille de sa propriété, l'agriculteur aurait pu stocker ce matériel usagé dans un endroit plus éloigné. Résultat, l'exploitant a l'obligation de ne plus stocker son matériel à moins de 25 mètres de la limite séparative des deux propriétés.
Le bornage est l'opération permettant de fixer d'une manière définitive la limite séparative d'un terrain avec la propriété privée voisine. Cette ligne de séparation entre les deux terrains est marquée par des repères matériels appelés « bornes ». Ces bornes, plantées dans le sol et généralement placées aux angles du terrain, peuvent être en pierre, en ciment ou en métal ; aujourd'hui, elles sont le plus souvent en plastique.
Un bornage ne souffre pas l'approximation. Ainsi, lors du bornage d'une propriété jouxtant un étang privé, la limite terrestre « théorique » retenue par l'expert en raison des variations du niveau des eaux n'a pas été validée par les juges (Cass. 3e civ. 8-7-2009 no 08-17.809 : Bull. civ. III no 174).
Lorsqu'un mur mitoyen court tout le long de la limite séparative, cette dernière est nécessairement située sur l'axe médian du mur et la demande en bornage est sans objet (Cass. 3e civ. 30-10-2012 no 11-24.141).
Le bornage n'est possible qu'entre deux propriétés privées. Si votre terrain borde une propriété relevant du domaine public (route, forêt domaniale, etc.), vous devez demander à l'autorité administrative propriétaire de procéder à la délimitation des propriétés.
Le bornage n'est pas obligatoire. Les limites des terrains ne figurent pas toujours dans les actes de propriété ou sur les documents du cadastre (ces derniers ne valent d'ailleurs pas preuve de la propriété). De nombreux actes de vente ne mentionnent que la contenance et les références cadastrales des parcelles.
Depuis une loi du 13 décembre 2000, les promesses de vente et les ventes de terrains dans lesquelles l'acquéreur exprime son intention de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation doivent contenir un descriptif du terrain et mentionner si ce descriptif provient ou non d'un bornage. Lorsque le terrain est situé dans un lotissement, le descriptif doit résulter d'un bornage.
En l'absence de ce descriptif et de l'indication de son origine, l'acquéreur peut agir en nullité de la vente dans le mois de la signature chez le notaire. Lorsque l'acte authentique de vente comporte la mention requise, l'acquéreur ne peut pas agir en nullité (C. urb. art. L 111-5-3).
Si deux voisins sont d'accord sur leur limite séparative, rien ne les oblige à faire réaliser un bornage, notamment lorsque la limite est apparente. Cette apparence résulte généralement d'une haie, d'un talus, d'un fossé, d'une clôture ou d'un mur. Mais rien ne prouve que cette limite corresponde à la limite réelle, à la limite juridique.
Il est préférable de procéder à un bornage dès qu'un propriétaire ignore la limite exacte de sa propriété et souhaite construire aux abords de cette limite, clôturer ou planter une haie. En effet, si la construction vient à déborder sur le terrain voisin (on parle d'empiétement), le propriétaire voisin pourra obtenir en justice la démolition de la partie empiétante. La condamnation à démolir est inévitable, même si l'empiétement est de 5 millimètres (Cass. 3e civ. 20-3-2002 no 00-16.015 : Bull. civ. III no 71).
Il est bien souvent nécessaire de connaître la limite exacte de propriété pour pouvoir construire. En effet, le règlement d'urbanisme applicable dans la commune peut comporter des règles relatives à l'implantation des constructions basées sur la limite séparative, telle une marge de recul par rapport au terrain voisin (les « prospects »).
Seul le propriétaire du terrain peut demander le bornage. Lorsque le terrain est en indivision (notamment à la suite d'un décès), un indivisaire ne peut pas agir seul : il faut l'accord de tous. En cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire peut agir seul ; l'usufruitier aussi, mais le bornage ainsi réalisé est inopposable au nu-propriétaire.
Le bornage peut être fait à l'amiable si les deux voisins sont d'accord pour le réaliser. La loi ne le soumet à aucune forme particulière, il doit seulement être contradictoire et obtenir l'accord des deux voisins. Le bornage peut donc être fait par les deux propriétaires dans un écrit conjoint décrivant la situation des lieux, comportant un plan et précisant les termes de leur accord.
En pratique, l'établissement de l'exacte limite de propriété entre deux terrains est confié à un géomètre expert. Celui-ci se rend sur les lieux, examine les titres de propriété et le plan cadastral, sollicite éventuellement des témoignages, mesure les terrains, rédige un procès-verbal de bornage et pose les bornes. Pour être valable le procès-verbal de bornage amiable doit être signé par les deux propriétaires concernés.
La signature de ce procès-verbal donne une valeur contractuelle au bornage. Celui-ci ne pourra pas être remis en cause par les propriétaires concernés : les surfaces mentionnées et les limites de propriété sont fixées de manière définitive. Cette opposabilité du bornage est limitée aux signataires eux-mêmes. Pour l'information des tiers, notamment les futurs acquéreurs des propriétés, il est conseillé de publier le procès-verbal au service de la publicité foncière - ou au livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle - après dépôt chez un notaire. C'est le notaire qui s'occupe des formalités. Cette publication est nécessaire lorsque le procès-verbal rectifie des erreurs matérielles ou des énonciations inexactes des titres de propriété.
SavoirRéalisé régulièrement, le bornage amiable s'impose au juge et n'autorise plus le recours à un bornage par voie judiciaire ; encore faut-il que la délimitation ait bien été matérialisée sur le terrain par des bornes (Cass. 3e civ. 19-1-2011 no 09-71.207 : Bull. civ. III no 9). Publié régulièrement, le bornage amiable s'impose à tous et n'autorise plus un nouveau bornage. Mais si le bornage délimite les propriétés, il ne détermine pas qui est propriétaire (Cass. 3e civ. 23-5-2013 no 12-13.898 : Bull. civ. III no 62).
Dès lors que l'un des propriétaires s'oppose au bornage amiable ou refuse de signer le procès-verbal, notamment parce qu'il est en désaccord avec la limite proposée, il est possible de s'adresser au juge. En effet, la loi prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës (C. civ. art. 646). C'est le tribunal d'instance du lieu de situation du terrain qui est compétent. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Toutefois, s'il y a une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l'un des voisins, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent ; l'assistance d'un avocat est alors obligatoire.
En pratique, le juge nomme un géomètre expert judiciaire qui procède aux opérations de bornage : établissement d'un projet de bornage, rédaction d'un procès-verbal d'abornement et pose des bornes sur le terrain. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal, le juge le rend opposable par un jugement susceptible d'appel. Pour l'information des tiers, il est conseillé de publier le bornage judiciaire (procès-verbal d'abornement signé ou homologué par le juge) au service de la publicité foncière.
Lorsqu'une borne a été déplacée (par un voisin, le plus souvent), le propriétaire peut agir devant le tribunal de grande instance dans le délai d'un an afin de rétablir les marques de la ligne séparative et obtenir des dommages et intérêts (action en déplacement de borne). Au-delà de ce délai, le tribunal de grande instance reste compétent mais la procédure à suivre sera plus lourde et le propriétaire devra, notamment, prouver son droit de propriété.
Le déplacement ou l'arrachage d'une borne est sanctionné pénalement. Si le dommage est léger, une amende maximale de 1 500 € est encourue (C. pén. art. R 635-1). Dans les cas graves, la peine peut atteindre deux ans de prison et 30 000 € d'amende (C. pén. art. 322-1).
La réalisation d'un bornage nécessite l'intervention d'un géomètre expert, dont les tarifs sont libres ; son coût d'intervention varie selon l'étendue de sa mission et la superficie du terrain ; il convient donc de faire jouer la concurrence. L'intervention du notaire pour l'établissement de l'acte de dépôt et les frais de publicité foncière sont en revanche réglementés (se renseigner auprès de son notaire).
La loi prévoit que le bornage se fait à frais communs (C. civ. art. 646). En pratique, le procès-verbal de bornage amiable doit préciser le mode de répartition (par exemple, par moitié ou en fonction de la superficie des terrains). En cas de bornage judiciaire, le tribunal peut librement répartir les frais de bornage ou les imputer en totalité sur le propriétaire ayant refusé de borner son terrain.
Tout propriétaire peut clore sa propriété (C. civ. art. 647). Il n'y a aucune limite dans le temps. Un propriétaire qui a laissé son terrain ouvert pendant des années peut toujours le clôturer.
Le droit de clore son terrain comporte quelques restrictions. Le propriétaire doit respecter la servitude de passage des terrains enclavés qui impose une liberté de passage sur une partie de son terrain. Il doit aussi respecter certaines servitudes administratives comme la servitude d'accès à la mer des piétons, celle de passage le long du littoral, les servitudes de halage et de marchepied permettant notamment le passage des pêcheurs le long des cours d'eau appartenant au domaine public ainsi que les servitudes édictées le long de certains sentiers de grande randonnée. La clôture ne doit pas faire obstacle à l'écoulement naturel des eaux.
AttentionLa loi vous autorise à clôturer votre terrain mais vous ne devez pas abuser de votre droit dans l'intention de nuire à votre voisin ni lui causer un trouble anormal de voisinage (par exemple, à la campagne, élever un mur de clôture privant votre voisin totalement de vue ou d'ensoleillement). Il a ainsi été jugé qu'un propriétaire a abusé de son droit de propriété en construisant en limite de son terrain un mur de clôture en parpaings bruts de 3 mètres de haut, ce qui a réduit de manière considérable la clarté des pièces du rez-de-chaussée du voisin (Cass. 3e civ. 9-5-2001 no 99-12.355).
Le mode de clôture (nature, aspect, hauteur, matériaux utilisés) est généralement déterminé par la réglementation d'urbanisme de la commune ou, lorsque la propriété dépend d'un lotissement, par le cahier des charges de ce lotissement. En l'absence de dispositions particulières, le mode de clôture est libre : mur, grillage, barbelés, haie végétale, fossé, etc.
Les clôtures électriques sont soumises à des dispositions spéciales en raison des dangers qu'elles présentent : déclaration spécifique en mairie, utilisation d'un matériel homologué, signalisation par des panneaux espacés au maximum de 50 mètres, interdiction de se brancher directement sur le réseau de distribution.
L'accord du voisin n'est pas nécessaire lorsque la clôture ne déborde pas sur la limite séparative. Si la clôture doit être implantée à cheval sur la limite séparative l'accord du voisin est nécessaire. Les murs mitoyens obéissent à des règles particulières présentées nos 71600 s.
La destruction ou la détérioration de clôture est sanctionnée pénalement. Si le dommage est léger, une amende maximale de 1 500 € est encourue (C. pén. art. R 635-1). Dans les cas graves, la peine peut atteindre deux ans de prison et 30 000 € d'amende (C. pén. art. 322-1).
A la campagne, il n'est pas possible de forcer le voisin à participer à l'édification de la clôture. Dans les villes, en revanche, la loi permet à chacun de contraindre son voisin à contribuer à la construction et à la réparation des murs de clôture séparant maisons, cours et jardins (C. civ. art. 663). Cette règle, dite de « clôture forcée », s'applique aux terrains dépendant d'une habitation.
On signalera que des juges ont appliqué la règle de la clôture forcée à des terrains situés à la campagne mais agencés comme à la ville, chacun des deux voisins y ayant construit une maison avec jardin (CA Rouen 26-5-2004 no 02/3718, 1e ch.).
Les deux propriétaires doivent se mettre d'accord sur les modalités d'établissement de la clôture (implantation privative ou mitoyenne, nature des matériaux utilisés, hauteur, etc.) et sur la répartition des frais (en principe un partage par moitié). Si le voisin refuse la clôture commune ou s'il n'est pas d'accord sur les conditions de sa réalisation, le litige doit être soumis au tribunal de grande instance avec l'assistance d'un avocat.
A défaut de règles particulières prévues par le règlement d'urbanisme de la commune, le cahier des charges du lotissement ou un usage local reconnu, la forme de la clôture forcée est prévue par la loi : un mur d'une hauteur de 3,20 mètres dans les villes de 50 000 habitants et plus, de 2,60 mètres dans les villes d'une population inférieure.
En cas de demande de clôture forcée, les deux propriétaires ont tout intérêt à s'entendre. Ils pourront alors prévoir un mode de clôture autre que le mur et convenir d'une hauteur différente de celle imposée par la loi, sous réserve de respecter les règles d'urbanisme.
La construction de mon pavillon étant terminée, j'ai l'intention de clôturer mon terrain, riverain du vôtre au nord et à l'ouest. Comme le prévoit l'article 663 du Code civil, j'aimerais que vous participiez à l'édification de cette clôture.
J'envisage la pose d'un grillage tissé plastifié de couleur verte et d'une hauteur de 1,80 mètres, ce qui semble être en usage dans le voisinage, monté sur poteaux scellés en métal profilé.
Je reste à votre entière disposition afin que nous convenions ensemble du prix et des modalités pratiques de cette réalisation.
L'édification d'une clôture est en principe libre. Par exception, en raison de sa localisation géographique, il peut être nécessaire de déposer avant l'exécution des travaux une déclaration à la mairie. Sont concernées les clôtures situées (C. urb. art. R 421-12) :
- dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
- dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement ;
- dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme ;
- dans une zone d'une commune en ayant décidé ainsi.
En dehors de ces cas, les clôtures sont dispensées de toute formalité.
Dans tous les cas, vous pouvez vous renseigner à la mairie.
Lorsque la déclaration est obligatoire, elle est déposée ou adressée (en deux exemplaires) par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la mairie avant le commencement des travaux. Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain et un plan de masse en trois dimensions de la clôture projetée.
L'administration a en principe un mois pour interdire le projet de clôture ou fixer des conditions spéciales à sa réalisation. Le délai de réponse de l'administration est porté à deux mois dans certains cas, notamment lorsque le projet se situe dans le périmètre d'un secteur sauvegardé. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai d'un ou deux mois, les travaux peuvent débuter (ils doivent être entrepris dans les deux ans).
La déclaration de clôture fait l'objet d'un affichage sur le terrain, qui doit être visible de l'extérieur, pendant toute la durée du chantier.
Les trottoirs font partie de la chaussée et leur entretien est à la charge du propriétaire de la voie. Dans les villes, cet entretien est à la charge de la commune sauf s'il s'agit d'une voie privée fermée à la circulation publique (l'entretien relève alors du propriétaire de la voie, ce peut être le cas dans un lotissement) ou d'une route départementale (l'entretien en incombe au conseil départemental, principe qui doit toutefois être combiné avec les pouvoirs de police du maire en matière de voirie, pouvant ainsi conduire, en cas de dommage, à un partage de responsabilité entre la commune et le département).
Dans les villes, il existe généralement un arrêté municipal imposant aux riverains de déneiger (ou de jeter du sable, de la cendre ou de la sciure en cas de verglas) sur toute la largeur du trottoir devant leur propriété. En cas de chute d'un piéton, le propriétaire riverain peut être tenu pour responsable s'il n'a pas respecté cette obligation.
Au titre de ce que l'on appelle les aisances de voirie publique, un riverain peut obtenir l'autorisation d'abaisser la hauteur de la bordure du trottoir pour pouvoir entrer chez lui en voiture. Cette autorisation, délivrée par la collectivité propriétaire de la voie, peut déterminer la position de l'accès ou limiter le nombre d'accès pour une même propriété. Les travaux sont réalisés par la collectivité qui réclame le remboursement des frais engagés au bénéficiaire de l'aménagement. Lorsque l'abaissement est réalisé dans le cadre d'une opération de construction, son coût est intégré dans les participations et taxes d'urbanisme qui seront payées lors de la délivrance du permis de construire. La mairie peut bien évidemment réaliser d'elle-même et gratuitement ce bateau.
Un mur mitoyen est un mur qui sépare deux propriétés privées et qui appartient aux deux propriétaires. Chaque voisin est copropriétaire du mur.
Le mur peut séparer deux bâtiments, deux cours, deux jardins.
Le mur peut être totalement mitoyen (exemple 1). Il peut également être mitoyen sur une partie et privatif sur une autre, par exemple lorsque deux maisons mitoyennes n'ont pas la même hauteur (exemple 2).


Tout mur édifié en limite de deux propriétés est présumé mitoyen sauf si :
- un des propriétaires possède un titre de propriété indiquant qu'il est le seul propriétaire du mur ;
- un seul des propriétaires a entretenu ou réparé le mur pendant plus de 30 ans sans que l'autre propriétaire participe à ces travaux ;
- le mur ne suit pas la limite séparative des propriétés en étant implanté d'une manière très irrégulière alternativement sur l'un et l'autre des terrains voisins ;
- le mur présente les caractéristiques d'un mur privé (corbeau, chaperon...).
Le mur sera présumé non mitoyen s'il présente les caractéristiques d'un mur privé. Tel sera le cas si (C. civ. art. 654) :
- le haut du mur est incliné d'un seul côté, les eaux de pluie s'écoulant sur une seule propriété (exemple 3). Si le mur est incliné des deux côtés, il est présumé mitoyen ;
- le mur est surmonté d'un chaperon d'un seul côté ; on appelle « chaperon » les tuiles, ardoises, etc., qui sont placées en haut du mur et qui empêchent la pluie de ruisseler le long du mur (exemple 4) ;
- le mur possède des corbeaux d'un seul côté, c'est-à-dire des pierres incluses dans le mur pouvant recevoir plus tard une poutre afin d'édifier une construction contre le mur (exemple 5).
Cette liste n'est pas limitative.



Un mur de soutènement a pour objet de soutenir les terres de l'une des propriétés lorsque les deux propriétés voisines ne sont pas au même niveau et que l'un des terrains surplombe l'autre. Si une seule propriété en tire profit, par exemple si le mur a pour unique fonction de maintenir les terres, le mur est présumé privatif (exemple 6).
En revanche, le mur est présumé mitoyen si les deux propriétaires bénéficient du mur. Tel est le cas lorsque le propriétaire de la maison en contrebas a adossé une construction contre le mur ou lorsque la hauteur du mur empêche toute vue sur la propriété voisine (exemple 7).


La mitoyenneté d'une partie ou de la totalité d'un mur de séparation entre deux propriétés peut être acquise à tout moment, par exemple en vue d'y appuyer une construction (C. civ. art. 661). Ce principe a été validé par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 12-11-2010 no 2010-60 QPC : JO 13).
Le voisin ne peut pas s'y opposer, sauf si le mur a été édifié non en limite de propriété mais sur son seul terrain, par exemple à 30 centimètres de la limite séparative.
Si le voisin refuse de céder la mitoyenneté du mur, le différend doit être porté devant le tribunal de grande instance (le recours à un avocat est obligatoire).
Si le mur a été construit sur le terrain voisin en limite séparative, le prix d'acquisition de la mitoyenneté est égal à la moitié du coût du mur et à la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. Il faut y ajouter les frais de cession comme les honoraires du notaire ou les frais de publication au service de la publicité foncière. En cas de litige sur le prix de la cession, c'est le juge qui en fixe le montant.
Deux propriétaires peuvent faire construire, à frais communs, un mur à cheval sur la limite séparative de leurs propriétés. Le mur est alors mitoyen dès l'origine. Mais si votre voisin a construit le mur à cheval sur la limite séparative sans votre accord, en empiétant sur votre propriété, vous pouvez exiger sa démolition. Si vous préférez en acquérir la mitoyenneté « à l'amiable » (le voisin ne peut pas vous l'imposer), vous paierez seulement la moitié du coût de construction du mur, la portion du sol correspondante vous appartenant déjà par hypothèse. Mais attention, si l'affaire est portée en justice, le mur sera démoli. En cas d'empiétement, la Cour de cassation refuse en effet d'appliquer les règles sur la mitoyenneté, que la demande émane de l'auteur ou de la victime de l'empiétement (Cass. 3e civ. 19-2-2014 no 13-12.107 : Bull. civ. III no 25).
Sous réserve de ne pas nuire au voisin, il est possible de surélever le mur mitoyen qui sépare deux propriétés (C. civ. art. 658). On parle d'« exhaussement ».
L'accord du voisin n'est pas nécessaire. Il est toutefois préférable, ne serait-ce que pour entretenir de bonnes relations de voisinage, qu'il soit informé du projet avant le commencement des travaux.
La surélévation peut se faire sur toute la largeur du mur, sur la moitié du mur ou à cheval sur la limite séparative.
Si le mur n'est pas en mesure de supporter la surélévation, par exemple s'il est vétuste, le coût de son renforcement, voire de sa reconstruction est à la charge du propriétaire exécutant les travaux de surélévation.
La partie surélevée du mur appartient en totalité au propriétaire auteur des travaux mais son voisin peut, dans tous les cas, en acquérir la mitoyenneté s'il le souhaite.
On peut, sans l'accord du voisin, placer des poutres et des solives à l'intérieur du mur mitoyen.
Lorsqu'un seul des propriétaires souhaite placer des poutres dans le mur, il peut les enfoncer dans la totalité du mur en ne laissant que 5,4 centimètres du côté du voisin. Toutefois, si le voisin veut ensuite incorporer une poutre au même endroit, il peut obliger le propriétaire mitoyen à réduire l'enfoncement de la poutre à la moitié du mur (C. civ. art. 657).

On ne peut construire contre ou dans le mur mitoyen qu'avec l'accord de son voisin. Si ce dernier s'y oppose, le tribunal de grande instance peut autoriser la réalisation des travaux après expertise technique (C. civ. art. 662).
Lorsque les travaux sont effectués sans l'accord du voisin, celui-ci peut solliciter en justice la suspension des travaux ou la démolition des constructions commencées.
Le propriétaire mitoyen qui ne demande pas l'accord de son voisin avant de commencer les travaux engage sa responsabilité civile pour faute. Le tribunal peut ordonner la démolition des constructions et/ou octroyer des dommages-intérêts au voisin. Le voisin devra toutefois prouver que les travaux lui ont causé un préjudice, par exemple en ayant compromis la solidité du mur.
J'ai pour projet d'agrandir la serre qui se trouve au fond de mon jardin, en appuyant une partie de l'extension envisagée sur le mur mitoyen qui sépare nos propriétés.
Conformément aux dispositions de l'article 662 du Code civil, je sollicite votre accord afin de pouvoir réaliser ces travaux.
Chacun des copropriétaires peut planter en espalier de chaque côté du mur mitoyen sans avoir à respecter les distances réglementaires (voir no 72000).
Toutefois, si l'un des propriétaires endommage le mur du fait des plantations, sa responsabilité pourra être engagée.
Chacun des copropriétaires doit participer aux dépenses nécessaires à l'entretien du mur, voire si nécessaire à sa reconstruction (C. civ. art. 655).
La participation aux frais d'entretien est proportionnelle aux droits de chacun des propriétaires sur le mur. Par exemple, si l'un des propriétaires détient à titre privatif la moitié du mur et la mitoyenneté de l'autre moitié, il devra s'acquitter des 3/4 des frais si le mur est réparé dans sa totalité.
A noter que si l'un des propriétaires est responsable de la dégradation du mur, il devra supporter l'excédent de dépense nécessaire à la restauration du mur.
Pour que les dépenses soient partagées, les réparations doivent être nécessaires. La réparation ne doit pas être faite dans l'intérêt d'un seul propriétaire. En cas de désaccord sur la nécessité de réparer le mur, le voisin qui veut le rénover doit obtenir une autorisation du tribunal de grande instance avant de débuter les travaux.
Un propriétaire peut à tout moment renoncer à la mitoyenneté d'un mur, sauf s'il est responsable de sa détérioration ou s'il en retire un avantage particulier, par exemple le mur soutient une construction lui appartenant, ses terres ou celles du voisin (C. civ. art. 656).
L'abandon est, de préférence, formulé dans un acte notarié publié au service de la publicité foncière afin d'être opposable aux tiers.
L'abandon de la mitoyenneté par l'un des copropriétaires lui permet de se décharger des frais d'entretien du mur.
En cas d'abandon de la mitoyenneté du mur, le voisin devient le propriétaire unique du mur et du sol sur lequel il repose. Le propriétaire abandonnant ne peut plus utiliser le mur pour y appuyer par exemple des plantations en espalier.
Même s'il a renoncé à la mitoyenneté d'un mur à un moment donné, un propriétaire peut l'acquérir à nouveau.
Délaissant ma résidence secondaire située à ..., je souhaite renoncer à la mitoyenneté du mur en pierres qui sépare nos propriétés et dont je ne retire aucune utilité.
Pour que cette situation soit sans équivoque, j'ai confié cette affaire à Maître ..., mon notaire, qui doit me faire signer un acte d'abandon puis le publier au service chargé de la publicité foncière.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles.
C'est l'aménagement qui, pratiqué par un propriétaire, lui permet de regarder chez le voisin. La vue existe même si, pour voir, l'on doit grimper sur une échelle ou un grand escabeau (Cass. 3e civ. 19-1-2005 no 03-19.179). Certaines cours d'appel, plus exigeantes, estiment qu'il n'y a de vue que lorsque celle-ci s'exerce dans des conditions constantes et normales, c'est-à-dire sans effort particulier.
L'ouverture donnant chez le voisin est généralement une fenêtre, une porte-fenêtre, un vasistas, une véranda, un balcon ou une terrasse. Il importe peu que cette terrasse soit située au rez-de-chaussée, en étage ou serve de toit (toiture-terrasse aisément accessible). La vue peut également résulter de la surélévation volontaire d'une partie du terrain.
La possibilité de réaliser une ouverture donnant chez le voisin doit respecter certaines règles de distance par rapport à la limite séparative. La loi distingue les « vues droites » et les « vues obliques » (C. civ. art. 678 et C. civ.679).
La « vue droite » est celle qui permet de regarder directement chez le voisin lorsque l'on se place dans l'axe de l'ouverture et que l'on regarde droit devant, sans se pencher ni tourner la tête à droite ou à gauche.
La « vue oblique » ou latérale est celle qui permet de regarder chez le voisin en se plaçant à l'angle de l'ouverture et en regardant à droite ou à gauche.
L'ouverture ne peut être réalisée que si elle se situe à 1,90 mètre au moins de la limite séparative en cas de vue droite et à 60 centimètres au moins de cette même limite en cas de vue oblique (exemple 1).

La distance se calcule à partir de la façade comportant l'ouverture (de l'angle de l'ouverture pour les vues obliques) ou des différents bords extérieurs s'agissant d'un balcon ou d'une terrasse jusqu'à la limite séparative (exemples 2 et 3).
Lorsqu'un mur sépare les deux propriétés, trois cas doivent être envisagés :
- le mur appartient à l'observateur : la limite séparative est la façade du mur orientée vers le voisin ;
- le mur appartient à l'observé : la limite séparative est la façade du mur visible depuis l'ouverture ;
- le mur est mitoyen : la limite séparative est située au milieu du mur.


Lorsque les deux propriétés sont séparées par un espace privé commun aux deux propriétaires (parcelle en indivision, cour commune, passage), la distance légale doit s'apprécier non pas au milieu de l'espace commun mais de l'autre côté de celui-ci (Cass. 3e civ. 14-1-2004 no 02-18.564 : Bull. civ. III no 9). Autrement dit, dès lors que la largeur de l'espace commun est supérieure à 1,90 mètre, il est possible de réaliser une ouverture en bordure de cet espace appartenant aux deux voisins.
Les règles de distance ne s'appliquent pas à l'intérieur d'une copropriété, et pas davantage lorsque le terrain voisin appartient au domaine public (une rue, par exemple). Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque la vue donne sur une servitude de passage interdisant de construire et profitant au voisin qui veut ouvrir la vue (voir no 72200 s.).
Si aucune vue n'est possible sur le terrain du voisin, les règles de distance n'ont pas à être respectées. C'est le cas, par exemple, lorsque la fenêtre donne sur un mur aveugle (CA Aix 19-6-1962 : D. 1962 p. 538) ou un toit sans ouverture (Cass. 3e civ. 3-7-1969 no 67-13.300 : Bull. civ. III no 551).
ConseilSi vous souhaitez ouvrir une fenêtre donnant sur le toit sans ouverture du voisin, obtenez au préalable son accord écrit et son renoncement à pratiquer dans le futur une ouverture dans ce toit. A défaut, s'il décidait un jour d'installer par exemple un Velux, il pourrait exiger l'obturation de votre vue ne respectant pas les distances légales. Ce risque est d'autant plus grand qu'il a été jugé qu'une servitude de vue ne peut pas s'acquérir par l'écoulement d'un délai de 30 ans lorsque la vue donne sur un toit aveugle (Cass. 3e civ. 9-5-2001 no 99-12.050).
Si les règles de distance n'ont pas été respectées, le voisin peut demander devant le tribunal de grande instance (l'assistance d'un avocat est obligatoire) l'obturation de cette ouverture ou la démolition de l'aménagement permettant la vue irrégulière. En pratique, c'est le juge qui décide des mesures appropriées : installation d'un panneau opaque empêchant toute vue droite ou oblique, recul de la véranda, démolition de la terrasse ou du balcon...
Le propriétaire peut s'opposer à l'obturation ou à la démolition s'il bénéficie d'une servitude de vue :
- la vue a été ouverte il y a plus de 30 ans sans que le voisin (passé ou actuel) s'y soit opposé ;
- la vue a été faite à un moment où les deux terrains constituaient une seule et même propriété (on parle de « servitude de vue par destination du père de famille ») ;
- la vue est autorisée par un titre, par exemple un contrat passé entre voisins. Pour être opposable aux tiers, notamment aux futurs acquéreurs des propriétés, cette servitude contractuelle devra être notariée et publiée au service de la publicité foncière ; l'existence de la servitude sera mentionnée dans les actes de vente.
L'existence d'une servitude de vue permet au propriétaire bénéficiaire de s'opposer à la fermeture de l'ouverture mais elle n'autorise pas son agrandissement. Elle interdit au voisin de construire à moins de 1,90 mètre de l'ouverture bénéficiant de la servitude (il peut construire en dessous mais pas au-dessus).
Dans les murs séparant deux propriétés (mur de clôture ou mur pignon d'une maison), seuls des jours peuvent être pratiqués car les règles de distance des vues droites et obliques ne peuvent pas être respectées.
Constitue un jour l'ouverture permettant de laisser passer la lumière (et non le regard). En principe, les jours comportent un châssis qui ne s'ouvre pas, un verre translucide et un treillis de fer maillé à 10 centimètres. Ils doivent être placés au minimum à une hauteur de 2,60 mètres au rez-de-chaussée et à 1,90 mètre en étage (C. civ. art. 677). La taille de l'ouverture n'est pas limitée.
Si les conditions d'ouverture du jour ne respectent pas ces prescriptions, les juges peuvent en ordonner la fermeture ou la mise en conformité. Des jours qui ne font qu'éclairer l'immeuble et offrent au voisin des « garanties de discrétion suffisante » sont toutefois exemptés de toute règle de hauteur minimale (Cass. 3e civ. 27-5-2009 no 08-12.819 : Bull. civ. III no 127). Il a même été jugé qu'un mur constitué de briques en verre translucide ne constituait ni un jour ni une vue, mais une paroi de mur à laquelle ne s'appliquent pas les règles des jours et des vues (Cass. 1e civ. 22-7-1964 : Bull. civ. I no 414).
En pratique, ce sont les possibilités de regarder aisément chez les voisins qui déterminent si l'ouverture doit être qualifiée de vue ou de jour.
Lorsque le mur est mitoyen (voir no 71600) ou est implanté sur le terrain du voisin en limite séparative, aucune fenêtre ou ouverture ne peut être pratiquée sans l'accord du voisin (le juge ne peut pas autoriser l'ouverture). Dans les autres cas, le percement d'un jour ne nécessite pas l'accord du voisin.
L'ouverture d'un jour constitue une simple tolérance (on parle de « jour de souffrance » ou de « jour de tolérance »). Son existence, même régulière et même datant de plus de 30 ans, n'empêche pas le voisin de l'obstruer en construisant en limite séparative, sauf intention manifeste de nuire.
Si vous achetez une maison comportant une fenêtre sur un mur pignon en limite séparative, renseignez-vous pour savoir si cette ouverture bénéficie d'une servitude de vue. A défaut, c'est une vue irrégulière ou un jour qui pourra être obstrué.
Les arbres et arbustes d'une hauteur supérieure à 2 mètres doivent être plantés à au moins 2 mètres de la propriété voisine. Les plantations d'une hauteur inférieure doivent être distantes d'au moins 50 centimètres du terrain voisin (C. civ. art. 671).
Toutefois, des règlements particuliers (arrêtés municipaux, par exemple) ou des usages peuvent prévoir des distances ou des hauteurs différentes. Ainsi, il est d'usage dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne de pouvoir planter jusqu'en bordure de propriété (CA Paris 24-4-1985 : D. 1987 IR p. 16). Même chose en Seine-Maritime (CA Rouen 17-10-2006 no 05/3458). Les arrêtés municipaux ainsi que les usages codifiés par la chambre d'agriculture peuvent être consultés en mairie.
Attention, le cahier des charges d'un lotissement peut prévoir des règles plus restrictives, par exemple une hauteur de haie limitée à 1,30 mètre (Cass. 3e civ. 27-3-2013 no 11-21.221 : Bull. civ. III no 44).
Si un mur sépare les deux propriétés, le propriétaire auquel il appartient peut planter en espalier contre le mur sans respecter les distances réglementaires. On appelle espaliers les rangées d'arbres fruitiers alignés contre un mur. Les plantations ne doivent pas toutefois dépasser la crête du mur. Si le mur est mitoyen, les deux propriétaires du mur peuvent planter en espalier.
AttentionLorsqu'elle s'applique, la règle de hauteur maximale des plantations doit être scrupuleusement respectée tout au long de l'année. Tout dépassement de la hauteur réglementaire sera sanctionné, alors même que l'art du jardinage eût commandé d'attendre quelques mois pour tailler à meilleure saison (Cass. 3e civ. 19-5-2004 no 03-10.077 : Bull. civ. III no 106). Mais, un propriétaire ne peut être condamné, par avance, à une taille annuelle de ses végétaux (Cass. 3e civ. 6-1-2009 no 07-21.948).
La distance se calcule à partir de l'axe médian du tronc d'arbre jusqu'à la limite séparative des deux propriétés (Cass. 3e civ. 1-4-2009 no 08-11.876 : Bull. civ. III no 78).
Si un mur sépare les deux propriétés, la distance se calcule à partir :
- du milieu du mur si le mur est mitoyen ;
- du mur si ce dernier appartient au voisin ;
- de la limite séparative si le mur appartient au propriétaire de l'arbre.
La mesure se fait au niveau du sol même si l'arbre n'est pas droit et penche vers la propriété voisine.
La hauteur se calcule du pied de l'arbre jusqu'à son sommet, même s'il existe un dénivelé entre le terrain du propriétaire de la plantation et celui du voisin (Cass. 3e civ. 4-11-1998 no 96-19.708 : Bull. civ. III no 208).

Si la distance n'a pas été respectée, le voisin peut exiger soit l'élagage de l'arbre à la hauteur autorisée, soit son arrachage (C. civ. art. 672). Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution (Cons. const. 7-5-2014 no 2014-394 QPC : JO 10, décision visant également l'article 671 du Code civil). Le choix entre l'élagage ou l'arrachage appartient au propriétaire de la plantation, sauf si l'arbre a été planté à moins de 50 centimètres de la propriété voisine. Dans cette dernière hypothèse, l'arbre devra obligatoirement être arraché.
Le propriétaire de l'arbre pourra s'opposer à l'arrachage ou à l'élagage de l'arbre si :
- l'arbre a dépassé la hauteur autorisée depuis plus de 30 ans sans que le voisin s'y soit opposé. Toutefois, si l'arbre est implanté dans la zone des 50 centimètres de la ligne séparative, où toute plantation est en principe interdite, le délai de prescription de 30 ans démarre à la date de la plantation (Cass. 3e civ. 3-4-2012 no 11-12.928) ;
- l'arbre a été planté à un moment où les deux terrains constituaient une seule et même propriété (on dit que l'arbre a été planté par « destination du père de famille ») ;
- le propriétaire possède un titre l'autorisant à planter à une distance non réglementaire (par exemple, un contrat entre voisins).
Si l'arbre meurt, le propriétaire ne pourra plus se prévaloir de ces exceptions et devra, pour replanter, respecter les distances réglementaires.
Signalons enfin que l'action en élagage ou en arrachage doit être dirigée contre le propriétaire du terrain où sont situées les plantations et non contre son locataire (Cass. 3e civ. 5-2-2014 no 12-28.701 : Bull. civ. III à paraître).
Si, bien que l'arbre ait été planté à bonne distance, ses racines empiètent sur la propriété voisine, le voisin peut les couper sans en avertir le propriétaire de l'arbre (C. civ. art. 673).
Si ce sont les branches de l'arbre qui empiètent, le voisin peut exiger que les branches soient élaguées mais il ne peut pas procéder lui-même à la coupe. Si le propriétaire de l'arbre refuse d'élaguer, le voisin devra s'adresser au tribunal pour que la coupe soit ordonnée au besoin sous astreinte. Cet élagage des branches peut être demandé même si l'empiétement a été toléré pendant plus de 30 ans et même si la coupe doit entraîner la mort des arbres (Cass. 3e civ. 18-10-2006 no 04-20.370 : Bull. civ. III no 203). Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un « arbre remarquable » répertorié en tant que tel dans le plan vert de la commune (Cass. 3e civ. 31-5-2012 no 11-17.313).
A noter que certains juges fixent la date de la coupe aux périodes habituelles d'élagage des arbres afin de préserver la plantation.
Dans un lotissement, la demande d'élagage d'un voisin a toutefois été rejetée, le cahier des charges prévoyant le maintien et la protection des plantations (Cass. 3e civ. 13-6-2012 no 11-18.791 : Bull. civ. III no 96). La coupe des branches aurait en effet entraîné une mutilation de l'arbre contraire à un tel objectif.
Lorsque les branches d'un arbre empiètent sur une propriété voisine, les fruits qui en tombent naturellement appartiennent au voisin. Il a donc le droit de les ramasser.
Si votre commune est couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) et si votre propriété dépend d'un espace boisé (bois, forêt, parc, espace boisé classé) ou, plus simplement, si le PLU le prévoit, la coupe ou l'abattage d'un arbre doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie au moins deux mois à l'avance (C. urb. art. L 130-1). Vous n'êtes dispensé de déclaration que pour l'enlèvement d'arbres dangereux, de chablis ou de bois morts (C. urb. art. R 130-1).
Les règles sont parfois plus contraignantes. Par exemple, la coupe ou l'abattage sont contrôlés par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsque l'arbre est situé :
- à moins de 500 mètres d'un monument historique, si l'opération est susceptible de modifier l'aspect des lieux ;
- dans un secteur sauvegardé (les règles à appliquer figurent dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur).
Faute de respecter ces obligations (déclaration ou autorisation), vous risquez une amende.
Signalons par ailleurs que certains arbres remarquables ont pu être classés ou inscrits en tant que tels au titre des monuments historiques ou des sites et monuments naturels, pratiques qui n'ont plus cours aujourd'hui. Renseignez-vous en mairie.
Si vous êtes en lotissement, n'oubliez pas de consulter le règlement et le cahier des charges : ils peuvent contenir des règles particulières en la matière (dans la mesure où elles correspondent à des règles d'urbanisme, les dispositions de ces deux documents sont toutefois remplacées par le PLU au bout de 10 ans).
Propriétaire riverain d'une voie publique, vous devez faire le nécessaire pour que vos plantations (arbres, branches, haies ou racines) ne débordent pas sur cette voie publique et n'entravent pas la circulation des véhicules ou des piétons. A défaut, outre une amende maximale de 1 500 €, vous risquez d'être mis en demeure par le maire ou le préfet de procéder aux travaux d'élagage et d'abattage nécessaires (CGCT art. L 2212-2). L'administration ne peut pas y faire procéder d'office à vos frais. Elle peut en revanche saisir le juge qui vous ordonnera d'exécuter les opérations qui s'imposent, au besoin sous astreinte. Par exception, l'exécution d'office et à vos frais des travaux est possible, après mise en demeure restée sans effet, si votre propriété est riveraine d'un chemin rural (il s'agit d'un chemin ouvert à la circulation publique appartenant au domaine privé de la commune) ou d'une voie communale (C. rur. art. D 161-24 et CGCT art. L 2212-2-2).
Si votre propriété est située à proximité d'un croisement, d'un virage ou d'un point dangereux ou incommode pour la circulation publique, vous pouvez être soumis à un plan de dégagement approuvé après enquête publique (C. voirie routière art. L 114-1 s. et C. voirie routièreR 114-1 s.). Ce plan détermine des servitudes de visibilité qui peuvent vous interdire de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan. Il peut également vous être imposé de supprimer les murs de clôture, ou de les remplacer par des grilles, et de supprimer les plantations gênantes. Le cas échéant, vous serez indemnisé du dommage direct, matériel et certain résultant de l'établissement de la servitude.
La commune doit entretenir les plantations qui sont situées sur son domaine public (état sanitaire, élagage, coupe près du sol, dite « recépage », visant à permettre la pousse de rejets). Si, en tant que riverain, vous subissez un dommage causé par ces plantations (perte d'ensoleillement, branches tombées sur votre toit, racines soulevant votre dallage, etc.), vous pouvez engager la responsabilité de la commune. Il vous suffira de démontrer que le dommage a pour origine la plantation concernée.
Mais avant de saisir le tribunal administratif, demandez au maire d'entreprendre les travaux nécessaires.
SavoirEn tant que riverain d'une voie publique, vous ne pouvez demander réparation que des seuls dommages dépassant en importance ceux que tout riverain est tenu de supporter sans indemnité en compensation des avantages qu'il tire de sa situation. Ainsi, vous n'obtiendriez probablement rien en raison des inconvénients résultant de la chute, sur votre toiture, des feuilles des platanes agrémentant la place publique voisine.
Que les distances et hauteurs réglementaires aient été ou non respectées, le propriétaire est responsable civilement de tous les dommages pouvant être occasionnés par cet arbre. Tel pourra être le cas si les racines de l'arbre endommagent des canalisations ou la maison voisine.
De même, un tribunal pourra ordonner la coupe ou l'arrachage de l'arbre si ce dernier cause un trouble anormal de voisinage (voir nos 71000 s.). Tel pourra être le cas si l'arbre prive le voisin de tout ensoleillement ou encore s'il est haut de plus de deux mètres et que ses racines passent sous la maison du voisin et en menacent la solidité, notamment en période cyclonique (Cass. 3e civ. 11-12-2007 no 07-11.610). Dès lors que le trouble anormal est caractérisé, peu importe que la plantation irrégulière le soit depuis plus de 30 ans (Cass. 3e civ. 4-2-2009 no 07-20.556).
Dès lors que le voisin a réclamé à plusieurs reprises la coupe des arbres penchant dangereusement chez lui, la tempête à l'origine de leur chute ne revêt pas les caractères de la force majeure permettant au propriétaire des arbres d'échapper à sa responsabilité (Cass. 3e civ. 10-12-2014 no 12-26.361 : RJDA 4/15 no 319, BDP 3/15 inf. 118).
Le brûlage à l'air libre des « déchets verts » des particuliers (tonte des pelouses, taille des haies et arbustes, élagage, etc.) est en principe interdit par le règlement sanitaire départemental type (Circ. du 18-11-2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts). Le préfet peut toutefois prévoir des dérogations dans les zones périurbaines et rurales où il n'existe pas de déchetterie ou de système de collecte de ces déchets. Le brûlage doit alors être pratiqué hors épisode de pollution, sur végétaux secs, entre 11 h et 15 h 30 durant les mois de décembre, janvier et février, entre 10 h et 16 h 30 les autres mois de l'année (hors mois interdits en raison du risque incendie). Des restrictions supplémentaires peuvent en outre être imposées au niveau local par arrêté municipal : distance minimale à respecter par rapport aux habitations, interdiction en cas de vent fort, présence d'un tuyau d'arrosage à proximité (se renseigner à la mairie).
Afin de lutter contre le risque d'incendie, les propriétaires fonciers sont, dans certaines parties du territoire, astreints à une obligation légale de débroussailler. Le débroussaillage a pour objet de limiter la propagation et l'intensité des incendies, notamment en espaçant la végétation, en procédant à la coupe et à l'élimination de tous bois morts, broussailles et herbes sèches ou encore en élaguant les arbres et arbustes jusqu'à une certaine hauteur.
Les régions concernées sont celles qui sont particulièrement exposées aux incendies : massifs forestiers des régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et des départements de l'Ardèche et de la Drôme (C. for. art. L 133-1). Il en va de même des bois et forêts classés à risque d'incendie par le préfet (C. for. art. L 132-1).
L'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé s'applique aux terrains situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, landes, maquis ou garrigue (C. for. L 134-6).
En zone urbaine délimitée par le plan local d'urbanisme (ou le plan d'occupation des sols), vous devez débroussailler la totalité de votre parcelle, qu'elle soit construite ou non.
En zone non urbaine, vous devez débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de votre maison (distance que le maire peut porter à 100 mètres) et dans une bande de 10 mètres de largeur (le préfet peut prévoir moins) prise de part et d'autre de la voie d'accès. Si le rayon de 50 mètres dépasse les limites de votre parcelle, vous êtes tenu de débroussailler y compris chez le voisin, sauf lorsque la surface concernée est incluse dans un rayon de 50 mètres autour de sa propre habitation. En pratique, vous devez demander au voisin (et à son propriétaire, s'il est locataire), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autorisation de pénétrer sur la propriété. Votre courrier doit l'informer de l'obligation de débroussailler et lui préciser que, faute de vous accorder cette autorisation dans le délai d'un mois, le débroussaillage sera à sa charge. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu d'en informer le maire, qui fera faire le nécessaire (C. for. R 131-14).
Toujours en zone non urbaine, si votre terrain n'est pas construit, vous n'êtes pas soumis à l'obligation de débroussailler.
Pour une illustration en images de ces différentes situations, voir le guide du débroussaillement publié par la préfecture de la Drôme sur son site internet (www.drome.gouv.fr : suivre le cheminement Politiques publiques > Agriculture, forêts et développement rural > Forêts > Prévention contre les incendies de forêts).
Sachez par ailleurs qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut prévoir des modalités particulières de débroussaillement en vue de la protection des constructions.
Enfin, en dehors des territoires visés ci-dessus, le préfet a le pouvoir d'imposer aux propriétaires de débroussailler leur terrain dans un rayon de 50 mètres autour des constructions, s'il s'agit d'une zone particulièrement exposée aux incendies (C. for. art. L 131-11).
SavoirC'est la position de la construction à l'intérieur de la bande des 200 mètres autour des bois et forêts qui conditionne la distance à débroussailler et ce, quel que soit l'emplacement du bâti dans cette bande. Ainsi, le propriétaire de la construction peut être amené à débroussailler à l'intérieur du massif qu'il jouxte. Par exemple, le propriétaire d'une habitation située à 10 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantation ou reboisement sera tenu de débroussailler jusqu'à 40 mètres à l'intérieur de ce massif boisé en direction de celui-ci et jusqu'à 50 mètres dans la direction opposée. Pour une construction située à 190 mètres de ce même massif, le propriétaire aura l'obligation de débroussailler jusqu'à 50 mètres en direction du massif, mais pas au-delà de 10 mètres dans la direction opposée (Rép. Peiro : AN 30-4-2013 p. 4715 no 20429).
Le coût d'un premier débroussaillage va de 1 500 € à 5 000 € par hectare selon qu'il est effectué mécaniquement ou à la main, suivant la configuration du terrain et sa facilité d'accès, etc. L'entretien courant, à effectuer tous les deux ou trois ans, est généralement deux fois moins cher.
Pour tenter d'en alléger la charge en négociant de meilleurs tarifs, les propriétaires concernés peuvent se regrouper en association syndicale. La solution est financièrement d'autant plus intéressante qu'une réduction d'impôt est accordée au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent des travaux de prévention contre les incendies de forêt. La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des cotisations versées, montant retenu dans la limite de 1 000 € par an et par foyer fiscal, soit une réduction annuelle maximale de 500 € (CGI art. 200 decies A).
Vous avez encore la possibilité de confier les travaux de débroussaillage à votre commune, qui vous les facturera ensuite (C. for. art. L 131-14).
Si vous conservez la charge du débroussaillage à titre individuel, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un crédit ou d'une réduction d'impôt si vous avez recours à une aide à domicile ou à un organisme agréé de services à la personne pour la réalisation des travaux. S'agissant de travaux de jardinage, l'avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses supportées, elles-mêmes prises en compte dans la limite de 5 000 € par an et par foyer fiscal, soit une réduction annuelle maximale de 2 500 € (CGI art. 199 sexdecies).
Si, après en avoir été mis en demeure, vous ne respectez toujours pas votre obligation au débroussaillage, le maire peut l'ordonner d'office et à vos frais. La commune peut en outre vous infliger une amende administrative pouvant aller jusqu'à 30 € par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillage (C. for. art. L 135-2).
Indépendamment de toute mise en demeure, vous risquez également une sanction pénale : amende de 750 €, qui est portée à 1 500 € si votre terrain est situé, notamment, dans une ZAC ou un lotissement (C. for. art. R 163-3). Surtout, vous pouvez être condamné pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie - la peine encourue est un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (C. pén. art. 322-5) - si l'absence de débroussaillement a permis la propagation de l'incendie (Cass. crim. 4-9-2007 no 06-83.383 : Bull. crim. no 192).
Enfin, si votre maison subit des dommages en raison d'un incendie de forêt alors que vous n'avez pas débroussaillé ainsi que vous y étiez tenu, votre compagnie d'assurance peut pratiquer une franchise supplémentaire à celle prévue le cas échéant au contrat, d'un montant maximum de 5 000 € (C. ass. art. L 122-8).
Un terrain est enclavé lorsqu'il n'a aucun accès à la voie publique ou lorsque cet accès est insuffisant, par exemple s'il ne permet pas le passage d'un véhicule (exemples 1 et 2).
Il y a également enclavement lorsqu'un terrain longe une route mais que celle-ci est inaccessible depuis la propriété. Tel sera le cas s'il y a une dénivellation très forte entre la propriété et la voie publique (exemple 3).

Le propriétaire d'un terrain enclavé peut demander un droit de passage sur l'une des propriétés qui l'entourent afin d'accéder à la voie publique (C. civ. 682). En pratique, on parle de « servitude de passage ». Ce droit lui sera obligatoirement accordé à condition :
- qu'il prouve que son terrain est enclavé ;
- qu'il ne soit pas directement responsable de son enclavement. Il est directement responsable de l'enclavement s'il a bâti une construction sur la partie de son terrain qui lui permettait d'accéder à la route.
Le droit de passage peut être demandé non seulement pour les besoins familiaux du propriétaire du terrain enclavé mais aussi pour l'exercice d'une activité agricole, industrielle ou commerciale.
Les voisins peuvent convenir ensemble du lieu du passage. Il est conseillé dans ce cas de constater l'accord dans un contrat écrit.
A défaut d'accord, le passage sera fixé par le juge. Il doit être pris à l'endroit où le trajet est le plus court entre le terrain enclavé et la voie publique (C. civ. art. 683). Cette règle s'applique même si le passage oblige à traverser plusieurs propriétés alors qu'un petit allongement du trajet permettrait de passer sur une seule propriété.
Toutefois, si le trajet le plus court est de nature à causer un dommage excessif au terrain qui subira le passage, un trajet plus long pourra être retenu. Tel sera le cas si l'établissement du droit de passage oblige à la coupe d'arbres ou à la démolition d'une construction.
Si l'état d'enclave provient de la division d'une propriété en plusieurs lots par suite d'une vente, d'un partage, etc., le passage ne peut être demandé que sur les terrains issus de la division. Lorsque aucun passage suffisant ne peut être créé sur les terrains divisés, le propriétaire du terrain enclavé pourra demander le passage sur une autre propriété (C. civ. art. 684).

L'étendue et les conditions du passage seront déterminées en fonction des besoins du propriétaire du terrain enclavé.
Les voisins peuvent convenir ensemble des conditions d'utilisation du passage. A défaut d'accord, les modalités du droit de passage seront fixées par le juge.
La largeur du passage peut être de un, deux, trois ou quatre mètres selon que le propriétaire souhaite circuler uniquement à pied ou a besoin de faire passer de gros engins agricoles.
Selon les cas, le passage peut être utilisé continuellement, certains jours de la semaine ou à certaines heures de la journée.
On appelle « tour d'échelle » le droit pour le propriétaire d'une construction édifiée en limite de propriété de poser, le long de cette construction et sur le sol de la propriété voisine, des échelles et des échafaudages pour le temps des travaux nécessaires à l'entretien de son bien.
L'exercice de ce droit nécessite un accord entre les voisins. Toutefois, le refus du voisin peut être considéré comme un abus du droit de propriété et le tribunal de grande instance peut autoriser un passage temporaire aux conditions suivantes (Cass. 3e civ. 15-2-2012 no 10-22.899 : Bull. civ. III no 32) :
- les travaux sont indispensables ;
- celui qui doit réparer son bien (mur, toiture, etc.) n'a pas d'autres possibilités pour réaliser les travaux que de passer chez son voisin ;
- le passage n'occasionne pas trop de dommages au voisin ;
- le passage est temporaire.
Le tribunal peut accorder une indemnité au propriétaire qui subit le tour d'échelle, notamment si la durée du droit de passage est longue et s'il cause un préjudice de jouissance important.
Le bénéficiaire du droit de passage devra indemniser son voisin de tous les dommages causés.
Si les besoins du bénéficiaire du passage évoluent ultérieurement, il pourra obtenir la modification des conditions d'utilisation du passage ou de son étendue. Le bénéficiaire du passage devra démontrer l'utilité des modifications. Le seul fait que le passage lui serait plus commode s'il était situé ailleurs n'est pas suffisant.
Le propriétaire supportant la servitude peut continuer d'utiliser son terrain à sa convenance. Toutefois, il ne peut pas entreposer sur le passage des objets portant atteinte au droit de passage. Il peut clore sa propriété, par exemple en posant une barrière ou un portail à l'entrée du passage, mais il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son voisin puisse continuer à utiliser normalement le passage, en lui remettant les clés de la barrière ou une télécommande qui permet d'ouvrir le portail, automatisé, à distance (Cass. 3e civ. 20-3-2012 no 11-15.140).
De même, le propriétaire peut placer une haie le long du passage pour préserver son intimité, mais il doit veiller à ce que les plantations ne réduisent pas l'étendue du droit de passage.
Le bénéficiaire du passage doit indemniser celui qui supporte la servitude (C. civ. art. 682).
L'indemnité est proportionnelle au préjudice qu'occasionnent l'établissement et l'usage du droit de passage (destruction d'un mur, d'arbres, perte de jouissance du terrain, gêne occasionnée...). L'indemnité peut être versée en une seule fois ou périodiquement tant que dure la servitude.
Le montant de l'indemnisation est fixé soit à l'amiable, soit par le tribunal de grande instance après expertise judiciaire.
Les frais d'établissement et d'entretien du passage sont le plus souvent à la charge de celui qui bénéficie du droit de passage (C. civ. art. 697 et C. civ.698 ; Cass. 3e civ. 12-3-2014 no 12-28.152 : Bull. civ. III no 38). Toutefois, si le passage est utilisé par les deux propriétaires, chacun d'eux devra participer à son entretien.
Celui qui subit le passage reste propriétaire du terrain, il doit donc acquitter les impôts correspondants et spécialement les impôts fonciers.
Si la propriété vient à être désenclavée, par exemple après la création d'une nouvelle route, le droit de passage n'a plus lieu d'être. Le propriétaire qui subissait le passage est alors en droit de demander la suppression des ouvrages (par exemple, un portail) implantés sur sa propriété, y compris dans le sous-sol, tels les câbles téléphoniques ou d'alimentation électrique ou les conduites d'eau.
Si le bénéficiaire du passage ne veut pas y renoncer, le propriétaire doit s'adresser au tribunal de grande instance qui constatera la disparition de la servitude (C. civ. art. 685-1).
Lorsque vous vous promenez le long d'un rivage, vous avez en principe le droit de passer sur les propriétés privées riveraines (C. urb. art. L 160-6).
Ce droit de passage, encore appelé « le sentier du douanier » (historiquement, il permettait à l'administration des douanes de surveiller les côtes), est applicable à l'ensemble du littoral français ainsi qu'aux rivages des étangs d'eau salée. En revanche, le domaine public fluvial (fleuves, rivières, lacs, etc.) n'est pas concerné. Pour les cours d'eau, d'autres servitudes peuvent exister (servitude de marchepied, servitude de halage, etc.) mais leur régime juridique est différent.
Le passage le long du littoral s'exerce en suivant le rivage sur une bande de 3 mètres de largeur. Cette distance se calcule en partant, dans la majorité des cas, du niveau des plus hautes eaux en l'absence de tempête.
Le tracé du passage peut être modifié par le préfet pour tenir compte, par exemple, d'un chemin préexistant ou de la présence d'obstacles naturels (amas rocheux, partie de la propriété trop pentue, etc.).
Attention, seul le promeneur à pied bénéficie de cette liberté de passage. L'usage d'un véhicule, motorisé ou non, est interdit.
Pour tenir compte des situations préexistant à la création, en 1976, de ce droit de passage et de la gêne qu'il est susceptible d'occasionner pour les propriétaires riverains, certains aménagements ont été prévus. Ainsi, cette servitude ne s'applique pas, en principe, aux terrains situés à moins de 15 mètres des habitations construites avant le 1er janvier 1976 ni à ceux qui sont contigus à une maison d'habitation et qui ont été clôturés par un mur avant le 1er janvier 1976.
Enfin, on signalera que le droit de passage peut être suspendu par le préfet dans plusieurs hypothèses parmi lesquelles on retiendra (C. urb. art. R 160-12) :
- le fait qu'il existe déjà un chemin ouvert au public permettant de longer le rivage ;
- les risques qu'entraînerait un tel passage pour la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre archéologique ou écologique (réserves et parcs naturels) ;
- le recul des terres émergées causé par l'évolution prévisible du rivage.
Il est bien de pouvoir se promener en bord de mer, encore faut-il pouvoir y accéder depuis l'intérieur des terres. En l'absence d'accès public direct au rivage à moins de 500 mètres, le préfet peut ouvrir à la circulation piétonne les voies et chemins privés à usage collectif (par exemple, voies d'un lotissement), à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel (C. urb. art. L 160-6-1). La distance de 500 mètres se calcule en ligne droite (« à vol d'oiseau ») entre (C. urb. art. R 160-16) :
- le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou du chemin privé devant faire l'objet du droit de passage ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent ;
- et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
Les plages sont, en principe, d'accès libre et gratuit pour le public (C. envir. art. L 321-9 ; CGPPP art. L 2124-4).
Par exception, 20 % de la superficie des plages naturelles (50 % pour les plages artificielles) peuvent faire l'objet d'une concession (CGPPP art. R 2124-16) : l'emplacement est attribué à un concessionnaire public ou privé qui peut exploiter la plage à titre commercial (location de transats, installation de terrains de beach-volley, etc.). En tout état de cause, ces concessions doivent préserver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une « largeur significative » tout le long de la mer. Cette largeur est déterminée au cas par cas par le préfet en fonction des caractéristiques des lieux.
Quant aux plages dont l'accès a été interdit par des propriétaires riverains indélicats, elles ne sont en rien privées et les propriétaires encourent évidemment des sanctions.
Depuis 1986, l'urbanisation dans les communes du littoral est réglementée pour éviter le mitage et l'édification d'un véritable mur entre la mer et l'arrière-pays. Plus on se rapproche du rivage et plus cette réglementation est contraignante.
Sur l'ensemble des territoires communaux, les constructions nouvelles doivent se faire soit en continuité avec les villes et villages existants, soit en hameaux nouveaux (ce que n'est pas un lotissement) (C. urb. art. L 146-4, I).
Dans les espaces proches du rivage, seule une extension limitée de l'urbanisation est admise (C. urb. art. L 146-4, II). La notion d'espaces proches du rivage est appréciée au cas par cas. Un terrain situé à 1 kilomètre et plus peut être considéré proche s'il forme une continuité avec le rivage et notamment s'il est en liaison visuelle avec lui. A l'inverse, un terrain situé à 300 mètres peut n'être pas considéré comme proche du rivage s'il en est séparé par une zone déjà urbanisée interdisant toute covisibilité entre ce terrain et la mer.
Quant au caractère limité de l'urbanisation, il s'apprécie en tenant compte de la nature des terrains concernés, de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées.
Enfin, dans la bande littorale, qui est de 100 mètres (ou plus si le plan local d'urbanisme l'étend) à compter de la limite haute du rivage, la distinction suivante s'impose (C. urb. art. L 146-4, III) :
- dans les espaces déjà urbanisés, l'extension de l'urbanisation doit rester limitée puisqu'il s'agit d'un espace proche du rivage ;
- en dehors des espaces urbanisés toute construction est interdite (sauf rares exceptions pour des installations exigeant la proximité immédiate de l'eau, conchyliculture par exemple). Les constructions existant lors de l'entrée en vigueur de la loi littoral ne peuvent faire l'objet que de travaux confortatifs (adaptation, réfection mais pas extension). La reconstruction à l'identique après sinistre ou la restauration d'un bâtiment en ruine est possible si les documents d'urbanisme locaux ne s'y opposent pas.
Que peut faire un propriétaire qui subit de graves désagréments en raison de travaux entrepris sur un terrain mitoyen ou voisin du sien ? Il dispose de trois procédures très différentes dans leur objet comme dans leurs modalités.
Si la construction doit être édifiée conformément à un permis de construire qui semble illégal, il est possible de demander l'annulation du permis au tribunal administratif et, dans l'immédiat, que ce dernier en suspende l'exécution.
Si les travaux, quoique soumis au permis de construire, sont effectués sans permis ou s'ils ne respectent pas les prévisions du permis qui a été délivré, porter plainte afin de déclencher une action pénale contre le voisin est également une solution.
Si la construction est édifiée sous couvert d'un permis légal mais porte atteinte à des droits réels du propriétaire (par exemple, elle empiète sur son terrain ou méconnaît des servitudes instituées au profit de sa propriété par un acte de droit privé), ou lui cause un trouble anormal de voisinage, le propriétaire peut s'adresser au juge civil pour obtenir des dommages et intérêts, voire la démolition, et, dans l'immédiat, l'arrêt des travaux.
Nous allons maintenant détailler ces trois procédures.
C'est devant le tribunal administratif que l'on peut obtenir l'annulation d'un permis de construire illégal. Il faut démontrer que le permis a été délivré selon une procédure irrégulière (le dossier de demande ne comportait pas toutes les pièces requises, l'administration n'a pas recueilli l'avis de certains organismes, etc.) ou que la construction autorisée n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme fixée par le Code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme (dont le plus important est le PLU : plan local d'urbanisme). La formulation des « moyens d'annulation » exige une étude attentive du permis, qui peut être consulté en mairie. Il sera difficile d'éviter de recourir à un avocat.
Un permis n'est pas illégal du seul fait que la construction occasionne des nuisances. Même le fait qu'elle porte atteinte aux droits privés d'un propriétaire ne constitue pas un motif d'annulation devant le tribunal administratif. Il faut, dans ce cas, aller devant le juge civil.
Il faut agir vite ! La requête, comprenant la demande d'annulation et l'argumentation sur laquelle elle repose, doit parvenir au tribunal administratif dans les deux mois qui suivent l'affichage du permis sur le terrain (C. urb. art. R 600-2). En l'absence d'affichage, le recours doit être déposé au plus tard un an après l'achèvement des travaux.
Le délai de deux mois est en principe prolongé si, avant qu'il soit expiré, le requérant a demandé - mais ce n'est pas obligatoire - à l'autorité qui a délivré le permis (en général le maire) de le retirer. Dans ce cas, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception d'une réponse négative du maire. Celui-ci peut ne pas répondre. Il est alors censé avoir rejeté la demande deux mois après la date à laquelle elle lui est parvenue ; le nouveau délai pour saisir le tribunal administratif commence à courir à compter de la date de ce refus implicite de retirer le permis. En tout état de cause, le maire ne peut retirer le permis que dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il l'a délivré (C. urb. art. L 424-5).
Dans les 15 jours du dépôt de la requête devant le tribunal administratif, il faut en adresser une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du permis et à l'autorité qui l'a délivré (C. urb. art. R 600-1). Si ces notifications ne sont pas effectuées dans le délai de 15 jours, le tribunal rejettera la requête comme irrecevable, sauf si l'affichage du permis sur le terrain ne mentionnait pas l'obligation de notifier les recours. De même, s'il est d'abord demandé au maire de retirer le permis, il faut adresser une copie de ce courrier au titulaire du permis.
Parallèlement au dépôt de la requête en annulation du permis, il est possible de présenter une « requête en référé » pour demander la suspension du permis jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur sa légalité. Cette suspension ne sera accordée que si l'argumentation est regardée comme sérieuse par le juge des référés. En cas de suspension, le voisin devra arrêter les travaux jusqu'au jugement de l'affaire (qui en général exige au moins un an).
SavoirQue le tribunal administratif refuse d'annuler le permis ou au contraire prononce son annulation, son jugement peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel. Et l'arrêt de la cour peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. La procédure peut être très longue et comporter de nombreux rebondissements. Afin de l'accélérer, une suppression transitoire de l'appel a été instaurée lorsque le projet se situe dans l'une des communes soumises à la taxe sur les logements vacants, dont la liste figure en annexe du décret 2013-392 du 10 mai 2013 (C. just. adm. art. R 811-1-1, applicable aux recours introduits entre le 1-12-2013 et le 1-12-2018).
Si les travaux, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont soumis au permis de construire, le fait de les réaliser sans avoir sollicité et obtenu un permis est un délit puni d'une amende importante (jusqu'à 6 000 € par mètre carré construit illégalement) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois (C. urb. art. L 480-4). Le fait de réaliser des travaux non conformes au permis de construire obtenu est aussi réprimé pénalement.
L'infraction est constatée par un procès-verbal dressé par un officier ou agent de police judiciaire ou un autre fonctionnaire habilité à cet effet. Le maire est tenu de faire dresser procès-verbal dès lors que l'infraction a été portée à sa connaissance (C. urb. art. L 480-1). Il appartient également au maire, après avoir recueilli les observations du titulaire du permis, d'ordonner l'interruption des travaux et de transmettre son arrêté au procureur de la République afin de le mettre en mesure d'engager des poursuites. L'injonction administrative d'interrompre les travaux peut être assortie de mesures de coercition (saisie des matériaux de construction ou du matériel de chantier). Le fait de ne pas la respecter est puni de 75 000 € d'amende et trois mois d'emprisonnement, peines s'ajoutant à celles déjà mentionnées pour construction en infraction (C. urb. art. L 480-3).
L'interruption des travaux peut également être ordonnée dans le cadre des poursuites pénales par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel. Les mêmes autorités ont le pouvoir d'ordonner la mainlevée des mesures d'interruption des travaux, qu'elles aient été prises par le maire ou qu'elles résultent de leur propre décision. Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites (classement sans suite) ou si le tribunal rend un jugement de relaxe, les travaux peuvent reprendre. Si le titulaire du permis est au contraire condamné, le tribunal ordonnera la démolition de l'ouvrage (ou sa mise en conformité avec le permis de construire obtenu mais qui n'a pas été respecté). A noter que le voisin fautif peut obtenir après coup un permis de construire régularisant les travaux. Dans ce cas, il n'échappera pas à sa responsabilité pénale mais le tribunal ne pourra pas ordonner la démolition de la construction.
Pour mettre en mouvement l'action pénale en cas de construction irrégulière, il existe deux voies.
On peut adresser au maire une demande tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs en faisant dresser procès-verbal de l'infraction et en ordonnant l'interruption des travaux. Un refus éventuel (qui peut résulter du silence gardé par le maire pendant deux mois) pourra être attaqué devant le tribunal administratif. La présentation d'une demande en référé devant le tribunal administratif sera susceptible de déboucher, dans un délai relativement bref, sur une injonction d'agir adressée au maire. L'inertie fautive de l'administration pourra engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat.
Il est également possible de provoquer l'action pénale, même si le procureur de la République a pris une décision de classement sans suite, en portant plainte et en se constituant partie civile ou bien en procédant à une citation directe du titulaire du permis. Si le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites, l'on peut se porter partie civile par voie d'intervention devant le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel. Le juge pénal accordera, le cas échéant, la réparation des dommages subis.
L'action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de grande instance. Elle a pour objet d'obtenir réparation d'un dommage causé par un tiers. S'agissant des dommages résultant de constructions, l'action pourra déboucher sur une indemnisation ou même sur la démolition de la construction. Le juge civil des référés pourra, à titre conservatoire, ordonner l'arrêt de travaux entraînant un trouble manifestement illicite.
L'action civile a un champ très vaste. Elle peut être utilisée dans trois situations, dont les deux premières correspondent à celles qui ont été examinées ci-dessus et la troisième à un cas de figure non couvert par les deux autres procédures.
Si le dommage résulte d'une construction édifiée conformément à un permis de construire mais en méconnaissance des règles d'urbanisme, le juge civil ne peut ordonner la démolition que si le permis a d'abord été annulé par le tribunal administratif. Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet de loi « Macron » prévoit également que le juge civil ne peut ordonner la démolition que si la construction est située dans certaines zones protégées, limitativement énumérées (adopté par l'Assemblée nationale le 18-6-2015). En l'absence de recours préalable en annulation du permis, l'action en responsabilité civile ne pourra déboucher que sur une condamnation à des dommages et intérêts, sous réserve que le juge administratif ait au préalable déclaré le permis illégal (C. urb. art. L 480-13).
Si le dommage résulte d'une construction édifiée sans permis ou en violation des prévisions d'un permis, l'action civile permettra également d'obtenir une indemnisation ou la démolition. Mais l'action pénale offre les mêmes possibilités.
Si le dommage résulte d'une construction édifiée conformément à un permis légal, mais portant atteinte aux droits privés d'un propriétaire (empiètement sur son terrain, violation de servitudes dont il bénéficie) ou entraînant des troubles anormaux de voisinage - c'est la troisième hypothèse -, l'action devant le juge civil constituera la seule voie de droit ouverte.
L'action en démolition d'une construction conforme à un permis doit être exercée dans le délai de 2 ans à compter de l'annulation du permis, et l'action en dommages-intérêts dans les 2 ans de l'achèvement des travaux (C. urb. art. L 480-13). En cas de construction sans permis ou en violation des prévisions d'un permis, l'action en responsabilité civile doit être exercée dans les 5 ans du jour où le voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque la construction porte atteinte à un droit réel, le délai de prescription est de 30 ans (C. civ. art. 2227).
AttentionPour qu'une action en responsabilité soit couronnée de succès, il faut non seulement que le titulaire du permis ait agi de manière illicite, mais aussi que le demandeur établisse avoir subi de ce fait un préjudice réel et certain. Ainsi, l'action d'un voisin se plaignant de ce qu'une construction dépasse de quelques décimètres la hauteur maximale autorisée par le PLU sera rejetée, une telle circonstance n'entraînant pour lui aucun dommage sensible (Cass. 3e civ. 20-2-2002 no 00-17.412 : Bull. civ. III no 47).
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre