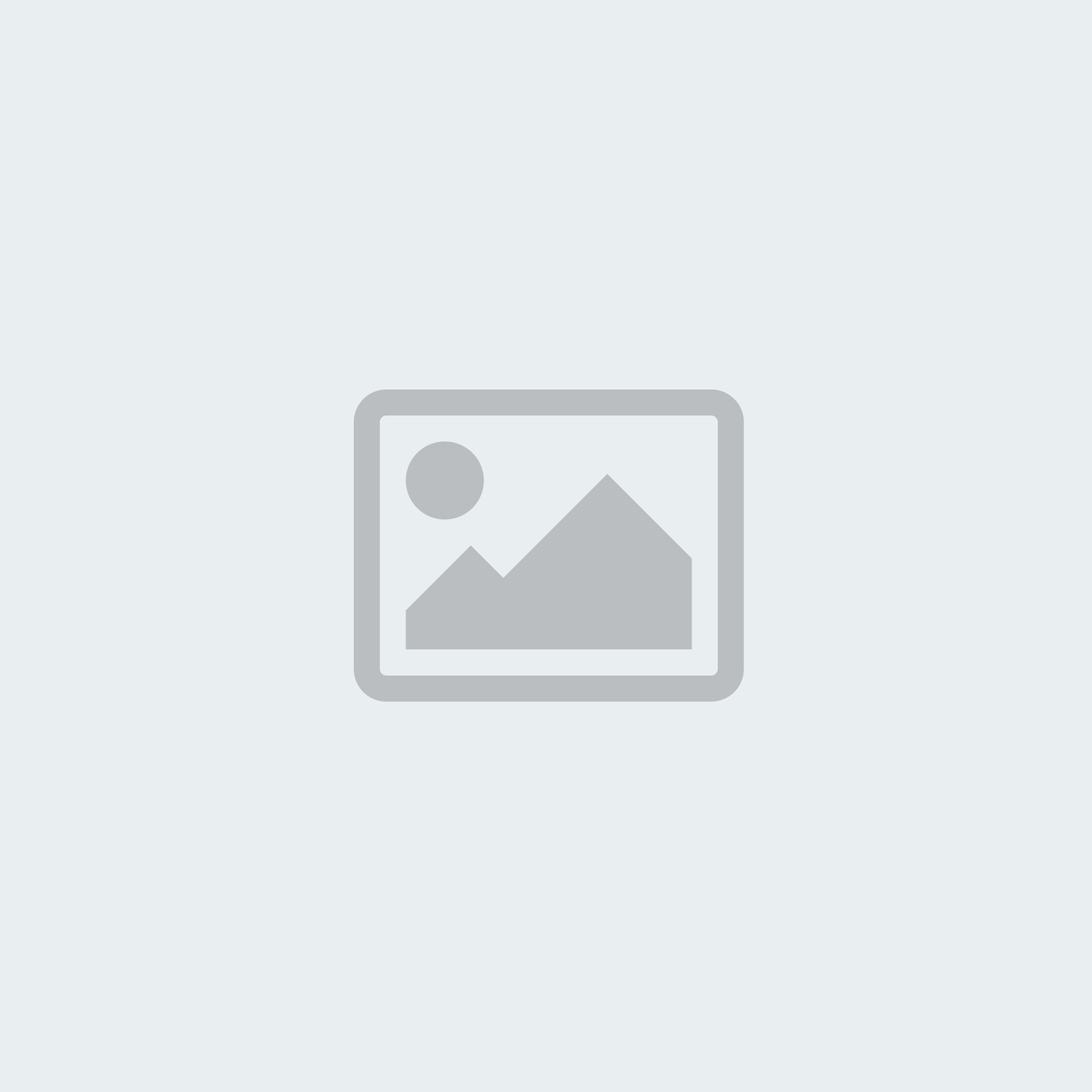Vaste sujet que les conditions d'emploi, qui recouvrent toute la vie du contrat de travail, depuis l'embauche du salarié jusqu'à son départ de l'entreprise. La plupart des règles applicables font l'objet d'études spécifiques tout au long des développements relatifs aux salariés : ainsi, par exemple, les horaires de travail ou la rémunération. Les développements qui suivent se limitent donc à des zooms sur des modes particuliers d'organisation du travail et sur les règles applicables en cas de modifications des conditions d'emploi initiales.
Le télétravail est un mode d'organisation du travail : le travail qui pourrait être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué, de façon régulière, en dehors de ces locaux grâce à l'usage des « technologies de l'information et de la communication ». En bref, le salarié travaille complètement ou partiellement en dehors des locaux de l'entreprise et communique avec son employeur via Internet.
Le télétravail fait l'objet de dispositions spécifiques dans le Code du travail (C. trav. art. L 1222-9 s.), qui s'appliquent à tous les salariés et qui reprennent les grandes lignes de l'accord interprofessionnel du 19 juillet 2005 d'application plus limitée (sont exclus certains secteurs, notamment le secteur agricole et les professions libérales).
Qu'il fasse partie des conditions d'embauche du salarié ou qu'il soit mis en place par la suite, le télétravail doit donner lieu à l'établissement d'un document écrit, contrat de travail ou avenant, précisant les conditions de passage en télétravail et celles de retour dans l'entreprise sans télétravail.
Sont concernés les salariés qui :
- travaillent chez eux, même s'ils sont tenus de se rendre dans les locaux de leur entreprise d'une façon plus ou moins régulière, par exemple deux jours par semaine ou par mois (le télétravailleur est à distinguer du travailleur à domicile, qui relève d'un régime tout à fait particulier) ;
- sont « nomades ». Il s'agit notamment des commerciaux qui ne sont pas tenus de revenir dans les locaux de leur entreprise et qui peuvent, par exemple, réaliser les tâches administratives et comptables qui leur incombent via Internet.
Ne sont pas des télétravailleurs :
- ceux qui ramènent ponctuellement du travail chez eux ;
- ceux qui travaillent en réseau au sein de l'entreprise dans des locaux géographiques distincts ;
- ceux qui exercent leurs fonctions dans des « télécentres », c'est-à-dire dans des locaux « délocalisés » et souvent partagés par plusieurs entreprises.
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés : ce dernier peut refuser une demande de télétravail sans avoir à justifier sa décision ; il ne peut pas imposer ce mode d'organisation.
Une exception toutefois, sous réserve de la parution d'un décret d'application : lorsque des circonstances exceptionnelles (menace d'épidémie, par exemple) ou la force majeure l'exigent, l'employeur peut imposer le télétravail pour permettre la continuité de l'activité et la protection des salariés.
La réversibilité du télétravail est assurée par :
- la priorité donnée au salarié qui souhaite mettre fin au télétravail sur les postes disponibles qui correspondent à ses qualifications et compétences professionnelles. Son employeur doit porter à sa connaissance les postes concernés ;
- le contrat de travail ou son avenant qui précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
L'accord interprofessionnel de 2005 prévoit en outre, si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, la mise en place d'une période d'adaptation dont la durée est fixée par l'accord collectif applicable ou l'avenant au contrat de travail (en pratique, cette durée est souvent identique à celle d'une période d'essai). Durant cette période, l'employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au télétravail moyennant un délai de préavis fixé par l'accord collectif ou le contrat. Le salarié est alors en droit de retrouver un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification (mais pas forcément le poste qui était le sien avant la mise en place du télétravail). En revanche, une fois cette période terminée, l'employeur ne peut plus mettre fin unilatéralement au télétravail (Cass. soc. 12-2-2014 no 12-23.051 : RJS 4/14 no 298).
Le télétravailleur est un salarié soumis au pouvoir hiérarchique de son employeur et bénéficiant des mêmes droits que les autres. Il peut notamment prétendre à la même rémunération et au même déroulement de carrière que ses collègues travaillant dans les locaux de l'entreprise et placés dans une situation d'emploi comparable à la sienne. Il a les mêmes droits à formation. Il doit même pouvoir bénéficier d'une formation appropriée à sa situation. En cas de licenciement, il peut prétendre aux mêmes indemnités que les autres salariés.
L'employeur doit prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'accord interprofessionnel de 2005 précise que l'employeur assume aussi les coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur ainsi que ceux relatifs à l'adaptation et à l'entretien de l'équipement personnel du salarié qui serait utilisé à titre professionnel.
L'employeur informe le salarié des restrictions à l'usage des équipements ou outils de communication fournis et des sanctions en cas de non-respect de ces restrictions.
Pour sa part, le télétravailleur doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés et, en cas de panne, en avertir immédiatement l'entreprise.
S'agissant des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile, les textes ne prévoient rien. La Cour de cassation a décidé qu'ils doivent être assumés par l'employeur lorsque le télétravail relève de sa demande, que celle-ci soit explicite (Cass. soc. 7-4-2010 no 08-44.865 : RJS 6/10 no 570) ou qu'elle résulte de l'absence de local professionnel mis à disposition (Cass. soc. 12-12-2012 no 11-20.502 : RJS 2/13 no 176 ; dans le même sens : Cass. soc. 4-12-2013 no 12-19.667 : RJS 2/14 no 133). Dans le cas contraire, leur prise en charge relève de la négociation entre les intéressés. La question peut aussi être prévue par l'accord collectif applicable (des forfaits peuvent être prévus).
Le télétravailleur gère l'organisation de son temps de travail. Restant soumis aux règles applicables en matière de durée du travail, sa charge de travail et les délais d'exécution qui lui sont fixés doivent être équivalents à ceux imposés aux salariés au sein de l'entreprise en situation comparable. L'employeur doit d'ailleurs organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
Il doit aussi prendre toute mesure utile pour prévenir l'isolement du télétravailleur par rapport à sa hiérarchie et aux autres salariés de l'entreprise. Le télétravailleur doit notamment bénéficier des mêmes entretiens professionnels et avoir accès aux mêmes informations que les autres salariés de l'entreprise.
L'employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur, ce qui implique qu'il doit :
- fixer, en concertation avec le télétravailleur, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter ;
- informer le télétravailleur de la mise en place éventuelle d'un moyen de surveillance, ce moyen devant être pertinent et proportionné à l'objectif ;
- respecter le caractère privé du domicile du télétravailleur. Il ne peut y avoir accès qu'après avoir obtenu l'accord du salarié, même si la visite a pour objet l'entretien du matériel.
Il n'est pas rare que l'employeur veuille modifier les conditions d'emploi du salarié, par exemple ses fonctions, sa rémunération, son lieu de travail ou ses horaires de travail.
En cas d'accord du salarié, proposition et acceptation doivent être formalisées par un avenant au contrat de travail ou par un échange de courriers.
Mais si le salarié est en désaccord avec la modification projetée ? Tout dépend alors de ce que l'employeur entend modifier :
- si c'est un élément du contrat de travail (rémunération ou durée du travail, par exemple), il doit recueillir le consentement du salarié. Une clause du contrat qui l'en dispenserait ne serait pas valable. A défaut d'accord, l'employeur doit renoncer à la modification ou licencier l'intéressé (licenciement pour motif personnel ou économique) ;
- si la modification porte sur les conditions de travail du salarié, l'employeur peut la lui imposer : en refusant, l'intéressé s'expose à un licenciement disciplinaire.
Attention : lorsque l'employeur veut modifier ou supprimer un avantage prévu par le statut collectif de l'entreprise (accord ou usage d'entreprise), des règles particulières s'appliquent : voir no 55090 et no 55150.
A condition qu'un accord d'entreprise le prévoie, l'employeur peut imposer aux salariés une modification du contrat de travail par le biais d'une mobilité interne à l'entreprise (C. trav. art. L 2242-1 s.). Cette mobilité peut être professionnelle (modification des missions du salarié) ou géographique (modification du lieu de travail) mais ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération ou de la classification du salarié. L'accord d'entreprise fixe les contours de cette mobilité interne, notamment la zone géographique dans laquelle elle peut être imposée, les mesures permettant aux salariés de concilier cette contrainte avec leur vie personnelle et familiale et celles d'accompagnement à la mobilité (formation, aides financières...).
Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues. Si le salarié refuse cette mobilité, il peut être licencié selon la procédure de licenciement individuel pour motif économique et bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'accord.
Dans les entreprises qui rencontrent de graves difficultés économiques conjoncturelles, le temps de travail (durée, organisation, répartition) et la rémunération des salariés peuvent être modifiés pendant au maximum deux ans par un accord de maintien dans l'emploi (C. trav. art. L 5125-1 s.). Par exemple, l'accord peut prévoir une augmentation de la durée du travail sans augmentation de salaire. En contrepartie, l'employeur s'engage notamment à ne pas rompre les contrats de travail pour motif économique pendant la durée de l'accord. La durée de ces accords devrait être portée à cinq ans (Projet de loi pour la croissance et l'activité dit « Macron » adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 18-6-2015).
La loi fixe un certain nombre de garanties pour les salariés. L'accord doit notamment respecter les durées maximales du travail, les repos obligatoires et les congés payés. Les rémunérations des salariés ne peuvent pas être abaissées en dessous de 1,2 Smic (soit 1 749,02 € mensuels en 2015). L'employeur qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris doit verser des dommages-intérêts aux salariés lésés, selon des modalités fixées par l'accord.
L'application de l'accord à chaque salarié est subordonnée à son acceptation. S'il refuse, il peut être licencié selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par l'accord.
Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit « Macron » adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015 prévoit que l'employeur ne serait pas tenu de reclasser le salarié mais que ce dernier bénéficierait du congé de reclassement ou du contrat de sécurisation professionnelle, selon la taille de son entreprise.
D'autres cas particuliers sont prévus par les textes :
- la mise en activité partielle (anciennement appelée chômage partiel), qui entraîne une réduction de la rémunération et de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que les salariés sont indemnisés à ce titre (C. trav. art. L 5122-1 s.) ;
- la réduction du temps de travail peut être imposée par accord collectif dès lors que le montant de la rémunération est maintenu (C. trav. art. L 1222-7).
C'est en principe le document écrit signé lors de l'embauche par l'employeur et le salarié. Certains salariés sont embauchés verbalement ; il n'en résulte pas pour autant qu'ils n'ont pas de contrat de travail et que l'employeur peut modifier leur salaire ou leurs fonctions.
L'expression « contrat de travail » recouvre donc :
- des documents écrits : texte signé à l'embauche et ses avenants ultérieurs, notes accordant une augmentation ou une promotion, mentions du bulletin de paie telles que l'emploi ou la qualification ;
- des éléments qui, même non écrits, constituent le socle de la relation de travail dans l'esprit du salarié et de l'employeur (on parle d'« intention des parties ») : salaire, qualification, fonctions, durée et, éventuellement, lieu du travail.
En principe, la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l'accord du salarié, même si les sommes concernées sont peu élevées ou si l'employeur prétend que le mode de rémunération proposé est plus avantageux pour le salarié (Cass. soc. 5-5-2010 no 07-45.409 : RJS 7/10 no 583). Ce caractère intangible de la rémunération, sauf accord du salarié, concerne non seulement son montant, mais aussi son mode de calcul.
Deux exceptions :
- les avantages salariaux issus du statut collectif de l'entreprise (accord de branche ou d'entreprise, usage ou engagement unilatéral de l'employeur) peuvent, dans certaines conditions, être modifiés ou supprimés sans l'accord du salarié. Au cas particulier des avantages issus d'un accord collectif, le salarié conserve, toutefois, le taux horaire qu'il avait acquis avant la modification ;
- la modification de la rémunération a lieu en application d'un accord de maintien dans l'emploi. Dans ce cas, elle reste subordonnée à l'acceptation du salarié. Mais si celui-ci refuse, il peut être licencié pour motif économique.
La partie variable de la rémunération dépend souvent de la réalisation d'objectifs. Le contrat de travail peut réserver à l'employeur le droit de fixer et de modifier unilatéralement ces objectifs, même si ces modifications sont susceptibles de diminuer la rémunération du salarié. A deux conditions : les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 2-3-2011 no 08-44.977 : RJS 5/11 no 393).
Le contrat de travail peut prévoir que l'employeur est en droit de modifier le lieu de travail du salarié : c'est la clause de mobilité, qui est opposable au salarié à condition de définir de façon précise sa zone géographique d'application. Cette zone peut, compte tenu de la nature des fonctions et du secteur d'activité, être très étendue et même comprendre l'ensemble du territoire national, par exemple pour un « coordinateur des opérations France » (Cass. soc. 9-7-2014 no 13-11.907 : RJS 10/14 no 668). Dans ce cas, le changement de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de l'intéressé.
A noter que si la clause de mobilité est contraire à la mobilité géographique prévue par un accord de mobilité interne, ce seront les stipulations de l'accord qui s'appliqueront.
L'employeur ne peut mettre en oeuvre la clause de mobilité qu'aux conditions suivantes :
- agir dans l'intérêt de l'entreprise ;
- respecter un délai de prévenance et les éventuelles dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur (notification écrite de la mutation, nécessité de motiver la mutation, indemnisation des déplacements pour trouver un logement, frais de double résidence, etc.) ;
- ne pas modifier d'autres éléments du contrat, notamment la rémunération. Le salarié peut refuser sa nouvelle affectation si celle-ci s'accompagne de la modification de sa rémunération. C'est par exemple le cas pour un changement de secteur commercial alors que l'un des éléments du salaire dépend du chiffre d'affaires du lieu d'affectation ;
- ne pas appliquer la clause de façon abusive ou déloyale ni porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié (employeur qui ordonne par télégramme à un salarié de rejoindre une nouvelle affectation à 150 km de la précédente dans un délai de 24 heures ; qui change le lieu de travail d'une salariée, l'empêchant de s'occuper de son enfant handicapé à l'heure du déjeuner, alors que le poste qu'on lui demande de quitter est vacant ; qui mute un salarié qui ne sait pas conduire dans un lieu non desservi par les transports en commun, sans lui fournir les moyens de s'y rendre). C'est au salarié de prouver que l'employeur a agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de l'entreprise.
Si l'employeur ne respecte pas l'ensemble de ces règles, le salarié est en droit de refuser sa mutation. Un licenciement motivé par ce seul refus serait injustifié.
La modification du contrat ou des conditions de travail ne doit pas porter atteinte à des dispositions d'ordre public ou être fondée sur un motif discriminatoire : âge, sexe, origine, grossesse, etc. Ainsi, par exemple :
- le changement d'affectation motivé par l'état de santé du salarié déclaré apte à la reprise de son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique n'est pas une simple application de la clause de mobilité et constitue une discrimination prohibée ;
- l'employeur ne peut pas imposer un changement de planning horaire à une salariée, changement lié à la visite sur le lieu de travail des membres de la direction, au motif que sa collègue « passait mieux » (autrement dit, avait une meilleure apparence physique) ;
- le transfert d'une salariée dans un autre service en raison de la création par son époux d'une entreprise concurrente constitue une discrimination fondée sur sa situation de famille.
La loi instaure une protection particulière pour les salariés homosexuels, qu'ils soient célibataires ou en couple : ils peuvent refuser les mutations géographiques dans un Etat incriminant l'homosexualité même si leur contrat comporte une clause de mobilité (C. trav. art. L 1132-3-2). Sont visés notamment les pays dans lesquels l'homosexualité est passible de la peine de mort (par exemple, l'Afghanistan ou le Yémen) et ceux la sanctionnant pénalement.
Toute sanction, licenciement ou mesure discriminatoire pris face au refus du salarié de refuser ces modifications du contrat ou des conditions de travail sont nuls.
Un changement de lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail (Cass. soc. 16-12-1998 no 96-40.227 : RJS 2/99 no 157). Il en est ainsi même s'il entraîne certains inconvénients pour le salarié, allongement du temps de trajet ou frais supplémentaires. Lorsque le salarié fait l'objet de plusieurs mutations successives, l'identité de secteur s'apprécie en fonction du lieu de travail précédent et non en fonction du lieu d'origine.
En revanche, et sauf accord de mobilité interne, la mutation dans un secteur géographique différent est une modification du contrat.
Pour apprécier si la mutation a lieu dans un même secteur géographique, le juge prend notamment en compte la distance et la situation du réseau de transport entre l'ancien et le nouveau site (et non par rapport au domicile) : existence et qualité des liaisons routières, fréquence des liaisons ferrées, etc. (Cass. soc. 15-6-2004 no 01-44.707 : RJS 10/04 no 997). Cette appréciation est faite au cas par cas, ce qui peut conduire à des solutions divergentes selon les tribunaux saisis.
Si une clause particulière du contrat de travail prévoit que le salarié exécutera son travail exclusivement en un certain lieu, le transfert en tout autre lieu constitue une modification du contrat, même s'il n'y a pas de changement de secteur géographique. Attention, la seule mention du lieu de travail dans le contrat ne vaut pas engagement de l'employeur ; il s'agit d'une simple information qui n'interdit pas d'imposer une mutation dans le même secteur géographique (Cass. soc. 3-6-2003 no 01-40.376 : RJS 8-9/03 no 980).
Une affectation temporaire en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement ou hors des limites prévues par une clause de mobilité peut être imposée à trois conditions : l'affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise ; elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles ; le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible (Cass. soc. 3-2-2010 no 08-41.412 : RJS 4/10 no 312).
Si les déplacements du salarié sont inhérents à ses fonctions, par exemple dans le cas d'un consultant international, il ne pourra pas les refuser même s'il n'a pas de clause de mobilité ou si celle-ci n'est pas valable (Cass. soc. 11-7-2012 no 10-30.219 : RJS 10/12 no 772).
La durée du travail est un élément essentiel du contrat de travail. Il y a modification du contrat en cas de passage d'un temps complet à un temps partiel, ou inversement. La modification de la durée du travail ne peut donc pas être imposée au salarié, sous réserve des cas visés nos 56204 et 56205.
Par ailleurs, le fait d'imposer au salarié des heures supplémentaires en raison des nécessités de l'entreprise, ou à l'inverse de réduire ou supprimer des heures supplémentaires effectuées précédemment, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
S'agissant des horaires de travail, la modification de la répartition des heures sur la journée ou la semaine, le nombre de ces heures restant inchangé, constitue en principe un simple changement des conditions de travail (Cass. soc. 22-2-2000 no 97-44.339 : RJS 4/00 no 374). Mais il y a modification du contrat si la mesure :
- porte sur un élément contractualisé ou considéré comme important par le salarié et l'employeur lors de la conclusion du contrat : par exemple, si le contrat de travail exclut explicitement le travail du samedi, l'employeur ne pourra pas répartir le travail sur six jours, du lundi au samedi, sans modifier ce contrat ;
- entraîne un bouleversement des horaires du salarié et porte une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Par exemple, la privation, même partielle, du repos du dimanche ne peut pas être imposée par l'employeur (Cass. soc. 26-9-2012 no 11-18.410 : RJS 6/10 no 570).
La modification des horaires de travail des salariés à temps partiel obéit à des règles beaucoup plus strictes (voir no 56024).
Constitue une modification du contrat de travail, et non un simple changement des conditions de travail, le passage : d'un horaire fixe à un horaire variable (ou inversement) ; d'un horaire continu à un horaire discontinu ; d'un travail de jour à un travail de nuit ; d'un horaire réparti du lundi au vendredi à un horaire concentré sur le samedi et le dimanche. A l'inverse, constitue un simple changement des conditions de travail une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée ou la modification du jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche.
L'employeur peut imposer une modulation du temps de travail des salariés à temps complet lorsqu'elle est prévue par un accord collectif (C. trav. art. L 3122-6). La modulation est la possibilité de décompter ce temps, non pas sur une semaine, mais sur un an au maximum, les périodes de haute activité ne donnant pas lieu à paiement d'heures supplémentaires si elles sont compensées par des périodes moins chargées.
Lorsque cette répartition résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, l'accord du salarié est nécessaire, sauf si le contrat de travail l'a expressément prévu.
Les juges appliquent les principes suivants :
- si la nouvelle tâche confiée au salarié correspond à sa qualification, il y a simple modification des conditions de travail ;
- à défaut, il y a modification du contrat de travail ; il en est ainsi même si l'employeur maintient la rémunération du salarié et sa qualification « sur le papier ».
Par exemple, ont été considérés comme des modifications du contrat de travail :
- le fait de rétrograder un salarié chef de région en adjoint au chef de région ;
- le fait pour un directeur commercial, après la nomination d'un directeur général, de changer de bureau, de se voir retirer la signature des comptes bancaires, ainsi que l'accès aux dossiers et au courrier, alors qu'auparavant il assurait seul la direction de l'entreprise ;
- le fait de retirer une délégation générale de signature avec pour conséquence une importante restriction apportée aux fonctions ;
- le fait de retirer progressivement à un salarié ses attributions, ses responsabilités et ses prérogatives et d'attribuer le tout à un nouveau salarié qui a ainsi évincé le premier ;
- le fait de cantonner un formateur à son activité complémentaire d'ingénierie pédagogique, celui-ci n'étant alors plus en mesure d'exercer ses activités principales.
Ont à l'inverse été considérés comme de simples modifications des conditions de travail :
- la mutation d'un cadre à la tête d'un autre département de l'entreprise, alors que son degré de subordination à la direction générale, sa qualification de fondé de pouvoir, son niveau hiérarchique et sa rémunération restaient inchangés ;
- le fait de décharger un directeur des affaires générales de la gestion des cadres de la société, alors que celle-ci ne représentait qu'une faible partie de ses fonctions et que, compte tenu de l'extension de l'entreprise, les attributions qu'il devait continuer d'assumer n'avaient pas diminué sensiblement.
Les solutions sont les mêmes lorsque l'employeur entend imposer au salarié des tâches supplémentaires. S'il peut, sans que cela constitue une modification du contrat de travail, demander à un salarié réalisant des opérations de vente sur un stand de procéder à l'encaissement de ces ventes, il ne saurait imposer :
- des tâches administratives de documentation technique à un salarié engagé comme dessinateur-projeteur « DAO » ;
- une permanence au standard, même une heure par jour une semaine sur trois, alors que le salarié a été engagé en qualité d'assistant bilingue au service contentieux.
Le salarié qui refuse une modification de ses conditions de travail prend le risque d'être licencié (Cass. soc. 10-10-2000 no 98-41.358 : RJS 12/00 no 1221). Ce refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire : le salarié a donc uniquement droit à l'indemnité de licenciement ainsi qu'à un préavis sous réserve que, durant celui-ci, il travaille aux nouvelles conditions.
Et si le salarié quitte l'entreprise ? En l'absence de lettre du salarié indiquant clairement qu'il démissionne, l'employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire mais peut le licencier pour refus de ses conditions de travail ou abandon de poste. En cas d'abandon de poste, le salarié n'aura ni indemnité de licenciement ni préavis si l'employeur se prévaut d'une faute grave.
Et si l'employeur ne prend aucune initiative ? A défaut de licenciement, le salarié ne peut prétendre ni à son salaire puisqu'il ne travaille pas ni aux indemnités de rupture, sauf à saisir le conseil de prud'hommes pour faire endosser à l'employeur la responsabilité de la rupture.
A noter qu'aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, notamment un représentant du personnel.
SavoirL'employeur qui change les conditions de travail d'un salarié doit agir de bonne foi. Si tel n'est pas le cas, le salarié licencié pour refus de se soumettre pourra obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a pris sa décision pour de mauvaises raisons, étrangères à l'intérêt de l'entreprise, et non à l'employeur d'apporter la preuve contraire, sa bonne foi étant présumée (Cass. soc. 13-2-2005 no 03-42.018 : RJS 5/05 no 477).
Avant de modifier un contrat de travail, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Il doit donc lui adresser sa proposition, accompagnée des informations nécessaires pour lui permettre de se décider en connaissance de cause. L'intéressé doit bénéficier d'un délai de réflexion raisonnable (en l'absence de précision de la convention collective, au moins 15 jours).
Le licenciement intervenu en violation de ces règles est abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts, même si la modification est justifiée.
L'employeur doit prouver l'accord du salarié. Celui-ci ne résulte ni de l'absence de réponse au terme du délai de réflexion ni de la poursuite du travail aux nouvelles conditions pendant plusieurs années.
En cas de modification pour motif économique, l'employeur doit nécessairement informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de réflexion est d'un mois ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaires (C. trav. art. L 1222-6 et L 1233-60-1).
S'il entend refuser la modification, le salarié sera prudent de le formaliser par courrier recommandé avec avis de réception. En effet, à l'issue du délai de réflexion et à défaut de réponse de sa part, il est considéré comme ayant accepté la modification. S'il refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, il commet une faute grave.
Le non-respect par l'employeur de la procédure lui interdit de se prévaloir d'une acceptation ou d'un refus du salarié et le licenciement prononcé en raison de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse. Il en va notamment ainsi si l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin du délai d'un mois, même si le salarié a déjà fait part de son refus.
En cas de modification du contrat pour motif disciplinaire (rétrogradation ou mutation, par exemple), l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire. En tout état de cause, l'accord du salarié est nécessaire. Mais si le salarié refuse, l'employeur peut sanctionner, non le refus de la modification, mais les fautes commises par une autre sanction (licenciement, éventuellement). Il doit alors engager une nouvelle procédure disciplinaire.
L'employeur doit respecter la procédure requise en cas de licenciement : convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification du licenciement précisant les motifs de celui-ci. Le salarié a alors droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Toutefois, si le salarié, lors de l'entretien, accepte la modification qu'il avait tout d'abord refusée, l'employeur ne pourra pas rompre le contrat.
SavoirL'exécution du préavis se fait aux conditions prévues au contrat (par exemple, si le salarié refuse une modification de rémunération, l'employeur doit maintenir le salaire initial pendant le préavis). Si ce n'est pas possible, par exemple en cas de mutation géographique, l'entreprise déménageant avant la fin du préavis, le salarié est dispensé d'exécuter celui-ci et a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Le refus du salarié ne justifie pas à lui seul le licenciement (Cass. soc. 21-3-2003 no 00-44.364 : RJS 4/03 no 417). Le licenciement n'a de cause réelle et sérieuse que si la modification du contrat est elle-même justifiée soit par des motifs tenant au salarié (par exemple faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle), soit par des motifs économiques (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du groupe). La cause de la modification doit figurer explicitement dans la lettre de licenciement.
Si la modification n'a pas de cause réelle et sérieuse, le licenciement est abusif : le salarié pourra saisir le conseil de prud'hommes et obtenir, en plus de ses indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts.
Les licenciements suivants ont été jugés abusifs :
- salariés refusant la modification de leur mode de rémunération effectuée dans le but de réaliser des bénéfices plus importants, et non de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe ;
- salarié qui, travaillant dans une agence, refuse sa nomination au poste de directeur d'une autre agence, la nomination étant simplement motivée par les impératifs de bonne gestion de l'entreprise (l'agence dans laquelle il travaillait était surdimensionnée et le poste de directeur de l'autre agence était vacant).
Si l'employeur applique la modification sans tenir compte du refus du salarié, celui-ci peut exiger la poursuite du contrat aux conditions antérieures (Cass. soc. 26-6-2001 no 99-42.489 : RJS 10/01 no 1117). En outre, si la modification unilatérale du contrat rend impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié peut, au choix :
- cesser le travail et saisir le conseil de prud'hommes en prenant acte de la rupture. Celle-ci sera considérée comme un licenciement abusif ouvrant droit aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'inconvénient est que le salarié doit attendre la décision des juges pour percevoir les indemnités qui lui sont dues et les éventuelles allocations chômage ; s'il perd devant les prud'hommes et n'obtient gain de cause qu'en appel, plusieurs années auront pu s'écouler ;
- continuer le travail et demander en justice la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, ce qui produira les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : en cas de succès, le salarié aura droit aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Cette formule permet au salarié de continuer à percevoir sa rémunération et, en cas d'échec de l'action, le contrat de travail se poursuit. Mais elle implique que le salarié puisse travailler, à titre temporaire et jusqu'à la décision des juges, aux nouvelles conditions (par exemple en cas de modification de sa rémunération ou même de ses fonctions). Elle est impraticable dans le cas contraire (par exemple en cas de mutation géographique).
A noter que, par exemple, n'a pas été considérée comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail la modification unilatérale du contrat ne touchant qu'une faible partie de la rémunération (Cass. soc. 12-6-2014 no 12-29.063 : RJS 8-9/14 no 626).
Si l'employeur considère le salarié comme démissionnaire, le salarié n'a qu'une solution : saisir le conseil de prud'hommes. Celui-ci jugera que la rupture est en fait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Nombre d'entreprises organisent des entretiens individuels d'évaluation, le plus souvent annuels. Leur finalité est de faire le bilan de l'activité du salarié, lui fixer des objectifs pour l'avenir, déterminer ses éventuels besoins de formation et envisager son évolution de carrière. Ces entretiens sont distincts des entretiens professionnels dont bénéficie obligatoirement l'ensemble des salariés au moins tous les deux ans.
L'employeur a le droit de mettre en place de tels entretiens. Mais il doit au préalable :
- informer les salariés, de manière individuelle ou collective, des méthodes et techniques d'évaluation utilisées ;
- consulter le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) si le dispositif d'évaluation commande les décisions salariales (augmentation de salaire, promotion, etc.) ;
- effectuer, le cas échéant, une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Le juge peut interdire à l'employeur d'appliquer le dispositif d'évaluation tant que ces différentes formalités n'ont pas été respectées.
Le dispositif d'évaluation doit reposer sur des critères objectifs, transparents et pertinents au regard de la finalité poursuivie (C. trav. art. L 1222-3). Les critères doivent donc être dépourvus de toute appréciation de valeur subjective, et être liés au travail.
Est par exemple licite le système qui évalue la performance et les comportements professionnels, dès lors que (CA Versailles 2-10-2012 no 12-00276 : RJS 1/13 no 4) :
- l'évaluation prévoit des définitions ne portant pas sur la personnalité et les traits de caractère mais sur les comportements au regard du travail à accomplir, tels l'appréciation de l'imagination et de la clairvoyance du salarié ;
- chaque comportement est illustré d'exemples multiples permettant de comprendre en quoi le comportement est évalué ;
- des livrets sont remis tant aux salariés qu'à ceux qui les évaluent afin d'éviter tout arbitraire.
De même est-il possible pour évaluer les aptitudes professionnelles d'un cadre dont l'activité n'est pas toujours quantifiable, de recourir à des critères comportementaux à condition qu'ils soient exclusivement professionnels et suffisamment précis pour permettre au salarié de l'intégrer dans une activité concrète et à l'évaluateur de l'apprécier de manière objective (CA Toulouse 21-9-2011 no 11-00604 : RJS 12/11 no 930).
Enfin, est admis un système de classement des salariés en fonction de leurs performances (« ranking ») à condition de ne pas imposer de quotas préétablis par catégorie (Cass. soc. 27-3-2013 no 11-26.539 : RJS 6/13 no 425) ou un système de « benchmark » reposant sur la comparaison de la performance des salariés, dès lors qu'il n'est pas générateur de souffrance au travail (CA Lyon 21-2-2014 no 12-06988 : RJS 5/14 no 367). De même, n'est pas illicite le dispositif comportant une autoévaluation par le salarié de ses propres performances professionnelles (CA Versailles 19-12-20141 no 13/03952 : RJS 3/15 no 170).
A l'inverse, est illicite :
- le dispositif d'évaluation qui ne permet pas de savoir si sa finalité est d'apprécier des compétences et des objectifs concrets ou l'adhésion du salarié à des valeurs d'entreprise aussi vagues que subjectives (TGI Nanterre 5-9-2008 no 08-5737 : RJS 11/08 no 1069) ;
- une évaluation professionnelle prenant en compte l'activité syndicale, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à la valoriser (Cass. soc. 23-3-2011 no 09-72.733 : RJS 6/11 no 536).
Lorsqu'une procédure d'évaluation existe au sein de l'entreprise, l'entretien annuel est une obligation pour le salarié qui ne peut pas refuser de s'y soumettre, sauf à commettre un acte d'insubordination qui peut être sanctionné. De son côté, l'employeur ne peut pas écarter certains salariés du dispositif sous peine de se voir reprocher un acte discriminatoire ou d'être condamné à indemniser le salarié qui, en l'absence d'entretien, a perdu une chance de voir sa carrière évoluer.
Si le salarié doit avoir un comportement correct au cours de l'entretien, il est en droit de manifester son désaccord avec son supérieur hiérarchique. Jugé par exemple qu'un salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir quitté la réunion brutalement ou refusé de signer le compte rendu de l'entretien dès lors qu'il ne s'est pas exprimé en termes injurieux ou abusifs et n'a pas remis en cause l'autorité ou le pouvoir de direction de son employeur (CA Chambéry 19-1-2010 no 09-1180 : RJS 11/10 no 829). En revanche, est valablement licencié pour faute grave le salarié qui a adopté une attitude volontairement passive durant l'entretien, tournant ostensiblement la tête et refusant de communiquer, puis qui a affiché à la vue de tous le compte rendu de l'entretien avec des commentaires injurieux à l'égard de son responsable hiérarchique.
On a vu que l'intéressé peut, sans encourir de sanction, refuser de signer le compte rendu de l'entretien. Mais ce refus ne suffit pas à infirmer les insuffisances qui y sont mentionnées si le même défaut est repris dans les évaluations successives et corroboré par d'autres pièces du dossier (CA Paris 8-2-2011 no 08-10559 : RJS 11/10 no 829).
Dans cette affaire, le bien-fondé du licenciement a été reconnu par les juges. A l'inverse, le licenciement d'un salarié en raison de ses absences répétées et de son manque d'assiduité a été déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que le dernier entretien d'évaluation, établi moins de deux mois avant le licenciement, avait conclu à « un vrai travail et des compétences certaines entachées par certaines libertés ; rien d'irrémédiable » (Cass. soc. 22-3-2011 no 09-68.693).
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre