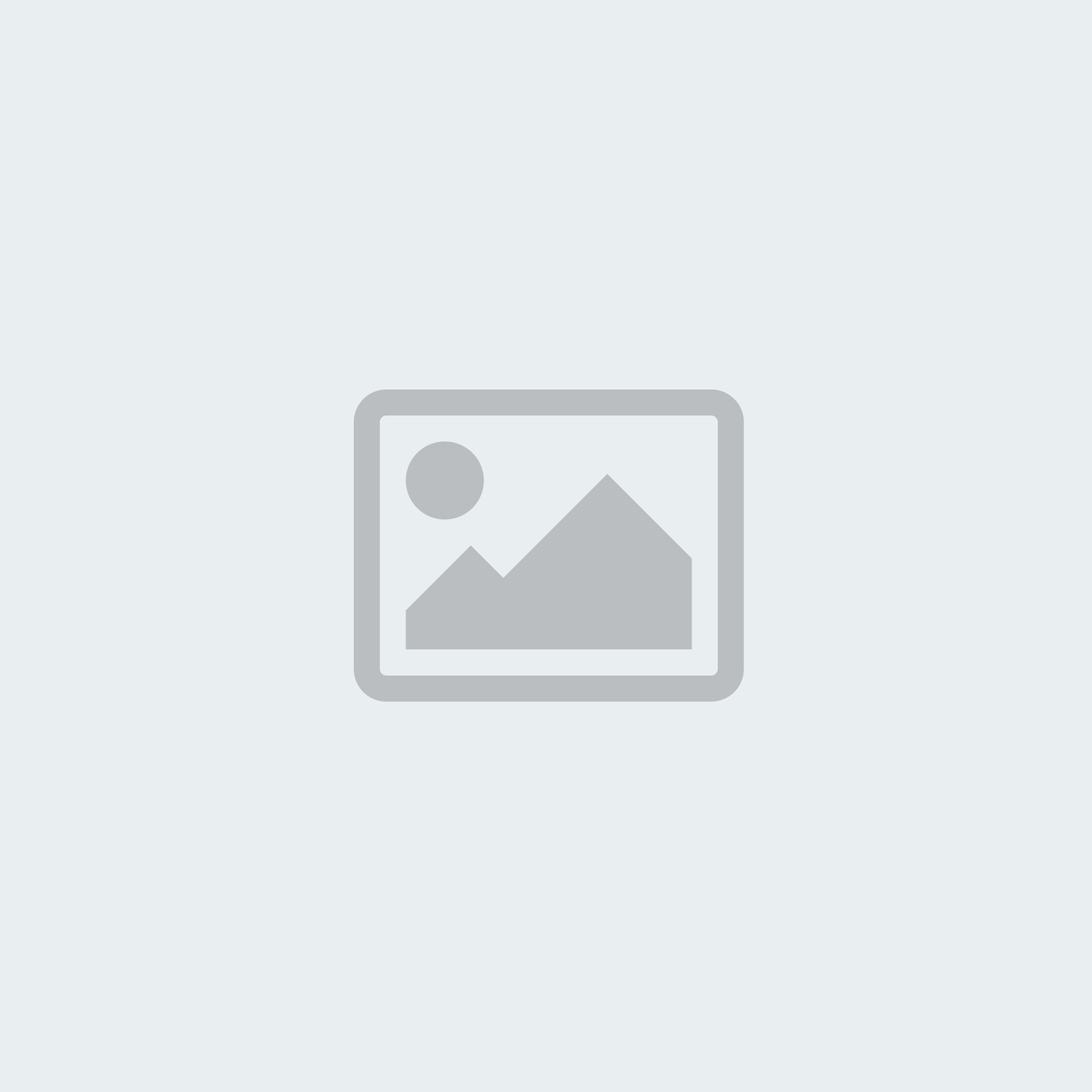Le curriculum vitae doit retracer le plus fidèlement possible le cursus scolaire et professionnel du candidat au poste. Il est naturel de valoriser telle ou telle expérience, mais attention aux inexactitudes : les tribunaux se montrent, certes, indulgents à l'égard des salariés recrutés sur la base de CV comportant des mentions erronées (sauf cas limites, ils jugent qu'il n'y a pas là motif à annuler le contrat ni même faute justifiant le licenciement), mais la découverte par l'employeur que le salarié a « gonflé » son CV ne peut qu'ébranler sa confiance en l'intéressé.
Les questions posées au candidat à un emploi doivent avoir pour seul objectif d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles. Toutes les questions permettant de compléter le curriculum vitae sont permises : informations sur l'état civil, la nationalité, les diplômes ou la formation, les antécédents professionnels, l'existence éventuelle d'une clause de non-concurrence, etc. A ces questions, il faut répondre de bonne foi.
En revanche, les questions qui n'ont aucun lien avec l'emploi proposé mais portent sur la vie privée du candidat ne sont pas autorisées : demandes de renseignements sur ses opinions politiques, sa religion, ses origines raciales, son appartenance syndicale, ses antécédents judiciaires (sauf pour certains emplois tels que convoyeur de fonds ou caissier), son état de santé (la visite médicale d'embauche est là pour confirmer l'aptitude physique), ses projets matrimoniaux ou encore, s'agissant d'une candidate, son éventuel état de grossesse. A pareilles questions, le salarié peut refuser de répondre ou mentir. De même, il ne peut lui être reproché d'avoir passé sous silence un élément personnel qui ne présente pas de lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé.
Oui. La loi oblige les entreprises à communiquer les résultats de leurs tests de recrutement aux candidats qui le demandent. Il est même possible, lorsque la sélection des candidats est effectuée de manière automatisée, c'est-à-dire par informatique, de connaître les motifs pour lesquels une candidature est refusée.
Dans certaines entreprises, les candidats à l'embauche sont soumis à des tests professionnels (exercice de saisie informatique ou de vente, etc.) permettant d'apprécier « en situation » leurs aptitudes à occuper le poste proposé (même s'ils ne sont pas placés dans les conditions normales de l'emploi).
En général de très courte durée, ces essais ne donnent pas lieu à rémunération, sauf si la convention collective applicable dans l'entreprise en dispose autrement. Dans ce cas, cette rémunération est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS (à la différence des remboursements de frais éventuellement accordés qui ne supportent aucun prélèvement).
L'essai professionnel demandé à un candidat ne se confond pas avec la période d'essai, qui est postérieure à l'embauche.
Si le candidat se blesse pendant l'essai professionnel, ce n'est pas considéré comme un accident du travail car cet essai précède une embauche éventuelle. Mais la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée s'il a commis une faute ou une négligence à l'origine de l'accident.
A l'issue de la procédure de recrutement, l'entreprise informe un des candidats de sa décision de l'embaucher. Si c'est par écrit, les termes employés sont à étudier avec attention.
Il peut, en effet, s'agir de simples pourparlers auxquels l'entreprise peut ne pas donner suite sans avoir à s'en justifier ni à indemniser le candidat.
Il peut s'agir, au contraire, d'une véritable promesse d'embauche, qui engage l'entreprise. Cette promesse d'embauche vaut contrat de travail : si l'entreprise revient sur sa décision, les règles et les conséquences financières liées à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à la résiliation anticipée non autorisée d'un contrat à durée déterminée s'appliquent. Le litige est de la compétence du conseil de prud'hommes.
Comment savoir si l'on se trouve en présence d'une promesse d'embauche ou de simples pourparlers ?
Les juges considèrent qu'il y a promesse d'embauche lorsque l'employeur adresse à une personne désignée une offre d'emploi ferme et précise, indiquant la nature de l'emploi proposé, la rémunération et, éventuellement, la date d'entrée en fonctions. Constitue par exemple une véritable promesse d'embauche la lettre rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons retenu votre candidature pour le poste de... dans notre société. Comme nous vous l'avons indiqué lors de nos différents entretiens, le poste sera à pourvoir à compter du... Votre rémunération annuelle sera de... €. Nous vous invitons à nous retourner cette lettre approuvée et signée avant le... »
SavoirNe constitue pas une promesse d'embauche la lettre qui, faisant suite à une candidature et à des entretiens de sélection, se borne à aviser une personne que sa « candidature a été retenue » et ne comporte aucune précision sur la rémunération, la date d'entrée en fonctions et le lieu de travail.
L'existence d'une promesse d'embauche étant reconnue de manière plus ou moins « généreuse » selon les juridictions, il est conseillé de ne pas démissionner de son poste actuel pour un autre emploi avant d'avoir reçu le nouveau contrat de travail.
Pas toujours. Sauf cas particuliers (embauche sous contrat à durée déterminée ou avec un horaire à temps partiel, notamment) et en l'absence de dispositions de la convention collective l'imposant, la rédaction d'un écrit n'est pas obligatoire. Le contrat de travail peut donc être conclu verbalement.
A défaut de contrat de travail écrit ou de lettre d'engagement, l'employeur doit communiquer au salarié, lors de l'embauche, une copie d'un document destiné à l'Urssaf et appelé « déclaration préalable à l'embauche ». Il précise la dénomination sociale ou le nom de l'entreprise, son code APE, son adresse, ses numéros Siret et Urssaf, les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, numéro national d'identification du salarié, ainsi que la date et l'heure de l'embauche. Ce document suffit pour prouver l'existence du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes (Cass. soc. 5-12-2012 no 11-22.769 : RJS 2/13 no 91).
Lorsque l'employeur établit un contrat de travail écrit, le salarié doit, avant de le signer, vérifier son contenu. Certaines clauses peuvent, en effet, se révéler pénalisantes.
La clause d'exclusivité interdit au salarié de travailler parallèlement pour un autre employeur, sauf à commettre une faute grave et risquer un licenciement sans indemnité.
Mais l'application d'une telle clause est encadrée : elle ne peut empêcher un salarié d'exercer une activité bénévole ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Elle est donc rarement admise pour les salariés à temps partiel.
La clause d'exclusivité est inopposable aux salariés qui bénéficient d'un congé ou d'un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ; il en est ainsi pendant toute la durée du congé ou du temps partiel, c'est-à-dire un an au maximum.
Avec une telle clause, le salarié accepte à l'avance la modification de son lieu de travail dans un périmètre précisément défini. Ce périmètre, compte tenu de la nature des fonctions et du secteur d'activité, peut être très étendu et même comprendre l'ensemble du territoire national (Cass. soc. 9-7-2014 no 13-11.906 : RJS 10/14 no 668).
La clause autorise l'employeur à muter ultérieurement le salarié dans un autre établissement ou une autre région, ou à déménager l'entreprise, sans que le salarié puisse refuser (un refus pouvant justifier son licenciement).
En revanche, la clause de mobilité ne permet pas à l'employeur d'imposer au salarié de partager son temps entre des lieux de travail différents ou de fixer son lieu de résidence dans un département déterminé sauf si cette contrainte est indispensable au regard de l'emploi occupé.
Le juge vérifie également que l'application de la clause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié.
Il s'agit d'une clause par laquelle l'employeur s'engage à ne pas licencier le salarié pendant une période déterminée (généralement au moins un an). Mais elle n'interdit pas une période d'essai ou le licenciement en cas de faute grave ou lourde du salarié. Par ailleurs, la rupture décidée d'un commun accord reste toujours possible et le salarié est libre de démissionner quand il le souhaite.
La présence d'une telle clause dans un contrat de travail ne change rien à sa nature. Elle ne transforme pas un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée.
L'employeur qui ne respecte pas la clause (il licencie avant la fin de la période de garantie d'emploi hors faute grave ou lourde) doit verser au salarié une indemnité, dont le montant est généralement prévu. Ce dernier correspond, au minimum, aux rémunérations que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de garantie sans déduction des allocations chômage (à charge pour Pôle emploi d'en demander le remboursement au salarié).
Les juges ne peuvent pas réduire ce montant s'il ne vise pas à sanctionner l'employeur mais à préserver un salarié difficilement reclassable de la perte de son emploi. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les juges assimilent la clause de garantie d'emploi à une sanction contractuellement prévue, ils peuvent réduire le montant de l'indemnité s'ils l'estiment excessif.
L'indemnité est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales pour sa totalité.
SavoirEn cas de licenciement, l'indemnité due au titre de la clause de garantie d'emploi se cumule avec l'indemnité légale de licenciement et le cas échéant de préavis. L'employeur peut aussi être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts si le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de rupture (sur le régime fiscal et social de ces dommages et intérêts, voir no 56845).
Les clauses de « parachute doré » sont rares et concernent surtout les cadres supérieurs. Elles fixent le montant de l'indemnité due au salarié en cas de rupture du contrat. Ce montant, supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective, peut être réduit par les juges s'il est manifestement excessif. S'agissant d'une indemnité contractuelle de rupture, elle suit le régime d'exonération plafonnée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux exposé no 56845 à propos de l'indemnité de licenciement hors plan de sauvegarde de l'emploi.
Il est généralement prévu que l'indemnité contractuelle de rupture ne sera pas versée au salarié licencié pour faute grave ou lourde.
Le rapport présenté à l'assemblée générale des actionnaires de la société les informe du montant de ces indemnités et des modalités selon lesquelles il a été déterminé.
Une telle clause interdit au salarié, après son départ de l'entreprise, d'exercer une activité concurrente, soit pour son propre compte, soit pour celui d'un autre employeur (mais elle ne l'empêche pas d'effectuer des démarches pour organiser une future activité concurrentielle, ni de postuler chez un concurrent).
La clause de non-concurrence prévoit généralement la sanction applicable en cas de non-respect de l'interdiction.
Elle peut être inscrite dans le contrat de travail dès l'embauche ou ajoutée plus tard, à l'occasion par exemple d'une mutation ou d'un changement de fonctions. Dans ce dernier cas, l'employeur établit un document annexé au contrat (on parle d'« avenant au contrat »). Le salarié n'est pas obligé d'accepter cet ajout qui constitue une modification de son contrat de travail. S'il refuse, l'employeur est en droit de le licencier à condition de convaincre les juges que l'insertion d'une telle clause était nécessaire. A défaut, le licenciement sera jugé injustifié.
Il faut bien faire la différence entre une clause de non-concurrence et une simple clause de confidentialité. Cette dernière n'empêche pas le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son précédent employeur du moment qu'il garde le silence sur les informations dont il a pu avoir connaissance ; elle n'ouvre pas droit à contrepartie financière (Cass. soc. 15-10-2014 no 13-11.524 : RJS 12/14 no 825).
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit remplir trois conditions.
Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Autrement dit, il faut un risque réel de concurrence. Tout dépend donc de la nature de l'activité de l'entreprise et des fonctions du salarié : la clause liant le responsable des relations commerciales d'une entreprise dans un secteur sensible est valable, à l'inverse de celle concernant un simple employé.
Au demeurant, des conventions collectives réservent l'application de la clause de non-concurrence à certaines catégories professionnelles (cadres, commerciaux, etc.).
L'interdiction de travailler instaurée par la clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace et dans les activités visées. Elle n'est pas valable si le salarié se trouve, en pratique, empêché d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience.
Pour apprécier le caractère limité ou non d'une clause, les juges tiennent compte du profil du salarié, de ses diplômes, de son expérience et de la possibilité pour lui de retrouver un emploi. Par exemple, est nulle la clause qui interdit à un salarié :
- de travailler dans son domaine d'activité alors qu'il a une spécialisation très « pointue » ;
- d'entrer pendant un an au service d'une entreprise ayant pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport grand public sur tout le territoire national.
La clause doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Cette indemnité dite de non-concurrence est versée soit au moment de son départ, soit de manière échelonnée pendant toute la durée de l'interdiction. En aucun cas, elle ne peut être intégrée au salaire et versée pendant l'exécution du contrat de travail.
Selon les termes de la clause, son montant est, le cas échéant, modulé en fonction de l'importance de l'interdiction. Mais il ne peut être ni minoré en fonction du mode de rupture du contrat de travail (Cass. soc. 9-4-2015 no 13-25.847 : RJS 6/15 no 409), ni dépendre exclusivement de la durée d'exécution du contrat de travail.
Considérée comme un élément de rémunération, l'indemnité de non-concurrence est soumise en totalité à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Elle peut se cumuler avec les allocations chômage et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
SavoirEn cas de litige, le juge peut seulement prononcer la validité ou la nullité de la clause. Il ne peut en réduire la durée d'application ou son périmètre géographique ou professionnel. Si la clause est nulle, le salarié a droit à des dommages et intérêts, qu'il ait respecté ou non la clause. Mais en l'absence de réel préjudice financier, le seul préjudice « moral » se traduira par le versement d'une indemnité symbolique.
Par ailleurs, si l'employeur ne règle pas l'indemnité de non-concurrence, le salarié peut en réclamer le paiement devant le conseil de prud'hommes ou demander à être libéré de sa propre obligation pour pouvoir entrer au service d'une entreprise concurrente
Si la clause de non-concurrence est rédigée en termes généraux (« à l'expiration du contrat », par exemple), elle est mise en oeuvre quel que soit le mode de rupture du contrat, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, etc. Elle doit être respectée même si l'entreprise cesse son activité.
La clause commence à s'appliquer à la date de cessation effective des fonctions. En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès que le salarié quitte l'entreprise (Cass. soc. 21-1-2015 no 13-24.471 : RJS 4/15 no 253).
L'employeur peut renoncer à la clause si le contrat de travail ou la convention collective lui en donne expressément la possibilité. Dans le cas contraire, l'accord du salarié est nécessaire.
Pour être valable, la renonciation doit intervenir selon les formes (souvent lettre recommandée avec avis de réception) et dans le délai éventuellement fixés par le contrat de travail et la convention collective. Lorsque cette dernière prévoit que le délai court à compter de la notification du licenciement, le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre de rupture. A défaut de précision de ceux-ci, l'employeur doit informer le salarié de sa décision lors de la date d'envoi de la lettre de licenciement ou dès la réception de la lettre de démission. Si la renonciation intervient après, elle n'est pas valable, et le salarié pourra réclamer la contrepartie financière éventuellement prévue pour la période pendant laquelle il a respecté la clause.
La renonciation de l'employeur doit être explicite et notifiée individuellement au salarié : elle ne saurait résulter de la seule indication, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de l'intention de l'employeur de libérer systématiquement les salariés licenciés de leur obligation ni de la mention « libre de tout engagement » apposée sur le certificat de travail.
Si le salarié ne respecte pas la clause et exerce une activité concurrente, même sur une courte durée, il encourt les sanctions suivantes :
- perte du droit à l'indemnité de non-concurrence ou obligation de la rembourser si elle a déjà été versée ;
- condamnation à des dommages-intérêts ou au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue dans le contrat. Le montant de cette dernière peut néanmoins être réduit par les juges s'ils l'estiment excessif, compte tenu du préjudice subi par l'employeur ;
- obligation d'interrompre son activité, assortie, le cas échéant, d'une astreinte le contraignant à payer une certaine somme pour chaque journée durant laquelle il continue d'exercer l'activité concurrente.
De nombreuses entreprises doivent appliquer, outre le Code du travail, des conventions ou des accords collectifs prévoyant des avantages supplémentaires au profit du personnel.
Il peut s'agir d'accords ou de conventions conclus au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement ou au niveau du groupe. De plus, l'entreprise est souvent soumise à des conventions ou accords conclus au niveau de la branche professionnelle à laquelle elle appartient. Accords et conventions de branche peuvent être nationaux ou locaux. Ils peuvent viser tous les salariés ou seulement une catégorie déterminée.
Lorsque la convention collective et le contrat de travail comportent une disposition qui a le même objet, on applique la disposition la plus favorable au salarié. Par exemple, si le contrat prévoit une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective, c'est la convention qui prime. La solution inverse est retenue si le contrat fixe une indemnité de licenciement plus élevée ou un préavis de licenciement plus long que la convention.
L'employeur est tenu :
- de remettre au salarié lors de son embauche une notice sur les textes conventionnels applicables ;
- d'afficher dans l'entreprise un avis récapitulant la totalité des conventions et accords collectifs en vigueur dans l'établissement.
Enfin, la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie du salarié fait présumer que cette convention est applicable. Cela dit, l'employeur peut apporter la preuve contraire.
Si ces règles ne sont pas respectées, le salarié ne peut pas se voir opposer les dispositions conventionnelles (clause de non-concurrence par exemple). Il peut, en revanche, s'en prévaloir.
Les conventions et accords collectifs applicables doivent être mis à la disposition du personnel à l'intérieur de l'établissement. Le lieu et les modalités de la consultation figurent sur l'avis mentionnant les conventions et accords collectifs en vigueur. Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur doit mettre sur celui-ci un exemplaire à jour de l'ensemble des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables. Les salariés peuvent également obtenir ces textes auprès des représentants du personnel.
Il est possible de consulter gratuitement les conventions collectives de branche les plus importantes sur le site www.legifrance.gouv.fr ou de les commander en écrivant à la documentation française (DILA - Administration des ventes, 23 rue d'Estrées, CS10733, 75345 Paris Cedex 07) ou par Internet (www.ladocumentationfrancaise.fr).
Les accords conclus pour une durée déterminée doivent s'appliquer jusqu'au terme prévu. Les accords conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés par l'un ou l'autre de leurs signataires. L'accord dénoncé survit pendant quinze mois ou une durée différente fixée par l'accord lui-même.
A l'expiration de ce délai, si un nouvel accord a été conclu, il remplace immédiatement le précédent, même s'il est moins favorable. Si aucun accord n'est conclu, les salariés en cours de contrat au jour de la dénonciation conserveront les avantages individuels acquis, c'est-à-dire les avantages individuels prévus par l'accord dénoncé et dont ils ont déjà bénéficié. Ceux-ci font désormais partie de leur contrat de travail. Prenons l'exemple de la dénonciation d'une convention collective prévoyant une prime d'ancienneté : si aucune convention n'est conclue pour la remplacer, les salariés continueront à la percevoir, à hauteur du montant atteint au moment de l'expiration du délai de négociation ; les salariés qui n'avaient pas, à cette date, l'ancienneté suffisante pour la percevoir ainsi que les nouveaux embauchés ne pourront pas y prétendre.
Les autres avantages, c'est-à-dire les avantages collectifs (tels que l'aménagement du temps de travail ou les garanties disciplinaires) et les avantages individuels dont les salariés n'ont pas encore bénéficié, sont supprimés : si, par exemple, une convention prévoyant une indemnité de licenciement plus élevée que l'indemnité légale est dénoncée et n'est pas remplacée, l'indemnité de licenciement sera ramenée au niveau légal pour tous les salariés : il s'agit d'un avantage individuel, mais non encore « acquis ».
Très souvent, l'embauche définitive est précédée d'une période d'essai pendant laquelle l'employeur comme le salarié peuvent librement mettre fin au contrat sans motif et sans indemnité. Cette période permet à l'employeur de vérifier l'adéquation du salarié au poste de travail et offre au salarié l'opportunité d'apprécier les conditions de travail et l'intérêt des fonctions (C. trav. art. L 1221-19 s.).
Quelle que soit sa qualification, toute période durant laquelle l'employeur se réserve le droit de mettre fin au contrat unilatéralement et sans motif est assimilée à une période d'essai.
Oui, la période d'essai ne se présume pas : elle doit être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
Qu'elle ne soit pas mentionnée dans la promesse d'embauche n'empêche pas son application dès lors qu'elle est prévue dans le contrat signé par la suite (Cass. soc. 12-6-2014 no 13-14.258 : RJS 8-9/14 no 607).
A défaut de mention d'une période d'essai dans le contrat ou la lettre d'engagement et même si la convention collective applicable à l'entreprise l'impose pour toutes les embauches, l'engagement présente un caractère définitif.
La période d'essai ne peut pas dépasser deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, quatre mois pour les cadres.
Une période plus courte peut être prévue par les intéressés eux-mêmes ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise conclu depuis le 26 juin 2008. Les durées plus longues résultant d'accords collectifs de branche conclus avant cette date restent valables sous réserve qu'elles ne soient pas jugées déraisonnables. Ont par exemple été jugées excessives des périodes d'essai de six mois pour un assistant commercial et d'un an (renouvellement compris) pour un cadre.
Certaines périodes travaillées peuvent être imputées sur la période d'essai et la réduire d'autant. C'est le cas lorsque le salarié est recruté :
- à l'expiration d'un ou plusieurs CDD, pour un poste de qualification équivalente ;
- à la fin d'une mission d'intérim mais seul le temps de mission accompli au cours des trois mois précédant l'embauche est pris en compte ;
- dans les trois mois suivant la fin d'un stage obligatoire de fin d'études : la durée de ce stage est déduite de la période d'essai sans pouvoir, toutefois, la réduire de plus de la moitié sauf accord collectif plus favorable ; si l'emploi correspond aux activités précédemment confiées au stagiaire, la durée du stage est intégralement déduite de la période d'essai.
Le point de départ de l'essai est le jour où le salarié entre en fonctions. L'employeur ne peut pas décider d'en différer le début, même si le contrat a débuté par une période de formation (y compris au sein d'un organisme extérieur). L'essai se termine le dernier jour de la période convenue, à minuit.
SavoirLe décompte de la période d'essai se fait en jours ou en mois calendaires. Lorsque la durée est exprimée en jours, tous les jours comptent, y compris ceux non travaillés tels les jours fériés ou les dimanches. Lorsque la durée est exprimée en mois, le calcul se fait de quantième à quantième : par exemple, une période d'essai d'un mois qui commence le 6 juin expire le 5 juillet à minuit (et non le 6) même si le 5 est un dimanche.
En cas d'absence du salarié pour maladie ou pour cause de congés pendant la période d'essai, l'employeur est en droit d'imposer une prolongation de celle-ci d'une durée au maximum équivalente à la durée de l'absence. Le salarié doit en être informé avant l'expiration de la période initiale.
Quant au renouvellement de la période d'essai, il est possible uniquement si la convention collective l'autorise et si le contrat de travail ou la lettre d'embauche le prévoit. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une fois. Renouvellement compris, sa durée ne peut pas dépasser quatre mois pour les ouvriers et les employés, six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, huit mois pour les cadres (toujours sous réserve de durées plus longues résultant d'un accord collectif conclu avant le 26 juin 2008).
Le renouvellement de l'essai n'est valable que si le salarié en a été informé et l'a accepté de manière expresse et non équivoque avant l'expiration de la période initiale : la simple poursuite du travail ne vaut pas acceptation.
Jusqu'à la fin de la période d'essai, les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables. Si l'employeur considère que l'essai n'est pas concluant, il peut décider de mettre un terme au contrat :
- sans avoir à justifier sa décision ;
- sans formalité particulière, sauf si la convention collective ou le contrat de travail en disposent autrement. Mais si l'employeur rompt l'essai pour raisons disciplinaires, il doit respecter la procédure correspondante ;
- sans avoir à verser d'indemnité au salarié, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.
De son côté, le salarié a le droit de rompre la période d'essai sans avoir d'explication à fournir.
L'absence de motivation de la rupture n'exclut pas le contrôle de sa légitimité. La période d'essai ayant pour seul objet l'appréciation de la valeur professionnelle du salarié, une rupture pour un autre motif est abusive et donne lieu au versement de dommages-intérêts. Tel est le cas par exemple si elle est prononcée en raison du refus par le salarié d'une diminution de sa rémunération ou pour un motif économique.
La loi interdit à l'employeur de rompre la période d'essai en raison de la grossesse de la salariée, mais l'intéressée n'est pas à l'abri d'une rupture pour un autre motif, par exemple pour insuffisance professionnelle. Il est, en revanche, totalement interdit de rompre l'essai d'un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
L'employeur ne peut pas rompre la période d'essai pour un motif discriminatoire (état de santé ou handicap du salarié, par exemple). Dans ce cas, la rupture est nulle et l'employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts et à réintégrer le salarié dans l'entreprise si ce dernier le demande.
Sauf disposition particulière de la convention collective applicable, aucun formalisme n'est exigé. L'employeur doit seulement formuler de façon explicite sa volonté de rompre le contrat. Il peut avertir le salarié oralement. Mais en général, afin de se ménager une preuve, il lui remet un courrier contre décharge ou le lui adresse en recommandé AR.
L'employeur doit faire connaître sa décision avant la fin de la période d'essai. Plus précisément, il doit envoyer sa lettre avant ce terme, peu important que celle-ci soit reçue après (Cass. soc. 28-11-2006 no 05-42.202 : RJS 2/07 no 208).
Si la lettre de rupture du contrat est envoyée après l'expiration de la période d'essai, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir les indemnités dues en cas de licenciement.
La rupture de la période d'essai, durant son cours ou à son terme, est obligatoirement précédée d'un délai de prévenance.
Lorsqu'elle est le fait de l'employeur, et sous réserve que la durée de la période d'essai stipulée soit d'au moins une semaine, le délai de prévenance ne peut pas être inférieur à :
- 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
- 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
- deux semaines après un mois de présence ;
- un mois après trois mois de présence.
La rupture qui intervient avant la fin de la période d'essai mais trop tard pour que le délai de prévenance puisse être respecté ne rend pas le contrat de travail définitif ; elle ne peut donc pas être assimilée à un licenciement (Cass. soc. 23-1-2013 no 11-23.428 : RJS 4/13 no 251). L'employeur met fin au contrat au terme de la période d'essai et doit, sauf faute grave du salarié, une indemnité égale au montant des salaires et avantages que l'intéressé aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise (C. trav. art. L 1221-25). Si l'employeur laisse la relation de travail se poursuivre au delà de la période d'essai afin de respecter le délai de prévenance, le contrat prend fin à l'expiration de la période d'essai et un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, naît et prend la suite (Cass. soc. 5-11-2014 no 13-18.114 : RJS 1/15 no 1). S'il est rompu sans notification des motifs, il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque la rupture de l'essai, quelle que soit la durée stipulée, est le fait du salarié, le délai de prévenance est de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
Au moment où le salarié quitte l'entreprise, l'employeur lui remet un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.
Lorsque la rupture est le fait de l'employeur, le salarié a droit aux allocations de chômage s'il justifie de la durée d'affiliation, c'est-à-dire d'activité salariée, requise (durée variable selon qu'il s'agit d'une indemnisation initiale ou d'un rechargement des droits).
Toutefois, si l'essai a duré moins de 91 jours, le salarié n'a droit à aucune indemnisation s'il avait démissionné de son précédent emploi, sauf s'il a été affilié au moins trois ans en continu au régime d'assurance chômage au titre d'une activité salariée dans une ou plusieurs entreprises.
Et si c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture de l'essai ? Il n'a en principe pas droit aux allocations de chômage. Toutefois, ces dernières lui sont versées, sous réserve qu'il justifie d'une durée d'affiliation suffisante, si l'essai n'a pas duré plus de 91 jours de date à date et si l'emploi à l'essai a fait suite à un licenciement ou à une fin de contrat à durée déterminée qui n'a pas donné lieu à inscription à Pôle emploi.
Le salarié peut avoir des droits issus non pas de la loi, de la convention collective ou de son contrat de travail, mais des usages en vigueur dans l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Usages et engagements unilatéraux de l'employeur peuvent porter sur les sujets les plus divers, par exemple la rémunération, les remboursements de frais, les congés, les indemnités de rupture ou la fourniture de repas.
Il s'agit d'une pratique de l'employeur qui est à la fois constante, générale et fixe.
Pour être considérée comme constante, une pratique doit s'être répétée un certain nombre de fois. C'est le cas de la prime versée tous les ans depuis cinq ans mais pas de celle versée une ou deux fois seulement en cinq ans.
Une pratique est générale lorsqu'elle s'applique à tous les salariés ou à une catégorie déterminée de salariés.
Enfin, est fixe une pratique dont les modalités de calcul sont identiques d'une année à l'autre. Il a même été jugé qu'une prime variant selon les années mais d'un montant minimal déterminé respectait l'exigence de fixité (Cass. soc. 24-2-2009 no 07-43.308 : RJS 5/09 no 433).
Il existe des usages d'entreprise ou d'établissement, mais aussi des usages propres à une région, à une localité ou à une profession.
C'est la décision de l'employeur, annoncée officiellement, d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés sans y être contraint par un texte. Constituent par exemple des engagements unilatéraux de l'employeur :
- une déclaration de l'employeur en réunion de comité d'entreprise annonçant l'octroi aux salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté de deux jours de congés supplémentaires ;
- un document distribué à chaque salarié lors de l'embauche et récapitulant les avantages « maison » auxquels il peut prétendre.
L'employeur, mais aussi un éventuel repreneur, doit respecter les usages établis dans l'entreprise ou les engagements unilatéraux qu'il a pris. Toutefois, il peut mettre fin à un usage d'entreprise (mais non à un usage local, régional ou professionnel). De même, il peut revenir sur ses engagements unilatéraux sauf s'ils sont pris pour une durée déterminée. Par exemple, si l'employeur annonce, au mois de juin, qu'il versera une prime exceptionnelle en fin d'année, il ne pourra pas revenir sur sa décision.
Les effets de la dénonciation faite dans les formes requises (information par écrit de chaque salarié concerné, information des représentants du personnel, délai de prévenance suffisant) sont radicaux : l'usage ou l'engagement unilatéral cessent tout simplement d'exister sans aucun maintien des avantages acquis. Le salarié n'a aucun moyen de s'y opposer.
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre