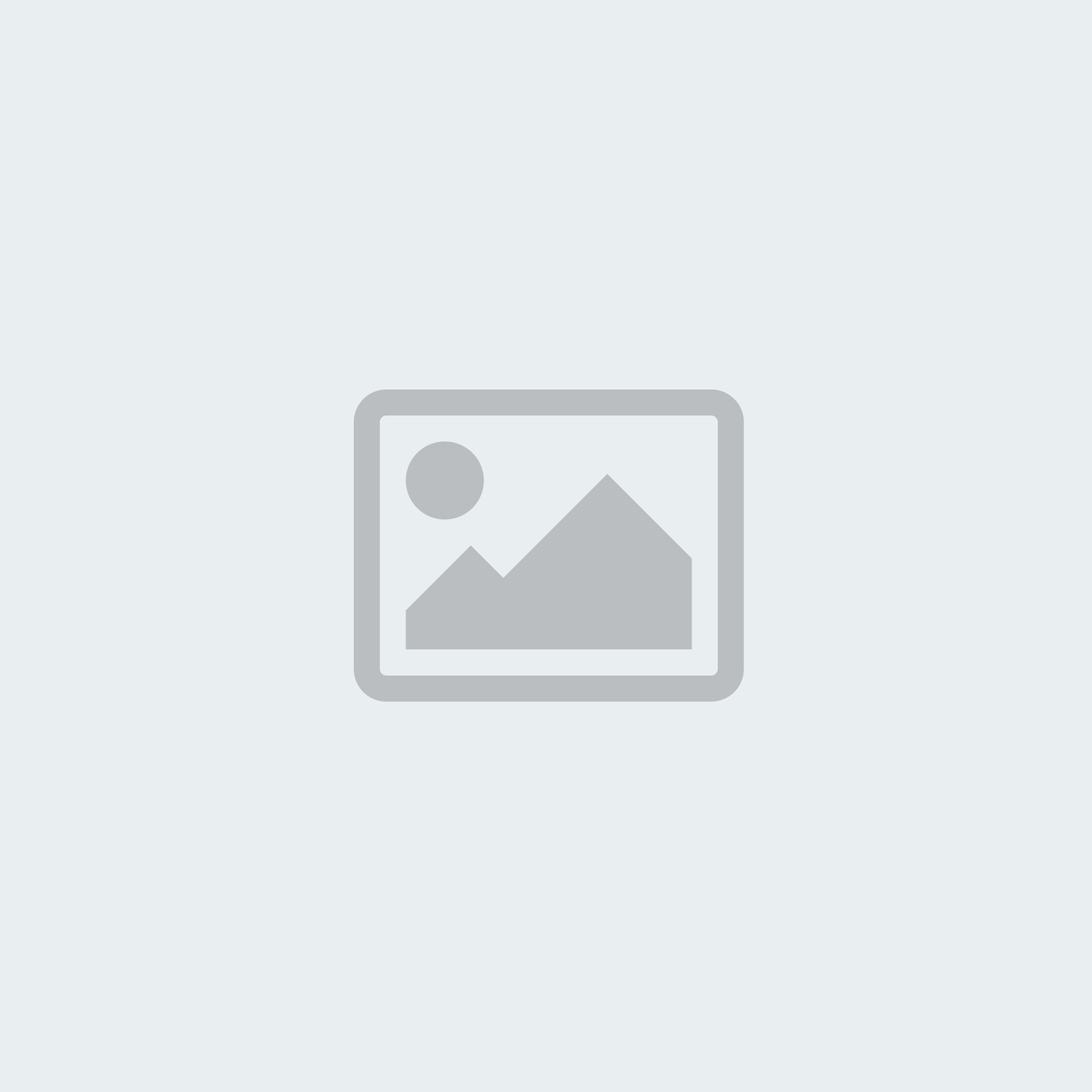Au sens strict, le devoir de conseil impose au notaire d'informer son client et de l'aider à contracter en toute connaissance de cause. En d'autres termes, le notaire doit vérifier que le client a parfaitement compris le contenu et la portée d'un acte avant de le signer.
Le devoir de conseil est aujourd'hui entendu si largement par les juges qu'il couvre en fait toutes les obligations qui pèsent sur le notaire aux fins d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit. C'est donc sur ce terrain que la responsabilité des notaires est le plus souvent engagée par leurs clients.
L'action en responsabilité doit être exercée auprès du tribunal de grande instance si le montant du litige est supérieur à 10 000 €, ce qui est fréquent dans ce type de contentieux. Au-dessous de cette somme et jusqu'à 4 000 €, c'est au tribunal d'instance qu'il convient de s'adresser. Si le montant en jeu est inférieur à 4 000 €, le juge de proximité est compétent. Cette dernière juridiction doit toutefois être supprimée à compter du 1er janvier 2017 (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 99) ; le tribunal d'instance sera alors seul compétent jusqu'à 10 000 €.
Territorialement, le tribunal compétent est soit celui du lieu où se situe l'étude du notaire (s'il est décédé, celui du domicile de ses héritiers), soit celui du lieu où la faute a été commise, soit enfin, si le notaire est appelé en garantie dans un second temps, celui devant lequel la demande en justice initiale est en cours.
Avant de poursuivre un notaire devant le tribunal, vous pouvez vous plaindre de son attitude en écrivant au président de la chambre des notaires du département ou au procureur de la République du tribunal de grande instance de son lieu de résidence. Il s'agit là de moyens de prévention et de règlement des conflits parfois très efficaces.
Mademoiselle Lucile Vinteuil
Villa Beauséjour
14390 Cabourg
Monsieur le Président
Chambre départementale des notaires du Calvados
6 place Louis Guillouard
14000 CAEN
Objet : réclamation
Monsieur le Président,
Je vous informe avoir confié à Maître Blandais, notaire à Balbec, le 16 septembre 2014, le règlement de la succession de ma mère décédée le 3 du même mois.
A ce jour, la déclaration de succession n'a pas été déposée ni aucun autre acte signé.
Malgré plusieurs démarches de ma part auprès du clerc chargé du dossier, je n'ai pu obtenir aucune explication sur les raisons de ce blocage. Quant à Maître Blandais, il reste injoignable.
Compte tenu du délai écoulé depuis l'ouverture de la succession, cette situation me semble pour le moins étrange. Je vous demande donc de bien vouloir faire le nécessaire.
Restant dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.
Lucile Vinteuil
Pièces jointes : copies des différents courriers de relance adressés à l'office notarial de Me Blandais.
L'éventail des fautes que peut commettre un notaire dans l'exercice de sa profession est très large : il peut s'agir du défaut de réalisation d'une formalité, du non-respect d'un délai, de la délivrance d'une information erronée ou insuffisante sur les risques afférents à l'opération projetée, etc.
Pour apprécier s'il y a eu faute, les juges comparent le comportement reproché à celui qu'aurait eu un « bon notaire », c'est-à-dire un notaire normalement avisé, diligent et compétent.
Quelques exemples de fautes que n'aurait pas commises un bon notaire et que les tribunaux ont sanctionnées :
- établir l'acte de vente d'un terrain sans avoir scrupuleusement vérifié que le vendeur était bien propriétaire de ce terrain (Cass. 1e civ. 13-11-1991 no 89-15.011 : Bull. civ. I no 310) ;
- déposer la déclaration de succession avec deux ans de retard (Cass. 1e civ. 26-11-2002 no 99-17.745 : Bull. civ. I no 286) ;
- ne pas attirer l'attention des parties à un acte de vente d'un lot de copropriété sur les risques d'un mesurage effectué par le vendeur lui-même et sur les conséquences d'une éventuelle erreur (Cass. 1e civ. 25-3-2010 no 09-66.282 : Bull. civ. I no 73) ;
- perdre le testament qui lui avait été confié (Cass. 1e civ. 8-3-2012 no 10-28.725).
D'une façon générale, les juges sont sévères à l'égard des notaires. S'agissant de l'obligation de conseil au sens strict, les juges estiment par exemple que ni la compétence du client ni l'intervention à ses côtés d'un autre professionnel (avocat, conseil fiscal, etc.) ne dispensent le notaire de ses obligations (Cass. 1e civ. 10-7-1995 no 93-16.894 : Bull. civ. I no 312 ; Cass. 1e civ. 3-3-2011 no 09-16.091 : Bull. civ. I no 44). Comble de la sévérité, un notaire a été condamné pour ne pas avoir éclairé un vendeur, lui-même notaire, sur les conséquences fiscales de la cession de son étude à un autre notaire (Cass. 1e civ. 3-4-2007 no 06-12.831 : Bull. civ. I no 142) !
En outre, le notaire doit la même efficacité et la même diligence au client occasionnel qu'à ses clients habituels.
Un simple « tiers », non client du notaire, peut rechercher la responsabilité de ce dernier si un acte lui a causé un préjudice. Ainsi, le notaire peut être tenu responsable à l'égard de la caution, tiers à l'acte de vente, dès lors qu'il a remis les fonds au vendeur sans avoir totalement désintéressé la banque, créancier inscrit, qui s'est retournée contre la caution (Cass. 1e civ. 10-9-2014 no 13-23.189 : BDP 2/14 inf. 74).
La charge de la preuve de la faute du notaire n'incombe pas à la « victime » du dommage. C'est au notaire de démontrer qu'il n'a pas commis de faute, preuve qu'il lui est en pratique très difficile de rapporter.
Lorsque deux notaires participent à un acte (par exemple, parce que le vendeur et l'acquéreur d'un immeuble ont souhaité être assistés chacun par son notaire habituel), ils sont responsables ensemble des fautes commises par l'un d'eux.
La prescription applicable est de 5 ans et court, non pas à compter de la faute, mais à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (C. civ. art. 2224). Aucune action n'est cependant possible au-delà de 20 ans à compter de la signature de l'acte (C. civ. art. 2232).
Même si votre notaire a pris sa retraite, vous devez agir directement contre lui pour les fautes qu'il a commises lorsqu'il était en exercice. Après son décès, ce sont ses héritiers (s'ils ont accepté sa succession) qui seront tenus à réparation. Si votre notaire est associé, vous avez le choix entre poursuivre votre notaire ou sa société, ou encore les deux ensemble.
Pour pouvoir être indemnisé, le client doit démontrer qu'il a subi un préjudice, c'est-à-dire un dommage certain et actuel. Si le dommage est présent (il est déjà survenu), il sera pris en compte sans difficultés. S'il est à venir, il ne sera indemnisable que si sa réalisation, certes différée, est inéluctable.
Ainsi, lorsqu'un acte de vente est annulé en raison d'une faute du notaire, l'acheteur ne peut pas demander à ce dernier de lui rembourser le prix d'achat s'il ne prouve pas que le vendeur est dans l'impossibilité de restituer cette somme (Cass. 1e civ. 5-4-2012 no 10-23.442). Car c'est bien au vendeur, dans un premier temps, qu'il appartient de rembourser l'acheteur. Et ce n'est que dans le cas où le vendeur est défaillant, de sorte que le préjudice du client est cette fois avéré, que le notaire sera condamné à payer des dommages-intérêts correspondant au montant du prix de vente. La défaillance du vendeur peut résulter de sa mise en liquidation judiciaire (Cass. 1e civ. 10-7-2013 no 12-23.746).
De même, le créancier hypothécaire qui n'a pas exercé son droit de suite contre l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice certain pour agir contre le notaire ayant remis le prix au vendeur sans purger les inscriptions sur l'immeuble (Cass. 1e civ. 27-2-2013 no 12-16.891 : Bull. civ. I no 27). Le droit de suite permet en effet au créancier titulaire d'une hypothèque de saisir le bien entre les mains de l'acquéreur et de le faire vendre afin d'être payé en priorité sur le prix.
Ensuite, le client doit prouver que la faute du notaire est bien à l'origine de son préjudice. Il s'agit d'établir un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.
Cette preuve ne pose pas de difficulté lorsque la faute commise consiste en un manquement à une obligation de réaliser une formalité (déposer une déclaration dans tel délai, vérifier l'origine de propriété du vendeur, etc.).
Le lien entre faute et dommage est en revanche plus difficile à établir lorsque la faute du notaire est un manquement à son obligation de conseil au sens strict, puisqu'il n'est jamais certain que le client, dûment informé d'un risque, aurait renoncé à contracter. Pour déterminer si la responsabilité du notaire est ou non engagée, les tribunaux prennent en compte l'importance du risque pris par le client en raison de la faute du notaire. Si ce risque est élevé, les juges retiennent la responsabilité du notaire.
La responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil est écartée s'il n'a pas communiqué une information qui lui était inaccessible. Mais pour parvenir à s'exonérer, le notaire devra prouver qu'il lui était impossible de connaître l'information (par exemple, il a réglé la succession du défunt sans tenir compte d'un enfant naturel dont l'existence était inconnue). Il sera responsable s'il existait le moindre indice de nature à éveiller ses soupçons, car il aurait dû alors effectuer les vérifications nécessaires. Par exemple, commet une faute le notaire qui règle la succession d'un pilote d'avion mort avec ses passagers et n'informe pas ses héritiers des dangers d'une acceptation pure et simple de la succession : en sa qualité de juriste professionnel, il ne peut ignorer le risque que les ayants droit des victimes engagent un recours en responsabilité (Cass. 1e civ. 18-3-1997 no 95-13.288).
Le notaire peut également être déchargé de toute responsabilité s'il n'a pas communiqué une information évidente. Mais faire le partage entre ce qui est évident et ce qui ne l'est pas confine parfois à l'impossible.
Il y a également décharge de responsabilité si l'information était imprévisible (changement de législation ou revirement de jurisprudence inattendus, par exemple).
Sa responsabilité étant de nature délictuelle, le notaire ne peut pas insérer de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans les actes qu'il fait signer. Il a tout au plus la possibilité de faire signer au client une reconnaissance de conseils donnés (no 52030).
Elle peut exonérer le notaire de sa responsabilité. Par exemple, le propriétaire qui consent un bail commercial en dissimulant le fait que le règlement de copropriété de l'immeuble interdit d'y exercer une activité commerciale ne peut pas réclamer au notaire réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'annulation du bail (Cass. 1e civ. 22-10-1996 no 94-19.828 : Bull. civ. I no 255). De même, l'héritier qui commet un recel successoral ne saurait se retourner contre le notaire chargé de régler la succession afin d'être garanti de sa condamnation et ce, même si le notaire a commis une négligence (Cass. 1e civ. 9-4-2014 no 13-16.348 : Bull. civ. I à paraître).
Cependant, la décharge n'a rien de systématique. Ainsi, l'acheteur d'un débit de boissons qui avait fourni au notaire une fausse attestation sur l'honneur pour cacher sa condamnation pour proxénétisme a obtenu réparation du préjudice résultant de la fermeture administrative de son établissement... (Cass. 1e civ. 9-11-1999 no 97-14.521 : Bull. civ. I no 299).
La faute d'un tiers (avocat ou autre notaire, par exemple) peut exclure la responsabilité du notaire. Le plus souvent, cette exonération n'est que partielle et les juges concluent à un partage de responsabilité, d'où une condamnation dite « in solidum » entre le notaire et le tiers. Ce partage est une sécurité supplémentaire pour la victime, qui n'aura pas à diviser ses recours et pourra si elle le souhaite demander réparation intégrale au notaire (par définition solvable), ce dernier devant ensuite se retourner contre le tiers s'il veut récupérer une partie des fonds qu'il aura dû verser.
SavoirLorsqu'ils sont confrontés à un problème juridique particulièrement délicat, les notaires demandent souvent un avis au Cridon (il s'agit de centres de recherche et de documentation régionaux, créés à l'initiative de la profession, et qui ont notamment pour objet d'aider les notaires dans la bonne exécution de leur devoir de conseil). Le fait d'avoir sollicité un tel avis avant de réaliser l'opération projetée par les clients ne dispense en rien le notaire de son devoir de conseil et ne peut donc pas l'exonérer de sa responsabilité (Cass. 3e civ. 11-9-2013 no 12-20.894).
Le notaire peut parfois se retrancher derrière le secret professionnel auquel il est astreint pour échapper à sa responsabilité au titre du devoir de conseil.
C'est ainsi que ne commet aucune faute le notaire qui s'abstient de révéler au vendeur d'un immeuble que son acheteur va revendre le bien dès le lendemain, à un prix très supérieur (Cass. 1e civ. 3-5-2006 no 04-17.599 : Bull. civ. I no 209).
Cela dit, les tribunaux n'acceptent que rarement ce moyen d'exonération. En effet, sans violer le secret professionnel, le notaire peut très souvent donner à son client des informations générales.
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation, le notaire aurait pu par exemple informer le vendeur des risques fiscaux liés à une sous-évaluation du bien, sans révéler les éléments qui lui faisaient « soupçonner » un prix de vente trop faible. Tant qu'il conseille le client en s'appuyant sur des critères comparatifs généraux, le notaire remplit son obligation de conseil dans le respect du secret professionnel.
Dans chaque ressort de cour d'appel, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle. Cette garantie se substitue au notaire défaillant chaque fois que le client peut justifier d'une créance exigible au titre de fonds ou de valeurs reçus par le notaire et non restitués ou de dommages-intérêts accordés à la suite d'une action en responsabilité. Attention, la caisse doit être saisie dans les deux ans de la défaillance du notaire ou de sa condamnation.
En outre, les notaires sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, à titre individuel.
Pour l'un et l'autre de ces mécanismes, seule la responsabilité professionnelle étant garantie, le notaire doit avoir agi dans l'exercice normal de ses fonctions. Si c'est le cas, le client peut agir indifféremment contre la caisse de garantie (ou l'assureur de cette dernière) ou contre l'assureur du notaire.
Pour se ménager la preuve qu'ils ont satisfait à leur obligation de conseil, les notaires font de plus en plus fréquemment signer à leurs clients un document spécifique appelé « reconnaissance de conseils donnés ». Il ne s'agit en aucun cas d'une décharge de responsabilité (interdite), mais d'un écrit qui atteste que le client est parfaitement informé et qu'il signe en connaissance de cause. Ce document n'est probant qu'à condition d'être clair, précis, complet et intelligible pour le client auquel il est destiné. S'il est trop général (document type), ou si les informations données sont insuffisantes, il n'établit pas que le notaire a rempli son devoir de conseil.
Plus rarement, la reconnaissance des conseils donnés par le notaire est contenue dans une clause de l'acte que doit signer le client. Signalons toutefois que la clause par laquelle le client déclare « faire son affaire personnelle » des conséquences de telle stipulation ou tel risque ne permet pas toujours au notaire d'échapper à sa responsabilité. Par exemple, même si l'acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle d'un jugement, non annexé à l'acte, concernant le bien vendu, il incombe au notaire de s'assurer que l'intéressé a eu connaissance de la teneur du jugement et de son incidence sur le sort de la vente (Cass. 1e civ. 14-11-2012 no 11-24.726 : Bull. civ. I no 241).
Quelle que soit la forme qu'emprunte la reconnaissance de conseils donnés, lisez-la attentivement (s'il s'agit d'une clause de l'acte, le notaire a de toute façon l'obligation de vous la lire mot à mot et à voix haute pendant le rendez-vous de signature) et n'hésitez surtout pas à vous faire expliquer, autant de fois que nécessaire, le ou les points qui vous paraissent difficiles à comprendre.
Le notaire doit en premier lieu vérifier l'identité du vendeur et de l'acheteur. S'il ne s'agit pas de clients connus, il doit leur demander des pièces justificatives. Dans une espèce où un homme en instance de divorce avait vendu un appartement commun accompagné d'une femme qu'il avait fait passer pour son épouse, le notaire a été condamné à rembourser aux acheteurs le prix de l'immeuble (l'annulation de la vente ayant été obtenue par la « véritable » épouse). Sa faute : s'être contenté de demander aux vendeurs leur livret de famille et leur contrat de mariage, alors qu'il aurait dû exiger une pièce d'identité officielle comportant à la fois une photographie et une signature (Cass. 1e civ. 6-2-1979 no 77-15.232 : Bull. civ. I no 45).
En ce qui concerne le contrôle du domicile des parties, le notaire n'a généralement pas les moyens de connaître avec certitude l'adresse future du vendeur (l'adresse portée dans l'acte étant bien souvent celle de l'immeuble vendu). Il n'a pas l'obligation de vérifier cette adresse, mais il doit avertir les acquéreurs des risques que cette méconnaissance implique. Faute d'avoir rempli cette obligation, un notaire a été condamné solidairement avec le vendeur introuvable à indemniser l'acheteur du fait des vices graves affectant l'immeuble (Cass. 1e civ. 4-2-2003 no 01-14.889 : Bull. civ. I no 39).
Le notaire doit vérifier la capacité des parties, en demandant un extrait d'acte de naissance. Si en marge de cet extrait figure la mention « répertoire civil », il doit demander une copie de l'extrait du répertoire civil au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de l'intéressé. Le notaire qui omet de requérir ce document engage sa responsabilité professionnelle s'il en résulte un préjudice pour ses clients (vente annulée en raison du placement sous tutelle de l'acheteur, par exemple).
Le notaire semble par ailleurs tenu d'une obligation de vérification renforcée pour les informations fournies par une partie représentée par procuration. Un notaire a ainsi été condamné pour ne pas avoir vérifié l'existence d'une procédure collective contre le vendeur représenté par sa mère et qui, déclarant être salarié, faisait en réalité l'objet d'une liquidation judiciaire (Cass. 1e civ. 12-5-2011 no 10-17.602). Jugé également qu'un notaire a fait preuve de légèreté et de négligence fautive en omettant de s'assurer personnellement de la capacité à vendre de sa cliente ayant donné procuration (Cass. 1e civ. 2-10-2013 no 12-24.754 : Bull. civ. I no 196). Dans cette affaire, les circonstances auraient dû éveiller les soupçons du notaire : les juges ont notamment relevé que ni l'activité professionnelle de l'intéressée (secrétaire) ni l'éloignement de son domicile (une commune de l'agglomération où est située l'étude) ne justifiaient le recours à une procuration.
SavoirPlus délicate est la vérification du caractère sain d'esprit de l'acheteur et du vendeur. Le notaire n'est pas psychiatre et n'a donc pas à expertiser l'état mental de ses clients. Mais face à une affection mentale manifeste, même pour un profane, le notaire doit refuser de prêter son concours à l'acte. A défaut, il engage sa responsabilité. Ajoutons que ce devoir de « détection » de l'altération mentale est plus sévèrement apprécié chez le notaire de famille, censé connaître suffisamment son client pour être à même de constater une éventuelle détérioration de ses facultés intellectuelles.
Il va de soi que le notaire doit vérifier l'étendue des droits immobiliers transmis, notamment l'origine de propriété du bien vendu. Par exemple, l'« erreur » du vendeur qui a vendu successivement son terrain à deux acheteurs différents ne dégage pas le notaire de sa responsabilité à l'égard des acquéreurs. Mais attention, le notaire n'est en principe pas tenu de vérifier l'origine d'une propriété au-delà de 30 ans (Cass. 1e civ. 17-11-2011 no 10-25.583).
Le notaire doit également requérir les états hypothécaires et s'assurer de l'absence de vices juridiques, charges et servitudes grevant le bien, sans naturellement se contenter des seules déclarations du vendeur. D'ailleurs, même si l'existence d'une servitude n'est pas révélée par l'état hypothécaire, le notaire est fautif de ne pas la mentionner dans un acte de vente du bien grevé alors qu'il avait lui-même rédigé l'acte ayant créé la servitude plusieurs années auparavant. En revanche, le notaire n'est pas tenu de requérir un état hypothécaire (Cass. 1e civ. 25-3-2010 no 08-20.351 : Bull. civ. I no 74) ni de vérifier l'origine de propriété de l'immeuble (Cass. 1e civ. 3-2-2011 no 09-69.617) avant la conclusion d'une promesse de vente, cet avant-contrat étant précisément destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l'expiration des délais utiles à l'obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la réalisation définitive de la vente.
L'obligation d'assurer l'efficacité de l'acte s'applique aussi en cas de vente sur plan. Le notaire doit ainsi vérifier le commencement effectif des travaux au jour de la vente, dès lors que la péremption du permis de construire du programme est imminente. Faute de l'avoir fait, les acheteurs d'un appartement et d'un parking ont versé 35 % du prix de vente en pure perte, le promoteur vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire. Compte tenu de la péremption du permis, que seul le commencement des travaux aurait permis d'éviter, la garantie financière d'achèvement n'a pas pu jouer (Cass. ass. plén. 5-12-2014 no 13-19.674 : BDP 3/15 inf. 119).
Le notaire doit aider son client à contracter en toute connaissance de cause et à opérer un choix parmi les différentes options qui s'offrent à lui. Le domaine de cette obligation est extrêmement vaste, puisqu'elle s'étend à tout risque quelconque susceptible d'altérer le consentement des contractants.
Engage par exemple sa responsabilité le notaire qui n'avertit pas le vendeur des risques qu'il prend en octroyant des conditions de prix trop favorables à son acheteur, ou en renonçant à son privilège de vendeur (qui permet, en cas de non-paiement, de faire vendre le bien aux enchères pour se payer sur le prix).
De la même façon, engage sa responsabilité le notaire qui n'attire pas l'attention de l'acheteur sur un prix trop élevé ou sur les risques liés au défaut d'assurance, à l'absence d'une clause suspensive d'obtention d'un permis de construire ou à la signature de l'acte authentique avant l'expiration des délais de recours contre ce permis.
Enfin, le notaire ne doit pas limiter ses conseils à un domaine du droit en particulier, tel le droit civil. Il lui appartient également d'éclairer ses clients sur les conséquences fiscales des actes signés. Un notaire a ainsi été condamné à payer les trois quarts d'un redressement fiscal pour ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de ses clients sur l'importance de la plus-value imposable suite à plusieurs ventes de parts de sociétés civiles immobilières (Cass. 1e civ. 15-2-2005 no 03-10.835). La responsabilité du notaire peut également être recherchée lorsqu'une acquisition réalisée au titre d'un régime fiscal de faveur s'avère en être exclue en raison de la nature des travaux (Cass. 1e civ. 26-1-2012 no 10-25.741).
ConseilQuel que soit le domaine concerné (droit immobilier, droit de la famille, etc.), demandez à votre notaire de vous adresser, plusieurs jours à l'avance, un projet de l'acte que vous devez signer. Vous pourrez ainsi prendre connaissance, à tête reposée, de la teneur des différents documents et solliciter des éclaircissements sur tous les points qui vous paraîtront obscurs. Les études de notaires certifiées ISO (International Organization for Standardization) procèdent systématiquement à de tels envois.
Le notaire doit respecter un certain nombre de formalités, telles que l'inscription du privilège du vendeur, le respect des délais de rétractation, des délais de paiement, ou de toute obligation contractuelle particulière.
Le notaire doit également déposer la déclaration des plus-values immobilières relevant du régime des particuliers et verser le montant de cette plus-value au service de la publicité foncière, au moment de la publication de la vente.
Le manquement à ces obligations engage évidemment la responsabilité du notaire.
L'acte de notoriété a pour objet d'établir la qualité d'héritier de telle ou telle personne, sa particularité étant d'être rédigé à partir des affirmations des héritiers et, éventuellement, de témoins.
Si l'intervention de témoins est jugée utile, le notaire qui procède à la rédaction de l'acte de notoriété doit bien sûr vérifier l'état civil des personnes qu'il entend. Parce qu'il lui est a priori impossible de savoir avec certitude si monsieur X ou madame Y a véritablement connu le défunt, il n'a pas l'obligation de vérifier la véracité de leurs affirmations. Cela dit, il n'est pas pour autant déchargé de toute obligation, puisqu'il doit vérifier le caractère plausible de ces affirmations. Engagerait par exemple sa responsabilité le notaire qui recevrait un acte de notoriété sur la déclaration de témoins qui, compte tenu de leur âge, ne pourraient pas avoir connu le défunt (CA Paris 28-2-1991, 2e ch. B : Juris-Data no 023370).
Le notaire ne saurait non plus se contenter des énonciations du livret de famille. Un notaire a ainsi été condamné pour avoir oublié un enfant issu d'une précédente union et dont l'existence n'était certes pas révélée par le livret de famille mais qui aurait été aisément découverte en consultant le jugement de divorce du défunt, lequel y était en revanche bien mentionné (Cass. 1e civ. 25-3-2009 no 07-20.774 : Bull. civ. I no 70).
Egalement appelée attestation notariée, l'attestation immobilière tend uniquement à faire publier aux services chargés de la publicité foncière compétents le transfert de propriété des immeubles successoraux, à défaut de partage immobilier publié dans les 10 mois du décès et avant toute vente de ces immeubles. Sa rédaction étant obligatoire, le notaire peut engager sa responsabilité s'il omet de l'établir, ou s'il ne l'établit qu'avec retard.
L'obligation de déposer une déclaration de succession dans les six mois du décès incombe légalement aux héritiers, et non au notaire. Mais en pratique, dès lors qu'un notaire a été chargé du règlement de la succession, il doit faire en sorte que la déclaration soit déposée en temps utile. A défaut, les héritiers qui auront payé au Trésor public les pénalités de retard pourront se retourner contre le notaire pour en obtenir le remboursement (Cass. 1e civ. 30-3-1994 no 92-16.666).
Ici encore, les tribunaux sont extrêmement réticents à décharger le notaire de sa responsabilité. Un notaire a ainsi été condamné pour ne pas avoir personnellement informé un légataire des sanctions fiscales encourues en cas de déclaration hors délai (Cass. 1e civ. 14-6-2007 no 06-16.379). La solution est sévère car l'avocat du légataire avait adressé au notaire, peu avant l'expiration du délai, un courrier attestant que l'intéressé était parfaitement informé de la nécessité de procéder à la déclaration dans les six mois du décès.
Jugé également que manque à son obligation de conseil le notaire qui, après avoir obtenu un premier report de délai, se contente d'envoyer à son client la copie de la lettre de l'administration fiscale refusant un nouveau report et mentionnant le fait que le versement d'un acompte provisionnel diminuerait le montant des pénalités. Ce notaire aurait dû appeler spécialement l'attention de son client sur les dangers d'une déclaration tardive et lui proposer de déposer une déclaration provisoire assortie d'un paiement partiel (Cass. 1e civ. 18-6-1996 no 94-10.753 : Bull. civ. I no 260).
Pour échapper à sa responsabilité, le notaire devra donc en pratique démontrer non seulement qu'il a informé son client des risques encourus par une déclaration tardive, mais également que cette non-déclaration résulte d'une volonté délibérée.
Enfin, un notaire a vu sa responsabilité engagée en cas d'omission d'une dette du défunt dans le passif de la déclaration de succession, ayant pour conséquence directe une majoration des droits payés et alors que le délai pour rectifier la déclaration était expiré (Cass. 1e civ. 25-6-2009 no 08-14.951).
En cas de blocage dans le règlement de la succession en raison d'un contentieux, le notaire qui ne dépose pas les sommes qu'il détient pour le compte de la succession à la Caisse des dépôts et consignations afin que les héritiers puissent profiter ultérieurement des intérêts ainsi produits est susceptible de voir sa responsabilité engagée (Cass. 1e civ. 29-6-2004 no 01-12.899).
Si rien n'a été fait après plusieurs mois alors que vous avez remis, depuis longtemps déjà, les pièces et éléments de renseignement qui vous ont été demandés, relancez le notaire, d'abord par courrier simple. En l'absence de réponse dans les jours qui suivent, renouvelez votre démarche par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si vos relances restent vaines, vous pouvez adresser une réclamation au président de la chambre des notaires du département, instance habilitée à recevoir les plaintes des clients (no 52002).
Lucile Vinteuil
Villa Beauséjour
14390 Cabourg
Maître Blandais
Notaire
3 impasse de l'Oubli
14395 Balbec
Objet : relance
Maître,
Je reviens vers vous concernant la succession de mon père, Pierre Vinteuil, décédé à Etretat le 3 septembre 2014.
Depuis le 16 septembre, jour où je me suis rendue en votre étude avec mon frère pour l'ouverture du dossier, je n'ai reçu aucune nouvelle de votre part. Vous restez, par ailleurs, injoignable au téléphone.
Je m'inquiète à l'approche de la date d'expiration du délai que nous avons pour déposer la déclaration de succession.
De plus, j'ai besoin de pouvoir prélever certaines sommes sur le compte courant de mon père afin de régler plusieurs factures concernant la maison d'Etretat. Or, le banquier me réclame la copie de l'acte de notoriété que nous n'avons toujours pas signé.
Restant dans l'attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées.
Lucile Vinteuil
L'avocat a le devoir d'informer de façon complète et précise le client qui le consulte ; l'avocat doit aussi conseiller son client, pour le guider dans le choix d'une décision à prendre, pour l'assister et le représenter devant une juridiction ou une administration, ou lors de la rédaction d'actes ou de documents de toute nature.
L'avocat, en s'exprimant en des termes intelligibles, doit s'assurer que son client a bien compris le sens et la portée de ses choix et des décisions qu'il prend à partir des informations fournies.
Le devoir de conseil incombant à l'avocat est donc entendu de façon très large. Il recouvre l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes que l'avocat peut être appelé à rédiger (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 56 ; décret 2005-790 du 12-7-2005 art. 9), à la manière d'un notaire. Le devoir de conseil recouvre également les diligences que l'avocat doit apporter dans l'assistance ou la représentation du client devant les tribunaux (CPC art. 416) ou devant les administrations publiques (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 6), ou encore l'attention, les soins, la prudence, la compétence, le dévouement dont l'avocat doit faire preuve envers son client en toutes circonstances (Décision CNB 2005-003 portant RIN art. 1, 1.3), notamment à l'occasion d'une simple consultation juridique.
Au-delà de la délivrance d'informations et de conseils au client, l'avocat doit aussi recueillir auprès de son client l'ensemble des éléments d'information utiles (Cass. 1e civ. 20-3-2014 no 13-11.841) et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux sa défense (Cass. 1e civ. 1-3-2005 no 03-16.329 : Bull. civ. I no 98).
Dès la fin de sa mission, l'avocat a le devoir de restituer spontanément les documents, même non originaux, qu'il a reçus de son client (Cass. 1e civ. 4-6-2014 no 13-16.959).
La responsabilité de l'avocat sera habituellement recherchée par un client pour méconnaissance du devoir de conseil, sur le fondement de la relation contractuelle qui s'est nouée entre lui et l'avocat. Cette relation, qui a pour objet la « prestation de services » que le professionnel est appelé à fournir au profit de son client, est parfois exprimée aujourd'hui en une « lettre de mission » ou, plus souvent, en une « convention d'honoraires » qui précise les obligations respectives des parties et qui indique ce sur quoi s'engage l'avocat.
C'est à partir de ce document ou, à défaut, à partir de l'accord verbal entre l'avocat et son client que les juges saisis d'une action en responsabilité apprécieront si l'avocat s'est conformé aux obligations qu'il a contractées envers son client et s'il a respecté son devoir général de conseil. La responsabilité de l'avocat est alors dite « contractuelle » (C. civ. art. 1137 et C. civ.1147).
Des personnes non clientes, y compris des personnes qui étaient parties à un acte rédigé par un avocat, pourraient rechercher la responsabilité de celui-ci. Ce pourrait être le cas pour des activités de l'avocat qui, telles le courtage ou l'intermédiation, sont étrangères aux missions de sa profession ; ce pourrait être aussi la conséquence d'une défaillance dans le devoir d'information auquel l'avocat est tenu au bénéfice de toutes les parties, même non clientes, à l'acte qu'il instrumente (RIN art. 7.2 ; Cass. 1e civ. 27-11-2008 no 07-18.142 : RJDA 3/09 no 198). En ces hypothèses d'un dommage que l'activité d'un avocat aurait occasionné à des tiers non clients, la responsabilité de l'avocat, dite « délictuelle » en l'absence de relation contractuelle directe avec la personne qui se prétend victime, doit être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité (C. civ. art. 1382 s.).
L'action en responsabilité exercée contre un avocat doit être portée devant le tribunal de grande instance, dès lors que l'intérêt financier du litige, c'est-à-dire le plus souvent le montant de l'indemnisation demandée, excède 10 000 €. Au-dessous de cette somme et jusqu'à 4 000 €, c'est au tribunal d'instance qu'il convient de s'adresser. Si le montant en jeu est inférieur à 4 000 €, le juge de proximité est compétent. Cette dernière juridiction doit toutefois être supprimée à compter du 1er janvier 2017 ; le tribunal d'instance sera alors seul compétent jusqu'à 10 000 €.
Exceptionnellement, s'agissant de la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour des faits qui ont trait aux fonctions exercées devant les juridictions administratives, la juridiction compétente pour en connaître sera le Conseil d'Etat (Ord. 10-9-1817 art. 13 ; CE 27-3-2015 no 382156 : JCP G 2015 act. 408).
De façon générale, la compétence territoriale revient à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet de l'avocat actionné en responsabilité.
En théorie, le demandeur a le choix avec la compétence de la juridiction où, en matière contractuelle, a été exécutée la prestation de service convenue avec le professionnel ; en théorie toujours, le demandeur a aussi le choix, en matière délictuelle, avec la compétence de la juridiction où la faute a été commise ou le dommage subi.
Mais, en pratique, ces différentes compétences territoriales coïncident le plus souvent avec la compétence générale de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet de l'avocat défendeur.
Néanmoins, en sa qualité d'auxiliaire de justice, l'avocat défendeur pourrait solliciter le « dépaysement de l'affaire », c'est-à-dire le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui où il exerce ses fonctions (CPC art. 47).
Les avocats du ressort d'une juridiction sont réunis en un ordre et placés sous l'autorité professionnelle d'un bâtonnier.
La personne victime d'un préjudice qu'elle attribue à la défaillance d'un avocat dans son devoir de conseil et d'assistance juridique a la faculté, avant d'introduire une action en justice, de saisir le bâtonnier, dont l'intervention auprès de son confrère peut permettre de régler la difficulté et d'éviter l'ouverture d'une procédure judiciaire, longue, coûteuse et hasardeuse.
Le bâtonnier peut aussi aider la victime dans le choix de l'avocat qui sera appelé à l'assister en justice car le passage à la phase judiciaire imposera de déterminer quel avocat consentira à exercer une action en responsabilité contre l'un de ses confrères.
L'avocat est tenu d'apporter au dossier qui lui est confié, comme à la consultation qui lui est demandée, l'attention, la pertinence, la prudence et les diligences que le client attend de tout professionnel compétent et avisé. A cette fin, l'avocat est tenu de recueillir toutes les informations factuelles et juridiques utiles, notamment, on l'a vu, auprès de son client qu'il doit solliciter à cette fin.
Il est devenu fréquent que la faute professionnelle reprochée à un avocat réside dans le fait d'avoir omis de s'informer pleinement, omis d'accomplir des démarches, omis de mentionner une demande dans une assignation ou par des conclusions, omis d'informer des voies de recours et de leurs délais, omis d'annexer une pièce à un acte, ou encore dans le fait d'avoir laissé passer un délai ou oublié de procéder à des formalités ou au dépôt d'un document, ce qui pourrait avoir occasionné à son client, en particulier, la perte d'un droit.
Bien entendu, comme c'est le cas pour tout rédacteur d'acte, tel un notaire, le simple défaut d'efficacité de l'acte rédigé par un avocat ou, a fortiori, l'invalidité de l'acte qu'il aurait élaboré fait présumer l'existence d'une faute commise par le professionnel dans sa mission d'élaboration - rédaction d'actes. Mais, au-delà de la garantie de validité et d'efficacité de l'acte que doit apporter l'avocat rédacteur, l'avocat est aussi tenu de son devoir général d'information, par exemple sur le risque que sa qualité de caution fait courir à son client, fondateur d'une société en formation : l'oubli d'en informer le client constitue une faute (Cass. 1e civ. 18-3-2014 no 12-28.784).
D'ailleurs, les juges saisis d'une action en responsabilité semblent aujourd'hui attendre de l'avocat qui intervient dans une instance en justice ou lors de la rédaction d'actes, non pas un résultat bénéfique pour son client, mais pour le moins que l'avocat fasse preuve d'une diligence renforcée dans le suivi et la conduite du dossier ou dans la rédaction de l'acte, voire qu'il fasse preuve d'une quasi-perfection.
Toute défaillance ou insuffisance dans la conduite d'une procédure, tout conseil juridique incomplet ou défectueux (mauvais choix ou oubli d'un moyen, voie de recours inappropriée), a fortiori tout manquement dans l'élaboration et la rédaction d'un acte sera automatiquement sanctionné comme une faute. L'avocat doit maîtriser le droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur, y compris celui qui ressort de la jurisprudence (Cass. 1e civ. 4-6-2014 no 13-14.363 : RJDA 11/14 no 822) ; si l'avocat ne peut prédire l'imprévisible, il serait fautif de ne pas anticiper une évolution prévisible du droit (Cass. 1e civ. 15-12-2011 no 10-24.550 : RJDA 2/12 no 179).
Désormais, pour les juges, l'avocat paraît devoir être un professionnel particulièrement prudent, vigilant, avisé, réactif et prévoyant, et non pas seulement un professionnel normalement diligent.
L'appréciation sévère de la faute de l'avocat par les juges n'est pas atténuée par la présence d'autres intervenants, à côté de l'avocat ou en assistance du client de celui-ci, que ces intervenants soient eux-mêmes des professionnels du droit, du chiffre ou du conseil.
L'appréciation sévère de la faute de l'avocat n'est pas non plus atténuée par les connaissances personnelles de son client, ni même par les compétences professionnelles que le client aurait pour conduire seul et mener à bien la mission qu'il a choisi de confier à l'avocat (Cass. 1e civ. 19-5-1999 no 96-20.332 : Bull. civ. I no 164).
L'appréciation sévère de la faute n'est pas davantage affectée par le fait que la mission que l'avocat a acceptée serait occasionnelle ou, au contraire, récurrente, ou encore par le fait que le client serait un client régulier de l'avocat pour avoir conclu avec celui-ci un « contrat d'abonnement ».
SavoirLorsque le client a confié une mission à un cabinet d'avocats constitué en société professionnelle, cette société et l'avocat personne physique qui a été chargé d'exécuter la mission sont coresponsables : le client insatisfait de la prestation a la faculté d'actionner en responsabilité, à son choix, soit de façon distincte la société d'avocats ou celui d'entre eux qui devait exécuter la mission soit encore de façon simultanée la société et le professionnel prestataire afin de les faire condamner ensemble à réparer le dommage (Cass. 1e civ. 8-3-2012 no 11-14.811 : RJDA 5/12, no 510). La responsabilité de l'avocat associé et de sa société n'est pas subsidiaire ; elle ne nécessite pas d'avoir exercé une action en réparation contre un autre responsable du dommage (Cass. 1e civ. 19-12-2013 no 13-11.807).
C'est à l'avocat, en sa qualité de prestataire de service et au titre de la responsabilité contractuelle envers son client, qu'il revient de prouver qu'il a bien exécuté son obligation de conseil et d'information, ainsi que l'obligation de s'informer auprès du client. Il incombe éventuellement aussi à l'avocat de prouver qu'il a prévenu le client en temps utile de son désistement afin que ses intérêts soient sauvegardés.
La preuve des diligences et des conseils développés par l'avocat peut être apportée par tous moyens et, s'il y a lieu, par le témoignage d'un autre professionnel, notamment d'un autre avocat qui était présent lors de la signature de l'acte critiqué par le client.
De même que pour d'autres professionnels tenus d'un devoir de secret, notamment les experts-comptables et les commissaires aux comptes, la défense de l'avocat actionné en responsabilité ne saurait être entravée par le secret professionnel auquel il est astreint. En revanche, le droit de défendre en justice n'autorise pas l'avocat à produire, sans l'accord de la personne concernée, un document couvert par un autre secret que le sien, en particulier un document qui serait protégé par le secret médical (Cass. 1e civ. 28-6-2012 no 11-14.486 : Bull. civ. I no 145).
Au titre de sa responsabilité délictuelle, un avocat pourrait avoir à répondre du préjudice que son activité professionnelle aurait occasionné à un tiers, non client.
La preuve de la faute imputée à l'avocat incombe alors au tiers qui demande réparation ; cette preuve est, a priori, plus difficile à rapporter que celle qui, pour le client, ressort de la mauvaise exécution, voire de l'inexécution de la prestation de service convenue avec l'avocat. Le tiers ne bénéficie donc pas du même avantage stratégique que le client en matière d'action en responsabilité contre un avocat.
De façon générale, l'action en responsabilité contre un professionnel se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime du préjudice, qu'elle soit client du professionnel ou simple tiers, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. En pratique, le délai de cinq ans court à compter du jour où la victime a connaissance des faits préjudiciables qu'elle impute à un professionnel. Néanmoins, aucune action n'est recevable au-delà de vingt ans à compter des faits générateurs du préjudice.
De façon particulière, l'action en responsabilité dirigée contre un avocat qui a représenté ou assisté un client en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui lui ont été confiées, se prescrit également par cinq ans, mais à compter de la fin de la mission (C. civ. art. 2225).
SavoirEn raison des incertitudes qui entourent en pratique la détermination de la fin de la mission, les avocats prennent souvent soin d'en informer leurs clients, en assortissant cette information d'éventuels conseils sur les suites qui conviendraient. En ce cas, il semble que, pour décharger l'avocat, l'information de fin de mission doive être formalisée dans un écrit ; cette information ne doit pas intervenir à contretemps, c'est-à-dire dans des circonstances préjudiciables pour le client (Décret 2005-790 du 12-7-2005 art. 13).
Tout d'abord, la responsabilité de l'avocat est limitée par les termes du mandat que lui a confié le client, donc par les instructions de celui-ci : la responsabilité de l'avocat mandaté ne saurait être étendue en l'absence d'instructions particulières de son client, par exemple en matière de liquidation complémentaire d'une astreinte, ou pour le non-renouvellement d'une inscription hypothécaire, lorsque le client a fait délibérément le choix, après avoir consulté un notaire, de ne pas mandater l'avocat, ni pour renouveler l'inscription, ni pour obtenir des conseils.
Ensuite, comme nul ne peut être tenu à l'impossible, l'avocat ne saurait être tenu au-delà de ce qui est connu et accessible par un bon professionnel. Ainsi, un avocat n'est pas tenu d'anticiper un revirement de jurisprudence imprévisible ou un changement de législation inattendu ; en revanche, il doit prendre en compte les évolutions de la jurisprudence et des textes légaux ou réglementaires, en particulier dans les précisions à apporter lors de la rédaction d'un acte, par exemple en mentionnant de manière suffisamment explicite le motif économique dans une lettre de licenciement.
L'avocat est garant, envers toutes les parties, de l'efficacité juridique et de l'équilibre des actes qu'il rédige ou à l'élaboration desquels il a contribué. En revanche, l'avocat n'est pas garant de leur opportunité économique. L'avocat n'est pas davantage garant de l'exécution des engagements qui figurent dans ces actes : en la matière, comme tout rédacteur d'actes, l'avocat n'est pas tenu d'une obligation particulière de mise en garde, par exemple sur la solvabilité ou sur la bonne foi d'un cocontractant, qui demeure présumée.
L'avocat n'est pas non plus tenu de vérifier les affirmations des parties à l'acte qu'il élabore, dès lors que n'existe aucun élément de nature à faire douter de la véracité de ces affirmations (Cass. 1e civ. 3-7-2013 no 12-22.665).
De façon générale, la frontière des devoirs professionnels de l'avocat tient à l'application de la règle de droit. Bien que l'avocat soit tenu de s'acquitter de son obligation d'information, il ne saurait être tenu de délivrer à son client une information qui aurait pour seul effet de permettre au client d'exercer un recours abusif parce que dilatoire, dans le seul dessein de permettre au client de gagner du temps.
Le devoir de l'avocat est, au contraire, de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec : l'avocat engagerait sa responsabilité s'il ne justifiait pas avoir averti son client des risques prévisibles auxquels celui-ci s'exposerait par ses choix ou par son obstination. Ainsi, l'obstination du client, qui a été parfaitement informé, décharge l'avocat qui conseillait une substitution de caution lors d'une cession de droits sociaux (Cass. com. 17-9-2013 no 12-17.949 : RJDA 12/13 no 1018).
N'engage pas sa responsabilité l'avocat qui n'a pas soulevé devant les juges un moyen qui était inopérant, ou encore l'avocat qui n'a pas accompli les diligences procédurales nécessaires dès lors qu'en toute hypothèse l'action projetée par le client était irrecevable, ou que son recours n'avait aucune chance d'être accueilli.
Et si l'avocat est tenu de recueillir auprès de son client toutes informations utiles à la délivrance d'un conseil pertinent, il n'est pas obligé de vérifier spontanément la véracité des affirmations des parties à l'acte qu'il instrumente, dès lors qu'aucun élément n'est de nature à faire douter de leur sincérité (Cass. 1e civ. 3-7-2013 no 12-22.665). Il n'a pas davantage à rappeler aux parties à l'acte le principe de bonne foi, de sincérité et de loyauté lors de la conclusion et de l'exécution du contrat, ni à alerter son client sur le risque d'insolvabilité des garants, en l'absence d'éléments conduisant à en douter (Cass. 1e civ. 31-10-2012 no 11-15.529 : RJDA 3/13 no 238).
SavoirA l'égard de son client, l'avocat ne pourrait pas, dans la « convention d'honoraires », s'exonérer de toute responsabilité. En revanche, en précisant la nature et l'étendue de ses prestations dans la convention, l'avocat pourrait limiter sa responsabilité. L'avocat pourrait aussi faire souscrire au client une reconnaissance expresse de conseils donnés, ou une « clause décharge », qui doit être précise et explicite ; le client a alors intérêt à prendre attentivement la mesure du document, en s'en faisant expliquer la portée si besoin, avant de le signer. Néanmoins, aucune limitation conventionnelle de responsabilité ne résisterait à la preuve d'une faute lourde imputée au professionnel.
Il n'est pas rare qu'en pratique un concours de fautes conduise à un partage de responsabilité entre l'avocat et son client, qui est lui-même tenu d'apporter à l'avocat un concours loyal jusqu'à l'achèvement de la mission (Cass. 1e civ. 14-11-2012 no 11-24.396), par exemple en l'avertissant de son changement de domicile ou de toute autre circonstance qui pourrait avoir une incidence sur la bonne exécution de la mission. Il en est ainsi alors même que l'avocat ne saurait être exempté de responsabilité en raison des connaissances et des compétences personnelles du client.
Plus exceptionnellement, l'impéritie des clients eux-mêmes pourrait être jugée, malgré le défaut d'information et de conseil imputé à l'avocat, la cause unique et exclusive de leur préjudice. Ainsi, des cédants de parts sociales se sont vu reprocher, malgré le défaut de conseil du rédacteur d'acte sur les conditions de paiement du prix, de ne pas avoir mis en oeuvre les garanties dont ils disposaient, ni demandé l'annulation de la vente.
Il n'est pas exceptionnel, en revanche, qu'en raison d'une pluralité d'intervenants lors de l'élaboration ou de la rédaction d'un acte, les magistrats condamnent ensemble différents professionnels, considérés comme coresponsables. Il peut s'agir de plusieurs avocats, ou encore d'avocats, de notaires et d'experts-comptables, condamnés « in solidum » à réparer le dommage que leur défaut commun de diligences aurait occasionné aux clients, voire à des tiers (Cass. 1e civ. 29-11-2005 no 02-13.550 : Bull. civ. I no 451).
En cas de coresponsabilité entre un avocat et d'autres intervenants, chacun des professionnels fautifs est tenu pour le tout à réparer le préjudice occasionné à la ou aux victimes. Mais ensuite, la charge de la réparation est répartie entre les différents professionnels fautifs, habituellement par « parts viriles », c'est-à-dire que le montant du préjudice est divisé par le nombre de personnes reconnues responsables.
La réparation d'un préjudice exige, au-delà de la preuve du fait générateur de responsabilité, la démonstration d'un préjudice actuel et certain qui soit rattaché par un lien de causalité à ce fait générateur, c'est-à-dire qui soit rattaché à la faute du professionnel.
Dans la mission d'assistance et de représentation du client en justice, le préjudice que l'avocat peut occasionner par un manquement à ses devoirs professionnels consiste le plus souvent dans le fait que son client a perdu une chance d'emporter la conviction des juges et de gagner le combat judiciaire.
Saisis d'une action en responsabilité contre un avocat que son client avait chargé d'agir en justice, les magistrats apprécient donc les « chances raisonnables de succès de l'action » dont la faute imputée à l'avocat aurait privé son client (Cass. 1e civ. 10-7-2014 no 13-20.606).
Si tel est le cas, le préjudice réparable consiste en la perte d'une chance, résultant de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable pour le client. Cette perte de chance, lors d'un procès, est souvent provoquée par une erreur de moyen ou de preuve, par un manque de diligence, par une omission de l'avocat, tel l'oubli de respecter un délai ou l'oubli d'accomplir une formalité.
Dans la mission de rédaction d'acte, assortie des devoirs d'information et de conseil, le préjudice qu'occasionne une défaillance de l'avocat consiste aussi le plus souvent en la perte d'une chance, pour le client, soit de ne pas s'engager, soit de s'engager différemment et de conclure un autre acte, soit encore d'adopter un autre contenu et d'autres clauses dans l'acte, mieux adaptés à ses besoins ou projets.
L'existence d'une autre action en responsabilité qui permettrait aussi la réparation du dommage souffert par la victime n'interdit nullement à celle-ci de demander réparation de la perte d'une chance née d'un défaut de diligence de son avocat (Cass. 1e civ. 19-12-2013 no 13-11.807 : RJDA 3/14 no 284).
L'évaluation de la chance perdue demeure délicate mais, en toute hypothèse, elle ne saurait être fixée au montant qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée : l'indemnisation sera donc moindre que ce qu'escomptait le client soit du procès soit de l'acte auquel l'avocat a contribué.
Les magistrats du tribunal de grande instance ou, en appel, ceux de la cour d'appel sont souverains pour apprécier la chance perdue dont le client de l'avocat demande réparation. En toute hypothèse, fut-elle faible, la chance perdue doit faire l'objet d'une évaluation (Cass. 1e civ. 16-1-2013 no 12-14.439 : RJDA 12/13 no 977).
Pour juger du caractère réel et sérieux de la chance perdue, les magistrats essaient, par exemple, de reconstituer la discussion en justice qui n'avait pas pu s'instaurer en raison d'une faute de procédure commise par l'avocat, ou de reconstituer les circonstances qui auraient dû être celles de la conclusion de l'acte si le client avait été correctement conseillé et informé par son avocat.
Il demeure que cette démarche en vue d'apprécier l'existence d'un droit à réparation, fondé sur la perte d'une chance, a un caractère quelque peu divinatoire, même si la Cour de cassation exerce un contrôle sur la reconstitution des faits et sur l'adéquation, au regard de la chance perdue, de la réparation qui a été allouée à la victime.
Bien que le préjudice du client de l'avocat soit souvent ramené à la perte d'une chance de triompher en justice, ou à celle de voir consacrer un droit ou d'en obtenir l'exécution, dans certains cas de figure, qui ne sont pas exceptionnels, le préjudice dont la réparation est accordée ne se réduit pas à une chance perdue : le préjudice est réparé à l'exacte mesure de la perte subie par la victime.
Il en est ainsi toutes les fois où l'avocat est tenu, par la loi ou par convention, de parvenir à un résultat précis, qui n'est soumis à aucun aléa.
Les hypothèses les plus fréquentes sont celles où l'avocat, qui avait pourtant été mandaté, omet de déclarer une créance de son client, ou omet de produire ou de se prévaloir d'une garantie dont bénéficiait son client, ou encore omet de contrôler l'existence d'une couverture financière, de sorte que le client a perdu les droits correspondants.
L'avocat, ou son assureur, doit alors indemniser la victime pour la valeur exacte des droits perdus.
Les avocats sont tenus de contracter assurance pour couvrir la responsabilité civile qui résulterait des « négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ». En pratique, cette obligation d'assurance est assumée par leur Ordre, qui répartit la charge correspondante entre les avocats.
Le maniement de fonds, d'effets ou de valeurs par les avocats pour leurs clients donne également lieu à assurance ou garantie contractée par l'ordre.
Enfin, lorsque les avocats remplissent les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, ou encore lorsqu'ils exécutent des « missions confiées par justice », ils doivent souscrire une assurance spéciale, contractée à titre individuel ou collectif.
La garantie de responsabilité des avocats personnes physiques ou des sociétés d'avocats est déclenchée par la réclamation (C. ass. art. L 124-5, al. 1). Cette réclamation peut intervenir dans les dix ans qui suivent la cessation volontaire d'activité de l'avocat ou son décès, ou encore qui suivent la dissolution de la société d'avocats à laquelle le client avait recouru.
SavoirLes fautes commises par les avocats à l'occasion de l'exercice d'activités qui n'entrent pas dans leurs fonctions, en particulier parce qu'il s'agit d'activités commerciales (intermédiation financière, apport d'affaires, courtage, entremise immobilière), ne sont pas couvertes par l'assurance « responsabilité civile professionnelle » qu'ils ont souscrite, ou que leur ordre a souscrite pour eux (voir par exemple, Cass. 1e civ. 15-3-2005 no 03-17.835 : Bull. civ. I no 129).
De même, la faute intentionnelle imputée à un avocat, très peu souvent retenue, n'est pas couverte par l'assurance professionnelle (Cass. 2e civ. 1-7-2010 no 09-14.884 : Bull. civ. II no 131).
L'expert-comptable et son client conviennent, par un contrat d'entreprise, que le premier doit fournir au second, qui le rémunère par versement d'honoraires, un ensemble de services correspondant aux compétences de l'expert-comptable qu'expose l'ordonnance du 19 septembre 1945 (Ord. 45-2138 art. 2), et que détaille une lettre de mission. En effet, les experts-comptables doivent passer avec leur client un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties (Décret 2012-432 du 30-3-2012 art. 151).
Le principe général de la responsabilité des experts-comptables est donc attaché aux travaux et activités professionnels (Ord. 45-2138 art. 12), tels que les définissent les dispositions légales et réglementaires, et que les précise la lettre de mission passée avec leur client.
La mission technique proprement dite consiste habituellement à réviser les comptes d'une entreprise cliente, ou seulement parfois à contrôler formellement les comptes établis en interne par l'entreprise cliente et à vérifier le processus comptable. La mission peut aussi comprendre des travaux comptables complémentaires ou des travaux annexes, telles des consultations ou études dans les domaines économique, financier et juridique, y compris sous forme de rédaction d'actes.
A la mission technique s'ajoute un devoir d'information et de conseil (Décret 2012-432 du 30-3-2012 art. 155).
Un expert-comptable ne peut donc prétendre s'en tenir à la simple exécution de la mission technique convenue avec son client. Il a un devoir général d'assistance et de conseil et une obligation générale d'investigation et d'alerte.
La responsabilité de l'expert-comptable est habituellement recherchée par un client soit en raison de la mauvaise exécution ou de l'inexécution des engagements liés à la prestation de services convenue soit, plus largement, pour méconnaissance du devoir général d'information et de conseil lui incombant.
Le fondement de la responsabilité est donc la relation contractuelle qui résulte de la lettre de mission que l'expert-comptable a présentée à la souscription de son client. La responsabilité de l'expert-comptable envers son client est alors dite « contractuelle » (C. civ. art. 1137 et C. civ.1147).
La question d'une éventuelle responsabilité dite « délictuelle » de l'expert-comptable se pose, en raison de l'incidence que la faute du professionnel peut avoir sur la situation de certains tiers non clients. En effet, des investisseurs, des créanciers, des associés ou actionnaires d'une société qui a conclu une lettre de mission avec un expert-comptable, n'hésitent plus à se prévaloir du préjudice que la mission comptable, prétendument mal conduite, leur aurait personnellement causé.
En outre lorsque, à titre accessoire de sa mission de révision des comptes, l'expert-comptable est rédacteur d'acte, il est tenu d'un devoir d'information et de conseil au profit de toutes les parties à l'acte, quand bien même il ne s'agirait pas de ses clients. A l'égard de ces tiers non clients un manque d'information ou un défaut de conseil engage la responsabilité délictuelle du rédacteur expert-comptable, comme de tout autre professionnel, avocat ou notaire, ayant participé à la rédaction de l'acte (C. civ. art. 1382 s.).
L'action en responsabilité exercée contre un expert-comptable exerçant à titre individuel, ou en société civile, ou encore en société d'exercice libéral, doit être portée devant le tribunal de grande instance, dès lors que l'intérêt financier du litige, c'est-à-dire le plus souvent le montant de l'indemnisation demandée, excède 10 000 €. Au-dessous de cette somme et jusqu'à 4 000 €, c'est au tribunal d'instance qu'il convient de s'adresser. Si le montant en jeu est inférieur à 4 000 €, le juge de proximité est compétent. Cette dernière juridiction doit toutefois être supprimée à compter du 1er janvier 2017 ; le tribunal d'instance sera alors seul compétent jusqu'à 10 000 €.
En revanche, lorsque les parties en litige sont commerçantes, ou ont une forme commerciale, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Il en résulte que le tribunal de commerce est seul compétent lorsque le demandeur en responsabilité est commerçant et lorsque l'expert-comptable défendeur est une société d'expertise comptable à forme commerciale.
De façon générale, la compétence territoriale revient à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve la résidence professionnelle de l'expert-comptable actionné en responsabilité (ou le siège de la société d'expertise comptable actionnée).
Les experts-comptables sont réunis en un ordre et placés, au sein d'une circonscription régionale, sous l'autorité professionnelle d'un conseil régional de l'ordre et de son président.
Le client ou le tiers qui s'estime victime d'un préjudice consécutif à des fautes qu'il attribue à l'exécution, par un expert-comptable, de sa mission professionnelle a la faculté, avant d'introduire une action en justice, de saisir le président du Conseil régional de l'ordre. La consultation de celui-ci, et son éventuelle intervention auprès de son confrère et de l'assureur de celui-ci peuvent permettre de régler la difficulté et d'éviter l'ouverture d'une procédure judiciaire, longue, coûteuse et aléatoire.
La méconnaissance des devoirs professionnels légaux ou jurisprudentiels, la mauvaise exécution ou l'inexécution des obligations contractuelles font naître la responsabilité des experts-comptables.
Ainsi, la simple mission dite de « présentation des comptes » inclut l'exécution de travaux déterminés par les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables. Selon ces normes, la mission comprend notamment l'examen des taux et modalités de récupération de la TVA pratiqués par le client (par exemple, une SCI), le rapprochement du chiffre d'affaires avec les déclarations de TVA, le contrôle de la TVA à récupérer et celui de l'IS, les « rapprochements bancaires » qui consistent à comparer, opération par opération, les mouvements de compte du client et ceux de sa banque.
Il en ressort que, même s'il n'est pas démontré qu'un cabinet d'expertise comptable avait pour mission d'établir lui-même toutes les déclarations fiscales, il avait l'obligation de procéder aux investigations et rapprochements nécessaires à sa mission de contrôle des comptes ; à défaut d'y avoir procédé avec soin, en se contentant, par exemple, de travailler sur de simples photocopies aisément falsifiables, l'expert-comptable engage sa responsabilité (Cass. com. 31-1-2012, no 11-12.194 : RJDA 4/12 no 415).
Néanmoins, au regard de la plupart des missions et prestations de services que doit effectuer un expert-comptable, la jurisprudence a posé le principe selon lequel l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de prudence et de diligence, de contrôle et de surveillance, dite aussi « obligation de moyens », qui est fonction des éléments que fournit le client (CA Paris 4-12-2007 no 06-14423 : RJDA 4/08 no 428).
Si la mission de l'expert-comptable comprend un « volet fiscal », il est rare que sa responsabilité soit dégagée : lorsque le préjudice subi par le client (redressement, taxation plus élevée) résulte d'une mauvaise option (option pour l'IS d'une SCI...), d'un conseil inapproprié, d'un manque d'information sur l'incidence fiscale d'une opération, l'expert-comptable est condamné à le réparer, éventuellement avec d'autres intervenants professionnels (Cass. 1e civ. 5-3-2009 no 08-11.374 : RJDA 6/09 no 511).
Les compétences personnelles des parties à un acte à l'élaboration duquel participe un expert-comptable, ou la présence d'un conseiller propre à l'une des parties, ne déchargent pas le professionnel de son devoir d'information et de conseil sur les incidences fiscales de l'acte : la responsabilité de l'expert-comptable demeure entière (Cass. 1e civ. 9-11-2004 no 02-12.415 : RJDA 8-9/05 no 929).
Quant au devoir général d'information et de conseil que prévoient les règles professionnelles, il consiste notamment à avertir le client en cas d'insuffisance ou d'irrégularités comptables, et à lui rappeler la nécessité d'une comptabilité régulière, probante, véritable, sincère ; à défaut de le faire, l'expert-comptable engage sa responsabilité (CA Paris 12-10-2001 no 99/17916 : BJS 2002 p. 42 § 5 note F. Pasqualini).
La faute réside ainsi dans le fait de ne pas avoir fait preuve de l'attention et des soins qu'un « bon expert-comptable, diligent et attentif » est censé apporter au respect des devoirs professionnels et à l'exécution d'obligations contractuelles similaires à celles qui ont été souscrites dans la lettre de mission. En pratique, c'est un expert judiciaire qui se référera à ce standard idéal du « bon professionnel » pour apprécier la qualité des travaux qu'il lui a été demandé d'expertiser, mais c'est le juge seul qui en déduira ou non l'existence d'une faute professionnelle.
Une demande en vue de la désignation d'un expert judiciaire est donc un préalable quasi obligatoire de l'action en responsabilité, ou le moyen d'étayer cette action.
Certaines des missions qui sont confiées aux experts-comptables excluent tout aléa et leur imposent l'exacte exécution de ce qui a été convenu avec leur client. Les obligations qui en découlent pour les professionnels ne sont plus « de moyens », mais « de résultat ». En cette hypothèse, la défaillance à l'obligation contractée, c'est-à-dire la faute professionnelle, se déduit de la simple absence du résultat convenu et attendu.
Il en est ainsi particulièrement pour les diverses missions déclaratives et de dépôt de documents qu'un expert-comptable accepte d'assumer au nom et pour le compte d'un client. La faute professionnelle résulte, en cette situation, de la seule démonstration d'un défaut d'établissement et de dépôt, dans les délais, de la déclaration ou du document, selon les modalités convenues entre les parties. Cette mission peut ressortir des factures établies par l'expert-comptable.
Il revient en ce cas à l'expert-comptable de faire le nécessaire pour obtenir en temps utile les pièces nécessaires à l'établissement des déclarations ou des documents promis. Dans l'hypothèse où ces pièces lui ont été refusées ou risquent de ne lui parvenir que tardivement, l'expert-comptable doit se démettre de sa mission. A défaut de s'être démis, il engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir d'une défaillance de son client (Cass. 1e civ. 17-12-1996, no 94-14.585 : Bull. civ. I no 455).
Il en est également ainsi d'une mission de rédaction d'actes ou de documents ayant un effet juridique, car l'expert-comptable, comme tout professionnel rédacteur d'actes, « est tenu envers son client d'en assurer toute l'efficacité et toute la portée » ; il doit informer et éclairer de manière complète toutes les parties à l'acte sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales, sur l'existence d'une surévaluation au préjudice de l'acheteur (Cass. com. 2-5-2007 no 05-21.295 : RJDA 4/08 no 420), sur le maintien d'engagements des cédants en qualité de cautions (Cass. com. 4-12-2012 no 11-27.454 : Dr. sociétés 2013 comm. 59 note R. Mortier).
A raison du devoir d'assurer la parfaite validité de l'acte, la faute du rédacteur résultera directement de la nullité de l'acte ou de son inefficacité. En revanche, l'expert-comptable rédacteur n'est pas garant de la bonne exécution de l'acte, ni garant de son opportunité économique.
Mais l'obligation générale de conseil qui incombe à l'expert-comptable peut étendre sa responsabilité au-delà de l'exécution de l'obligation de résultat convenue. Il a été jugé ainsi que, bien que sa mission n'ait pas porté sur la rédaction des contrats de travail, un expert-comptable qui avait accepté une « mission sociale » accessoire des travaux comptables, mission qui consistait à établir les bulletins de paie et à effectuer les déclarations aux organismes sociaux, était tenu d'une obligation de conseil quant à la conformité des contrats de travail aux dispositions légales et réglementaires (Cass. com. 17-3-2009 no 07-20.667 : BJS 2009 p. 682 § 136 note Th. Granier). L'expert-comptable est ainsi garant du respect par l'entreprise cliente des obligations conventionnelles de celle-ci ; à ce titre, il doit vérifier la convention collective applicable à l'entreprise et veiller à l'affiliation des salariés au régime complémentaire de prévoyance et retraite que prévoit la convention (CA Paris 24-2-2015 no 14/01994 : RJDA 6/15 no 417 ; à rapprocher de CA Paris 21-10-2014 no 13/11575 : RJDA 1/15 no 28 à propos du défaut d'affiliation d'un gérant de SARL à une caisse de retraite).
SavoirL'expert-comptable associé d'une société d'expertise comptable est personnellement responsable des travaux qui lui sont confiés (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 12). Il en résulte que le client d'une société d'expertise comptable a le choix : rechercher la responsabilité personnelle de son interlocuteur, expert-comptable associé, ou rechercher la responsabilité de la société pour laquelle il travaille, voire rechercher la responsabilité de l'un et de l'autre.
Pour prouver que l'expert-comptable n'a pas exécuté, ou a incorrectement exécuté ce à quoi il s'était engagé, il faut d'abord déterminer le contenu de ses obligations, qui ressort en principe des termes de la lettre de mission. Si la lettre de mission est imprécise, les magistrats apprécient volontiers à partir du montant des honoraires convenus l'étendue exacte des prestations dues. De même, la rédaction des factures établies par l'expert-comptable est un élément d'appréciation de la teneur des travaux qu'il dit avoir effectués.
Ainsi a-t-il été jugé qu'au regard de la faiblesse des honoraires perçus, un expert-comptable n'assumait aucune mission fiscale et n'avait pas à établir ni à déposer de déclarations au nom de son client, ni à l'informer ou le conseiller en ce domaine : on ne pouvait faire aucun grief à l'expert-comptable sur le fondement d'un défaut de dépôt de déclaration ou de conseil (CA Limoges 7-2-2013 no 12/00268 : BJS 2013 p. 399 note Th. Granier).
A l'inverse, il a été jugé que l'importance des honoraires, leur maintien et, a fortiori, leur augmentation démontrent l'existence d'une mission fiscale ou sociale complète (CA Paris 22-3-2011 no 08-12744 : RJDA 11/11 no 929).
Dans le cas général où l'expert-comptable n'est tenu que d'une « obligation de moyens », la preuve de sa défaillance dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ne se déduit pas de l'existence du préjudice dont le client fait état : la démonstration d'un dommage n'implique pas, à elle seule, l'existence d'une faute professionnelle.
Le client supporte la charge de prouver que l'expert-comptable n'a pas correctement exécuté sa mission, telle qu'elle résulte de la convention des parties et des devoirs de la profession.
Toutefois, si l'obligation contractée par l'expert-comptable était « de résultat », la simple absence d'obtention du résultat qui avait été convenu fait preuve de la faute commise par le professionnel.
Ainsi, de façon générale, il appartient à l'expert-comptable de vérifier la cohérence des résultats de l'entreprise cliente et de leurs principales composantes, au moins par sondage, afin de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes. Mais on ne saurait déduire de la révélation ultérieure de malversations imputables à un salarié que l'expert-comptable a nécessairement manqué à son obligation de contrôle. Il en serait de même si des contrôles fiscaux et sociaux ont conduit à des redressements au détriment du client : ces faits ne sont pas, à eux seuls, suffisamment probants de la réalité des négligences professionnelles alléguées par le client, qui doit étayer par d'autres éléments la faute qu'il impute au professionnel.
Néanmoins la preuve, par le client de l'expert-comptable, d'une insuffisance des diligences du professionnel peut être apportée par tous moyens, le plus souvent avec l'assistance d'un expert judiciaire dont le client a sollicité la désignation.
L'obligation de secret professionnel qui pèse sur l'expert-comptable (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 21) lui interdit de prodiguer information ou conseil, relatif à l'entreprise cliente, au profit de tiers, serait-ce au conjoint du client : l'épouse du client ne saurait faire grief à l'expert-comptable de ne lui avoir fourni aucune information sur le fonctionnement de l'entreprise dirigée par son mari (Cass. 2e civ. 11-7-2002 no 00-22.618).
En revanche, il ne saurait être reproché à un expert-comptable de fournir à un tiers des informations dues en vertu d'une disposition légale. Tel est le cas des informations comptables et documents dus à l'acquéreur d'un fonds de commerce : on ne saurait reprocher à l'expert-comptable du vendeur de les avoir fournis à l'acheteur du fonds. De même, comme le commissaire aux comptes, l'expert-comptable d'une entreprise est délié du secret professionnel au profit d'un ensemble d'instances et d'organismes.
SavoirL'expert-comptable est admis, en défense à une action en responsabilité, à apporter la démonstration de la réalité de ses diligences, y compris par la production de son dossier et de ses notes de travail, sans que l'on puisse lui faire reproche de méconnaître le devoir de secret professionnel (Cass. com. 22-2-2005 no 02-13.348 : RJDA 6/05 no 720).
A l'inverse, l'expert-comptable actionné en responsabilité ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour entraver la mise en oeuvre de mesures d'instruction ordonnées par le juge, telle une expertise judiciaire.
Les personnes qui s'estiment victimes des activités et travaux d'un expert-comptable ou d'une société d'expertise comptable disposent du délai de droit commun pour agir en responsabilité : quel que soit le cas de figure, tant côté demandeur que côté défendeur de l'action en responsabilité, le délai pour agir est de cinq ans (C. civ. art. 2224 ; C. com. art. L 110-4).
Le point de départ de ce délai de prescription se situe en principe au jour où la prestation de services litigieuse a été exécutée ou aurait dû l'être, c'est-à-dire au jour du fait dommageable, et encore seulement à partir du jour où le titulaire du droit à réparation « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » car, de façon générale, le délai de prescription ne court qu'à partir du moment où le créancier connaît les faits et a la possibilité d'agir (C. civ. art. 2234) ; néanmoins, la durée totale du délai ne peut excéder vingt ans, à partir du jour où le droit est né (C. civ. art. 2232).
Dans l'hypothèse où la mission contractuelle de l'expert-comptable a été cantonnée à la présentation des comptes annuels et à l'établissement de la liasse fiscale, il convient de prendre en considération les limites de la mission convenue entre les parties (Cass. com. 26-2-2013 no 11-28.397 : Dr. sociétés 2013 comm. 116 note R. Mortier).
Il faut aussi considérer les limites des techniques de sondages ou d'épreuves que l'expert-comptable est appelé à mettre en oeuvre dans l'exécution de sa mission car l'expert-comptable ne dispose pas des pouvoirs d'investigation qui sont reconnus à d'autres professionnels, tels les commissaires aux comptes. La responsabilité de l'expert-comptable s'en trouve allégée dès lors qu'une mise en oeuvre pourtant attentive des techniques de sa profession ne lui permettait pas de découvrir les détournements ou les fraudes commis par des salariés ou par des dirigeants de l'entreprise cliente (Cass. com. 3-6-2008 no 06-16.119 : RJDA 12/08 no 1281).
De même, bien que la jurisprudence ait mis à la charge de l'expert-comptable une « obligation générale d'investigation et d'alerte », il n'est pas tenu de procéder à un audit juridique des opérations enregistrées en comptabilité (Cass. com. 23-4-2003 no 00-21.698 : Dr. sociétés 2004 comm. 53 note F.G. Trébulle) ; mais il doit signaler toute anomalie comptable susceptible d'engendrer un préjudice distinct de celui résultant d'une mauvaise conjoncture économique.
De façon générale, le devoir d'information et de conseil trouve ses limites non seulement dans les techniques de sondages ou d'épreuves mises en oeuvre par le professionnel conformément à sa lettre de mission mais aussi dans l'état du droit positif et, notamment, dans l'état de la doctrine administrative du moment. Spécialement, on ne saurait exiger de l'expert-comptable qu'il anticipe sur l'interprétation des textes, qu'il anticipe un changement de doctrine fiscale ou sociale (Cass. com. 12-7-1993 no 91-17.592 : Bull. civ. IV no 298), ou qu'il prévoit un retour à une doctrine passée, une modification des dispositions légales ou de la jurisprudence.
De même, en cas de détournements imputables à des dirigeants ou à des salariés de l'entreprise cliente, l'expert-comptable est volontiers exempté de toute responsabilité dès lors que la lettre de mission, limitée à la présentation des comptes annuels, était seulement « adaptée à la découverte d'anomalies usuelles », et que les détournements sont apparus très « sophistiqués » (Cass. com. 3-11-2004 no 03-11.169 F-D : RJDA 4/05 no 405, 1e espèce).
SavoirUne décharge conventionnelle de responsabilité ne permettrait d'alléger la responsabilité de l'expert-comptable qu'à l'égard de l'entreprise cliente, et non à l'égard des tiers (investisseurs, repreneurs, créanciers de l'entreprise cliente), en raison de l'effet relatif des conventions. En outre, depuis longtemps, la jurisprudence écarte une telle décharge de responsabilité en cas de commission d'une faute « lourde » par le professionnel.
Le principe général est que la preuve d'une « faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute » (par exemple pour un expert-comptable en situation de conflit d'intérêts : Cass. com. 2-11-2011 no 09-72.404 : BJS 2012 p. 307 no 171 note Th. Granier), pas davantage l'existence d'un dommage n'implique nécessairement que sa survenance doive être imputée à la commission d'une faute par le professionnel.
Il n'est pas exceptionnel que le dommage résulte exclusivement de la faute commise par la victime elle-même (Cass. com. 23-10-2001 no 98-16.720 : BJS 2002 p. 44 note F. Pasqualini). La reconnaissance d'une faute que le juge pourrait imputer au seul client de l'expert-comptable sanctionnerait d'ailleurs la méconnaissance, par le client, du devoir de coopérer qui lui incombe, selon la Cour de cassation (Cass. com. 10-10-2013 no 11-22.188 : BJS 2014 p. 121 chron. J.-F. Barbièri).
On ne peut donc écarter la discussion sur l'existence du lien causal lorsque l'expert-comptable invoque l'absence de causalité entre la faute qui lui est reprochée dans la vérification de la comptabilité d'une société et les premiers détournements imputables à un salarié de celle-ci (Cass. com. 24-10-2000 no 98-10.702 : Bull. civ. IV no 160), ni lorsqu'il n'est pas avéré, en matière de rédaction d'actes, que le défaut d'information et de conseil imputé au professionnel rédacteur de l'acte est la cause déterminante du préjudice allégué par le client (voir par exemple, Cass. 1e civ. 19-12-2000 no 98-10.852 : Bull. civ. I no 328).
Mais s'il est avéré que la présentation fallacieuse des comptes d'une entreprise cliente, consécutive aux fautes de son expert-comptable, a induit en erreur les créanciers de cette entreprise, de sorte que les fautes du professionnel ont entraîné la poursuite de l'exploitation et l'accroissement final du passif, le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice subi par les créanciers est caractérisé (Cass. com. 23-3-2010 no 09-10.791 : BJS 2010 p. 480 § 96 note Ph. Merle).
L'analyse du lien causal pourrait aussi faire apparaître que plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage.
Ce pourrait être le cas lorsque le client n'a pas fourni à l'expert-comptable toutes les pièces nécessaires aux travaux comptables : le client participerait à son propre préjudice et ne saurait obtenir qu'une réparation partielle de ce préjudice.
Ce pourrait être également le cas lorsque la responsabilité de l'expert-comptable a concouru à produire le dommage avec celle d'autres professionnels, commissaires aux comptes, banquiers, voire avec celle d'autres intervenants, cédants ou entreprise cliente elle-même (Cass. com. 17-1-2012 no 10-28.668 F-D : Rev. sociétés 2013 p. 43 note Th. Granier).
SavoirUn concours de fautes imputées à des professionnels conduit, selon la jurisprudence dominante, au prononcé d'une condamnation des professionnels à réparer in solidum le dommage occasionné au demandeur, défalcation faite éventuellement de la faute commise par celui-ci sur le montant de la réparation. Chacun des professionnels fautifs est alors tenu pour le tout à réparer le préjudice occasionné à la victime. Par la suite, la charge de la réparation est répartie entre les différents professionnels fautifs selon les indications du juge.
La jurisprudence moderne tend à retenir que les défaillances professionnelles imputées à un expert-comptable ont seulement privé son client de la possibilité de remédier aux anomalies relevées, c'est-à-dire ont seulement fait perdre à la victime une chance d'éviter le préjudice dont elle demande réparation.
Ainsi, la réparation d'une simple perte de chance a été substituée à la réparation de la totalité de la perte subie, en l'occurrence celle d'un redressement fiscal qui avait été appliqué à un « montage » insuffisamment éclairé de conseils (Cass. 1e civ. 5-3-2009 no 08-11.374 : RJDA 6/09 no 511).
Cette « perte d'une chance » constitue donc un chef de préjudice distinct de celui dont la victime demande habituellement réparation. En conséquence, la victime n'obtiendra qu'une partie, souvent faible, des indemnités qu'elle a sollicitées.
En théorie, l'évaluation de la « chance perdue » ne saurait conduire à l'application d'un forfait : le juge devrait d'abord évaluer le montant total des préjudices subis par le client de l'expert-comptable avant de traduire les préjudices en perte de chance, par l'application d'un abattement ou par un calcul en pourcentage. Mais il est assez fréquent que l'évaluation relève de l'artifice (voir par exemple, TGI Paris 27-11-2012, 9e ch. : Bull. CNCC décembre 2012 no 168 p. 694 note Ph. Merle).
En outre, il est fréquent que le préjudice dont la victime demande réparation à un expert-comptable ne coïncide pas avec ce que le juge estime réparable, ce qui conduit soit à un rejet de la demande de réparation (par exemple, pour la mise en oeuvre d'une garantie : Cass. com. 10-12-2013 no 12-20.252 : RJDA 3/14 no 258), soit à une réparation qui ne porte que sur certains chefs, souvent faibles, de la demande (par exemple, pour la constitution d'une SARL par un artisan : CA Paris 6-5-2014 no 13/03388 : RJDA 8-9/14 no 705). Le demandeur a donc intérêt à cerner au plus près l'exact préjudice dont il sollicite la réparation par le professionnel.
En dépit de l'actuelle préférence pour la réparation de la seule « perte d'une chance », il n'est pas rare que, le plus souvent au titre de sa « mission fiscale », l'expert-comptable fautif soit condamné, seul ou avec d'autres intervenants, à réparer l'entier préjudice allégué par le client (paiement de l'impôt lui-même ou des majorations et pénalités appliquées).
D'ailleurs, lorsque l'expert-comptable est condamné à réparer le dommage avec d'autres personnes - réparation in solidum (un commissaire aux comptes, un banquier, le cédant du contrôle d'une entreprise) -, quelle que soit la répartition ultérieure de la charge de la réparation entre eux, il est assez habituel que soit réparé l'entier préjudice infligé à la victime.
Une solution semblable est retenue dans l'hypothèse de rédaction d'acte, en particulier de rédaction d'un acte de cession de contrôle à l'occasion duquel l'acquéreur aurait été victime d'une surévaluation de l'entreprise dont le contrôle a été cédé (Cass. com. 2-5-2007 no 05-21.295 644 : RJDA 4/08 no 420).
Il arrive aussi que la condamnation à réparer porte sur l'entier préjudice invoqué par le demandeur dans l'hypothèse de détournements commis par un salarié du client. Toutefois, en ce cas, le montant de la réparation est souvent atténué par la prise en compte d'une faute de la victime, qui a elle-même contribué à produire son dommage.
Les experts-comptables sont tenus de contracter assurance pour couvrir la responsabilité civile qui résulterait des « négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions » (Ord. 45-2138 du 19-9-1945 art. 17, al. 1 ; Décret 2012-432 du 30-3-2012 art. 134 à 140). Ils ont le choix entre une assurance individuelle et l'adhésion au « contrat-groupe » de la profession. Ils devront procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance dès qu'ils seront informés du simple risque de voir leur responsabilité professionnelle engagée.
En pratique, les problèmes de couverture ne sont pas rares, souvent en raison d'un plafonnement des risques couverts ou de la seule souscription des « conditions minimales » d'assurance, voire en raison d'une déclaration tardive du sinistre, ou d'une résiliation prématurée de la police (mais la « garantie subséquente », qui couvre les dommages issus de réclamations intervenues après résiliation du contrat mais qui trouvent leur origine dans la période de garantie, a été portée à dix ans au bénéfice des experts-comptables : C. ass. art. R 124-2).
De façon plus exceptionnelle, le problème de couverture pourrait naître de l'imputation à l'expert-comptable d'une faute intentionnelle, qui exclut la garantie (C. ass. art. L 113-1, al. 2). Tel devrait être le cas lorsque l'expert-comptable a été condamné pénalement en qualité de complice d'une présentation de comptes infidèles. Néanmoins, par souci de ne pas affecter le droit à réparation des victimes, les juges civils évitent autant que possible d'appliquer la qualification (voir par exemple : Cass. com. 30-10-2012 no 11-20.591 : RJDA 1/13 no 65).
Le transporteur a l'obligation d'assurer la sécurité de ses voyageurs, qu'il doit amener sains et saufs à destination (C. civ. art. 1147 ; Cass. civ. 21-11-1911). Il est tenu à une obligation de résultat (Cass. 1e civ. 13-3-2008 no 05-12.551 : Bull. civ. I no 76). Cette obligation de sécurité n'existe que pendant le transport proprement dit, qui commence à l'instant où le voyageur monte dans le véhicule et s'achève au moment où il en descend. Précisons que le temps de correspondance entre deux trains n'est pas considéré comme un temps de transport.
En cas d'accident pendant le transport ainsi défini, la victime n'a pas à prouver que la SNCF ou la RATP ont commis une faute : même si la cause de l'accident reste inconnue, le transporteur est responsable des blessures subies par ses voyageurs.
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 12 mai dernier, voyageant à bord du train no 7522 à destination d'Avignon, j'ai violemment percuté le siège placé devant moi après un arrêt brusque du train.
J'ai été blessé aux bras, au visage et aux jambes comme en témoigne le certificat médical ci-joint.
Du fait de la gravité de mes blessures, j'ai dû cesser mon activité professionnelle pendant trois mois. En vertu de l'article 1147 du Code civil, vous êtes responsable des dommages que j'ai subis.
Je vous demande de bien vouloir m'indiquer comment vous envisagez de réparer mon préjudice.
Oui, mais très difficilement. Le transporteur ne s'exonère pas en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Il n'échappe à sa responsabilité qu'en prouvant que le dommage est dû :
- à un cas de force majeure : tel est le cas, par exemple, si le train a déraillé à la suite d'un éboulement imprévisible sur les rails, mais pas du fait d'un sabotage pendant une grève ;
- à une faute de la victime ou d'un tiers, à condition que cette faute ait présenté les caractères de la force majeure. Si tel est le cas, le transporteur sera totalement exonéré ; sinon, il devra réparer l'intégralité du préjudice. Il n'y a pas de partage de responsabilité. Ainsi, la SNCF a été déclarée entièrement responsable de la chute mortelle d'un adolescent qui, après avoir ouvert la porte du train en marche, avait effectué des rotations autour de la barre d'appui au centre du marchepied ; l'ouverture des portes par les enfants empruntant le train était prévisible et il aurait suffi de mettre des agents de contrôle dans tout le train pour l'empêcher (Cass. mixte 28-11-2008 no 06-12.307 : Bull. mixte no 3). Même solution dans une espèce où un voyageur avait tenté de monter dans le train tandis que celui-ci avait commencé à rouler (Cass. 1e civ. 13-3-2008 no 05-12.551 : Bull. civ. I no 76). En revanche, l'agression commise par un voyageur devenu subitement fou furieux constitue un cas de force majeure pour la SNCF (Cass. 1e civ. 23-6-2011 no 10-15.811 : Bull. civ. I no 123).
Des règles différentes s'appliquent en cas d'accident de transport ferroviaire international : la SNCF est exonérée de sa responsabilité dès lors que la victime n'a pas eu un comportement conforme à la conduite normale d'un voyageur (Cass. 1e civ. 13-3-2008 no 05-11.800).
Le voyageur sans billet ne peut pas attaquer la SNCF ou la RATP pour mauvaise exécution du contrat de transport (qu'il n'a par hypothèse pas conclu).
La solution est la même pour le voyageur muni de billet qui s'est trompé de train : l'accident ne s'est pas produit dans l'exécution du contrat qu'il a conclu avec la SNCF (Cass. 1e civ. 1-12-2011 no 10-19.090 : Bull. civ. I no 209).
Mais le voyageur sans billet, tout comme le voyageur distrait, peut engager la responsabilité délictuelle du transporteur, en application des règles que l'on a vues au début de ce Dossier. Il devra donc soit prouver la faute de la SNCF ou de la RATP, soit attaquer le transporteur en tant que gardien de la chose qui a causé son dommage. Par exemple, la SNCF, en tant que gardienne du train, est partiellement responsable du décès d'un voyageur ayant forcé le système de sécurité des portes du train puis sauté sur les voies alors que le train était à pleine vitesse : pour la Cour de cassation un tel comportement n'est pas imprévisible. Il n'est donc pas constitutif d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité.
Le transporteur n'a aucune obligation particulière de sécurité envers ses voyageurs en dehors de la durée du transport proprement dit. Le voyageur qui est victime d'un accident avant de monter dans le train ou après en être descendu ne peut obtenir d'indemnisation que s'il engage la responsabilité délictuelle du transporteur. Les règles applicables sont alors celles que l'on a vues au début de ce Dossier. Le transporteur est par exemple responsable si, entraînée par la chute d'un autre utilisateur, une personne se blesse sur un escalator de la RATP qui est gardienne de l'escalier mécanique (Cass. 2e civ. 13-3-2003 no 01-12.356 : Bull. 2e civ. no 65).
La SNCF n'a aucune obligation en ce qui concerne les bagages et effets personnels des voyageurs ; ceux-ci doivent rester sous la surveillance de leurs propriétaires. S'ils sont volés, leur propriétaire ne pourra se faire indemniser qu'en engageant la responsabilité civile délictuelle du transporteur, c'est-à-dire en prouvant la faute de la SNCF (Cass. 1e civ. 10-7-1996 no 94-17.205 : Bull. civ. I no 307).
Dans les TGV, les bagages encombrants sont obligatoirement déposés à l'entrée de la rame et les voyageurs ne peuvent pas les surveiller constamment. De ce fait, certains tribunaux ont retenu la responsabilité de la SNCF en cas de vol ou de dommage aux bagages. D'autres, plus nombreux, estiment que, conformément au cahier des charges de la SNCF, cette dernière n'est pas responsable des bagages à main.
Dans une affaire où une passagère a été agressée, blessée et dépouillée de ses bijoux, il a été jugé que l'obligation de la SNCF de conduire sain et sauf un passager à destination n'était pas limitée à l'absence de blessure. Les dommages subis par ses vêtements et les objets qu'il porte sur lui ne peuvent être dissociés de ses autres préjudices. En n'affectant que deux contrôleurs à la surveillance du train, la SNCF a commis une faute et doit indemniser la victime de tous ses dommages : ses préjudices corporels, bien sûr, mais également ses dommages matériels résultant du vol de ses bijoux et des dégâts subis par ses vêtements (Cass. 2e civ. 3-7-2002 no 99-20.217 : Bull. civ. II no 183).
Si le voyageur a confié ses bagages au transporteur, ce dernier en est responsable. Cela dit, les contrats des transporteurs prévoient des plafonds de garantie : par exemple, dans le cadre de son service bagages à domicile, la SNCF plafonne l'indemnité à 500 € par bagage en cas de perte ou de détérioration.
La SNCF a une obligation de ponctualité. Cet impératif figure dans son cahier des charges.
En cas de retard, les compensations proposées par la SNCF diffèrent selon le train emprunté.
Les voyageurs des trains TGV, Intercités de jour, TGV Lyria et TGV France-Italie qui subissent un retard imputable à la SNCF d'au moins 30 minutes peuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire qui prend la forme de bons voyage ou du remboursement d'une partie du prix du billet. Pour les trains Intercités 100 % ECO, la compensation ne s'applique que pour les retards d'au moins une heure (Source : http://aide.voyages-sncf.com).
|
Durée du retard |
TGV, Intercités de jour, TGV Lyria, TGV France-Italie |
|---|---|
|
Entre 30 mn et 59 mn |
25 % du prix du billet en bons voyage (1) |
|
Entre 1 et 2 h |
25 % du prix du billet en bons voyage (1) |
|
ou | |
|
|
Remboursement de 25 % du prix du billet (2) |
|
Entre 2 et 3 h |
50 % du prix du billet en bons voyage (1) |
|
|
ou |
|
|
remboursement de 50 % du prix du billet (2) |
|
Plus de 3 h |
75 % du prix du billet en bons voyage (1) |
|
|
ou |
|
|
Remboursement de 75 % du prix du billet (2) |
|
(1) Les bons voyage sont valables un an pour tout achat d'un billet de train pour un parcours en France ou en Europe (hors TER et Transilien) en gare ou boutique SNCF. (2) Le remboursement n'est possible que si son montant est supérieur à 4 €. | |
Les modalités de compensation sont indiquées sur les enveloppes garantie ponctualité remises par les agents en gare. Lorsque le retard est de plus de deux heures, ces enveloppes sont distribuées à bord du train.
La demande de compensation, accompagnée du billet, peut également être adressée par courrier ordinaire à l'adresse suivante : Centre Régularité SNCF - SNCF BP 1203 - 14089 Caen cedex 6.
Pour vous aider, vous pouvez télécharger un formulaire de demande de compensation à l'adresse internet suivante : http://aide.voyages-sncf.com/files/aide/imce/formulairegarantieponctualite.PDF
Les billets iDTGV bénéficient seulement d'une compensation en bons voyage égale à 25 % du prix du billet pour tout retard de plus de 60 minutes et à 50 % si le retard dépasse 120 minutes. Les bons voyage sont envoyés par e-mail à l'adresse saisie lors de la commande du billet.
Les passagers de l'Eurostar (à destination de l'Angleterre) bénéficient :
- en cas de retard compris en 1 et 2 heures, d'un aller simple gratuit ou de 50 % sur un aller-retour ou d'un remboursement de 25 % du prix du billet ;
- en cas de retard compris en 2 et 5 heures, d'un aller-retour gratuit ou d'un remboursement de 50 % du prix du billet ;
- en cas de retard de plus de 5 heures, du remboursement du trajet retardé et d'un aller-retour gratuit.
Pour les Thalys (trains à destination de la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne), les retards d'au moins 30, 60 ou 120 minutes donnent lieu à une compensation en bons Thalys d'une valeur de 20, 50 ou 100 % du prix du billet ou, sur demande, à remboursement de 25 % du prix du billet à partir d'une heure et de 50 % à partir de 2 heures de retard. Pour obtenir votre compensation, vous pouvez compléter le formulaire sur thalys.com ou transmettre le formulaire qui vous est remis en gare ou à bord ou un courrier explicatif à l'adresse suivante : Service Clientèle Thalys, BP 14, B-1050 Bruxelles 5, Belgique. Pour les compensations en euros, joignez un relevé d'identité bancaire.
Aucune autre indemnisation n'est possible. Le voyageur ne pourra pas obtenir réparation du préjudice réellement subi du fait du retard du train (il a manqué sa correspondance ou un rendez-vous important, il a perdu une journée de vacances, etc.). En effet, la SNCF ne doit indemniser le voyageur que des conséquences prévisibles du retard lors de la vente du billet. Ainsi, dans une affaire où un avocat n'avait pas pu assister son client à la suite d'un important retard de train, la décision de la juridiction de proximité qui lui avait octroyé des dommages-intérêts pour perte d'honoraires, perte de crédibilité vis-à-vis de son client et pour réparation de l'inquiétude et l'énervement éprouvé a été cassée par la Cour de cassation : la SNCF ne connaissait pas le motif du voyage de l'avocat lorsqu'elle lui a vendu le billet (Cass. 1e civ. 26-9-2012 no 11-13.177).
Les hôteliers sont responsables des vols et dommages causés aux biens de leurs clients dans l'enceinte et le parking de l'hôtel (C. civ. art. 1952 s.).
Pour obtenir réparation, le client devra bien entendu démontrer l'existence et le montant du dommage qu'il a subi. Mais il n'a pas à prouver que l'hôtelier a commis une faute : la responsabilité de l'hôtelier est engagée quelle que soit l'origine du dommage.
En cas de vol, il faut bien sûr faire une déclaration de vol au commissariat (ou à la gendarmerie).
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Séjournant dans votre hôtel, j'ai constaté le 2 juillet dernier que ma caméra, mon ordinateur ainsi que mon téléphone portable avaient disparu de ma chambre.
Conformément aux articles 1952 s. du Code civil, vous êtes, en votre qualité de dépositaire, responsable du préjudice que j'ai subi.
Vous trouverez ci-joint des copies de ma déclaration de vol et des factures des objets disparus.
Je vous prie donc de bien vouloir m'indemniser de ce dommage dans les meilleurs délais.
La loi limite les dommages-intérêts dus par l'hôtelier à un maximum de :
- 100 fois le prix de journée de la chambre occupée par le client lorsque le vol ou le dommage s'est produit dans l'enceinte même de l'hôtel ou lorsque la voiture du client est volée dans le parking de l'hôtel, soit une indemnisation maximale de 10 000 € pour une chambre à 100 € ;
- 50 fois le prix de journée de la chambre occupée par le client en cas de vol dans la voiture d'un client garée sur le parking de l'hôtel ou en cas de dommage au véhicule, soit une indemnisation maximale de 5 000 € pour une chambre à 100 €.
Mais ces limitations de la responsabilité de l'hôtelier ne sont pas applicables et le client a droit à une réparation intégrale s'il démontre que :
- son préjudice est dû à une faute de l'hôtelier ou de l'un de ses employés. Tel est le cas par exemple lorsqu'un établissement haut de gamme met à la disposition de ses clients un coffre non sécurisé ;
- les objets volés avaient été remis à l'hôtelier pour qu'ils soient placés dans le coffre de l'hôtel.
Non, sauf s'il démontre que le dommage est dû à la force majeure, ce qui est très difficile en pratique. Il a même été jugé qu'un vol à main armée n'exonérait pas l'hôtelier (il est vrai qu'en l'espèce le veilleur de nuit de l'hôtel avait imprudemment ouvert la porte aux malfaiteurs). Précisons que n'ont aucune valeur les panonceaux indiquant que l'hôtel n'est pas responsable des vols et des dommages subis par les clients.
Lorsque le client demande une réparation excédant les plafonds indiqués ci-avant, les tribunaux retiennent parfois la faute de la victime pour prononcer un partage de responsabilité. Par exemple, l'hôtelier qui s'engage à avoir un parking surveillé commet une faute en n'assurant pas correctement la surveillance de ce parking, mais le client qui laisse des objets de valeur dans sa voiture sans en prévenir la direction de l'hôtel commet aussi une faute. Sa négligence le rend responsable de la moitié de son dommage.
Si le restaurateur n'a pas l'obligation de combler vos papilles, il a au moins celle de vous amener sain et sauf au terme de votre repas. A défaut, il s'expose à se voir réclamer des dommages-intérêts. Ont par exemple été condamnés des restaurateurs qui avaient servi :
- des aliments avariés ;
- des épinards sur lesquels une cliente s'était cassé plusieurs dents ;
- une carafe de soude caustique à la place d'une carafe de vin.
Engage sa responsabilité le restaurateur qui continue à servir des boissons alcoolisées à une personne ivre. Par exemple, après le décès d'un de ses clients suite à son alcoolisation aiguë, un restaurateur a été condamné à verser des dommages-intérêts aux parents et à la soeur de la victime (Cass. 1e civ. 20-6-2002 no 99-19.782).
Le restaurateur doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éviter qu'il arrive un accident à l'un de ses clients. Par exemple, le restaurateur est responsable si :
- son chien mord un client ;
- un client tombe dans une trappe laissée ouverte alors qu'il n'existait aucune signalétique indiquant cette embûche inattendue ;
- un serveur renverse un plat sur un client.
Le restaurateur devra dédommager le client : frais de nettoyage ou de remplacement des vêtements abîmés, réparation du dommage corporel, etc.
Le restaurateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il prouve que l'accident est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ou d'un tiers (personne qui se lève brutalement et bouscule le serveur).
Sauf exception, les dommages causés à un client par un autre client ou par une personne extérieure à l'établissement n'obligent pas le restaurateur à réparer le préjudice.
Les tribunaux retiennent la responsabilité du restaurateur si un vol a été commis dans un vestiaire surveillé par un employé du restaurant.
En revanche, le dépôt d'un manteau sur un portemanteau non surveillé, au-dessus duquel il est indiqué que le restaurant décline toute responsabilité en cas de vol, se fait aux risques et périls du client (Cass. 1e civ. 1-3-1988 no 86-15.563 : Bull. civ I no 57).
Lorsque vous déposez des vêtements chez le teinturier, ce dernier doit les inspecter et mentionner sur le bon qu'il vous remet les éventuelles réserves sur la qualité des articles déposés (trou dans une jupe, tache peut-être indélébile, etc.).
En l'absence de réserves, la responsabilité du teinturier pourra être engagée s'il vous rend un vêtement endommagé.
Pour obtenir réparation, vous devez adresser une réclamation au teinturier.
Si le teinturier prouve qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son travail, il sera exonéré de toute responsabilité (C. civ. art. 1789 ; Cass. 1e civ. 20-12-1993 : Bull. civ. I no 376). Par exemple, les dégradations dues à un vice dans le tissu ne peuvent pas donner lieu à réparation. En revanche, si le teinturier a fait bouillir votre pull en laine, il engage sa responsabilité.
Si le teinturier perd un vêtement déposé, il doit le rembourser à son client. Le dédommagement correspond, le plus souvent, à la valeur d'achat de l'article remis, diminuée d'un coefficient de vétusté (plus le vêtement est ancien, moins le client est indemnisé).
Les teinturiers doivent afficher les conditions de leur responsabilité et de l'indemnisation des clients en cas de perte, vol ou détérioration des vêtements qui leur sont remis (Arrêté du 27-3-1987 : JO 20-10 p. 12238). Ces conditions s'imposent aux clients sauf si :
- elles ne sont pas directement visibles par le client (par exemple, l'affiche est placée dans l'arrière-boutique) ;
- elles sont abusives (par exemple, le teinturier décline toute responsabilité) ;
- le teinturier a volontairement abîmé le vêtement ;
- le dommage n'a pu se produire qu'en raison d'une faute particulièrement grave du teinturier (faute dite lourde, par exemple laver de la laine à 90 degrés).
A adresser de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 4 août dernier, je vous ai donné à nettoyer un costume et une robe. Vous avez été dans l'incapacité de me restituer le costume et m'avez rendu la robe avec des taches qui n'existaient pas au moment où je vous l'ai remise.
Vous trouverez ci-joint copie des tickets de dépôt.
Conformément à l'article 1789 du Code civil, vous êtes responsable des dommages subis. En conséquence, je vous demande de m'indemniser de mon préjudice évalué à 800 €.
Le Code des postes et des communications électroniques prévoit une indemnisation plutôt faible en cas de perte, de retard ou de dégradation d'un courrier ou d'un colis affranchi au tarif normal. Si votre envoi a de la valeur, il est préférable de l'assurer en l'envoyant en recommandé (assurance forfaitaire), en valeur déclarée ou en souscrivant une assurance dite « ad valorem ». En cas de problème, vous bénéficierez d'un meilleur dédommagement.
Si vous avez souscrit une assurance forfaitaire, La Poste vous versera le montant de l'assurance souscrite même si votre préjudice est moindre. Si vous avez souscrit une assurance ad valorem, vous serez indemnisé, dans la limite du montant de l'assurance souscrit, en fonction de la valeur réelle de l'objet perdu ou endommagé.
Pour un retard de distribution, l'indemnisation est limitée au montant du tarif d'affranchissement (CPCE art. L 8 et CPCER 2-4).
En cas de perte (envoi non distribué plus de 40 jours après son dépôt à La Poste) ou d'avarie, les dédommagements dus sont égaux à 2 fois le tarif d'affranchissement pour les courriers ordinaires (soit 1,52 € pour une lettre prioritaire affranchie avec un timbre rouge ou 1,36 € pour une lettre verte de moins de 20 g au 1er janvier 2015) ou à 3 fois le prix de l'affranchissement pour les courriers suivis.
Pour un colis, l'indemnisation est un peu plus généreuse. Ainsi pour un Colissimo, l'indemnité forfaitaire est fixée à 23 € par kilo (tarif au 1er mars 2015).
La souscription d'une assurance ad valorem ou l'envoi en recommandé ne modifient pas l'indemnisation en cas de retard de distribution, qui reste limitée au montant du tarif d'affranchissement.
Seules les pertes et les avaries bénéficient d'un traitement « privilégié ».
Pour les courriers recommandés, vous recevrez une indemnité forfaitaire de 16 € en cas d'envoi au tarif R1, de 153 € pour un courrier au tarif R2 ou de 458 € pour un courrier au tarif R3.
Pour un Colissimo recommandé, l'indemnisation forfaitaire variera de 50 € à 800 € en fonction du taux de recommandation choisi (50 € pour un R1, 200 € pour un R2, 400 € pour un R3, 600 € pour un R4 et 800 € pour un R5). Si cela vous est plus favorable, vous pourrez demander à vous faire indemniser sur la base de 23 € par kilo.
Afin d'assurer mieux vos colis, vous pouvez également souscrire une assurance ad valorem. En cas de perte ou de détérioration, vous percevrez une indemnisation plafonnée à 500, 1 000 ou 1 500 €, selon le nombre de vignettes achetées.
ConseilPour vos plis les plus importants, pensez à l'envoi en valeur déclarée. L'objet, d'un poids maximal de 5 kg, est inséré dans un emballage sécurisé spécifique. En cas de perte ou de détérioration, vous percevrez une indemnité égale à la valeur annoncée lors du dépôt dans la limite de 5 000 €.
Il est interdit d'insérer dans un envoi en valeur déclarée des billets ou des pièces. L'or, l'argent et les autres métaux précieux ne peuvent être transportés que sous la forme de bijoux. Les pierres précieuses sont autorisées ainsi que, notamment, les bijoux cassés et les pièces de collection.
Sauf geste commercial de La Poste, vous ne pourrez pas obtenir plus que les indemnités décrites ci-dessus même si votre préjudice est plus important. Ces indemnisations constituent en effet des plafonds de responsabilité. Une seule exception, la faute lourde du service postal. Dans ce cas, La Poste doit réparer l'intégralité du préjudice que vous avez subi.
La faute lourde peut être définie comme une négligence d'une particulière gravité. Il y a faute lourde, par exemple, lorsque des plis sont volés dans la zone de fret de La Poste (Cass. com. 7-9-2010 no 09-66.477). Mais Chronopost ne commet pas une faute lourde en ne respectant pas les délais d'acheminement auxquels il s'était engagé (Cass. com. 13-6-2006 no 05-12.619).
En cas de préjudice, vous devez, directement ou par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, formuler une réclamation soit à un guichet de La Poste, soit par courrier (Service consommateurs, 99999 La Poste ; un formulaire papier et une enveloppe à affranchissement prépayé sont disponibles dans les bureaux de Poste), soit sur le site internet www.laposte.fr à la rubrique « Service consommateurs », sous-rubrique « Déposer une réclamation ».
Le dépôt d'une réclamation donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception attestant la date de la demande. Cet accusé de réception vous sera utile si vous devez faire appel au médiateur de La Poste.
Vous devez apporter la preuve de l'envoi et du montant de l'affranchissement. Pour un courrier ordinaire, cette preuve est quasiment impossible à apporter...
Si vous avez souscrit une assurance ad valorem, vous devez également fournir une facture attestant la valeur de l'objet perdu ou endommagé.
Sauf nécessité d'une enquête approfondie, La Poste s'est engagée à apporter une réponse à toute réclamation dans un délai de 30 jours pour les envois métropolitains.
En cas de retard, l'indemnisation est limitée au prix du transport, droits, taxes et frais divers exclus.
En cas de perte (courrier non distribué plus de 30 jours après son dépôt à La Poste, dans un « Chrono relais » ou dans une agence Chronopost) ou de détérioration, vous percevrez une indemnité égale à la valeur de l'objet dans la limite de 250 €. Toutefois pour un « Chrono 18 », un « Chrono classique » ou un « Chrono Relais Europe », la limite est portée à 23 € par kilo sans que l'indemnisation ne puisse excéder 690 €. Vous percevrez un dédommagement plafonné à 5 000 € si vous avez souscrit une assurance ad valorem. En cas de faute lourde de Chronopost, vous serez indemnisé de la totalité de votre préjudice.
Les réclamations doivent être adressées au « Service Clients » dont les coordonnées figurent sur le bordereau de transport, au plus tard 21 jours après la livraison ou, dans le cas de perte d'un envoi, dans un délai d'un 1 an à compter de la date de livraison prévue. Vous devez joindre tous les justificatifs attestant de votre préjudice.
En cas de détérioration de l'objet, le destinataire doit porter des réserves détaillées sur le bordereau de livraison. A défaut, il vous faudra apporter la preuve que le dommage a eu lieu pendant le transport.
La Poste n'est pas responsable en cas de non-respect par le client des conditions générales de vente concernant notamment l'affranchissement, la constitution des colis, la nature des objets envoyés, l'adressage. Elle est également exonérée en cas de force majeure : inondation, incendie, etc. Dans ces hypothèses, le client ne perçoit aucune indemnité.
Si la réponse de La Poste ne vous satisfait pas (elle considère qu'elle n'est pas responsable, vous estimez qu'elle a commis une faute lourde) ou si vous n'avez pas reçu de réponse deux mois après le dépôt de votre réclamation, vous pouvez saisir le médiateur de La Poste soit en écrivant à Monsieur le Médiateur du groupe La Poste - Case postale F 407 - 44 boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15, soit en saisissant votre demande sur le site internet www.laposte.fr/mediateurdugroupe. En toutes hypothèses, vous devrez adresser les pièces justifiant votre réclamation par courrier (preuve de l'envoi, facture, accusé de réception de votre réclamation à La Poste, réponse éventuelle de cette dernière, etc.).
Avant de saisir le médiateur, vous devez avoir déposé une réclamation auprès de La Poste. A défaut, le médiateur se déclare incompétent. Il en sera de même si vous avez déjà saisi les tribunaux.
Le recours au médiateur est gratuit.
Dans la grande majorité des cas, le médiateur rend son avis dans un délai de deux mois.
Il ne faut pas attendre de miracle de la médiation (les propositions d'indemnisation correspondent rarement au préjudice subi par l'expéditeur), mais le médiateur pourra conseiller à La Poste de faire un geste commercial. Par exemple, 100 € en remboursement des frais de déplacement supportés par un couple pour aller récupérer en urgence des passeports acheminés par erreur à Metz au lieu de Besançon ; la moitié de la valeur de l'envoi pour un client dont le chien a déchiqueté le colis, le facteur ayant déposé le paquet devant la maison au lieu de laisser un avis de passage alors qu'il savait le chien présent sur la propriété.
Si le médiateur considère que La Poste a commis une négligence particulière, il peut préconiser l'indemnisation totale du client. Tel a été le cas pour une cliente dont les chèques-cadeaux adressés en paiement d'une commande - et jamais arrivés - avaient, selon l'enquête de gendarmerie, été volés. Même préconisation pour un client dont le colis avait été déposé par le facteur à l'arrière de la maison mais qui avait ensuite disparu.
Si l'indemnisation proposée par La Poste ou par le médiateur ne vous convient pas, vous pouvez saisir les tribunaux. Mais rappelons-le, c'est uniquement en cas de faute lourde de La Poste que les juges octroient la réparation intégrale du préjudice subi par le client.
La saisie du tribunal doit être faite dans un délai d'un an à compter de l'envoi de votre courrier ou de votre colis (six mois pour un envoi à l'étranger).
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre