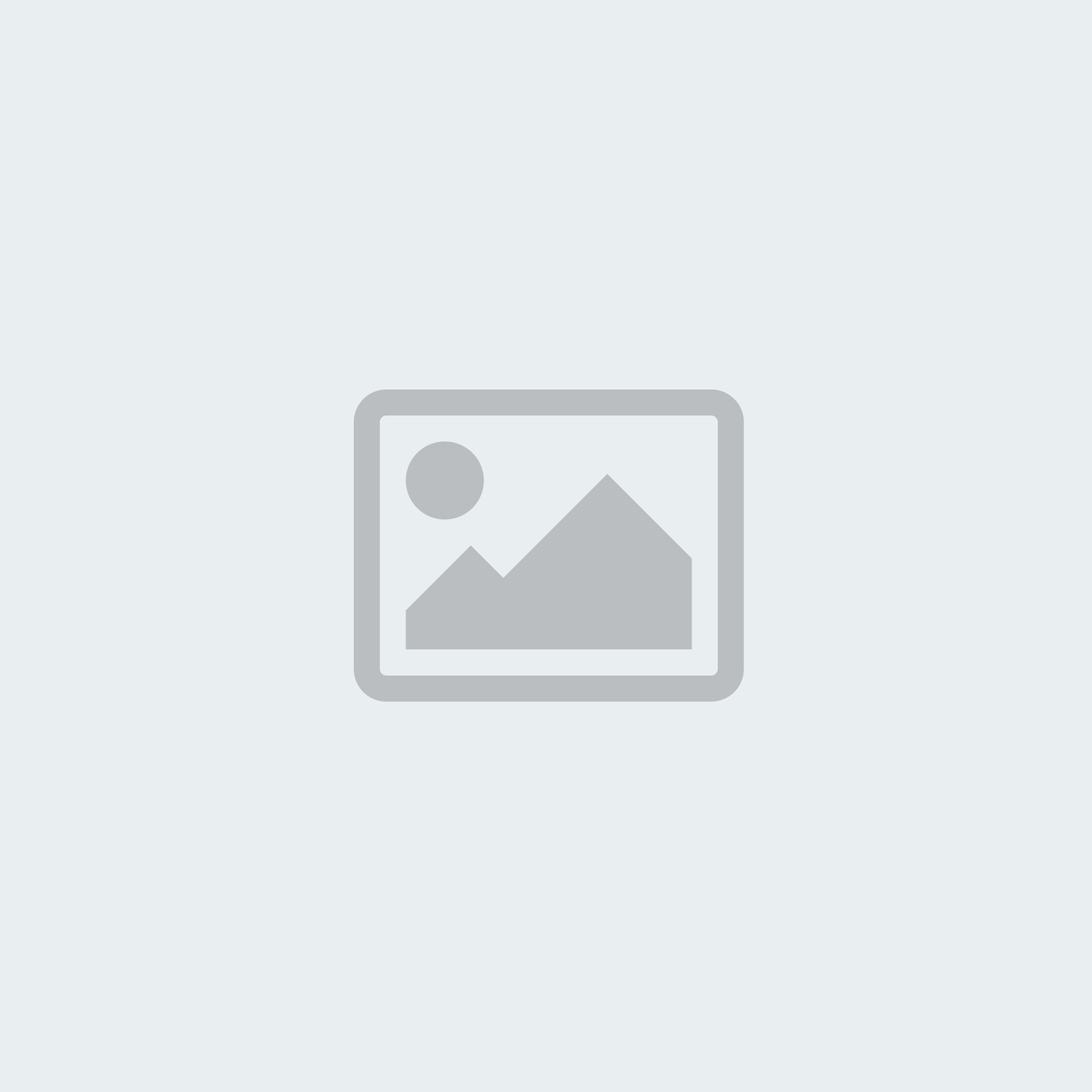Le conjoint survivant bénéficie d'un régime de faveur en matière successorale :
- il hérite dans toutes les configurations familiales, avec des droits non négligeables puisqu'il reçoit au minimum un quart de la succession de son conjoint. Si le défunt ne laisse pas de descendance, il a même la qualité d'héritier réservataire, ce qui interdit à son conjoint de le déshériter complètement ;
- il dispose de droits particuliers sur son logement, qui lui permettent de rester dans les lieux et donc de conserver son cadre de vie.
Pour bénéficier de ces droits, le conjoint n'a aucune condition particulière à remplir ; il lui suffit de ne pas être divorcé au jour de son veuvage.
|
Prestations |
Droits du conjoint survivant |
Se reporter au no |
|---|---|---|
|
Capitaux décès |
Si la personne décédée était salariée ou, dans certaines conditions, ex-salariée : capital décès de la sécurité sociale, complété le cas échéant par un second capital versé par le régime de prévoyance de l'entreprise. | |
|
|
Si la personne décédée était au chômage ou préretraitée : allocation décès (sous forme de capital). | |
|
|
Si la personne décédée exerçait une profession non salariée (industrielle, commerçante ou libérale) : capital décès. | |
|
Rentes et pensions |
Si la personne décédée exerçait une activité professionnelle, salariée ou non, ou était retraitée : versement au conjoint survivant, sous certaines conditions, d'une allocation veuvage ou de pensions de réversion. | |
|
|
Si la personne décédée était salariée et que son décès a été causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle : versement d'une rente. | |
|
Prestations familiales |
Si le conjoint survivant a au moins un enfant à charge : allocation de soutien familial + (sous condition de ressources) montant majoré du RSA. Il a aussi droit aux autres prestations familiales dans les conditions de droit commun. | |
|
Remboursement des frais médicaux (maladie ou maternité) |
Le conjoint ayant droit d'un assuré décédé a droit au maintien temporaire gratuit des droits puis peut bénéficier de la CMU. S'il a ou a eu au moins trois enfants à charge, ses droits sont maintenus sans limitation de durée. |
Le conjoint survivant dispose de deux droits successifs destinés à lui assurer la jouissance de son logement :
- il a d'abord le droit de rester gratuitement dans les lieux pendant un an ;
- il peut ensuite bénéficier jusqu'à sa mort d'un droit d'habitation assorti d'un droit d'usage sur le mobilier du logement.
Le conjoint survivant est également privilégié dans l'accès à la propriété de son logement. S'il se trouve en indivision avec d'autres héritiers, il a priorité pour se faire attribuer la propriété du logement et de son mobilier au moment du partage de la succession.
Le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite de son logement et du mobilier du logement pendant les 12 mois qui suivent le décès (C. civ. art. 763) : il peut rester chez lui, les frais liés à son occupation étant à la charge de la succession. Ce droit est d'ordre public, ce qui signifie que le conjoint ne peut pas en être privé, même par testament du défunt. Il est également d'application automatique : le conjoint n'a pas à demander l'autorisation de rester dans les lieux.
Le logement protégé est celui qui constituait la résidence principale du conjoint à l'époque où il est devenu veuf. Trois observations :
- le droit du conjoint n'est pas subordonné à la condition que les époux aient vécu ensemble. S'ils vivaient séparément, le survivant a droit à la jouissance de sa propre résidence principale, même s'il y vivait en concubinage à l'époque du décès ;
- le conjoint ne perd pas son droit s'il se remarie dans les 12 mois du décès ;
- le droit est limité à la résidence principale. La résidence secondaire n'est pas protégée, même à titre subsidiaire. Le conjoint ne peut pas obtenir la jouissance gratuite de sa résidence secondaire en remplacement de ses droits sur son habitation. De la même façon, il ne peut pas revendiquer un droit de jouissance sur le studio relevant de la même copropriété que son habitation principale, mais indépendant et non attenant à celle-ci (Cass. 1e civ. 25-9-2013 no 12-21.569 : Bull. civ. I no 191).
Le droit temporaire reconnu au conjoint sur son logement est un effet direct du mariage et non un droit successoral. Il en résulte les conséquences suivantes :
- le conjoint bénéficie du droit temporaire même s'il renonce à la succession ;
- le fait pour le conjoint de se prévaloir du droit temporaire n'emporte pas acceptation tacite de la succession ;
- la valeur du droit ne s'impute pas sur la part d'héritage du conjoint.
Le droit temporaire au logement s'applique, que le bail ait été conclu au nom de l'un ou l'autre des époux ou des deux.
Le conjoint doit payer les loyers, mais ceux-ci lui sont intégralement remboursés par la succession au fur et à mesure de leur paiement. En pratique, le remboursement est effectué par le notaire chargé du règlement de la succession, qui prélève sur celle-ci les liquidités nécessaires au vu des quittances établies par le propriétaire.
A notre avis, le conjoint ne peut se faire rembourser que le loyer proprement dit, à l'exclusion des charges de l'immeuble. Le remboursement de la taxe d'habitation semble également exclu.
Le conjoint a droit pendant un an non seulement à la jouissance gratuite de son habitation, mais aussi à la jouissance gratuite du mobilier de ce logement. Ces droits sont applicables lorsque :
- le logement était la propriété exclusive du défunt ;
- le logement était la propriété des deux époux : bien commun ou encore bien indivis entre les époux, sans distinguer selon les quotités possédées par l'un et par l'autre.
Dans les deux cas, le conjoint peut rester dans les lieux. Il ne doit aucune indemnité aux autres héritiers, ni pour l'occupation du logement, ni pour la jouissance du mobilier.
Le droit temporaire s'applique également lorsque le logement était en indivision entre le défunt et une tierce personne (par exemple, le logement appartenait pour un tiers au défunt et pour deux tiers à ses frères, ou pour moitié aux époux et pour moitié à leurs enfants). Le conjoint peut rester dans les lieux pendant un an et l'indemnité d'occupation qu'il doit verser au tiers lui est intégralement remboursée par la succession, au fur et à mesure de son paiement.
Le droit temporaire ne s'applique pas lorsque :
- le défunt était seulement usufruitier du logement : l'usufruit prenant fin au décès de son titulaire, le logement ne se retrouve pas dans sa succession ;
- le logement est la propriété d'une société civile (ou autre société). Il en est ainsi à notre avis même si les époux étaient les deux seuls associés de la société.
Le conjoint n'est pas imposable sur la valeur de son droit temporaire. Il en va ainsi :
- en matière de droits de succession, dont le conjoint survivant est totalement exonéré (CGI art. 796-0 bis). En tout état de cause, le droit temporaire n'est pas un droit de nature successorale ;
- et en matière d'ISF, faute d'assiette. Le droit temporaire est dépourvu de valeur patrimoniale en raison de son caractère incessible et intransmissible (BOI-PAT-ISF-30-50-10 no 100).
Passé le délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier sa vie durant d'un droit d'habitation sur son logement et d'un droit d'usage sur le mobilier de ce logement (C. civ. art. 764 à C. civ.766).
Ces droits viagers du conjoint sur sa résidence principale ont le même champ d'application que le droit temporaire d'un an dont ils prennent la suite, sous deux réserves :
- si le logement était en indivision entre l'époux défunt et un tiers, le conjoint survivant ne peut pas prétendre au maintien dans les lieux passé le délai d'un an ;
- si le logement était loué par les époux, le survivant ne bénéficie que d'un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession et garnissant le logement. Ceci dit, à raison des règles en matière de bail d'habitation, les époux sont en principe cotitulaires du bail qui assure leur logement (C. civ. art. 1751) ; à défaut, notamment s'ils ne vivaient pas ensemble, le survivant bénéficie du transfert du bail à son profit s'il en fait la demande (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 14).
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur celle des droits successoraux que recueille le conjoint et vient donc en diminution de sa part d'héritage. Cependant, le conjoint n'a pas à indemniser la succession si la valeur des droits d'habitation et d'usage excède sa part de succession.
SavoirLe droit d'habitation donne au conjoint survivant la possibilité de rester dans les lieux, mais non d'y rester gratuitement. Le conjoint doit acquitter les réparations d'entretien et les charges afférentes à l'immeuble, ainsi bien sûr que la taxe d'habitation (en tant qu'occupant). S'il est redevable de l'ISF, il est également imposable sur la valeur - en pleine propriété - du logement (après application de l'abattement de 30 % tant que le logement constitue sa résidence principale) et du mobilier.
Pour protéger leur droit de propriété, les héritiers peuvent demander au conjoint de faire un état de l'immeuble et un inventaire des meubles qui y sont situés.
Les droits d'habitation et d'usage ne sont ni d'application automatique, ni d'ordre public. Le conjoint n'en bénéficie que s'il en fait la demande et à la condition de ne pas en avoir été privé par le défunt.
La demande du conjoint doit être faite dans un délai d'un an à compter du veuvage, c'est-à-dire pendant l'année au cours de laquelle il bénéficie de la jouissance gratuite du logement. Aucune condition particulière de forme n'est prévue ; en pratique, l'acte notarié doit être privilégié : il conserve la preuve de la demande et fait foi de sa date.
Ajoutons que le conjoint n'a de véritable intérêt à effectuer cette demande que s'il hérite du quart, de la moitié ou des trois quarts de la succession en pleine propriété. S'il hérite de toute la succession en usufruit, il n'a pas besoin du droit d'habitation pour conserver la jouissance de son logement, puisque l'usufruit lui assure des droits plus étendus. S'il hérite de toute la succession en pleine propriété, la demande est sans objet.
Le conjoint peut être privé par le défunt de ses droits d'habitation sur le logement et/ou d'usage sur le mobilier. Mais c'est en pratique assez rare :
- ce n'est possible que par testament notarié. Un testament olographe (c'est-à-dire écrit en entier, date et signé de la main de son auteur) est inefficace, même s'il déshérite par ailleurs totalement le conjoint ;
- si le conjoint recueille la totalité de la succession en usufruit, que ce soit par l'effet de la loi (en présence uniquement d'enfants communs) ou d'une donation au dernier vivant, la clause du testament le privant de ses droits sur son logement est par elle-même sans effet. Pour être efficace, la privation de droits doit s'accompagner du legs du logement à une tierce personne (un enfant, par exemple).
Tant qu'il continue à vivre dans le logement, le veuf ou la veuve conserve le bénéfice des droits d'habitation et d'usage, même s'il se remarie.
Il ne peut en principe ni les céder ni les louer. Cependant, il peut donner le bien en location à usage d'habitation ou à usage professionnel pour se procurer les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement si le logement n'est plus adapté à ses besoins : nécessité de trouver un logement plus fonctionnel, de se rapprocher de ses enfants, etc. Le conjoint est à notre avis seul maître à bord pour définir ses besoins.
Le conjoint et les autres héritiers du défunt peuvent passer une convention pour convertir en rente viagère ou en capital les droits d'habitation et d'usage. S'il y a un enfant mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, la convention doit être autorisée par le juge.
Le conjoint a priorité pour devenir propriétaire de son logement.
Si le conjoint hérite d'une quotité en pleine propriété (par exemple, un quart de la succession) et se retrouve de ce fait en indivision avec d'autres héritiers du défunt, il peut demander au juge de lui attribuer lors du partage :
- son logement dès lors qu'il constituait déjà sa résidence à l'époque où il est devenu veuf ;
- les meubles qu'il contient ;
- le véhicule du conjoint s'il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante, par exemple pour pouvoir rester dans son logement.
L'attribution préférentielle de la propriété du logement, de son mobilier et du véhicule est de droit pour le conjoint (C. civ. art. 831-3).
Si le conjoint attributaire du logement doit payer une soulte aux autres héritiers (parce que sa part dans la succession est inférieure à la valeur du logement), il bénéficie à concurrence de la moitié de cette soulte de délais de paiement spéciaux (jusqu'à 10 ans). Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal (4,29 % pour le second semestre 2015).
Le conjoint survivant hérite toujours, même s'il n'a pas été fait de donation au dernier vivant ou de testament à son profit. L'étendue de ses droits dépend des héritiers avec lesquels il vient en concours à la succession :
- en présence d'enfants du défunt, il hérite de la totalité de la succession en usufruit ou du quart de la succession en pleine propriété ;
- si le défunt ne laisse pas de descendance, il hérite de la moitié, des trois quarts ou de la totalité de la succession en pleine propriété.
Ces droits sont présentés dans le tableau ci-après.
Ajoutons que le conjoint survivant qui serait dans le besoin dispose d'une créance alimentaire contre la succession. Mais cette protection, qui prend la forme d'un droit à pension, est largement illusoire : si le conjoint se retrouve démuni, c'est le plus souvent parce que ni la communauté ni la succession ne comportent de biens suffisants.
|
|
Droits du conjoint |
Droits des autres héritiers |
|---|---|---|
|
1. Le défunt laisse des descendants vivants |
|
|
|
Les descendants sont tous issus du couple |
Au choix du conjoint : - soit la totalité en usufruit ; - soit 1/4 en pleine propriété |
Les enfants reçoivent, en fonction du choix du conjoint : - soit la totalité de la nue-propriété ; - soit 3/4 en pleine propriété |
|
Un ou plusieurs descendants sont issus d'un autre lit du défunt |
1/4 en pleine propriété |
Les enfants reçoivent 3/4 en pleine propriété |
|
2. Le défunt n'a pas de descendance |
|
|
|
Il laisse ses deux parents |
1/2 en pleine propriété (1) |
Les parents reçoivent 1/2 en pleine propriété (1/4 chacun) (1) |
|
Il laisse son père ou sa mère |
3/4 en pleine propriété (1) |
Le parent survivant reçoit 1/4 en pleine propriété (1) |
|
Ses deux parents sont décédés |
Toute la succession (2) |
Néant (2) |
|
(1) S'ils ont donné des biens à leur enfant, les parents bénéficient d'un droit de retour sur ces biens. (2) Sous réserve, le cas échéant, des droits des frères et soeurs du défunt sur les biens de famille. | ||
La situation est la suivante (C. civ. art. 757) :
- si tous les enfants du défunt sont issus du couple, le conjoint a le choix entre la pleine propriété du quart et l'usufruit de la totalité de la succession ;
- si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d'un autre lit, le conjoint survivant hérite du quart en pleine propriété sans possibilité d'option pour l'usufruit. La part de succession qui lui est attribuée sera alors définitivement perdue pour ses beaux-enfants, qui n'ont par hypothèse pas vocation à hériter de lui.
Lorsque le défunt ne laisse aucun enfant d'un autre lit, son conjoint a le choix entre la pleine propriété du quart et l'usufruit de toute la succession. L'option n'est soumise à aucune condition particulière de forme. En pratique, l'acte authentique doit être privilégié : le notaire pourra conseiller le conjoint sur le choix à effectuer et l'acte notarié fera la preuve de l'option retenue en cas de litige avec les enfants.
Il n'existe pas à proprement parler de délai pour opter. Cependant, si le conjoint néglige d'exercer son option, tout héritier peut l'y inviter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conjoint devra alors prendre parti dans les trois mois. A défaut, il sera réputé avoir opté pour l'usufruit.
Si le conjoint meurt avant d'avoir fait son choix, il est réputé avoir opté pour l'usufruit (C. civ. art. 758-4). Les enfants du défunt, qui sont par hypothèse également ceux de son conjoint ultérieurement décédé, récupéreront alors la pleine propriété des biens de la succession.
Ils sont nombreux : étendue et composition du patrimoine laissé par le défunt, ressources propres et besoins du conjoint, âge du conjoint et des enfants, état des relations du conjoint avec ses enfants, etc. Le choix est évidemment à l'appréciation de chacun.
Quelques observations générales peuvent cependant être faites :
- pour le conjoint, l'option pour la totalité de la succession en usufruit est toujours la plus avantageuse, puisqu'elle est la seule qui lui permette de conserver la jouissance de l'ensemble des biens de la succession et donc de maintenir son niveau de vie inchangé ;
- pour les enfants, l'option pour l'usufruit est en revanche désavantageuse, puisqu'ils vont être privés de la jouissance de leur part d'héritage - tout en devant en assumer certaines charges - jusqu'au décès du second de leurs parents. Bien sûr, rien n'empêche le conjoint de faire ultérieurement donation à ses enfants de l'usufruit de tel ou tel bien de la succession (mais il faudra alors payer des droits de donation).
Au regard des droits de succession, le choix est neutre pour le conjoint, qui est totalement exonéré.
Pour les enfants, l'option pour l'usufruit est globalement la plus économique. Certes, les droits qu'ils acquittent sur la valeur de la nue-propriété (déterminée par application du barème fiscal de l'usufruit prévu à l'article 669 du CGI) peuvent être plus élevés que ceux qui auraient été dus sur trois quarts en pleine propriété (si le conjoint a au moins 81 ans), mais ils récupéreront au décès du conjoint la pleine propriété des biens du prédécédé en franchise d'impôt.
Il exerce ses droits sur les biens existants, c'est-à-dire sur tous les biens laissés par le défunt à son décès, à l'exception de ceux qui ont été légués par testament.
Exemple M. Lebleu est mort le 1er mai 2015 en laissant une veuve et trois enfants. De son vivant, M. Lebleu avait fait une donation-partage à ses enfants pour un montant total de 300 000 €. Il a légué par testament 50 000 € à une association, mais n'a pris aucune disposition particulière au profit de sa femme.
Les biens laissés par M. Lebleu sont évalués à 500 000 € (après liquidation de son régime matrimonial).
Si sa veuve opte pour l'usufruit, elle exercera ses droits sur 450 000 € (soit les biens existants, diminués du legs de 50 000 €).
Pour protéger leur héritage, les enfants peuvent demander au conjoint usufruitier de faire un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles (C. civ. art. 600).
Les enfants peuvent également contraindre le conjoint survivant à placer les sommes d'argent dont il a l'usufruit. Le conjoint ne peut pas toucher au capital : il n'a droit qu'aux intérêts. Le choix du placement doit être exercé d'un commun accord entre le conjoint et les enfants du défunt. A défaut d'accord, c'est au juge de décider.
Si les enfants dispensent le conjoint de son obligation de placement, le conjoint peut librement disposer de l'argent (à condition en principe de fournir des garanties). Il peut alors dépenser, donner ou investir l'argent, sa seule obligation étant de restituer une somme identique à la fin de l'usufruit.
Oui. Tant que le partage définitif de la succession n'est pas intervenu, l'usufruit peut être transformé soit en rente viagère, soit en capital (C. civ. art. 759 à C. civ.762). La conversion a pour effet de rendre les enfants pleinement propriétaires des biens de la succession, à charge pour eux de verser à leur père ou mère soit une rente pendant toute sa vie, soit un capital.
La conversion en rente viagère peut être demandée par le conjoint survivant ou par l'un ou plusieurs de ses enfants nus-propriétaires.
En cas de désaccord entre les héritiers, la demande de conversion est soumise au juge qui tranche en fonction des circonstances et des intérêts en cause. Cependant, il n'a pas le pouvoir d'accorder, contre la volonté du conjoint survivant, la conversion en rente viagère de l'usufruit du logement occupé par lui, pas plus que du mobilier de ce logement.
S'il ordonne la conversion, le juge détermine le montant de la rente, qui doit correspondre à la valeur de l'usufruit. Il fixe aussi les modalités d'indexation de la rente et les garanties de paiement que devront offrir les enfants (hypothèque, engagement de caution, etc.).
La conversion de l'usufruit en capital n'est possible que s'il y a accord du conjoint survivant et des enfants nus-propriétaires.
Si la conversion de l'usufruit est demandée avec effet rétroactif à la date du décès, il en est tenu compte pour le calcul des droits de succession dus par les enfants (BOI-ENR-DMTG-10-50-10 no 130) :
- si la conversion est opérée avant le dépôt de la déclaration de succession, les droits sont calculés en déduisant de l'actif successoral taxable la valeur du capital ou de la rente viagère (c'est la valeur de capitalisation de la rente qui est déduite, déterminée selon le barème des rentes viagères établi par l'administration fiscale) ;
- si la conversion intervient après le dépôt de la déclaration de succession (à effectuer en principe dans les six mois du décès), l'impôt initialement déterminé doit être recalculé. L'administration accorde aux héritiers six mois à compter de la conversion pour déposer une déclaration complémentaire.
Lorsqu'il n'est pas prévu que les effets de la conversion de l'usufruit remonteront au jour du décès, les droits de succession sont calculés sans en tenir compte.
L'opération de conversion elle-même est dans tous les cas taxée au droit fixe de 125 €.
SavoirEn cas de conversion de l'usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires ne peuvent pas déduire de leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu la rente qu'ils versent au conjoint. Quant au conjoint, il est imposable sur une fraction de la rente, en fonction de son âge au moment de la conversion : 70 % s'il a moins de 50 ans, 50 % s'il a de 50 à 59 ans, 40 % s'il a de 60 à 69 ans et 30 % s'il a 70 ans ou plus.
Ce sera le cas soit obligatoirement si le défunt a eu un ou plusieurs enfants d'un autre lit, soit sur option du conjoint en présence uniquement d'enfants communs.
Le calcul des droits du conjoint nécessite plusieurs opérations. Ces opérations, qui sont complexes, sont effectuées par le notaire.
Il faut d'abord déterminer la masse de calcul, c'est-à-dire une assiette théorique dont le conjoint a vocation à recevoir le quart.
Il faut ensuite calculer la masse d'exercice des droits du conjoint, c'est-à-dire la valeur des biens sur lesquels il va effectivement pouvoir exercer des droits. Il faut par exemple tenir compte de la réserve des enfants, sur laquelle le conjoint ne peut pas exercer de droits en pleine propriété. La masse d'exercice est au maximum égale aux biens existants.
Il faut enfin comparer le quart de la masse de calcul à la masse d'exercice : les droits en pleine propriété du conjoint sont plafonnés à la plus faible des deux sommes.
Reste une dernière complication : on a vu précédemment que, sauf testament authentique contraire du défunt, le conjoint survivant peut demander à bénéficier jusqu'à sa mort d'un droit d'habitation sur son logement et d'un droit d'usage sur le mobilier de ce logement. Si le conjoint souhaite se prévaloir de ce droit, il faudra en comparer la valeur à celle de ses droits en propriété (masse d'exercice ou quart de la masse de calcul) :
- si la valeur du droit viager sur le logement et son mobilier est inférieure à celle de ses droits en propriété, le conjoint prendra le complément sur les biens existants ;
- si la valeur du droit viager excède celle de ses droits en propriété, le conjoint n'hérite de rien mais il ne doit aucune indemnité aux enfants.
Pour déterminer la masse de calcul, les biens à prendre en compte sont les suivants :
- les biens laissés par le défunt à son décès, exception faite de ceux qu'il a légués par testament ;
- la valeur des biens qui ont été donnés par le défunt à ses héritiers (conjoint ou enfants), sauf si la donation s'accompagnait d'une dispense de rapport. Doit également à notre avis être prise en compte la valeur des biens donnés aux enfants par donation-partage consentie en avancement de part successorale, bien que les donations-partages ne soient jamais rapportables à la succession du donateur.
La masse d'exercice est égale à la masse de calcul, après soustraction :
- de la réserve des enfants, par exemple, les 3/4 de la succession si le défunt a eu trois enfants ;
- de la valeur des biens donnés aux héritiers (conjoint ou enfants), lorsque cette valeur a été prise en compte dans la masse de calcul. Attention cependant : pour les donations aux enfants, la valeur des biens n'est déduite que si elle ne l'a pas déjà été au titre de la réserve, ce qui suppose que la libéralité dépasse la part de réserve de son bénéficiaire et s'impute sur la quotité disponible.
Il faut ensuite comparer le quart de la masse de calcul à la masse d'exercice : seul le plus faible des deux montants est retenu.
M. Lerouge est mort le 6 mars 2015 en laissant une veuve et trois enfants, dont deux d'un premier lit. De son vivant, M. Lerouge avait donné 50 000 € à chacun de ses enfants et 45 000 € à son frère. M. Lerouge n'a fait ni testament, ni donation au dernier vivant.
Les biens laissés par M. Lerouge s'élèvent à 635 000 € après liquidation de son régime matrimonial.
On suppose que les donations aux enfants sont rapportables à la succession et que leur montant n'a pas à être réévalué.
Masse de calcul des droits du conjoint :
|
biens laissés au décès : |
635 000 € |
|
biens donnés aux enfants : |
+ 150 000 € |
|
Total : |
= 785 000 € |
Les droits théoriques de Mme Lerouge sont de 785 000 € × 1/4 = 196 250 €.
Masse d'exercice des droits du conjoint :
|
masse de calcul : |
785 000 € |
|
moins la réserve des enfants : |
- 622 500 € |
|
Total : |
= 162 500 € |
La masse d'exercice étant inférieure au quart de la masse de calcul, les droits de propriété de Mme Lerouge s'exerceront au maximum sur 162 500 €.
Rappelons que, pour calculer la réserve, il faut prendre tous les biens laissés au décès (soit 635 000 €), y compris le cas échéant ceux légués par testament, et y ajouter le montant des donations (soit 195 000 €). Sur les 830 000 € obtenus, la réserve des enfants est des 3/4, soit 622 500 €. Chaque enfant dispose d'une réserve de 207 500 € (1/3 de la réserve globale). La donation de 50 000 € reçue par chacun est donc intégralement imputable sur la réserve et n'a pas à être soustraite pour le calcul de la masse d'exercice (elle est déjà soustraite au titre de la réserve).
La veuve ou le veuf hérite (C. civ. art. 757-1 et C. civ.757-2) :
- de la totalité de la succession si les deux parents du défunt sont morts avant lui (sous réserve, le cas échéant, des droits des frères et soeurs du défunt sur les biens de famille : voir no 46113) ;
- des trois quarts de la succession si un seul des deux parents du défunt est encore en vie. Le survivant des parents recueille le quart restant de la succession ;
- de la moitié de la succession si les deux parents du défunt sont encore en vie. Ces derniers reçoivent l'autre moitié, à raison d'un quart chacun.
Rappelons que les parents bénéficient d'un droit de retour sur les biens qu'ils ont donnés à leur enfant décédé avant eux et que la part des biens soumise au droit de retour s'impute sur leurs droits successoraux.
SavoirLorsque le conjoint hérite de la totalité ou des trois quarts de la succession, les grands-parents du défunt qui seraient dans le besoin (ou ses arrière-grands-parents) disposent d'une créance alimentaire contre la succession (C. civ. art. 758). Lorsque le conjoint hérite des trois quarts de la succession, cette créance ne peut à notre avis être revendiquée que par les grands-parents évincés de la succession par la présence du conjoint. Par exemple, si le père du défunt est déjà décédé, alors que sa mère est toujours vivante (et recueille le dernier quart de la succession), seuls les grands-parents paternels du défunt peuvent réclamer une pension alimentaire à la succession.
Lorsque le défunt ne laisse aucun descendant, son conjoint survivant a la qualité d'héritier réservataire pour un quart de la succession. A hauteur de ce quart, il ne peut pas être déshérité.
Exemple M. Leblanc est mort le 15 avril 2015. Quelques années auparavant, il avait donné 400 000 € à son frère et unique parent. A son décès, il laisse des biens pour 500 000 € et 200 000 € de dettes. Par testament, il a légué 250 000 € à une fondation, sans prendre aucune disposition en faveur de sa femme.
|
Biens existants : |
500 000 € |
|
|
Dettes à déduire : |
- 200 000 € |
|
|
Actif net de la succession : |
= 300 000 € |
300 000 € |
|
Donation à ajouter : |
|
+ 400 000 € |
|
Masse de calcul de la réserve : |
|
= 700 000 € |
Montant de la réserve de Mme Leblanc : 700 000 € × 1/4 = 175 000 €.
Madame Leblanc pourra demander que le legs à la fondation soit réduit à 125 000 €, de façon à recevoir sa réserve de 175 000 € dans la succession de son mari.
Les frères et soeurs du défunt sont en principe complètement évincés de la succession par le conjoint survivant. Cependant, il existe une exception à cette règle : lorsque le conjoint a vocation à hériter de l'intégralité de la succession parce que le défunt ne laisse ni descendant, ni père, ni mère, les biens de famille sont dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants (C. civ. art. 757-3). Ce droit de retour ne bénéficie aux frères et soeurs ou neveux et nièces du défunt que pour autant qu'ils sont les descendants du ou des parents à l'origine de la transmission des biens. Il en résulte que les demi-frères et demi-soeurs du défunt n'en bénéficient que si les biens proviennent de leur parent commun.
Les biens concernés sont ceux que le défunt a reçus de ses parents ou grands-parents (voire de ses arrière-grands-parents) par donation ou héritage et qui se retrouvent en nature dans sa propre succession. Il peut s'agir, par exemple, d'une maison dont le défunt a hérité de sa mère et dont il est toujours propriétaire à son décès. Si les biens ont été vendus, donnés ou légués par le défunt, ils échappent aux frères et soeurs (qui n'ont ni droit sur le prix de vente ni action contre les donataires ou légataires).
Sont à notre avis exclues du droit de retour les sommes d'argent données ou léguées au défunt, en raison à la fois de la finalité même du droit de retour (conservation des biens dans leur famille d'origine) et de la fongibilité de l'argent (comment prouver que les sommes retrouvées dans la succession du défunt sont celles qui lui ont été données ou léguées par ses parents ?).
L'effet du droit de retour est de créer une indivision sur les biens en cause entre le conjoint survivant et ses beaux-frères et belles-soeurs (ou ses neveux et nièces) jusqu'au partage de la succession.
On a vu précédemment comment s'opérait ce calcul lorsque le conjoint hérite du quart de la succession en pleine propriété. Les règles sont ici les mêmes, sous les réserves suivantes.
Lorsque le conjoint hérite de la moitié ou des trois quarts de la succession, c'est la moitié ou les trois quarts de la masse de calcul qui doivent être comparés à la masse d'exercice.
Si le conjoint hérite de la totalité de la succession, il n'y a par hypothèse ni donation rapportable ni réserve à prendre en compte (celle du conjoint n'entre pas ici en ligne de compte).
Que le conjoint hérite de la moitié, des trois quarts ou de la totalité de la succession, le droit de retour éventuel des frères et soeurs sur la moitié des biens de famille est exclu de la masse de calcul, et donc de la masse d'exercice des droits du conjoint.
Pour augmenter les droits successoraux de son conjoint, et pour lui donner davantage de choix.
Certes, les droits accordés par la loi au conjoint survivant ne sont pas négligeables. Cependant, dans la plupart des situations, une donation au dernier vivant permet d'améliorer encore la situation de son conjoint. C'est le cas, tout particulièrement, lorsque l'époux laisse des descendants ou ses père et/ou mère.
Contrairement à la donation au dernier vivant, le testament n'est pas spécifiquement destiné à la protection du conjoint. Un testament peut même être utilisé pour déshériter son conjoint, dans les limites autorisées par la loi.
Cependant, pour celui qui souhaite avantager son conjoint, les deux actes peuvent remplir le même objet et produisent les mêmes effets :
- le maximum qui peut être laissé au conjoint est le même ;
- si le défunt a fait de nombreuses donations, le risque de réduction pour atteinte à la réserve des enfants est identique ;
- la date d'effet de la donation au dernier vivant est celle du décès de son auteur, comme celle du legs fait par testament ;
- la révocation est possible dans les deux cas jusqu'à la mort du conjoint donateur ou testateur ;
- le conjoint est dans les deux cas exonéré de droits de succession.
En définitive, pour l'époux qui veut avantager son conjoint, il n'y a pas de raison particulière de privilégier l'une des opérations par rapport à l'autre. Tout au plus peut-on observer que la pratique notariale conseille aux époux de faire une donation au dernier vivant, acte obligatoirement notarié et qui est généralement établi de façon réciproque entre les conjoints.
Il peut arriver qu'un époux souhaite favoriser son conjoint tout en le privant de certains des droits que la loi lui accorde. Il doit alors faire un testament, car une donation au dernier vivant ne peut pas retirer de droits au conjoint. Par exemple, l'époux qui a des enfants d'un premier lit et qui veut laisser à son conjoint l'usufruit de toute sa succession, à l'exclusion du quart en pleine propriété prévu par la loi, devra faire un testament pour priver son conjoint de ce quart en pleine propriété. Quant à la libéralité portant sur l'usufruit, elle pourra être prise dans le même testament ou être faite par donation au dernier vivant.
Il faut penser à vérifier régulièrement que la donation au dernier vivant ou le legs au profit de votre conjoint est toujours pertinent, de façon à pouvoir actualiser, si nécessaire, les dispositions antérieurement prises.
En tout état de cause, si vous avez fait une donation au dernier vivant ou un testament avant le 1er janvier 2007, il est souhaitable de consulter votre notaire pour vérifier que la libéralité est compatible avec les règles issues de la réforme des successions opérée par la loi du 23 juin 2006. Et si l'acte est antérieur au 1er juillet 2002, date à laquelle les droits du conjoint survivant ont radicalement changé, la consultation s'impose ! A défaut, les dispositions adoptées risquent d'entraîner un contentieux dont l'issue sera aléatoire, puisque les juges devront tenter d'interprétrer vos volontés.
Ainsi, à propos d'un homme décédé en 2004 et qui, ayant des enfants d'un premier lit, avait rédigé un testament en 1987 pour priver son épouse de son usufruit légal (portant à l'époque sur un quart de la succession), il a été jugé que la veuve bénéficiait du quart en pleine propriété désormais prévu par la loi, car « la volonté du testateur n'avait pas pu être de la priver de droits en pleine propriété que la loi ne lui reconnaissait pas au moment de la rédaction du testament » (Cass. 1e civ. 25-3-2009 no 08-13.667). Mais une affaire similaire a donné lieu à la solution inverse (exclusion du quart en propriété pour la veuve), les juges ayant estimé que le mari avait voulu limiter les droits de son épouse pour ne pas pénaliser ses enfants d'un premier lit (Cass. 1e civ. 15-12-2010 no 09-68.076 : Bull. civ. I no 269).
La protection du conjoint dans le cadre successoral passe par l'établissement d'une donation au dernier vivant ou d'un testament.
En dehors du cadre successoral, d'autres outils sont à la disposition des époux. Comme on l'a vu un peu plus haut dans ce Dossier, la protection financière du conjoint passe d'abord par le choix d'un régime matrimonial assorti, le cas échéant, d'avantages matrimoniaux. Rappelons que, dans l'hypothèse extrême de l'adoption du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant, le conjoint récupère l'intégralité des biens du couple.
Autre possibilité, toujours en dehors du cadre de l'héritage : souscrire au profit de son conjoint une assurance-vie en cas de décès. Le veuf ou la veuve touchera cette assurance, rente ou capital, en plus des droits qu'il peut avoir dans la succession.
Les personnes qui ont des enfants ne peuvent librement disposer que d'une partie de leur succession, appelée quotité disponible. En réalité, il existe deux quotités disponibles différentes :
- la quotité disponible ordinaire, qui peut être utilisée pour donner ou léguer des biens à qui l'on veut : conjoint, concubin, enfant, cousin, ami, etc. ;
- et la quotité disponible spéciale entre époux, qui, comme son nom l'indique, ne peut être utilisée qu'en faveur de son conjoint.
Il ne peut pas y avoir de cumul des deux quotités disponibles, faute de quoi la part réservée aux enfants risquerait d'être réduite à néant.
En présence d'enfants, il est cependant possible de laisser :
- à son conjoint, l'usufruit de toute sa succession ;
- et à un bénéficiaire autre que son conjoint, la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire (par exemple, la nue-propriété de la moitié de la succession s'il n'y a qu'un enfant).
Pour les personnes qui laissent des enfants, le montant de la quotité disponible spéciale entre époux susceptible d'être attribuée au conjoint par donation au dernier vivant ou par testament est le suivant (C. civ. art. 1094-1) :
- soit l'usufruit de la totalité de la succession ;
- soit 1/4 de la succession en pleine propriété plus 3/4 en usufruit ;
- soit la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, qui s'élève à la moitié de la succession s'il n'y a qu'un enfant, à 1/3 de la succession s'il y a deux enfants et à 1/4 de la succession s'il y a trois enfants ou plus.
Par rapport aux droits que le conjoint tirerait de la loi, la donation au dernier vivant présente les avantages suivants :
- elle permet à l'époux qui a des enfants d'un autre lit de laisser à son conjoint l'usufruit de toute sa succession, ce que la loi ne prévoit que lorsque tous les enfants sont communs ;
- s'il y a moins de trois enfants, elle offre au conjoint survivant une quotité en pleine propriété supérieure à celle prévue par la loi, qui est fixée à 1/4 quel que soit le nombre d'enfants : le conjoint qui opte pour la quotité disponible ordinaire récupère la moitié de la succession s'il n'y a qu'un enfant et 1/3 s'il y a deux enfants ;
- elle permet de cumuler des droits en propriété et des droits en usufruit, ce que la loi ne prévoit pas ;
- sauf indication contraire de l'acte, elle offre au conjoint survivant le choix entre les trois quotités autorisées. Par comparaison, la loi n'offre de choix au conjoint qu'en présence d'enfants communs, et encore cette option est-elle réduite à deux branches (l'usufruit de la totalité ou la propriété du quart de la succession) ;
- toujours sauf indication contraire de l'acte, elle permet au conjoint survivant qui le souhaite de limiter la libéralité qui lui est faite, en ne prenant qu'une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
Les droits de succession dus par les enfants sont calculés en fonction de ce qu'ils reçoivent effectivement compte tenu de l'option exercée par le conjoint survivant. Si le conjoint utilise sa faculté de limiter la libéralité qui lui est faite (ce que la loi appelle le cantonnement de l'émolument), ce cantonnement n'est pas considéré comme une donation faite aux enfants par le conjoint. La part supplémentaire reçue par les enfants est taxée comme si elle leur avait été directement transmise par le défunt (CGI art. 788 bis). En pratique, la non-taxation du cantonnement n'est favorable que si l'enfant qui en bénéficie indirectement est un enfant d'un autre lit du défunt.
Le conjoint survivant ne peut pas cumuler les droits qu'il tire de la libéralité au dernier vivant et ceux que la loi lui accorde. Les libéralités reçues par le conjoint bénéficiaire d'un testament ou d'une donation au dernier vivant s'imputent obligatoirement sur ses droits légaux dans la succession. Une réserve toutefois : si les libéralités faites au conjoint sont inférieures à sa vocation légale, il peut réclamer le complément, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
Il arrive parfois que le défunt ait lui-même décidé ce qu'il voulait laisser à son conjoint. Dans ce cas, la donation ou le testament indique la quotité précise qui doit revenir au veuf ou à la veuve.
Le plus souvent, la donation au dernier vivant ou le legs est rédigé de telle sorte qu'il donne au survivant le droit de choisir lui-même ce qui lui semble le plus avantageux parmi les trois quotités prévues par la loi. Parce que le maximum autorisé peut évoluer entre la date de l'acte et celle du décès, les actes sont généralement rédigés sans indiquer précisément ce qui sera laissé au survivant des époux. La donation ou le testament mentionne, par exemple, que le conjoint pourra choisir « la quotité disponible la plus large entre époux au jour du décès ». Qu'est-ce que la quotité la plus large ? Elle dépend du nombre d'enfants :
- si le défunt n'avait qu'un enfant, c'est la moitié de la succession, c'est-à-dire la quotité disponible ordinaire ;
- si le défunt avait deux enfants ou plus, c'est le quart en pleine propriété plus les trois quarts en usufruit (quotité disponible spéciale).
Bien qu'il existe trois quotités différentes, le choix du conjoint survivant s'exerce pratiquement toujours en faveur de la totalité en usufruit ou de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété.
L'option pour la totalité en usufruit est, comme on l'a déjà indiqué, le choix le plus avantageux pour le conjoint. C'est aussi le plus économique sur le plan fiscal pour les enfants (no 46090).
En pratique, l'option pour l'usufruit n'est exercée que lorsque le défunt a eu des enfants d'un autre lit. Lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint tire de la loi elle-même la faculté d'opter pour l'usufruit de toute la succession et il peut avoir intérêt à opter pour cet usufruit légal, plutôt que pour l'usufruit conventionnel : l'option pour l'usufruit légal protège le conjoint en cas de découverte tardive d'un testament révoquant la donation au dernier vivant. L'option pour l'usufruit conventionnel offre toutefois l'avantage de permettre au conjoint de cantonner son émolument.
Quelques observations sur l'option pour l'usufruit exercée en présence d'enfants d'un autre lit du défunt :
- cela reste l'option la plus avantageuse pour le conjoint. Cela dit, elle va le rendre usufruitier de ses beaux-enfants. Or, tout démembrement de propriété nécessite un minimum d'entente entre usufruitiers et nus-propriétaires, dont les intérêts sont antagonistes. S'il y a risque de conflits, le conjoint a sans doute intérêt à renoncer à l'usufruit et à opter pour des droits en pleine propriété ;
- l'option pour l'usufruit sauvegarde les intérêts des beaux-enfants, qui sont assurés de récupérer leur héritage au décès du conjoint survivant. Mais si ce dernier est beaucoup plus jeune que le défunt, les enfants risquent de n'hériter que très tardivement ;
- la conversion de l'usufruit en rente ou en capital est toujours possible, dans les conditions exposées no 46098.
Cette option permet au conjoint de récupérer :
- la moitié de la succession si le défunt ne laisse qu'un enfant ;
- le tiers de la succession si le défunt laisse deux enfants.
Si le défunt laisse trois enfants ou plus, l'option pour la quotité disponible ordinaire ne présente pas d'intérêt sur le plan financier : elle n'offre au conjoint qu'un quart de la succession, ce à quoi il a déjà droit du seul effet de la loi. Cependant, la donation au dernier vivant peut prévoir les biens sur lesquels porteront les droits en pleine propriété du conjoint, ce qui reste un avantage. En outre, et de la même façon qu'en cas d'option pour l'usufruit conventionnel, le conjoint a la faculté de cantonner son émolument.
Quelques observations :
- si le défunt a des enfants d'un autre lit, la fraction de succession accordée en pleine propriété au conjoint échappera définitivement à ces enfants ;
- si le conjoint survivant se remarie, les biens qu'il a recueillis au moment de son veuvage pourront ensuite aller à son nouveau conjoint et échapper à ses propres enfants ;
- les enfants et le conjoint vont se trouver dans l'indivision jusqu'au partage, situation qui n'est pas toujours facile à gérer mais qui peut être préférable à un usufruit conflictuel.
Les enfants du défunt peuvent dans certains cas contraindre le survivant à échanger une donation au dernier vivant ou un legs qui lui a été fait en pleine propriété contre un usufruit sur une partie de la succession (C. civ. art. 1098). Le droit de demander cet usufruit forcé est réservé aux enfants d'un autre lit du défunt et est subordonné aux conditions suivantes :
- le défunt ne doit pas s'y être opposé, même tacitement, dans l'acte de donation ou dans son testament. Une donation au dernier vivant laissant au conjoint survivant le choix entre les trois quotités autorisées exclut la possibilité de l'usufruit forcé (Cass. 1e civ. 3-12-1996 no 94-21.799 : Bull. civ. I no 437) ;
- les enfants à protéger doivent avoir accepté la succession ;
- les enfants ne doivent pas avoir été privés de l'usufruit de leur part d'héritage par le legs ou la donation au dernier vivant : l'usufruit forcé ne peut se concevoir que s'il reste un usufruit à laisser au conjoint en échange du don ou du legs en pleine propriété dont il est privé. Pas d'usufruit forcé, donc, si le conjoint survivant reçoit la quotité disponible spéciale du 1/4 en pleine propriété et des 3/4 en usufruit.
Parmi les autres mesures de protection des enfants, rappelons que :
- quel que soit le bénéficiaire de la libéralité, les enfants peuvent obtenir la réduction des donations ou des legs en pleine propriété qui empiéteraient sur leur part de réserve (à condition qu'ils n'aient pas renoncé par avance à demander la réduction) ;
- les enfants nus-propriétaires peuvent demander au conjoint usufruitier de faire un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles. Ils peuvent également obliger le conjoint à placer l'argent dont il a l'usufruit.
Si les conditions de l'usufruit forcé sont réunies, le choix de l'enfant est le suivant :
- soit il laisse faire la donation au dernier vivant ou le legs au conjoint et il se contente de la part de pleine propriété qui lui a été attribuée, sachant qu'a priori il ne récupérera jamais ce qui a été donné ou légué à sa belle-mère ou à son beau-père dont il n'hérite pas ;
- soit il refuse d'être privé d'une part de son héritage et il choisit d'abandonner au conjoint survivant l'usufruit de la part de succession dont il aurait hérité s'il n'avait pas eu de belle-mère ou de beau-père.
Exemple M. Dupond a eu deux enfants : Adrien d'un premier mariage et Anatole d'un second. Il a légué à sa seconde épouse le tiers de sa succession en pleine propriété.
1. Adrien ne s'oppose pas au legs. Mme Dupond va récupérer le tiers de la succession et les enfants vont se partager le solde, soit 1/3 pour chacun. A la mort de Mme Dupond, son fils Anatole héritera de sa mère, ce qui fait qu'en définitive il aura reçu 1/3 + 1/3 de la succession de son père (soit 2/3), alors que son demi-frère Adrien n'en aura eu que 1/3.
2. Adrien s'oppose au legs. Il doit laisser à sa belle-mère l'usufruit de la part de succession qu'il aurait recueillie si son père ne s'était pas remarié. Puisqu'il y a deux enfants, il aurait reçu la moitié de la succession. Il doit donc laisser à sa belle-mère l'usufruit de la moitié de la succession, lui-même héritant de la moitié en nue-propriété. Son frère Anatole reçoit toujours 1/3 en pleine propriété. Quant à Mme Dupond, elle reçoit une moitié de la succession en usufruit + la moitié du legs qui lui a été fait, soit 1/6e en pleine propriété. A la mort de Mme Dupont, chacun des deux frères aura bien récupéré la moitié de la succession de son père.
Pour les personnes qui meurent sans descendance mais en laissant leurs père et/ou mère, l'intérêt de la donation au dernier vivant est d'accroître les droits du conjoint. Il est en effet possible de déshériter ses parents (qui ont droit normalement chacun à un quart de la succession) et de laisser l'intégralité de ses biens à son conjoint survivant. Seule limite : si les parents ont donné des biens à leur enfant, ils auront le droit de les reprendre en vertu du droit de retour que leur confère la loi.
Les personnes qui meurent en ne laissant ni descendant, ni père, ni mère n'ont guère de raison de faire une donation au dernier vivant : leur conjoint hérite de la totalité de leur succession par le seul effet de la loi. La donation au dernier vivant peut toutefois présenter un intérêt s'il existe des biens de famille au sens défini no 46113, puisque ces biens ont vocation à revenir pour moitié aux frères et soeurs. Une donation au dernier vivant permet de faire obstacle au droit de retour des frères et soeurs, ce qui permettra au conjoint de recevoir la pleine propriété de l'intégralité des biens.
En l'absence d'accord du commerçant, les possibilités de revenir sur votre décision sont très limitées. Elles sont différentes selon la qualification des sommes versées d'avance. Il s'agit d'un acompte si cela est indiqué sur le bon de commande ou le reçu. Dans le cas contraire, ce sont des arrhes (C. consom. art. L 114-1). Quel que soit le montant de la commande, il est donc essentiel de vérifier le texte du contrat avant de signer.
Si vous avez versé un acompte, vous êtes totalement engagé et devez payer le solde du prix de la commande.
Si vous avez versé des arrhes, vous pouvez certes renoncer à votre achat, mais vous perdez dans ce cas le montant des sommes déjà versées. Toutefois, par un geste commercial, le vendeur peut proposer un avoir par lequel il reconnaît devoir une somme d'argent à valoir sur un achat futur. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous opposer à ce que l'avoir soit limité dans le temps ou restreint à un rayon précis. Si c'est le commerçant qui renonce à la vente, il doit vous verser le double des sommes versées (C. consom. art. L 131-1).
SavoirLe consommateur qui effectue un achat dans une foire ou dans un salon doit être informé par l'exposant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation (C. consom. art. L 121-97 ; Arrêté du 2-12-2014 : JO du 12 p. 20831). En revanche, lorsque la conclusion du contrat s'accompagne d'une offre de crédit affecté, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat (C. consom. art. L 121-98).
Si vous avez acheté un produit à un démarcheur qui s'est présenté chez vous, vous pouvez vous raviser dans les jours qui suivent la signature du contrat, sans avoir à vous justifier. Même chose si vous avez acheté un produit lors d'une vente organisée sur votre lieu de travail (par exemple, une vente organisée par le comité d'entreprise), d'une excursion organisée par un commerçant ou d'une réunion organisée chez des connaissances. Les tribunaux étendent cette protection aux clients invités à se rendre dans un magasin contre la promesse d'un cadeau.
De même, tout consommateur qui se rend dans les locaux d'une entreprise pour passer commande d'un bien ou d'un service, après avoir été convaincu par une lettre publicitaire reçue à son domicile, bénéficie de la protection liée au démarchage à domicile. Il doit en être informé par le vendeur, qui ne peut accepter aucun paiement durant la période de réflexion (Cass. 1e civ. 4-2-2015 no 14-11.002 : BDP 4/15 no 160).
Il faut envoyer au vendeur par courrier recommandé avec avis de réception le formulaire détachable qui figure en principe dans le contrat de vente ou une lettre rédigée selon le modèle suivant : « Comme me le permet l'article L 121-21 du Code de la consommation, je vous informe par la présente que j'annule la commande ci-après : commande no 15/2541 du 20-6-2015 : service de table 24 pièces en porcelaine, modèle Incassable. Ci-joint copie du contrat. »
Vous disposez à partir du jour de signature de la commande de 14 jours, dimanches et jours fériés compris, le jour de l'achat ou de la commande n'étant pas pris en compte (C. consom. art. L 121-21). Par exemple, si la commande a été passée le 1er juillet, le délai démarre le 2 juillet à 0 heure et vous avez jusqu'au 15 juillet minuit pour vous rétracter. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Si, par exemple, le délai expire le 14 juillet, vous pouvez dénoncer votre commande jusqu'au 15 juillet inclus.
Avant de signer un contrat avec un démarcheur, il est impératif de vérifier que le contrat est correctement daté et n'est pas antidaté. Sinon, vous risquez de perdre votre possibilité d'annuler dans les 14 jours.
Il est interdit au démarcheur de recevoir tout ou partie du paiement de la marchandise commandée avant la fin du délai de rétractation de 14 jours. La méconnaissance de cette interdiction entraîne la nullité du contrat et est punie de sanctions pénales.
Vous pouvez agir en justice. Il faut saisir le tribunal compétent (no 47184) pour demander l'annulation du contrat. Par ailleurs, le commerçant ou le démarcheur qui refuse de tenir compte de la rétractation du client s'expose à des sanctions pénales. On peut alerter les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (en abrégé, DGCCRF ; voir coordonnées no 47190) ou porter plainte directement auprès du procureur de la République. En se constituant partie civile dans le cadre de la procédure pénale, la victime peut suivre l'enquête puis demander le remboursement des paiements effectués et le paiement de dommages-intérêts lors de l'audience de jugement.
Nous vous conseillons, avant toute action judiciaire, d'essayer de résoudre le problème à l'amiable, en faisant intervenir une association de consommateurs ou en vous adressant à la commission paritaire de médiation de la vente directe, 100 avenue du Président Kennedy 75016 Paris. Tél. : 01 42 15 30 00 (un formulaire de réclamation est disponible sur www.fvd.fr, rubrique « Tout savoir sur la vente directe / commission paritaire de médiation »).
La loi prévoit de lourdes sanctions pénales pour le professionnel qui obtient d'une personne un engagement d'achat par ruse ou par contrainte, en abusant de sa faiblesse ou de son ignorance, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements compte tenu de son âge, de son état de santé ou de la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait (par exemple, une panne de chaudière en plein hiver).
Si l'on est victime de tels agissements et qu'on souhaite faire annuler la commande, on peut tout d'abord tenter d'obtenir à l'amiable l'annulation de la vente. Il est possible d'agir au-delà du délai de rétractation de 14 jours prévu en cas de démarchage à domicile, mais il est conseillé de ne pas trop tarder.
Le consommateur peut envoyer à l'entreprise pour laquelle travaille le démarcheur un courrier rédigé sur le modèle suivant.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 10 juin dernier, lors de la visite à son domicile d'un de vos vendeurs, mon père, M. Paul Dubois, a acquis une collection de 50 DVD. Le vendeur a exigé qu'il lui remette immédiatement un chèque de 1 050 €. Or, mon père, âgé de 85 ans et malvoyant, n'a pas mesuré la portée de son engagement. D'ailleurs, il ne possède pas de lecteur de DVD.
Je considère que votre vendeur s'est rendu coupable d'abus de faiblesse à son égard, délit puni par l'article L 122-8 du Code de la consommation. Je vous demande donc d'annuler cette commande et de rembourser à mon père la somme de 1 050 € qu'il a versée.
Si nous n'obtenons pas satisfaction dans les plus brefs délais, nous porterons plainte auprès du procureur de la République.
En cas d'échec de cette démarche, il faut porter plainte, soit directement auprès du procureur de la République, soit en saisissant la DGCCRF. Vous pouvez, dans le cadre de la procédure pénale, demander des dommages-intérêts en vous constituant partie civile.
On peut également tenter de faire annuler le contrat par le tribunal compétent (voir no 47184) pour obtenir la restitution des sommes versées, en faisant valoir que le consentement n'a pas été libre et a été obtenu notamment par tromperie (on parle alors de vice du consentement).
En principe, lorsque vous avez fait un achat à distance (courrier, téléphone, Internet, téléachat, etc.), vous pouvez changer d'avis : vous renvoyez le colis et le commerçant doit vous rembourser la totalité des sommes que vous avez versées, y compris les frais de livraison (même si vous avez demandé une livraison rapide plus chère). Vous n'avez pas à vous justifier et aucuns frais à payer, excepté les frais de réexpédition. Il est conseillé de retourner le produit en recommandé, pour avoir une preuve de la date d'expédition.
Ce « droit de repentir » vaut pour l'achat de produits (vêtements, livres, ordinateurs, meubles, etc.), et de prestations de services (travaux, réparations, etc.).
Le commerçant doit vous rembourser par chèque ou virement, sauf si vous acceptez une autre modalité de remboursement (bon d'achat, avoir, etc.).
Il n'est pas possible de changer d'avis s'il s'agit de produits personnalisés et sur mesure ou de produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être réexpédiés ou sont susceptibles de se périmer ou encore de se détériorer rapidement (aliments, par exemple). L'immatriculation d'un véhicule ne suffit pas à le personnaliser (Cass. 1e civ. 20-3-2013 no 12-15.052 : RJDA 7/13 no 598).
La rétractation n'est pas non plus admise pour les journaux et les magazines, et pas davantage pour des enregistrements audio, vidéo et logiciels informatiques si l'emballage a été ouvert. Même chose pour les prestations de services dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai normal de rétractation.
En principe, le délai est de 14 jours francs à compter de la livraison du produit ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services ; cependant, le consommateur peut exercer son droit de rétractation sans attendre la réception du bien, dès le jour de la conclusion du contrat. Le délai est décompté comme indiqué no 47012.
Le délai de rétractation est prolongé de 12 mois lorsque le vendeur à distance n'a pas fourni par écrit à l'acheteur avant la commande, puis confirmé au plus tard au moment de la livraison, un certain nombre d'informations, notamment : prix et caractéristiques essentielles du produit ou du service, modalités de paiement et de livraison, conditions et modalités du droit de rétractation, adresse où présenter les réclamations, service après-vente et garanties commerciales. Mais le délai est ramené à 14 jours à partir du moment où le commerçant fournit ces informations (C. consom. art. L 121-21 et C. consom.L 121-21-1).
Si vous avez exercé votre droit de rétractation dans les délais, la société de vente à distance doit vous rembourser dans les 14 jours. Au-delà, la somme due est automatiquement augmentée des intérêts au taux légal (4,06 % au 1er semestre 2015) pendant 10 jours, puis majorée de 5 % si le retard est compris entre 10 et 20 jours, de 10 % si le retard est compris entre 20 et 30 jours, de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours, de 50 % entre 60 et 90 jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal (C. consom. art. L 121-21-4). Si la société refuse de changer ou de rembourser le produit, elle risque une amende administrative importante (jusqu'à 75 000 €).
Avant d'engager une action en justice, il faut tenter de régler le problème à l'amiable en envoyant une lettre rédigée comme dans l'exemple suivant.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Comme me le permet l'article L 121-21 du Code de la consommation, je vous ai retourné pour remboursement le 6 juillet 2015 une collection de DVD « Un siècle de cinéma » que j'avais commandée par Internet à votre société et qui m'avait été livrée le 3 juillet 2015. Mais à ce jour, vous ne m'avez pas remboursé la somme de 175 € que je vous avais versée en paiement de ces articles.
Je vous demande donc de me verser somme, majorée dans les conditions prévues par l'article L 121-21-4 du Code de la consommation.
A défaut, je saisirai la DGCCRF ainsi que le juge civil.
Pièce jointe : copie de l'avis de réception du colis.
Dans un deuxième temps, il peut être utile de contacter une association de consommateurs ou la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, 60 rue La Boétie, 75008 Paris (Internet : www.fevad.com, Tél. : 01 42 56 38 86), qui peut intervenir auprès de ses adhérents.
Si cette démarche n'est pas concluante, vous pouvez porter plainte auprès de la DGCCRF. Vous pouvez demander des dommages-intérêts en vous constituant partie civile. Vous pouvez également saisir le tribunal compétent (voir no 47184) pour obtenir le remboursement ou l'échange.
L'envoi forcé est une pratique commerciale interdite qui expose le commerçant à des sanctions pénales. Le procédé est le suivant : le consommateur reçoit à son domicile un article qu'il n'a pas commandé, accompagné d'une lettre lui indiquant qu'il a le choix entre le conserver contre paiement ou le réexpédier dans un certain délai.
Le consommateur n'est pas tenu par l'offre qui lui est faite : il n'a l'obligation ni de payer ni de renvoyer l'article. Mais, il ne doit pas le détruire : en effet, l'entreprise expéditrice en reste propriétaire et peut venir le récupérer. Il faut donc le tenir à sa disposition.
Que faire si le commerçant menace le consommateur de poursuites en cas de non-paiement ? Il faut lui répondre par courrier en lui indiquant qu'on envisage de porter plainte pour envoi forcé. La lettre, à envoyer de préférence en recommandé avec avis de réception, peut être rédigée sur le modèle suivant : « Vous m'avez envoyé le 10 juin 2015 un livre sur l'astrologie au XIIIe siècle que je n'ai pas commandé. Conformément à l'article L 122-3 du Code de la consommation, je n'ai pas à vous payer la somme que vous me réclamez pour cet envoi ni à vous réexpédier ce livre. Je le tiens à votre disposition à mon domicile où vous pourrez le récupérer à la date dont nous conviendrons ensemble. Si vous continuez à me réclamer le paiement de ce livre ou sa réexpédition, je porterai plainte contre votre société auprès du procureur de la République ».
Le commerçant est obligé de prévoir dans le contrat, c'est-à-dire dans le bon de commande, une date limite de livraison (C. consom. art. L. 111-1). Sauf cas de force majeure (incendie, grève, etc.), cette date s'impose à lui, même si le bon de commande spécifie qu'elle n'est qu'indicative.
Si le bon de commande ne prévoit pas de date limite de livraison, le commerçant doit vous livrer au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. En cas de retard, vous devez demander au commerçant d'effectuer la livraison dans un « délai supplémentaire raisonnable » (C. consom. art. L 138-2).
Lorsque la date de livraison indiquée dans le contrat constitue une « condition essentielle » du contrat (par exemple, la livraison d'une robe de mariée avant la date du mariage), vous n'avez pas à relancer le commerçant et pouvez demander directement l'annulation de la vente (C. consom. art. L 138-2).
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.
« Le 12 septembre 2015, j'ai commandé dans votre magasin un fauteuil de marque Comfort, modèle Champagne, au prix de 350 €. Selon le bon de commande ci-joint, vous vous étiez engagé à me livrer au plus tard le 26 septembre 2015. Or, à ce jour, je n'ai pas reçu ma commande. En application de l'article 1610 du Code civil, je vous demande de me livrer sous quinzaine, faute de quoi, je demanderai l'annulation de la vente ».
Si vous n'avez pas été livré après la relance du commerçant, vous pouvez demander la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date de dénonciation du contrat.
Si le remboursement des sommes versées d'avance intervient au-delà du délai de 14 jours, la somme à rembourser est de plein droit majorée de 10 % jusqu'à 30 jours, de 20 % jusqu'à 60 jours et de 50 % au-delà (C. consom. art. L 138-3).
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 12 septembre 2015, j'ai commandé dans votre magasin un fauteuil de marque Comfort, modèle Champagne, au prix de 350 €. Selon le bon de commande ci-joint, vous vous étiez engagé à me livrer au plus tard le 26 septembre 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 29 septembre 2015, je vous ai demandé d'effectuer la livraison sous quinzaine. Or, à ce jour, je n'ai pas reçu ma commande. Je vous informe donc par la présente de ma décision d'annuler ma commande et, comme me le permet l'article L 138-3 du Code de la consommation, de me rembourser l'acompte versé de 150 € dans un délai maximum de quatorze jours.
Le commerçant doit livrer à l'acheteur la marchandise prévue par le contrat.
Au moment de la livraison, il faut vérifier que les articles sont bien ceux qui ont été commandés. L'acheteur doit refuser de signer le bon de livraison avant d'avoir procédé à cet examen. Si la marchandise ne correspond pas à sa commande, il doit refuser la livraison en indiquant sur le bon de livraison les raisons de ce refus.
Il faut ensuite envoyer au commerçant une lettre exigeant soit une nouvelle livraison conforme à la commande, soit l'annulation de la commande et le remboursement des sommes versées.
En cas de refus ou en l'absence de réponse du commerçant, il faudra saisir le tribunal pour non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance (C. civ. art 1610 et C. civ.1611).
En pratique, le consommateur a le choix entre cette action et l'action en garantie légale de conformité.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 2 mai 2015 j'ai commandé dans votre magasin un canapé convertible trois places modèle Texas. Or, la livraison que je viens de recevoir ne correspond pas à cette commande : le canapé n'est pas convertible.
Je vous mets donc en demeure par la présente de me livrer dans les plus brefs délais une marchandise correspondant à ma commande, comme vous en fait obligation l'article 1614 du Code civil.
Pièce jointe : copie du bon de commande.
En cas de tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire en cas de mensonge du commerçant sur les caractéristiques essentielles du bien (par exemple, vous découvrez à la livraison que le canapé prétendument en cuir vachette est en croûte de porc), vous pouvez obtenir l'annulation de l'achat pour dol ou agir en garantie légale de conformité. Vous pouvez aussi invoquer le non-respect de l'obligation de délivrance du vendeur. Par ailleurs, le commerçant encourt des sanctions pénales.
Si la marchandise livrée est endommagée, vous devez réagir de la même façon que lorsque la livraison n'est pas conforme à la commande. En premier lieu, vous devez refuser la livraison et mentionner les avaries sur le bon de livraison.
Vous devez ensuite envoyer le plus rapidement possible au commerçant une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de vous livrer la marchandise commandée en bon état. En cas de refus ou en l'absence de réponse du commerçant, il vous faudra saisir le tribunal en demandant soit l'exécution de la commande, soit la résiliation de la vente et le remboursement des sommes versées. Vous pouvez aussi agir en garantie légale de conformité.
Si la livraison est incomplète, il faut le signaler sur le bon de livraison en précisant les éléments manquants, puis envoyer au vendeur une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de livrer dans les plus brefs délais le reste de la marchandise.
Lorsque la livraison est effectuée non par le vendeur, mais par un transporteur choisi par le consommateur, c'est à celui-ci qu'il faut adresser une réclamation si la marchandise est abîmée ou la livraison incomplète. Il faut bien sûr refuser de signer le bon de réception et indiquer sur celui-ci les manquants ou les avaries, puis confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception adressée au transporteur en lui demandant une indemnisation pour le préjudice.
Attention, le délai pour réagir auprès du transporteur est très bref : trois jours seulement (non compris les jours fériés) à compter de la livraison (C. com. art. L 133-3 al. 1). Si ce délai est expiré, il est conseillé d'avertir le commerçant ; il n'est pas rare que celui-ci accepte de remplacer la marchandise ou de rembourser le client.
SavoirLe vendeur est responsable vis-à-vis du client des fautes des prestataires auxquels il fait appel. Ainsi, quand un colis est perdu par La Poste, le vendeur doit dédommager intégralement le client de son préjudice (Cass. 1e civ. 13-11-2008 no 07-14.856 : RJDA 10/09 no 838). Les clauses des contrats limitant sa responsabilité sur ce point, fréquentes en pratique, sont nulles.
La loi Toubon du 4 août 1994 impose l'utilisation du français dans les notices d'emploi des produits vendus en France. Cette règle s'impose strictement aux produits français et aux produits provenant d'un Etat qui ne fait pas partie de l'Union européenne (Chine, Japon, etc.). S'agissant des produits européens, chaque Etat membre de l'Union peut imposer l'utilisation de sa langue nationale à condition que cette obligation s'applique à tous les produits, nationaux ou importés, et ait pour but d'assurer au consommateur une information appropriée, notamment en matière de sécurité.
Autrement dit, en France, l'utilisation du français est en général la règle.
Ont été jugées illégales, par exemple, la vente de logiciels avec une notice en anglais (CA Paris 27-1-1997 : RJDA 12/97 no 1576) et la vente de guirlandes électriques avec une notice en allemand (Cass. crim. 26-4-2000 : RJDA 12/00 no 1209).
Il est admis que des dessins ou des symboles remplacent des explications en langue étrangère s'ils sont aisément compréhensibles et n'induisent pas en erreur le consommateur. Ainsi, la vente de toupies avec des instructions de montage en allemand a été jugée légale dès lors que les précautions d'utilisation étaient en français et que le montage était expliqué au moyen de schémas explicites (CA Paris 25-10-2006 no 05-6174 : RJDA 11/07 no 1185).
Si la notice d'utilisation est souvent reproduite sur papier, elle est, pour le matériel informatique, essentiellement présentée sous forme électronique. Ce mode de présentation ne dispense pas d'employer le français.
La loi impose l'utilisation du français, mais pas la pureté de la langue. Une syntaxe incorrecte et des fautes d'orthographe sont regrettables mais pas illégales.
En pratique, si vous achetez un produit accompagné uniquement d'une notice en langue étrangère, commencez par demander au vendeur ou au fabricant une traduction, en vous fondant sur la loi Toubon. En cas de refus, signalez le problème à la DGCCRF.
Dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la loi définit comme abusive une clause qui aboutit à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Une telle clause est réputée non écrite, autrement dit le professionnel ne peut pas s'en prévaloir.
Afin de simplifier les recours du consommateur, la réglementation prévoit deux listes : une liste des clauses abusives interdites (liste dite noire) et une liste des clauses présumées abusives (liste dite grise).
La liste noire comporte 12 clauses interdites (C. consom. art. R 132-1). Par exemple, ne doivent pas figurer dans les contrats les clauses :
- interdisant au consommateur de demander la résiliation du contrat lorsque le professionnel ne respecte pas ses obligations ;
- supprimant ou réduisant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations ;
- réservant au professionnel le droit de modifier les caractéristiques ou le prix du bien ou du service (voir toutefois ci-après les dérogations admises) ;
- obligeant le consommateur à respecter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes.
La liste grise répertorie 10 clauses présumées abusives (C. consom. art. R 132-2). En cas de litige, c'est le professionnel qui devra apporter la preuve que la clause figurant au contrat n'est pas abusive. Il s'agit notamment des clauses :
- autorisant le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur qui renoncerait à conclure le contrat sans prévoir une indemnisation du consommateur si c'est le professionnel qui renonce ;
- reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
- imposant au consommateur des conditions de résiliation plus rigoureuses que celles prévues pour le professionnel.
Les listes ci-dessus ne s'appliquent pas à tous les contrats. Certaines dérogations sont prévues (C. consom. art. R 132-2-1). Ainsi, l'interdiction de la clause réservant au professionnel le droit de modifier les caractéristiques ou le prix du bien ou du service n'est pas applicable aux contrats portant sur des produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas (par exemple, un contrat de fourniture de gaz). Les contrats relatifs aux produits financiers bénéficient également de cette dérogation.
Notons qu'une clause peut être déclarée abusive par un tribunal même si elle ne figure pas dans les listes ci-dessus.
Signalons enfin que la Commission dite « des clauses abusives », chargée d'identifier dans les contrats proposés aux consommateurs les clauses abusives émet des recommandations destinées à inciter les professionnels à les modifier ou supprimer (C. consom. art. L 534-3). Ces recommandations n'ont pas de caractère obligatoire mais, en général, les tribunaux amenés à se prononcer sur le caractère abusif d'une clause, les suivent. Elles peuvent être consultées sur le site Internet de la Commission : www.clauses-abusives.fr.
La loi donne une définition précise des soldes (C. com. art. L 310-3) : il s'agit des « ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui ont lieu durant des périodes définies ».
La réglementation prévoit deux périodes de soldes dans l'année, chacune d'une durée de six semaines, les traditionnels soldes d'hiver et d'été.
Les articles soldés doivent avoir été proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes.
Le commerçant doit faire un double marquage des prix des articles soldés, avec l'ancien prix barré et le nouveau prix réduit. Si le taux de réduction est le même dans tous les rayons, le commerçant peut se borner à indiquer ce taux sur un panneau en précisant que la remise sera faite à la caisse.
L'objectif des promotions est de développer les ventes de produits ou de prestations sélectionnés spécialement pour l'opération. Ces opérations peuvent être organisées à tout moment de l'année, y compris juste avant les soldes.
La publicité d'une vente promotionnelle par affichage ou prospectus ou sur Internet doit préciser l'importance de la réduction, les produits ou prestations concernés et indiquer :
- soit la période pendant laquelle se déroule l'opération (exemple du 1er au 15 avril 2015). Dans ce cas, les articles ou les prestations en promotion doivent être disponibles à la vente pendant toute cette période. Si un article manque, vous pouvez exiger que le commerçant vous procure un article équivalent au prix annoncé dans la publicité ;
- soit la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ;
- soit la mention « jusqu'à épuisement des stocks ».
Dans le magasin, le commerçant est tenu d'indiquer sur les articles en promotion l'ancien prix barré ou prix de référence et le nouveau prix (Arrêté du 11-3-2015 : JO du 24 p. 5378).
Un commerçant ne peut pas refuser de vendre un article en promotion au prix indiqué en prétextant une erreur d'étiquetage. Les tribunaux considèrent que la vente n'est nulle que si l'erreur d'étiquetage fait apparaître un prix dérisoire qu'un consommateur normalement avisé ne peut sérieusement prétendre avoir pris pour la valeur réelle de l'article (Cass. 1e civ. 4-7-1995 : Bull. civ. I no 303).
Nombreux sont les commerçants qui annoncent que les articles soldés ne seront ni repris ni échangés.
Ces limitations de garanties sur les soldes et les promotions sont illégales. Un article soldé ou en promotion bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents ou de service après-vente que tout autre article.
En revanche, rien ne contraint le commerçant à reprendre l'article si l'acheteur change d'avis (par exemple, la couleur qu'il a choisie ne lui plaît plus).
Les loteries publicitaires sont des opérations promotionnelles permettant aux consommateurs d'obtenir des gains ou des avantages de toute nature soit par tirage au sort, soit en faisant appel au hasard d'une autre façon. Les plus fréquentes sont celles proposées par les sociétés de vente par correspondance.
Il résulte du Code de la consommation (Code de la consommationart. L 121-36) que toute loterie publicitaire mise en oeuvre par un professionnel à l'égard des consommateurs est licite dès lors qu'elle n'est pas déloyale. Cela signifie que la loterie ne doit être ni contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ni altérer, ou être susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (C. consom. L 120-1).
Les documents publicitaires sont souvent rédigés de telle sorte que le destinataire peut croire que le tirage au sort a déjà été effectué et qu'il a gagné. Par exemple, une personne précisément dénommée reçoit une lettre lui annonçant qu'elle a gagné le lot principal, sans que le caractère aléatoire de son gain soit mis en évidence (la personne a seulement été choisie par « prétirage », un deuxième tirage pour l'attribution du lot est prévu). Les tribunaux ont déjà condamné des sociétés organisatrices à verser des dommages-intérêts ou le gain apparemment attribué aux personnes concernées : que le client renvoie ou non son bon de participation, l'entreprise se trouve engagée vis-à-vis de lui et doit lui délivrer le lot annoncé ou l'indemniser (Cass. 1e civ. 19-3-2015 no 13-27.414).
Mais attention, les tribunaux tiennent compte de la bonne ou de la mauvaise foi du consommateur : a ainsi vu son action en justice rejetée une personne qui avait renvoyé le « bon de validation » d'une loterie accompagné d'une lettre recommandée menaçant l'organisateur de poursuites judiciaires si la somme qu'elle avait gagnée ne lui était pas versée. Les juges ont considéré que cette attitude démontrait qu'elle avait bien perçu le caractère équivoque des documents publicitaires.
Lors d'un achat, les clients se voient souvent offrir une garantie contractuelle, également appelée « garantie commerciale » (C. consom. art. L 211-15). Il s'agit d'une garantie facultative accordée par le fabricant ou le commerçant, gratuite ou payante, d'une durée variable selon les points de vente ou les marques (de quelques mois à plusieurs années), par laquelle le professionnel s'engage à réparer gratuitement la marchandise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
Les garanties contractuelles n'ont pas toutes la même étendue : certaines assurent la gratuité des pièces de rechange et de la main-d'oeuvre, mais pas le déplacement.
Il est essentiel de lire le bon de garantie (c'est-à-dire le document prévoyant la garantie). Celui-ci doit indiquer notamment ce que couvre la garantie, sa durée et rappeler que l'acheteur bénéficie aussi des garanties légales. Comme tous les documents destinés au client, le bon de garantie doit être clair : par exemple, si les caractères sont si petits qu'ils sont presque illisibles, vous pouvez exiger une nouvelle version du document. En cas de doute, le document s'interprète dans le sens le plus favorable au consommateur.
Si l'appareil est immobilisé pour réparation pour au moins sept jours, la garantie contractuelle est prolongée d'autant (C. consom. art. L 211-16). Ce délai de sept jours court à compter de la demande d'intervention ou du jour où l'acheteur a rapporté l'appareil pour réparation au SAV.
Pendant la période d'immobilisation, le vendeur n'est pas tenu de fournir un bien de remplacement, sauf s'il le propose dans le contrat de garantie. Même dans ce cas, il n'échappe pas au prolongement de la garantie si le bien est immobilisé plus de six jours.
Que se passe-t-il si l'appareil est perdu par le SAV ? Le commerçant doit indemniser le client. S'il refuse de le faire ou lui propose une indemnisation dérisoire, le client a intérêt à lui envoyer une lettre qui peut être rédigée selon le modèle suivant.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 9 janvier dernier, j'ai donné à réparer à votre service après-vente mon appareil photo numérique FLOUT 600 que vous deviez me restituer le 31 janvier. A cette date, vous avez été dans l'incapacité de me le rendre et vous m'avez seulement proposé un « geste commercial » sous la forme d'un bon de réduction de 200 € pour l'achat d'un appareil neuf dans votre magasin.
Or, en application des articles 1146 et 1147 du Code civil, vous êtes tenu d'indemniser mon dommage. En conséquence, je vous demande de me verser la somme de 550 € correspondant à la valeur de mon appareil photo (établie à partir de la cote du magazine « Chasseur d'images »).
Pièces jointes : copies du bon de réparation et de la facture d'achat.
Dans un premier temps, il faut lui envoyer un courrier le mettant en demeure de s'exécuter, puis, si ce courrier reste sans effet, tenter une démarche amiable en contactant une association de consommateurs ou le syndicat professionnel auquel le commerçant ou le fabricant appartient. En cas de nouvel échec, il ne reste plus qu'à saisir le tribunal.
La lettre au commerçant ou au fabricant peut être rédigée selon le modèle suivant.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Le 30 avril 2013, j'ai acheté dans votre magasin un lave-vaisselle Toutblanc Réf. B 321. Comme l'atteste le bon de garantie, vous vous étiez engagé à réparer gratuitement toutes pannes pendant une durée de deux ans. Mon appareil est tombé en panne le 15 janvier 2015 mais, lorsque je vous ai prévenu le 19 janvier 2015, vous avez refusé de le reprendre pour réparation. En application de l'article 1134 du Code civil, j'exige que vous répariez gratuitement cet appareil dans un délai de 15 jours. En cas de refus, je saisirai le juge et réclamerai des dommages-intérêts.
Pièce jointe : copie du bon de garantie.
Le commerçant doit garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du produit au contrat (C. consom. art. L 211-4). La garantie de conformité couvre aussi bien la panne complète que le dysfonctionnement d'un appareil ou le caractère décevant de ses performances. Cette garantie s'applique en effet dans toutes les situations où le produit est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec l'acheteur. Le vendeur doit aussi garantir l'acheteur contre les défauts résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation.
Une seule condition est nécessaire pour bénéficier de cette garantie : les défauts devaient exister à la date où l'acheteur a pris possession du produit. Les défauts apparus moins de six mois après cette date sont présumés remplir cette condition (C. consom. art. L 211-7). Ce délai sera porté à deux ans à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.
Le vendeur ne peut se dégager de la garantie qu'en apportant la preuve que le défaut existait au moment de la vente, que le consommateur le connaissait ou ne pouvait l'ignorer ou encore que le défaut a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur lui-même.
L'acheteur a un délai de deux ans à compter du jour où il prend possession du bien pour agir (C. consom. art. L 211-12).
Dans un premier temps, l'acheteur peut demander soit la réparation du produit, soit son remplacement, dans les deux cas sans aucuns frais. En cas de différence de coût manifeste entre les deux options, le commerçant peut imposer la moins chère (C. consom. art. L 211-9).
Si dans le mois qui suit sa demande, l'acheteur n'a rien obtenu, il peut exiger, à son choix, le remboursement intégral (en rendant le produit) ou une réduction du prix (en gardant le produit). Si le défaut n'est pas grave, seule la seconde solution est possible (C. consom. art. L 211-10).
L'acheteur peut en plus réclamer des dommages-intérêts.
Le commerçant ne peut pas refuser le retour du produit au seul motif qu'il n'est pas dans son emballage d'origine. Une telle clause serait qualifiée d'abusive par le juge.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Première étape (joindre la copie du ticket de caisse). J'ai acheté dans votre magasin le 30 mars 2015 une poussette Bébé Plus. Or, dès le lendemain, j'ai découvert qu'il était très difficile de débloquer le frein, une fois celui-ci enclenché.
Je vous ai rapporté la poussette le 4 avril 2015 pour échange (ou pour réparation), mais vous m'avez opposé un refus. En application de l'article L 211-9 du Code de la consommation, je vous demande de m'échanger sous quinzaine la poussette contre un article identique et en bon état de fonctionnement (ou de procéder à cette réparation).
Deuxième étape (joindre la copie de la première lettre). Je vous ai adressé le 6 avril 2015 une lettre vous mettant en demeure de m'échanger sous quinzaine ma poussette défectueuse contre un article identique en bon état de fonctionnement. A ce jour, je n'ai toujours pas obtenu satisfaction.
En application de l'article L 211-10 du Code de la consommation, j'exige que vous me remboursiez dans les plus brefs délais la somme de 240 € correspondant au prix d'achat de la poussette. Je m'engage à vous restituer la poussette dès que j'aurai obtenu ce remboursement.
Variante (au choix du client)
Comme me le permet l'article L 211-10 du Code de la consommation, j'ai décidé de garder la poussette mais j'exige d'être remboursé dans les plus brefs délais de la moitié du prix d'achat de la poussette, soit 120 €, à titre de compensation du défaut présenté par le frein.
Le commerçant est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts cachés du produit qu'il a vendu (C. civ. art. 1641).
Trois conditions sont nécessaires pour faire jouer cette garantie :
- le défaut doit être grave, c'est-à-dire tel qu'il rend le produit impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait donné un prix inférieur s'il l'avait connu (pannes répétées, par exemple) ;
- il doit être antérieur à l'achat ;
- il doit être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat.
C'est à l'acheteur de prouver que ces conditions sont réunies, en fournissant des attestations, factures de réparation, ou encore en faisant procéder à une expertise.
La garantie des vices cachés ne peut être invoquée lorsque les défauts sont postérieurs à la vente et dus à une usure normale ou à une mauvaise utilisation du produit, ou lorsqu'ils étaient apparents ou ont été révélés par le commerçant avant la vente (par exemple, mention du défaut sur l'étiquette). Elle ne le peut pas davantage si les défauts sont mineurs, diminuant seulement l'agrément de l'utilisation de la marchandise.
Lorsque l'acheteur est un non-professionnel, le vice est réputé caché à son égard s'il a pu légitimement en ignorer l'existence au jour de la vente et à condition qu'il ait accordé une certaine attention à l'examen du bien vendu.
La garantie des vices cachés permet à l'acheteur d'obtenir à son choix le remboursement du prix qu'il a payé à condition de rendre la marchandise, ou un remboursement partiel s'il choisit de la garder (C. civ. art. 1644). Il peut en plus obtenir des dommages-intérêts si le défaut du produit lui a causé un préjudice et s'il prouve que le commerçant connaissait ce défaut (C. civ. art. 1645).
Souvent, le commerçant propose d'échanger l'article défectueux contre un article neuf ou d'assurer à ses frais la réparation. L'acheteur peut accepter ces propositions, mais ce n'est pas une obligation pour lui.
Dans un premier temps, il faut rapporter la marchandise au vendeur ou prévenir celui-ci par lettre. Cette lettre peut être rédigée selon le modèle ci-après.
En cas d'échec de cette démarche, l'acheteur devra agir en justice pour faire valoir ses droits.
L'action en garantie des vices cachés peut être engagée aussi bien contre le fabricant que contre le commerçant.
L'action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
J'ai acheté dans votre magasin le 30 mai 2013 un ensemble Home cinéma, avec une garantie commerciale d'un an. Dès la première utilisation, nous avons été très déçus de ses performances et avons dû supporter par la suite de multiples avaries, nécessitant de nombreuses réparations dans vos ateliers, dont la dernière le 16 avril 2015.
Je considère que cet appareil présente un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. Je vous mets par suite en demeure de le reprendre et de me rembourser la totalité du prix, soit 3 500 €.
A défaut, je saisirai le tribunal et réclamerai des dommages-intérêts.
L'acheteur a le choix. Il est plus facile de faire jouer la garantie de conformité parce que ses conditions sont moins difficiles à remplir. Mais la garantie des vices cachés présente l'intérêt de pouvoir être engagée plus tard que la garantie de conformité ; le délai pour agir de deux ans démarre en effet à compter de la découverte du défaut, et non de la prise de possession du bien. Lorsque le délai pour engager l'action en garantie de conformité est expiré, c'est la garantie des vices cachés qu'il faut mettre en oeuvre (à condition bien sûr que les conditions exigées soient remplies).
Lorsqu'on est victime d'un accident provoqué par l'utilisation d'un produit présentant un défaut, on peut obtenir des dommages-intérêts du fabricant ou du commerçant qui l'a vendu (C. civ. art. 1386-1). Il faut pour cela engager une action devant les tribunaux.
Quelles preuves fournir ? La victime de l'accident n'a pas à prouver la faute du professionnel, mais seulement le caractère défectueux du produit, soit qu'il présente un défaut de fabrication, soit qu'il n'offre pas toute la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (ce peut être le cas lorsque le fabricant délivre à l'utilisateur une information insuffisante sur les précautions d'emploi). La victime doit bien sûr aussi prouver qu'elle a subi un dommage (atteintes corporelles et dommages matériels, sauf ceux causés au produit lui-même) et que le défaut du produit est bien la cause du dommage. Par exemple, un fabricant d'une lotion à base d'huiles essentielles a été condamné à indemniser les parents d'un enfant pris de convulsions après l'application de la lotion car la notice d'utilisation ne comportait aucune contre-indication au sujet des enfants (TGI Nanterre 22-6-2007 no 06-8208).
La victime a un délai de trois ans à compter du jour de l'accident (ou du jour où elle a connaissance du dommage, du défaut du produit et de l'identité du fabricant) pour engager une action judiciaire (C. civ. art. 1386-17). Mais passé un délai de 10 ans après la mise en circulation du produit, il n'est plus possible de mettre en cause la responsabilité du professionnel, sauf faute particulière de celui-ci (C. civ. art. 1386-16).
Reste la possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle du commerçant qui a vendu le produit. Celui-ci a en effet vis-à-vis de ses clients une obligation de sécurité, qui consiste à ne livrer que des produits exempts de vice susceptible de créer un danger. A défaut, il peut être condamné à verser des dommages-intérêts au client.
Le professionnel peut voir sa responsabilité écartée notamment s'il prouve qu'au moment de la mise en circulation du produit (c'est-à-dire au moment de sa commercialisation), le défaut n'existait pas ou n'était pas décelable compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques (C. civ. art. 1386-11).
Toute personne victime ou témoin d'un accident dû au mauvais fonctionnement d'un produit ou d'un service ou qui constate un risque lié à son utilisation peut en informer la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC).
La CSC a pour mission de recueillir des informations sur les dangers présentés par les produits et services et de recenser les accidents domestiques. Elle informe le public à l'aide de communiqués de mise en garde et émet des avis destinés aux pouvoirs publics.
Pour la saisir, il suffit de remplir un formulaire accessible sur Internet (www.securiteconso.org). On peut aussi adresser à la Commission une simple lettre à l'adresse suivante : Commission de la sécurité des consommateurs, 6, rue Louise Weiss - Télédoc 312 - 75703 Paris Cedex 13. Il faut décrire le plus précisément possible le risque ou les circonstances de l'accident et leurs conséquences (emplacement, type et gravité de la lésion accompagnée si possible de certificats médicaux) et indiquer les références du service et du produit en cause (marque, numéro de référence du modèle, lieu et date d'achat).
La lettre peut être rédigée en s'inspirant du modèle suivant :
Monsieur le Président,
Le 15 avril dernier, j'ai fait l'acquisition aux Galeries Démodées, 5 place Philibert à Créteil, d'un barbecue de la marque Demon, modèle Family life.
Or, cet appareil présente un grave défaut de stabilité. Le 1er mai, l'utilisant pour la première fois, j'ai installé le barbecue sur la terrasse dallée de ma maison. Alors que mon épouse y déposait des brochettes, l'appareil s'est renversé sur elle, lui infligeant des brûlures sévères aux jambes et aux pieds, comme l'atteste le certificat médical ci-joint.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des suites que vous réserverez à cette affaire.
Pièces jointes : copie de la facture et du certificat médical.
|
|
Obligation de délivrance |
Garantie des vices cachés |
Garantie légale de conformité |
Responsabilité du fait des produits défectueux |
|---|---|---|---|---|
|
Champ d'application |
Toute vente |
Toute vente |
Toute vente |
Mise en oeuvre possible par le consommateur contre le producteur, même en l'absence de contrat avec ce dernier |
|
Défauts visés |
Bien non conforme au contrat (quantité, qualité, accessoires du bien) Retard de livraison |
Défaut grave, non apparent, rendant le bien impropre à sa destination ou en réduisant fortement l'usage |
Bien impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable Bien ne présentant pas les caractéristiques convenues ou impropre à l'usage spécial recherché par l'acheteur Défaut de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation |
Produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre |
|
Option de l'acheteur |
Annulation de la vente Réparation ou remplacement Dommages-intérêts |
Annulation de la vente et remboursement ou réduction du prix Dommages-intérêts si le vendeur avait connaissance du vice |
Réparation ou remplacement du bien A défaut, annulation de la vente ou réduction du prix |
Dommages-intérêts |
|
Délai pour agir |
5 ans à compter de la vente |
2 ans à compter de la découverte du vice |
2 ans à compter de la délivrance du bien |
Double délai : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux et 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur |
|
Charge de la preuve du défaut |
Acheteur |
Acheteur |
Acheteur, mais présomption d'antériorité des défauts apparaissant dans les 6 mois de la vente (délai porté à deux ans à compter du 18-3-2016, sauf pour les biens d'occasion) |
Acheteur, qui n'a pas à prouver la faute du producteur |
|
Contre qui agir ? |
Vendeur direct |
Vendeur direct Vendeur intermédiaire Fabricant |
Vendeur direct |
Vendeur direct ou producteur |
Sauf situation d'urgence absolue, avec danger pour les personnes ou les bâtiments, l'établissement d'un devis est obligatoire dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager pour les travaux de dépannage, de réparation ou d'entretien dont le montant dépasse 150 € TTC (Arrêté du 2 mars 1990).
Le devis doit comporter les mentions suivantes : date, nom et adresse du professionnel, nom et adresse du client, lieu d'exécution des travaux, décompte détaillé en quantité et prix de chaque prestation et des produits nécessaires à l'opération prévue, éventuellement frais de déplacement, somme globale à payer hors taxes et TTC (en précisant le taux de TVA), durée de validité de l'offre et indication du caractère gratuit ou payant du devis.
En dehors de cette obligation particulière, tout professionnel a une obligation d'information préalable du client en ce qui concerne ses tarifs : taux horaire de la main-d'oeuvre TTC, modalités de décompte du temps passé, prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, frais de déplacement. Cette information se fait soit par affichage dans le local où la clientèle est reçue, soit par la remise au client d'un document écrit lorsque la prestation est offerte sur le lieu même de l'intervention.
Les devis sont généralement gratuits. Toutefois, certains artisans font payer les devis qu'ils établissent. Ils en ont le droit, à condition d'avoir informé à l'avance le client du coût de ce document. En pratique, lorsque le devis est payant, son coût est souvent déduit du prix de la réparation si le client donne suite.
Qu'il soit obligatoire ou facultatif, le devis engage l'artisan sur les travaux à effectuer et leur prix. Si le client l'a accepté, le professionnel doit se conformer au devis. Le client a le droit de refuser de payer des travaux non prévus et de ne régler que le prix annoncé dans le devis.
Une hausse imprévue du coût de la main-d'oeuvre ou des matériaux ne permet pas au professionnel de réclamer un supplément de prix, sauf si le devis prévoit cette éventualité.
Le client n'est pas tenu d'accepter le devis que lui propose le professionnel. Mais une fois qu'il l'a signé en y inscrivant la mention « bon pour travaux » ou « devis reçu avant l'exécution des travaux », il se trouve engagé vis-à-vis de l'artisan et doit donc payer les travaux effectués conformément au devis, au prix convenu.
Avant de signer le devis, vérifiez que sa durée de validité n'est pas expirée. La plupart des devis fixent une date limite au-delà de laquelle l'offre de prix n'est plus valable. Si le devis est caduc, il est prudent de réclamer un nouveau devis.
Pour les travaux, dépannages, réparations, la remise au client d'une note ou d'une facture est obligatoire si le prix est d'au moins 25 € TTC.
En dessous de ce montant, le professionnel doit délivrer au client une facture si celui-ci le demande. La facture doit notamment indiquer le taux horaire de la main-d'oeuvre, le temps passé à l'exécution des travaux, les frais de déplacement, le détail des pièces changées (dénomination, quantité, prix). S'il y a eu devis, la facture peut simplement faire référence à celui-ci, sans être détaillée.
Lorsque le montant estimé de la réparation toutes prestations et toutes taxes comprises dépasse 150 €, le dépanneur doit établir en présence du client, avant toute intervention, en sus du devis, un ordre de réparation : ce document décrit l'état initial des lieux ou des appareils, la raison de l'appel et la nature des travaux à effectuer (Arrêté du 2-3-1990).
Si au cours du dépannage le dépanneur propose des travaux supplémentaires qui ne sont pas strictement nécessaires à la réparation (par exemple, la pose d'un adoucisseur d'eau parce que le lave-linge est entartré), le client bénéficie de la loi sur le démarchage à domicile : il peut se raviser dans les 14 jours de la signature du contrat (C. consom. art. L. 121-21). Et le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie pendant un délai de 7 jours, sauf pour des travaux à réaliser en urgence et expressément sollicités par le consommateur, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence (C. consom. art. L 211-18-2).
Enfin, si le client estime avoir été victime de la part du dépanneur d'une tromperie ou d'un abus de faiblesse (par exemple, il a été contraint d'accepter le remplacement non nécessaire d'un appareil pour un prix exorbitant), il peut saisir d'une plainte la DGCCRF.
En tout premier lieu, il faut refuser de payer la facture si les travaux ou réparations ont été mal réalisés ou s'ils ont été inefficaces. Il faut par ailleurs envoyer au professionnel une lettre le mettant en demeure de reprendre les travaux ou les réparations.
Cette lettre peut être rédigée comme suit.
A envoyer de préférence par lettre recommandée avec avis de réception
Je vous ai demandé d'effectuer des travaux de peinture et de tapisserie à mon domicile, conformément au devis en date du 21 avril 2015 que j'ai approuvé le 28 avril 2015. Or, je constate que les travaux effectués présentent à ce jour de nombreux défauts : les enduits ont été bâclés, la couleur de la peinture n'est pas celle convenue entre nous (ci-joint copie du devis), enfin le papier peint a été très mal posé dans le salon. Je vous mets en demeure par la présente de reprendre les travaux dans un délai de 10 jours. Si vous ne vous exécutez pas dans ce délai, je saisirai le tribunal pour demander l'autorisation de faire terminer les travaux par une autre entreprise et à vos frais, comme me le permet l'article 1144 du Code civil. Dans l'attente, je ne réglerai pas la facture que vous m'avez envoyée.
En cas d'échec, on peut s'adresser à une association de consommateurs ou au syndicat professionnel auquel appartient le cas échéant l'artisan, pour une tentative de conciliation.
Pour les travaux du bâtiment, on peut ainsi s'adresser à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), 2, rue Béranger 75140 Paris Cedex 03 (Tél. : 01 53 60 50 00).
Pour les dépannages et réparations en matière de chaudières, chauffages, chauffe-eau, etc., on peut contacter le Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (Synasav), 2, place de la Gare, 37700 Saint-Pierre-des-Corps (Tél. : 02 47 63 02 71).
Si cette démarche n'aboutit pas, il faudra saisir les tribunaux et demander soit la résiliation du contrat, soit l'exécution forcée des travaux et réparations, ainsi que des dommages-intérêts.
Quel est le tribunal compétent pour les litiges de consommation ? Tout dépend du montant du litige : jusqu'à 4 000 € c'est la juridiction de proximité qui est compétente. De 4 001 € à 10 000 €, c'est le tribunal d'instance. Au-dessus de ce montant, vous devrez saisir le tribunal de grande instance. La juridiction de proximité disparaît le 1er janvier 2017. C'est le tribunal d'instance qui sera alors compétent jusqu'à 10 000 €.
Vous avez fait appel à un artisan pour la réalisation de travaux dans votre logement. Lors du chantier, des dommages ont été causés par les ouvriers qui sont intervenus. L'artisan doit vous indemniser. Vous pouvez lui envoyer par courrier une lettre simple en vous inspirant du modèle suivant.
Si l'artisan ne donne pas suite à ce premier courrier, envoyez-lui une relance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si malgré vos courriers il refuse de vous indemniser, il vous faudra saisir les tribunaux.
« Votre société a réalisé début janvier 2015 l'aménagement complet de ma cuisine. Lors des travaux de raccordement de la plomberie, une fuite d'eau importante a été provoquée ; elle s'est propagée dans mon salon occasionnant des dégâts au parquet flottant. Un menuisier est intervenu pour le remettre en état pour un montant de 1 250 €.
Conformément aux articles 1146 et suivants du Code civil, vous êtes responsable des dégâts causés dans l'exécution du contrat.
Je vous demande donc de me rembourser le montant de la facture du menuisier.
Pièce jointe : copie de la facture du menuisier. »
Les services de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont compétents chaque fois que les consommateurs sont victimes d'une pratique commerciale interdite et sanctionnée pénalement. Vous pouvez les saisir par lettre recommandée avec avis de réception relatant en détail les agissements dont vous avez à vous plaindre et indiquant clairement vos coordonnées et celles du professionnel (commerçant, vendeur, démarcheur, etc.). Après enquête, les agents de la DGCCRF peuvent dresser un procès-verbal et transmettre celui-ci au parquet pour des poursuites pénales. Pour connaître les coordonnées du service de votre département, consultez www.economie.gouv.fr/dgccrf.
Pour obtenir des informations en matière de droit de la consommation, vous pouvez vous adresser au centre d'appel « Allô, Service Public » Pour le contacter, il faut téléphoner au 3939 (coût d'un appel local à partir d'un téléphone fixe).
Vous pouvez également vous adresser à une association de défense des consommateurs qui vous guidera ou vous assistera dans vos démarches. Si vous avez été victime d'un dommage faisant l'objet d'une action de groupe, vous avez intérêt à vous rapprocher de l'association agréée en charge de l'action (voir no 47250).
La contrefaçon est une imitation d'un produit de marque effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque. Elle constitue une tromperie, le contrefacteur créant une confusion entre le produit imité (l'original) et le produit contrefaisant (la copie) pour profiter de la notoriété de la marque. La contrefaçon touche de nombreux secteurs : vêtements, médicaments, maroquinerie, lunettes, CD, montres, parfums, jouets, pièces détachées pour l'automobile, etc. Sur le plan juridique, elle constitue une atteinte au droit de propriété intellectuelle de l'entreprise propriétaire de la marque.
Vous risquez d'abord de faire une mauvaise affaire. Les produits contrefaisants sont en effet souvent de moins bonne qualité que les originaux. Usure rapide, coutures qui lâchent, pannes prématurées sont des désagréments auxquels vous devez vous attendre.
Plus grave, vous risquez de mettre en danger votre santé (risques d'allergies ou de réactions cutanées en raison de l'utilisation de teintures nocives ou d'alliages de mauvaise qualité). Les contrefaçons peuvent s'avérer également dangereuses d'utilisation car elles ne respectent généralement pas les normes de sécurité en vigueur (normes électriques, par exemple).
En cas de problème, vous ne bénéficierez d'aucune garantie ni service après-vente. Il vous sera quasiment impossible d'obtenir réparation du vendeur.
Rapporter de voyage des contrefaçons vous expose enfin à de lourdes sanctions. A votre retour, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle douanier, spécialement si vous revenez d'un pays connu pour être une plaque tournante de la contrefaçon. Si vous êtes pris en possession d'objets contrefaisants, ils vous seront confisqués pour être détruits. En outre, vous risquez une amende douanière comprise entre une et deux fois la valeur des produits imités ainsi qu'un emprisonnement maximum de trois ans. Si vous êtes en possession d'un nombre important de copies, une procédure pénale peut être engagée contre vous ; la peine encourue est de 300 000 € d'amende et de trois ans d'emprisonnement (CPI art. L 716-10). Aux sanctions douanières et pénales peuvent s'ajouter des dommages-intérêts réclamés par l'entreprise victime de la contrefaçon.
SavoirSi les contrôles douaniers sont principalement effectués dans les aéroports et les ports, ils peuvent intervenir n'importe où sur le territoire national (sur la route, dans une gare, à la terrasse d'un café, etc.). Dans tous les cas, ce sera à vous de prouver que l'objet que vous portez ou transportez n'est pas une contrefaçon mais un original.
Si certaines contrefaçons peuvent être facilement détectées (finitions approximatives, dissymétrie des rayures, mauvaise qualité du tissu ou du cuir, fragilité des coutures, etc.), d'autres sont plus difficiles à repérer. Quelques indices doivent vous mettre la puce à l'oreille. Ainsi, un prix anormalement bas, un paiement exigé en espèces ou l'absence de facture doivent attirer votre attention. De même, un emballage peu soigné pour un produit « de luxe » (simple sac en plastique, erreurs dans l'orthographe de la marque ou de la société, impression floue, mauvaises associations de couleurs, etc.), des erreurs sur les étiquettes, un logo légèrement différent de l'original sont autant de signes de contrefaçon. L'examen des certificats d'authenticité, des conditions de garantie et de service après-vente peut aussi donner des indications.
Pour éviter de vous faire piéger, mieux vaut effectuer vos achats dans les boutiques officielles ou agréées plutôt que sur des marchés ou auprès de vendeurs à la sauvette. N'oubliez pas de vérifier la présence sur les jouets et les appareils électriques des logos attestant du respect des normes de fabrication européennes (CE) ou françaises (NF).
(1) Partie réalisée par Patrice Macqueron, professeur de droit privé.
L'action de groupe est réservée aux associations agréées de défense des consommateurs. Elle permet à ces associations d'agir en justice au nom d'un groupe de consommateurs pour obtenir réparation de leurs préjudices matériels résultant du manquement d'un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles (C. consom. art. L 423-1 à C. consom.L 423-26).
Elle n'est ouverte que pour la réparation de préjudices individuels et ne permet pas de défendre un intérêt collectif dépassant celui des consommateurs concernés.
Une action de groupe permet de demander la réparation des dommages présentant les quatre caractéristiques suivantes (C. consom. art. L 423-1) :
- ils sont matériels et peuvent être trop modestes pour justifier une action individuelle (c'est là tout l'intérêt d'une action de groupe). Les préjudices corporels et/ou moraux, nécessitant une appréciation au cas par cas, le plus souvent après expertise, ne peuvent pas faire l'objet de cette action collective ;
- ils ont été subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique. Le consommateur est dorénavant défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (C. consom. art. prélim.). Notons que la similarité de situation est un état de fait dont les contours, assez flous, relèveront du pouvoir d'appréciation des juges du fond ;
- ils ont été provoqués par des pratiques anticoncurrentielles ou par la mauvaise exécution d'une vente ou d'une prestation de service, à l'exclusion de tout autre type de contrat ;
- ils ont pour origine un même professionnel (ou les mêmes professionnels).
Même limité à la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels, le champ de la procédure est large et les domaines de l'action de groupe sont très vastes : produits défectueux dont l'obsolescence a été programmée, ventes abusivement liées, conditions tarifaires ayant fait l'objet d'ententes illicites, frais bancaires injustifiés, défaut de livraison de biens vendus à distance, inexécution d'un ou plusieurs services prévus dans un forfait, etc.
La possibilité d'intenter une action de groupe est réservée aux associations de défense agrées au niveau national (C. consom. art. L 432-1, al. 1). Le législateur n'a pas voulu que l'action puisse être exercée par une association spécialement conçue pour répondre à un problème particulier de consommation. Il a préféré que le paysage consumériste soit resserré autour d'associations fortes, bien structurées, ayant une couverture territoriale équilibrée et complète, afin précisément de pouvoir conduire avec succès des actions de groupe d'ampleur nationale (Rép. Tardy : JO AN 21-1-2014 p. 703 no 32348).
Pour pouvoir être agréée au niveau national, une association de consommateurs doit notamment réunir au moins 10 000 membres.
En cas de défaillance d'une association ayant intenté une action de groupe, toute autre association agréée au niveau national pourra demander au juge, à compter de sa saisine et à tout moment, à se substituer dans les droits de la première association (C. consom. art. L 423-24).
Aujourd'hui, 15 associations sont agréées au niveau national :
- l'Adeic : Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur ;
- l'Afoc : Association Force ouvrière consommateurs ;
- l'Alldc : Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs ;
- la CGL : Confédération générale du logement ;
- la CLCV : Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;
- la Cnafal : Conseil national des associations familiales laïques ;
- la CNAFC : Confédération nationale des associations familiales catholiques ;
- la CNL : Confédération nationale du logement ;
- la CSF : Confédération syndicale des familles ;
- Familles de France ;
- Familles rurales ;
- la Fnaut : Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;
- l'Indecosa-CGT : Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés ;
- l'UFC-Que Choisir : Union fédérale des consommateurs ;
- l'Unaf : Union nationale des associations familiales.
L'action de groupe est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le professionnel (C. consom. art. L 211-15, C. urb.R 432-2 à C. urb.R 432-4). Elle n'est pas recevable si une précédente action de groupe portant sur les mêmes faits, les mêmes manquements et les mêmes préjudices a déjà fait l'objet d'un jugement ou d'un accord de médiation homologué (C. consom. art. L 423-23).
Il existe quatre procédures différentes :
- une procédure judiciaire dite « normale » ;
- une procédure particulière pour les dommages provoqués par des pratiques anticoncurrentielles ;
- une procédure judiciaire dite « simplifiée » ;
- une éventuelle médiation judiciaire.
Dans cette procédure, le juge doit, dans la même décision, tout à la fois (C. consom. art. L 423-3 à C. consom.L 423-5, C. consom.L 423-7 et C. consom.L 423-8) :
- constater que les conditions de recevabilité de l'action sont réunies et statuer sur la responsabilité du ou des professionnels, au vu des cas individuels présentés par l'association ;
- définir le groupe de consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et fixer les critères de rattachement au groupe ;
- déterminer les préjudices susceptibles d'être réparés ainsi que leur montant et les modalités de leur réparation. A cette fin, il peut ordonner toute mesure nécessaire à la conservation des preuves et à la production de pièces, même si elles sont détenues par le professionnel ;
- éventuellement condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais de l'association ;
- ordonner les mesures de publicité permettant d'informer les consommateurs susceptibles d'être membres du groupe, sans aucune restriction de principe (presse écrite, radio, télévision, Internet, etc.) ;
- fixer les délais et les modalités de l'adhésion des consommateurs au groupe pour obtenir réparation de leur préjudice.
Les mesures de publicité permettant d'informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaire (appel, opposition) ni de pourvoi en cassation, réserve faite de ce qui est dit ci-après sur les pratiques anticoncurrentielles. Elles sont à la charge du professionnel (C. consom. art. L 423-4).
Lorsque les dommages subis par les consommateurs sont dus à des pratiques anticoncurrentielles (entente illicite, pris abusivement bas, etc.), la responsabilité du ou des professionnels ne peut être engagée par le juge de l'action de groupe que sur le fondement d'une décision d'une autorité de la concurrence ou d'une juridiction constatant cette pratique (C. consom. art. L 423-17, al. 1).
Une fois la décision établissant le manquement du professionnel devenue définitive, une association dispose de cinq ans pour engager l'action de groupe (C. consom. art. L 423-17, al. 1 et C. consom.L 423-18).
La procédure suivie est la même que celle de la procédure « normale » sous réserve de deux particularités :
- les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable (C. consom. art. L 423-17) ;
- les mesures de publicité ordonnées par le juge sont immédiatement exécutoires, sans attendre que sa décision soit définitive, afin de permettre aux consommateurs d'adhérer plus rapidement au groupe (C. consom. art. L 423-19).
Elle est applicable lorsque (C. consom. art. L 423-10, al. 1) :
- les consommateurs victimes d'un dommage sont identifiés et leur nombre connu (par exemple lorsqu'ils figurent sur un fichier client) ;
- leur préjudice est d'un même montant ou d'un montant identique par prestation rendue ou par référence à une période ou à une durée.
Une fois la responsabilité du professionnel établie, le juge peut, à la différence de la procédure dite « normale », le condamner (C. consom. art. L 423-10, al. 1 et 2 ; C. urb.R 423-8 à C. urb.R 423-10) :
- à indemniser individuellement et directement les consommateurs dans le délai et selon les modalités qu'il fixe ;
- à informer individuellement les consommateurs - qui n'auront donc aucune démarche préalable à effectuer - pour leur permettre d'être indemnisés, s'ils acceptent la compensation proposée par le jugement.
Une fois l'action de groupe introduite, une médiation peut être organisée à tous les stades de la procédure. Seule l'association requérante peut y participer, dans les conditions générales de la médiation fixées par la loi 95-125 du 8 février 1995 (C. consom. art. L 423-15). L'accord négocié par l'association au nom du groupe est soumis au juge qui, après vérification de sa conformité avec les intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer, l'homologue et lui donne force obligatoire (C. consom. art. L 423-16).
En adhérant au groupe, un consommateur victime d'un préjudice mandate l'association pour obtenir l'indemnisation déterminée par le juge.
Le délai dont dispose le consommateur pour adhérer au groupe est fixé par le juge. Il ne peut être ni inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par la décision judiciaire (C. consom. art. L 423-5).
Les modalités de l'adhésion sont également déterminées par le juge qui précise si les consommateurs doivent s'adresser directement au professionnel ou à l'association (C. consom. art. L 423-23 et C. urb.R 423-14).
Toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite (C. consom. art. L 423-25).
Précisions que l'adhésion au groupe n'entraîne pas l'adhésion à l'association (C. consom. art. L 423-5, al. 3 et 4).
SavoirL'obligation pour le consommateur de manifester expressément sa volonté d'adhérer au groupe (système dit de l'« opt-in ») distingue l'action de groupe de la « class action » américaine qui bénéficie à toutes les victimes, même si elles ne se sont pas exprimées, à l'exception de celles qui ont expressément déclaré ne pas vouloir agir dans le cadre de cette action (système dit de l'« opt-out »).
Tout dépend de la procédure.
Dans la procédure simplifiée, les consommateurs sont indemnisés directement et individuellement par le ou les professionnels reconnus responsables de leur dommage (C. consom. art. L 423-10).
Dans la procédure normale, les consommateurs sont dédommagés par l'association de consommateurs (C. consom. art. L 423-5, al. 1). Pour recevoir les demandes d'indemnisation et représenter les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation, l'association peut, avec l'autorisation du juge, se faire assister par un avocat ou un huissier de justice (C. consom. art. L 423-9 et C. urb.R 423-5).
Toute somme perçue par l'association pour indemniser les consommateurs doit être consignée à la Caisse des dépôts et consignations dans un compte qui ne peut être débité que pour le versement des sommes dues aux consommateurs (C. consom. art. L 423-6).
Toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit doivent être soumises au juge ayant déjà statué, dans les délais qu'il a déterminés dans sa décision initiale (C. consom. art. L 423-7, C. consom.L 423-10, al. 3 et C. consom.L 423-12).
L'association requérante représente les membres du groupe non indemnisés pour demander l'exécution forcée de la nouvelle décision (C. consom. art. L 423-13). L'intégralité des frais et droits de recouvrement liés à l'exécution forcée seront à la charge du professionnel (C. consom. art. L 423-14).
Signalons que pour éviter tout risque d'inexécution, le juge peut, dans la première décision rendue, ordonner au professionnel de consigner à la Caisse des dépôts et consignations une partie des sommes qu'il a été condamné à payer (C. consom. art. L 423-8, al. 2).
Non. Un consommateur ayant subi un dommage moral et/ou corporel du fait du manquement d'un professionnel doit en demander réparation à titre individuel, selon le droit commun, même s'il a adhéré à un groupe pour demander l'indemnisation de son préjudice matériel (C. consom. art. L 523-22).
S'agissant d'un dommage matériel, le consommateur peut choisir d'exercer une action individuelle ou de recevoir l'indemnisation fixée par le juge en adhérant au groupe.
SavoirL'introduction d'une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles des consommateurs en réparation des mêmes préjudices. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire, ni d'un pourvoi en cassation (C. consom. art. L 423-20).
Le consommateur peut donc attendre l'issue de l'action de groupe pour opter entre le bénéfice de l'indemnisation déterminée par le juge, en adhérant au groupe, ou l'exercice d'une action individuelle en responsabilité, sans risquer de voir cette dernière prescrite.
Tout contribuable peut, s'il s'estime imposé à tort ou surtaxé ou s'il veut obtenir la restitution d'un impôt payé en trop, demander une décharge ou une réduction d'impôt (LPF art. L 190 al. 1). Les règles du contentieux de l'impôt (bien-fondé et régularité de l'imposition) sont complexes. Elles sont présentées de manière schématique dans le tableau reproduit ci-après. Certaines d'entre elles sont approfondies dans les développements qui suivent.
|
Chronologie de la procédure |
Nature des principaux impôts concernés |
Observations | |
|---|---|---|---|
|
Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxes foncières |
Droits d'enregistrement (droits de mutation à titre onéreux, droits de succession et de donation), ISF | ||
|
Etablissement de l'impôt |
Avis d'imposition |
Déclaration spontanée ou avis de mise en recouvrement |
|
|
Réclamation |
Centre des finances publiques |
Délais de réclamation : se reporter aux développements consacrés aux différents impôts. Exigibilité de l'impôt : - suspendue en cas de demande de sursis de paiement jusqu'à la décision du tribunal ou, si celui-ci n'est pas saisi, jusqu'à l'expiration du délai de saisine ; - maintenue en l'absence de demande de sursis de paiement : poursuites du comptable public. | |
|
Décision de l'administration |
|
Impôt payé (en tout ou partie) : droit aux intérêts moratoires sur impôts dégrevés. Impôt non payé (sursis de paiement) : - si le contribuable accepte la décision de rejet partiel ou total : il doit payer l'impôt non dégrevé ; - s'il conteste la décision devant le juge : l'impôt reste non exigible jusqu'à la décision du tribunal. | |
|
• Admission totale de la réclamation |
- Le litige est terminé. | ||
|
• Rejet partiel de la réclamation |
- Le litige persiste pour la partie rejetée. | ||
|
• Rejet total de la réclamation |
- Le litige persiste pour le tout. | ||
|
Recours juridictionnel |
Tribunal administratif (TA) |
Tribunal de grande instance (TGI) |
Délai de recours contre la décision : deux mois ; pas de délai butoir en l'absence de décision de l'administration dans les six mois de la réclamation. |
|
Jugement du tribunal |
- Décharge totale de l'imposition - Décharge partielle de l'imposition - Rejet du recours du contribuable |
Impôt payé (en tout ou partie) : droit aux intérêts moratoires sur impôts déchargés. Impôt non payé (sursis de paiement) : le jugement met fin au sursis de paiement. Le contribuable doit payer l'impôt laissé à sa charge et, s'il s'agit d'un impôt direct établi à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, payer des intérêts moratoires. | |
|
Appel du jugement |
Cour administrative d'appel (CAA) (les jugements intervenus notamment en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle ainsi que les recours gracieux ne peuvent pas faire l'objet d'un appel mais seulement d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat) |
Cour d'appel (CA) |
Délais d'appel : deux mois devant la CAA, un mois devant la CA. Exigibilité de l'impôt : l'appel ne dispense pas du paiement de l'impôt. Le contribuable peut demander : - au président de la CAA statuant en référé, la suspension de l'imposition (référé-suspension) ; - au premier président de la CA statuant en référé, l'aménagement ou la suspension de l'exécution du jugement du TGI. |
|
Arrêt CAA ou CA |
- Décharge totale de l'imposition - Décharge partielle de l'imposition - Rejet du recours du contribuable |
Impôt payé (en tout ou partie) : le contribuable a droit aux intérêts moratoires sur l'impôt déchargé (en tout ou partie). Impôt déchargé par le tribunal et rétabli par la cour : le contribuable doit payer l'impôt mais il ne doit pas d'intérêts moratoires ; il doit restituer ceux qu'il a éventuellement perçus. Impôt non payé et maintenu par la cour : le contribuable doit payer l'impôt. S'il s'agit d'un impôt direct établi à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, il doit des intérêts moratoires. | |
|
Recours en cassation |
Conseil d'Etat (CE) |
Cour de cassation (C. cass.) |
Délai de recours : deux mois. Exigibilité de l'impôt : le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif. Pour les impôts directs, le contribuable peut demander la suspension de l'imposition (référé-suspension). |
|
Arrêt CE ou C. cass. |
- Cassation avec renvoi devant la CAA ou la CA - Cassation sans renvoi - Rejet du pourvoi |
Fin du litige : - en cas de rejet du pourvoi ou de cassation sans renvoi, la décision est définitive et met fin au litige ; - en cas de cassation avec renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, dont la décision peut faire l'objet d'un dernier pourvoi en cassation. | |
La procédure contentieuse commence obligatoirement par une phase administrative qui consiste à présenter une réclamation devant le service des impôts (LPF art. R 190-1).
Une démarche verbale peut suffire pour obtenir satisfaction mais, en principe, la réclamation est présentée par écrit, sous la forme d'une lettre envoyée au service des impôts du lieu d'imposition ou au directeur chargé d'une direction régionale, nationale ou spécialisée si l'imposition a été établie à l'initiative de cette direction ; un récépissé doit être adressé au réclamant, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique.
La demande doit mentionner l'imposition contestée, contenir l'exposé sommaire des faits, moyens et conclusions et porter la signature manuscrite de son auteur ou de son mandataire (conjoint, avocat, etc.).
La réclamation doit être accompagnée de pièces justificatives. Selon la nature de l'impôt, il s'agira soit de l'avis d'imposition ou d'une copie de cet avis, ou encore d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie, etc.
SavoirLe contribuable, qu'il soit télédéclarant ou non, peut également présenter une réclamation directement par Internet via son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. La demande peut concerner notamment l'impôt sur le revenu et les impôts locaux mais pas l'ISF. Le contribuable doit sélectionner l'impôt sur lequel porte sa demande, l'année concernée et préciser le motif de sa réclamation. Le service en ligne transmet automatiquement la réclamation au service compétent. Le contribuable n'est pas tenu de joindre des justificatifs particuliers.
Les délais impartis pour réclamer varient selon les impôts ; nous les indiquons par conséquent dans l'étude consacrée à chaque impôt.
Ces délais ne courent pas si l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas l'existence et le caractère obligatoire de la réclamation préalable ainsi que les délais dans lesquels elle doit être présentée (CE 27-6-2005 no 259368 : RJF 10/05 no 1101). Mais attention, le contribuable ne peut se prévaloir de l'absence de l'une de ces mentions que si l'irrecevabilité qui lui est ultérieurement opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas du contribuable qui, n'ayant pas été informé du caractère obligatoire de la réclamation préalable auprès de l'administration, conteste l'imposition directement devant le juge. En revanche, lorsque le contribuable, ayant été informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais impartis, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de la réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée (CE 26-3-2012 no 325404 : RJF 6/12 no 644). De même, un contribuable qui a présenté sa demande après l'expiration du délai général de réclamation ne peut, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée, soutenir qu'aucun délai ne lui était opposable au motif que les avis d'imposition mentionnaient seulement ce délai général et non le délai spécial de réclamation applicable en l'espèce, dès lors que le délai spécial expirait avant le délai général et que l'omission de cette mention n'a, en conséquence, pas privé l'intéressé de la faculté de déposer des réclamations (CAA Bordeaux 17-10-2013 no 12BX02867 : RJF 5/14 no 493).
La réclamation doit être postée au plus tard le jour de l'expiration du délai de réclamation, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés faisant foi comme le cachet de La Poste (LPF art. L 286). Il est préférable d'envoyer la réclamation sous pli recommandé, bien que ce ne soit pas obligatoire, afin de conserver une preuve de la date d'envoi.
La réclamation en ligne peut être formulée à compter de la réception de l'avis d'imposition et jusqu'à la date limite de réclamation propre à l'impôt concerné.
Tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, il est possible de présenter des réclamations successives relatives à la même imposition.
La réclamation est étudiée par l'administration, qui a six mois pour y répondre en motivant sa décision (à défaut de motivation, les délais de recours devant les tribunaux ne commencent pas à courir). Elle peut éventuellement avertir le contribuable qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour statuer ; ce délai ne peut pas dépasser trois mois (LPF art. R 198-10).
Si l'administration n'a pas statué sur la réclamation dans les délais, celle-ci est considérée comme implicitement rejetée, ce qui permet au contribuable de saisir le tribunal (sans qu'aucun délai de recours contentieux puisse lui être opposé tant que l'administration ne lui a pas répondu).
Quels que soient la nature de l'imposition et le montant des sommes en litige, le contribuable peut différer leur paiement (LPF art. L 277). Il lui suffit de le demander dans sa réclamation initiale (ou dans une demande ultérieure faite avant l'expiration du délai légal de réclamation) en indiquant le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend. L'exigibilité de l'impôt est alors suspendue jusqu'au jugement du tribunal ou, si le tribunal n'est pas saisi, jusqu'à l'expiration du délai dont disposait l'intéressé pour le saisir.
ConseilSi vous avez des doutes sur l'issue de la procédure, vous pouvez avoir intérêt à régler l'impôt litigieux. Vous éviterez ainsi, en cas d'échec, d'avoir à payer des pénalités pour paiement tardif d'un montant d'autant plus élevé que la procédure aura été longue (pour l'impôt sur le revenu, les taxes foncières et d'habitation et l'ISF, majoration de 10 % et, le cas échéant, intérêts moratoires dans les conditions indiquées ci-après no 49070 ; pour les droits d'enregistrement, notamment les droits de succession, majoration de 5 % et intérêt de retard de 0,40 % par mois).
Lorsque les droits contestés (pénalités non comprises) sont inférieurs à 4 500 €, le contribuable bénéficie automatiquement du sursis de paiement (pour autant qu'il le demande).
A partir de 4 500 €, le contribuable doit en principe constituer des garanties permettant d'assurer le recouvrement de l'impôt. Le montant de la garantie à fournir est limité au seul principal de l'impôt ; le contribuable n'a donc à constituer de garanties ni pour l'intérêt de retard ni pour les pénalités. La garantie la plus simple est la caution bancaire.
Si les garanties présentées sont jugées insuffisantes par le comptable public, celui-ci doit notifier son refus par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut, les garanties offertes sont réputées acceptées.
Le refus des garanties par le comptable public peut être contesté devant un juge du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance (suivant la nature de l'impôt contesté) par la voie d'une procédure d'urgence, le référé fiscal (LPF art. L 279 et LPFL 279 A). Le juge du référé doit être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision de refus des garanties. Il a un mois pour se prononcer et sa décision est susceptible d'appel. La requête au juge du référé n'est recevable que si l'on justifie de la consignation préalable d'une somme égale au dixième des impôts contestés (ou d'une caution bancaire, etc.).
Si le contribuable ne présente aucune garantie ou si les garanties présentées ont été rejetées, le sursis s'applique mais le comptable public peut prendre des mesures conservatoires (saisies mobilières, etc.). La procédure de référé fiscal peut être utilisée pour demander la limitation ou l'abandon des saisies conservatoires faites par le comptable si ces saisies ont des conséquences difficilement réparables. Aucun délai n'est alors imposé et aucune consignation préalable n'est nécessaire.
Enfin, mais en matière d'impôts directs uniquement (impôt sur le revenu, taxes foncières et taxe d'habitation, notamment), le contribuable peut recourir à la procédure de référé-suspension pour demander la suspension de la mise en recouvrement de son imposition au juge administratif. Le juge ne peut prononcer la suspension que si elle est justifiée par l'urgence et si le contribuable invoque des moyens qui créent un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Cette procédure intéresse les contribuables qui, n'ayant pas demandé le sursis de paiement, s'exposent aux mesures de recouvrement forcé du comptable public ; elle intéresse également ceux qui sont confrontés à des saisies conservatoires parce qu'ils n'ont pas présenté de garantie ou présenté des garanties insuffisantes à l'appui de leur demande de sursis.
Lettre à établir sur papier libre
A adresser de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
(Selon votre situation)
- Impôt direct recouvré par voie de rôle (impôt sur le revenu, etc.)
J'ai été assujetti(e) à... (nature de l'impôt) au titre de l'année... (ou de la période du... au...) sous l'article numéro... du rôle de la ville (ou de la commune) de... pour un montant de... € en principal et de... € pour majorations (ou pénalités).
- Droits d'enregistrement ou ISF acquittés spontanément auprès du service des impôts : demande en restitution
Au titre de l'ISF (année) (ou) de la déclaration de succession souscrite le (date), j'ai payé la somme de... € en principal et de... € en pénalités (éventuellement) auprès du service des impôts de... (indiquez les coordonnées du comptable).
Vous voudrez bien trouver ci-joint photocopie de l'avis d'imposition (ou extrait de rôle ou de la déclaration) relatif à cette imposition.
- S'il s'agit d'une imposition supplémentaire consécutive à un contrôle fiscal
A la suite d'un examen de ma situation fiscale personnelle qui s'est déroulé du... au..., j'ai fait l'objet de rectifications qui ont conduit à l'établissement et à la mise en recouvrement des impositions suivantes : ... (énumérez-les avec précision, en mentionnant la nature des impositions, l'année de rattachement ou la période, le montant en principal des impositions complémentaires exigées, éventuellement celui des majorations ou pénalités). Je joins la photocopie de l'avis d'imposition (ou de l'extrait de rôle ou de l'avis de mise en recouvrement) relatif à cette imposition complémentaire. Vous trouverez également ci-joint copie des observations que j'ai formulées, après proposition de la (ou des) rectification(s) en cause, auprès du vérificateur et dont ce dernier n'a pas (ou n'a que partiellement) tenu compte.
(Tous recours)
Je conteste le bien-fondé (ou le montant total ou partiel) de cette (ou ces) imposition(s) pour les raisons suivantes : ... (faites un exposé concis des faits et arguments sur lesquels s'appuie cette contestation). Je vous demande, en conséquence, la décharge (ou de m'accorder un dégrèvement, une réduction de... €) de cette (ou de ces) imposition(s), (éventuellement) ainsi que la décharge (ou le dégrèvement ou la restitution) des majorations et pénalités correspondantes.
(Si l'imposition n'a pas encore été payée)
Par application de l'article L 277 du Livre des procédures fiscales, je demande le sursis de paiement du principal de la (ou des) cotisation(s) contestée(s) (ou quote-part d'impôt contestée) et des pénalités qui s'y rapportent.
(Si l'imposition a été payée, ainsi qu'éventuellement les pénalités ou majorations)
Je vous demande, pour les raisons ci-dessus exposées, la restitution des sommes déjà versées ainsi que (éventuellement) celle des majorations et pénalités correspondantes. Vous trouverez ci-joint les justificatifs des versements effectués.
(Tous recours)
Conformément à l'article R 190-1, 6e al. du Livre des procédures fiscales, je souhaite recevoir un récépissé de la présente réclamation.
Pièces jointes : photocopie de l'avis d'imposition (ou de l'extrait de rôle, ou de l'avis de mise en recouvrement) ou de la déclaration
(et, s'il y a lieu, autres pièces, à énumérer : mandat, etc.).
Si le contribuable n'est pas satisfait de la décision prise par l'administration, ou s'il n'a pas reçu de réponse dans les six mois de la réclamation, il peut porter le litige devant les tribunaux. L'administration peut d'ailleurs ne pas statuer elle-même sur la réclamation et la soumettre d'office au tribunal compétent.
La juridiction compétente est différente suivant la nature de l'impôt contesté.
Les recours dirigés contre les décisions prises par l'administration à la suite de réclamations en matière d'impôts directs (impôt sur le revenu, taxes foncières et taxe d'habitation, notamment) sont portés en première instance devant le tribunal administratif puis, en appel, devant la cour administrative d'appel. Enfin, le Conseil d'Etat statue sur les pourvois en cassation. Par exception, certains jugements, notamment ceux rendus en matière d'impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières) et de redevance audiovisuelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un appel mais seulement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Quelle que soit la juridiction, la procédure est écrite. La demande, ou requête, au tribunal administratif est signée par le contribuable lui-même ou par son avocat (ou tout autre mandataire de son choix). Elle est adressée au greffe du tribunal du lieu d'imposition. Les requêtes présentées par un avocat peuvent être adressées par voie électronique via l'application « Télérecours » (la procédure est applicable devant l'ensemble des juridictions administratives de métropole).
La requête doit contenir l'exposé des faits, moyens et conclusions du demandeur. Elle doit être accompagnée de trois copies (sauf lorsqu'elle est transmise par voie électronique), ainsi que de la décision de l'administration (si elle a été rendue avant le dépôt de la requête). Le demandeur ne peut pas contester d'autres impositions ou demander des dégrèvements supérieurs à ceux visés dans sa réclamation initiale. En revanche, le contribuable peut présenter des moyens nouveaux devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel.
Devant la cour administrative d'appel, la requête doit être présentée par un avocat. Devant le Conseil d'Etat, le recours à un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire (y compris en cas de pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés).
Le délai pour saisir le tribunal administratif est de deux mois à partir de la réception de la décision de l'administration (LPF art. R 199-1). Si l'administration ne s'est pas prononcée dans les six mois de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif quand il veut. Toutefois, si la décision de l'administration intervient avant qu'il ait saisi le tribunal, il ne dispose plus alors que du délai normal de deux mois.
Lorsque l'intéressé est absent au moment de la réception de la lettre de l'administration, le délai court du jour où il est allé retirer la lettre au bureau de poste, si le retrait a été effectué dans le délai imparti par l'administration postale ; si le contribuable n'a pas retiré le pli recommandé, le délai court du jour où il a été avisé que la lettre était à sa disposition au bureau de poste (jour du dépôt de l'avis de passage). En revanche, lorsque le contribuable a changé d'adresse en cours d'instance sans en avoir avisé l'administration fiscale mais en ayant souscrit auprès de La Poste un ordre de réexpédition pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, la présentation d'un pli contenant la décision de l'administration à l'ancienne adresse, du fait d'une défaillance des services postaux, ne fait pas courir le délai de saisine du tribunal (CE 18-3-2005 no 254040 : RJF 6/05 no 603).
Pour être recevable, la demande doit parvenir au greffe avant l'expiration du délai, sauf retard imputable à un fonctionnement anormal de La Poste. Il s'agit d'un « délai franc », qui ne prend pas en compte le jour de la réception de la notification de la décision. Exemples : si la notification de la décision administrative a été reçue le 18 mai, le délai de deux mois expire le 19 juillet à minuit ; si elle a été reçue le 30 décembre, le délai expire le 1er mars à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai est augmenté d'un mois pour les contribuables demeurant dans les DOM ou les collectivités territoriales d'outre-mer, de deux mois pour ceux qui demeurent à l'étranger.
Le délai est de même durée pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation.
Le jugement du tribunal administratif met fin au sursis de paiement. Les sommes éventuellement laissées à la charge du contribuable (droits en principal et pénalités) redeviennent exigibles. Le contribuable qui fait appel de ce jugement peut demander à la cour administrative d'appel la suspension de son imposition. Pour cela, il doit introduire auprès du greffe de la cour une requête en référé-suspension distincte de la requête principale par laquelle il fait appel du jugement. La suspension peut être ordonnée si elle est justifiée par l'urgence et s'il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition (CE 25-4-2001 no 230166-230345 : RJF 7/01 no 1016).
A établir sur papier libre, à adresser de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Par décision en date du..., notifiée le..., le Directeur des services fiscaux de... (ville) a rejeté en totalité (ou en partie, à hauteur de... €) la réclamation que je lui avais adressée le..., en vue de la décharge (ou de la réduction ou de la restitution) de l'imposition contestée. Cette imposition est constituée de... (préciser la nature de l'imposition, son montant, l'année, le lieu, etc.) ainsi que (éventuellement) des sanctions ou pénalités y afférentes (à préciser).
Le montant de la somme qui m'est réclamée s'élève à... €, se décomposant comme suit : ... (donner le détail).
Vous trouverez ci-joint la décision prise par le Directeur sur ma réclamation.
Je conteste le bien-fondé de cette décision et, par la présente requête, j'ai l'honneur de porter le litige devant votre juridiction.
DISCUSSION
Pour rejeter les moyens exposés dans ma réclamation, le Directeur des services fiscaux développe l'argumentation suivante :
... (donner un résumé de cette argumentation).
Je ne partage pas ce point de vue.
En effet, ... (combattre chacun des moyens avancés par l'administration, en produisant, si besoin est, les divers textes ou décisions de jurisprudence sur lesquels on entend s'appuyer).
(Eventuellement) De plus, je tiens à faire valoir les moyens suivants :
... (à développer)
(Si l'on souhaite une expertise)
Il me paraît indispensable, dès à présent, que votre tribunal ordonne une expertise, afin d'établir... (indiquer avec précision les faits sur lesquels on désire que porte l'expertise et les éléments que l'on est en mesure de communiquer à l'expert).
CONCLUSIONS
Par les moyens exposés ci-dessus et tous ceux que je pourrais développer en cours d'instance, je demande à votre tribunal de faire droit à ma requête et de prononcer en ma faveur la décharge (ou la réduction ou la restitution) de l'imposition (ou de la quote-part d'imposition) contestée.
(Si l'imposition en cause a déjà fait l'objet d'un paiement total ou partiel)
Je demande que me soient restituées les sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires (joindre les reçus ou justificatifs des versements effectués).
(Si l'on a demandé le sursis de paiement)
(Demande formulée dans la réclamation préalable) Je me permets de rappeler que ma réclamation préalable était assortie d'une demande de sursis de paiement des sommes contestées.
(Demande de sursis de paiement séparée) Je me permets de rappeler qu'une demande de sursis de paiement a été présentée au Directeur des services fiscaux (ou Responsable du service des impôts) avant l'expiration du délai de réclamation.
(Si l'on souhaite obtenir le remboursement des frais d'instance)
Par application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative, je demande également que l'administration soit condamnée à me rembourser les frais irrépétibles que j'ai été, ou serai, amené(e) à exposer au cours de cette instance. Le montant de ceux-ci sera indiqué au tribunal à l'issue de l'instruction.
Je joins à la présente requête les pièces suivantes, numérotées comme suit :
... (faire l'inventaire des pièces jointes : décision de l'administration, trois copies de la requête, mandat s'il y a lieu, etc.).
En matière de droits d'enregistrement et d'ISF, le contribuable qui veut contester la décision rendue par l'administration sur sa réclamation doit saisir le tribunal de grande instance (TGI) (LPF art. L 199 al. 2). Le tribunal compétent est celui du bureau chargé du recouvrement ou, en cas d'insuffisance d'évaluation de biens, le bureau de la situation des biens (LPF art. R 202-1). L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le délai de recours est de deux mois à compter du jour de la réception de la décision du service des impôts ; toutefois, aucun délai n'est imposé si l'administration n'a toujours pas répondu à la réclamation au bout de six mois (et tant qu'aucune décision n'intervient). Dans le délai dont il dispose, le contribuable doit, par voie d'huissier, assigner l'agent de l'administration qui a pris la décision de rejet de la réclamation (ou qui n'a pas notifié de décision dans les six mois). Il doit ensuite remettre une copie de l'assignation au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa signification par l'huissier ; à défaut, l'assignation est caduque et le tribunal ne peut pas être saisi (BOI-CTX-JUD-10-20-10 no 80).
Le jugement du tribunal met fin au sursis de paiement. Mais le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut accorder l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution du jugement si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le contribuable (BOI-CTX-DG-20-70-30 no 200).
Le jugement du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement. La constitution d'avocat est obligatoire. Le contribuable (sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle) et l'administration fiscale doivent payer un droit d'appel de 225 € chacun (CGI art. 1635 bis P modifié par la loi 2014-1654 du 29-12-2014).
L'arrêt de la cour d'appel peut être attaqué devant la Cour de cassation. Le pourvoi doit être présenté par un avocat à la Cour de cassation, dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification régulière de l'arrêt.
Les délais d'assignation et d'appel devant des TGI ou des cours d'appel situés en métropole ainsi que de pourvoi en cassation sont allongés d'un mois pour les contribuables demeurant dans les DOM et les collectivités territoriales d'outre-mer, de deux mois pour ceux demeurant à l'étranger.
Si vous obtenez un remboursement d'impôt à l'issue d'une procédure contentieuse, vous avez droit à des intérêts moratoires, que le remboursement soit accordé par le tribunal ou par l'administration à la suite de votre réclamation (LPF art. L 208, al. 1). Vous pouvez également y prétendre lorsque vous obtenez la restitution de consignations que vous aviez dû verser pour obtenir le sursis de paiement (LPF art. L 208, al. 2).
Les intérêts moratoires ne sont pas dus en revanche lorsque le remboursement est accordé à titre gracieux, lorsqu'il fait suite à un dégrèvement d'office prononcé à la seule initiative du service des impôts ou encore en cas de restitutions d'excédents de versements d'impôt opérées par les comptables publics.
Les intérêts sont calculés, jour par jour, au taux de 0,40 % par mois, sur la totalité des sommes remboursées. Ils sont décomptés depuis la date du paiement de l'impôt ou, le cas échéant, depuis la date du versement des consignations, jusqu'au jour du remboursement ou de la restitution des consignations. Ils ne sont pas capitalisés.
L'administration vous les doit quel qu'en soit le montant, même s'il n'est que de quelques euros.
Les intérêts moratoires sont payés d'office, sans demande spéciale, en même temps que les sommes remboursées. S'ils sont versés tardivement, ils deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du jour où vous en avez demandé le versement par une sommation de payer (CE 6-5-1983 nos 28850 et CE6-5-198330971 : RJF 6/83 no 839). En règle générale, ils ne sont pas imposables (BOI-CTX-DG-20-50-30 no 320).
Vous êtes redevable d'intérêts moratoires lorsque vous perdez devant le tribunal administratif ou lorsque vous vous désistez après avoir formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement (réclamation par laquelle vous contestiez une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'autres impôts directs établie à la suite d'une rectification ou taxation d'office) (LPF art. L 209). Ces intérêts viennent en plus de la majoration de 10 % pour paiement tardif.
Ils ne sont pas dus lorsque le litige n'a pas dépassé le stade de la réclamation devant l'administration.
Si vous faites appel du jugement du tribunal administratif et si la cour administrative d'appel vous donne gain de cause, les intérêts seront annulés ou vous seront remboursés. Si, à l'inverse, la juridiction d'appel annule un jugement qui vous avait été favorable, vous n'êtes pas redevable d'intérêts moratoires.
Les intérêts sont calculés, au taux indiqué ci-dessus pour les intérêts en faveur du contribuable, sur le montant de l'impôt en principal et des pénalités d'assiette maintenus à votre charge (CE 28-1-2004 no 244632 : RJF 5/04 no 539). Ils sont décomptés à partir du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement de l'impôt jusqu'au jour du paiement effectif.
On appelle recours « gracieux », par opposition au recours contentieux, la demande que l'on peut présenter à l'administration à propos d'impositions ou de pénalités régulièrement établies, dont on ne conteste pas le bien-fondé (LPF art. L 247). Cette demande fait appel à la bienveillance administrative pour la remise ou la réduction des sommes à payer.
Les demandes qui visent le principal de l'impôt ne sont possibles qu'en matière d'impôts directs et ne peuvent être motivées que par des difficultés financières (en pratique, le contribuable est dans l'impossibilité de régler ses impôts).
Les demandes relatives aux pénalités, y compris les intérêts de retard, peuvent être formulées pour tous les impôts et taxes.
Les pénalités peuvent également être atténuées par voie de transaction, c'est-à-dire par un accord entre l'administration et le contribuable, à condition que les délais de recours contentieux ne soient pas expirés. Lorsqu'elle est approuvée par l'administration et exécutée par le contribuable, la transaction est définitive et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse (LPF art. L 251). La transaction est exclue notamment lorsque le contribuable est soupçonné de fraude fiscale ou qu'il tente de nuire au bon déroulement d'un contrôle fiscal.
Les tiers déclarés solidairement responsables du paiement d'impôts non établis à leur nom peuvent, sans contester en droit le principe ou la quotité de leur obligation, demander à en être dispensés par la voie du recours gracieux. Ces demandes en décharge de responsabilité solidaire peuvent porter sur tous les impôts (CE 12-3-2014 no 355306 : RJF 6/14 no 632).
Les demandes sont adressées au service des impôts du lieu d'imposition, sans condition de délai (en pratique toutefois, pour les demandes de transaction, avant l'expiration du délai de recours contentieux). Une simple lettre suffit, qui doit contenir les indications nécessaires à l'identification de la question.
Les décisions sont prises par des autorités différentes selon l'importance des sommes faisant l'objet de la demande (directeur départemental des finances publiques, directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée, ministre). Les décisions des directeurs susvisés peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre, qui statue en dernier ressort. Si l'administration ne répond pas dans les deux mois à une demande gracieuse, elle est réputée l'avoir rejetée. Toutefois, le délai de réponse de l'administration est porté à quatre mois en cas de demande de transaction ou de demande en remise particulièrement complexe.
Les décisions de rejet des demandes gracieuses peuvent être contestées par la voie du « recours pour excès de pouvoir ».
Lettre à établir sur papier libre, à adresser de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Je vous présente, au titre de la juridiction gracieuse, une demande de remise (ou d'atténuation) de l'imposition suivante : ... (précisez celle-ci, l'année concernée, l'article et la date de mise en recouvrement, etc.).
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis d'imposition qui m'a été adressé.
Il m'est réclamé une somme de... €, soit... € en principal et... € en pénalités.
Les graves difficultés financières que je connais actuellement ne me permettent malheureusement pas de régler cette somme.
En effet, ... (donnez toutes les indications utiles qui permettront d'apprécier vos difficultés de paiement, y compris les revenus du conjoint et s'il y a lieu des personnes à charge. Enumérez les charges de famille qui vous incombent. Si vous avez été privé d'emploi, exposez-en toutes les conséquences. Ne dissimulez pas tous les efforts consentis pour rétablir votre situation ou celle de l'entreprise. Si vous vous trouvez en situation de surendettement, sachez que la saisine de la commission de surendettement vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs. Exposez les difficultés de tout ordre, notamment de santé, auxquelles vous-même ou vos proches vous trouvez confrontés).
Je vous remercie de bien vouloir m'accorder la remise (ou la plus large atténuation possible) de cette imposition.
(Si des poursuites vont être, ou ont déjà été, engagées)
Le comptable public risquant d'engager des poursuites (ou ayant engagé des poursuites) pour obtenir paiement des sommes en cause, je vous demande d'intervenir pour qu'il accepte de suspendre ces mesures pendant l'examen de ma requête.
Pièces jointes : énumérez toutes les pièces justificatives.
On parle de « dégrèvement » ou « restitution d'office » lorsque l'administration rectifie les erreurs commises au préjudice des contribuables soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une démarche autre qu'une réclamation régulière (LPF art. R 211-1) : par exemple, une démarche verbale ou une réclamation hors délai.
Un dégrèvement d'office peut être accordé jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue. Exemple : si le délai de réclamation a expiré le 31 décembre 2014, l'administration peut dégrever d'office jusqu'au 31 décembre 2018. Cette prescription peut toutefois être interrompue par une demande ou une démarche du contribuable ou d'un tiers agissant pour son compte.
Il existe par ailleurs des dégrèvements d'office spéciaux que l'administration peut ou doit appliquer. Ils concernent principalement les impôts directs locaux. Exemples : dégrèvement de taxe foncière pour disparition d'immeubles non bâtis par suite d'événements extraordinaires, pour pertes de récoltes ou de bétail, etc. ; dégrèvement de taxe d'habitation pour les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu ou faiblement imposées, etc. Lorsqu'il s'agit d'un dégrèvement d'office obligatoire, il peut être prononcé dans un délai de trente ans.
Si l'on ne paie pas ses impôts dans les délais, on risque non seulement des pénalités de retard mais aussi des poursuites (LPF art. L 257-0 A). De même que l'on peut contester le montant de l'impôt, c'est-à-dire son bien-fondé et la régularité de la procédure d'imposition, on peut, s'il y a lieu, s'opposer à ces poursuites. Mais cette contestation obéit à des règles particulières, différentes de celles applicables aux réclamations relatives au montant de l'impôt.
Les poursuites engagées à l'encontre d'un contribuable qui n'a pas payé un impôt dont il conteste le montant sont étudiées au début du présent dossier.
Ce sont les actions mises en oeuvre par les comptables de l'administration pour obtenir le recouvrement des sommes impayées. Elles entraînent des frais supplémentaires, calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement est réclamé, dans la limite de 500 € (CGI art. 1912).
Lorsque le redevable ne s'acquitte pas des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une demande de sursis de paiement, le comptable public adresse, sauf exceptions, une lettre de relance. Le comptable est dispensé d'adresser celle-ci notamment dans le cas où le contribuable a précédemment été défaillant au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition impayée.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la notification de la lettre de relance, et en l'absence d'une demande de sursis de paiement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer à l'expiration de ce délai. Lorsque le comptable est dispensé de l'envoi d'une lettre de relance, il peut, sans délai, adresser une mise en demeure de payer au contribuable si celui-ci n'a pas payé l'impôt à sa date limite de paiement et n'a pas non plus formulé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement.
Les poursuites donnant lieu à des frais ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après l'envoi de la mise en demeure de payer lorsque celle-ci n'a pas à être précédée d'une lettre de relance. Ce délai est réduit à 8 jours lorsque la lettre de relance est restée sans effet.
SavoirLes comptables publics ont un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement de la créance du Trésor ; le délai est de six ans pour certains redevables qui ne sont pas résidents fiscaux de France (LPF art. L 274). A l'expiration de ce délai, l'action en recouvrement est prescrite. Le délai de prescription peut toutefois être interrompu, notamment si des poursuites sont engagées ou si le contribuable reconnaît sa dette : l'administration bénéficie alors d'un nouveau délai de prescription de même durée.
Les poursuites proprement dites peuvent consister dans la saisie et la vente des biens mobiliers ou immobiliers. Toutefois, le moyen le plus couramment utilisé consiste à saisir, entre les mains des tiers, l'argent que ces derniers doivent au contribuable : les salaires, par exemple, les comptes bancaires ou postaux ou encore les contrats d'assurance-vie (LPF art. L 262 et LPFL 263-0 A). Pour saisir des sommes d'argent, l'administration dispose d'une procédure spécifique, l'avis à tiers détenteur, qu'elle peut utiliser lorsque sa créance est assortie du privilège du Trésor. Ce privilège garantit à l'administration de faire partie des premiers créanciers payés et concerne la plupart des impôts, notamment l'impôt sur le revenu, les impôts locaux, les droits d'enregistrement, etc.
Si sa créance n'est pas privilégiée, elle peut utiliser les procédures ordinaires : « saisie-attribution » ou, lorsqu'il s'agit de salaires, saisie des rémunérations.
Quelle que soit la procédure mise en oeuvre, l'administration doit respecter les règles de saisissabilité des salaires.
L'administration peut aussi faire jouer la responsabilité solidaire de certains tiers pour leur faire payer l'impôt dû par un contribuable. Par exemple, cette responsabilité solidaire existe entre les époux ou personnes pacsées pour l'impôt sur le revenu ou la taxe d'habitation du couple, et peut exister avec un propriétaire pour le paiement de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises (ex-taxe professionnelle) dues par un locataire qui a quitté les lieux.
On peut faire opposition aux poursuites (mais pas aux actes préliminaires tels que la lettre de relance) en contestant :
- soit la régularité de la forme de l'acte de poursuite ou les modalités d'exercice des poursuites ;
- soit l'existence ou le montant de la dette due au Trésor, compte tenu des paiements effectués, ou encore son exigibilité, par exemple si les délais de recouvrement sont prescrits, ou pour tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (puisque ceux-ci ne peuvent être contestés que par voie de réclamation ordinaire : nos 49005 s.).
Pour être valable, l'opposition doit être faite dans un délai de deux mois (LPF art. R 281-3-1).
L'opposition doit être faite par écrit et adressée au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale (LPF art. R 281-1). Celui-ci a deux mois pour y répondre mais doit impérativement accuser réception de la réclamation (même si elle a été adressée à une autorité incompétente). Si le contribuable n'est pas satisfait de la réponse ou s'il n'obtient aucune réponse dans le délai de deux mois, il peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai. Le tribunal compétent est le juge de l'exécution (président du tribunal de grande instance) lorsque l'opposition porte sur la régularité formelle de l'acte ou les modalités d'exercice des poursuites ; dans les autres cas (par exemple, contestation de l'existence de la dette), c'est le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance selon qu'il s'agit d'impôts directs ou de droits d'enregistrement et d'ISF.
Le contribuable qui a saisi le juge administratif d'un contentieux des poursuites peut également demander au juge administratif du référé (référé-suspension : no 49025) la suspension de l'exécution de l'acte de poursuites si l'urgence le justifie et s'il invoque un moyen qui crée un doute sérieux sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée (CE 10-4-2002 no 241604 : RJF 7/02 no 856).
Que vos difficultés viennent du service des impôts ou du comptable public, vous pouvez vous adresser au conciliateur fiscal départemental ou au médiateur des ministères économiques et financiers. Ils ont pour mission d'étudier les litiges entre l'administration fiscale et les contribuables et de rechercher une solution amiable afin d'améliorer la qualité des services rendus aux usagers.
Que vous saisissiez l'un ou l'autre, votre demande, accompagnée le cas échéant des copies de pièces justificatives, doit avoir été précédée d'une première démarche, rejetée au moins partiellement, auprès du service concerné (rejet ou admission partielle d'une réclamation, rejet d'une demande de remise des pénalités, refus de délais de paiement, etc.).
La saisine du conciliateur départemental ou du médiateur n'est pas obligatoire. Il est important de noter qu'elle n'interrompt pas les délais de recours contentieux impartis au contribuable pour saisir un juge de son litige, et qu'elle ne le dispense pas non plus de payer les sommes réclamées.
Le conciliateur fiscal départemental peut être saisi pour tout problème lié au calcul ou au paiement de l'impôt ou toute difficulté concernant la qualité du service rendu par l'administration fiscale. Toutefois, il n'est pas compétent pour les litiges liés à un contrôle fiscal (vérification de comptabilité ou examen de situation fiscale personnelle) ou ceux relatifs à la publicité foncière, ni pour les demandes qui ont déjà fait l'objet d'une requête auprès du président de la République, du Premier ministre, du ministre des finances, des directeurs généraux de l'administration fiscale, du défenseur des droits, des parlementaires et des élus locaux.
Dans les 30 jours de sa saisine, le conciliateur informe le contribuable de sa décision ou de l'état du traitement de sa demande pour les dossiers les plus complexes. Rien n'interdit au contribuable n'ayant pas obtenu satisfaction auprès du conciliateur départemental de saisir ensuite le médiateur des finances.
Les contribuables saisissent le conciliateur par courrier ou courriel (conciliateurfiscalxx, dgfip.finances.gouv.fr, xx correspondant au code du département).
La compétence du médiateur est plus large que celle du conciliateur puisqu'il intervient également sur les litiges consécutifs à un contrôle fiscal.
Le médiateur examine votre dossier. Lorsque la réclamation lui paraît fondée, il adresse une recommandation au service et, si celui-ci maintient sa position, il peut soumettre l'affaire à l'appréciation du ministre. Le recours au médiateur ne doit pas être négligé, il est souvent efficace.
Pour saisir le médiateur, il vous suffit de transmettre votre demande par courrier à Monsieur le médiateur des ministères économiques et financiers, BP 60153, 14010 Caen Cedex 1 ou par courriel en remplissant le formulaire téléchargeable sur www.economie.gouv.fr/mediateur/demande-mediation/personnes-physiques.
Cette demande peut, par exemple, être rédigée selon le modèle suivant : « Monsieur le médiateur, le 1er décembre 2014, j'ai opté pour le paiement mensualisé de mon impôt sur le revenu 2014. Les prélèvements correspondants ont débuté normalement en janvier 2015. Or, malgré cette option, le comptable public de Plouzeben a prélevé sur mon compte bancaire, en février 2015, le premier tiers provisionnel de l'impôt 2014 (1 564 €).
Le 12 mars 2015, j'ai demandé par courrier le remboursement de cette somme prélevée à tort. En réponse, le 19 mars 2015, j'ai reçu une lettre de la trésorerie m'informant du bien-fondé de ma demande et d'un remboursement sous huitaine. Or, à ce jour, malgré mes relances téléphoniques, je n'ai toujours pas obtenu ce remboursement. Je vous demande donc d'intervenir auprès du comptable public de Plouzeben pour qu'il procède au remboursement. »
La responsabilité civile est l'obligation de réparer financièrement les dommages causés à autrui. Elle se subdivise en deux grandes catégories :
- la responsabilité contractuelle, dont l'objet est de réparer les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat (il n'est pas nécessaire que le contrat ait été conclu par écrit : par exemple, l'hôtelier devra indemniser le client dont la chambre a été cambriolée) ;
- la responsabilité délictuelle, qui tend à réparer les dommages causés en dehors de tout contrat. Par exemple, le propriétaire d'un chat indemnisera le visiteur griffé par son siamois. De même, le cycliste devra verser des dommages-intérêts au passant qu'il a renversé.
C'est par ce second type de responsabilité, qui intéresse la vie de tous les jours et qui fait généralement l'objet d'une assurance de responsabilité, que nous commencerons. Nous traiterons ensuite de responsabilités contractuelles particulières, notamment celles du notaire, de l'avocat, de l'expert-comptable ou de la SNCF.
Celui qui commet une infraction, c'est-à-dire une contravention, un délit ou un crime, s'expose à des sanctions pénales : le plus souvent une amende ou une peine de prison. Cette responsabilité pénale ne fait pas obstacle au droit de la victime d'engager la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction pour lui demander des dommages-intérêts. Pour ce faire, elle a le choix entre agir devant le juge pénal en se constituant partie civile ou agir devant le juge civil.
Même si le juge pénal relaxe l'auteur d'un dommage, considérant que celui-ci n'a pas commis de faute pénale, le juge civil peut retenir contre lui une faute civile (imprudence, négligence, etc.) et le condamner à verser des dommages-intérêts à sa victime.
SavoirLa responsabilité pénale n'est bien sûr pas assurable. Mais la responsabilité civile de l'auteur d'une infraction pénale reste couverte par l'assureur si le dommage n'a pas été intentionnel : l'assureur d'un incendiaire accidentel devra indemniser les héritiers des victimes, pas l'assureur d'un assassin. Cela dit, la distinction entre dommage intentionnel et dommage involontaire est parfois subtile : par exemple, le dommage est involontaire lorsque le mari, voulant blesser sa femme, a par erreur poignardé quelqu'un d'autre.
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre