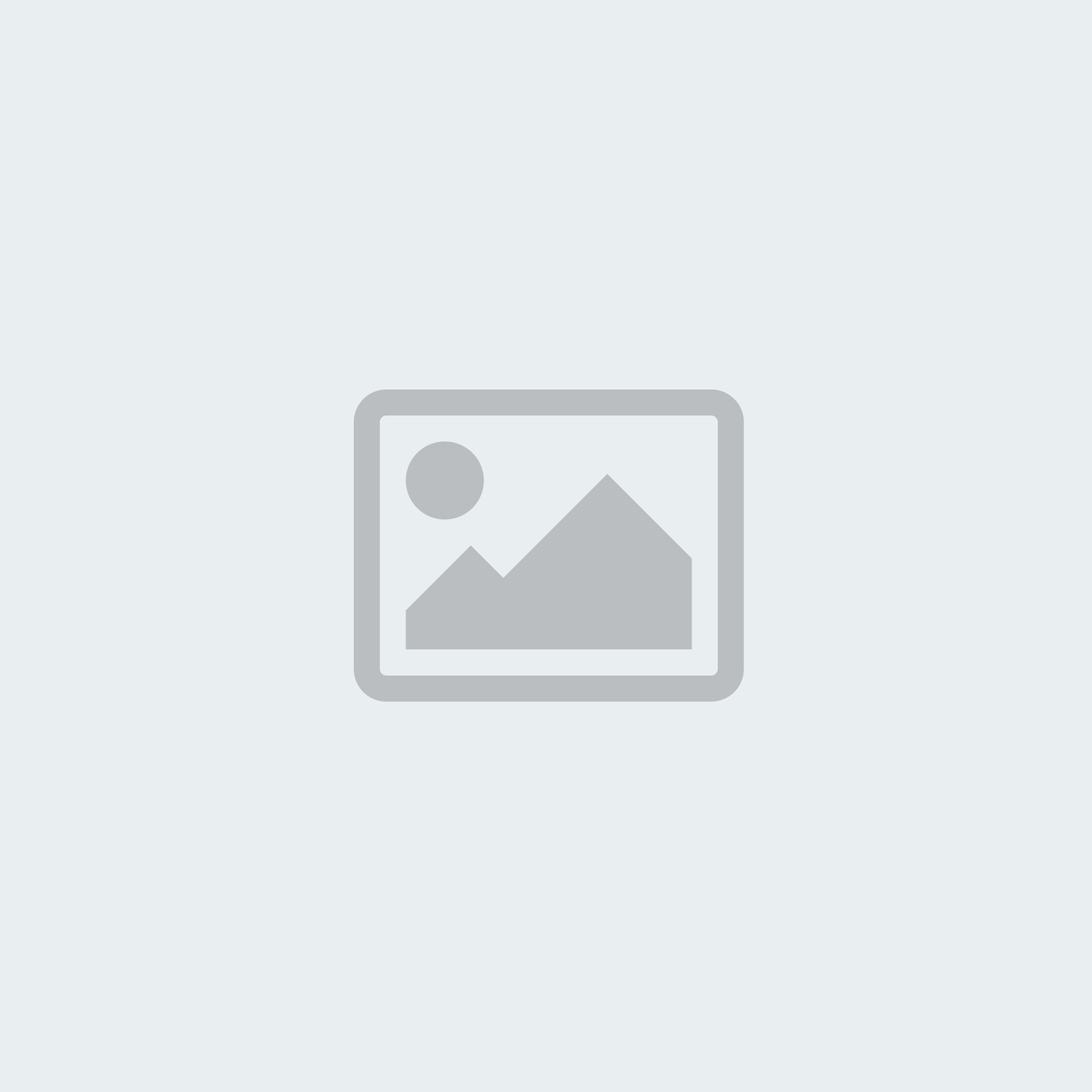|
Principales aides accordées aux handicapés ou à leurs proches | |
|---|---|
|
Nature de l'aide |
§ § |
|
Aides accordées aux parents d'enfants handicapés | |
|
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément | |
|
Les autres aides accordées aux parents d'enfants handicapés | |
|
Ressources des adultes handicapés jusqu'à 60 ans | |
|
Allocation aux adultes handicapés (AAH) | |
|
Complément d'AHH pour logement indépendant, complément de ressources et majoration pour vie autonome | |
|
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) | |
|
Pension d'invalidité | |
|
Prestation de compensation | |
|
Ressources des adultes handicapés après 60 ans | |
|
Remplacement de l'AAH par un avantage vieillesse | |
|
Pension de retraite substituée à la pension d'invalidité | |
|
Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) | |
|
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) | |
|
Aide sociale | |
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ancienne allocation d'éducation spéciale : AES) vise à compenser les frais supplémentaires que le handicap d'un enfant entraîne pour ses parents.
Son montant est faible : 129,99 € par mois depuis le 1er avril 2015. Mais l'allocation vient s'ajouter aux autres prestations familiales auxquelles les parents peuvent éventuellement prétendre, notamment l'allocation journalière de présence parentale. Et lorsque le handicap de l'enfant est lourd, les parents ont droit à un complément d'allocation.
Les personnes assumant seules la charge d'un enfant handicapé qui ouvre droit à l'AEEH et qui a besoin d'une tierce personne bénéficient d'une majoration pour parent isolé d'enfant handicapé. En pratique, cette majoration n'est versée que si :
- l'état de l'enfant permet d'obtenir au moins le complément d'AEEH de 2e catégorie ou la prestation de compensation (voir no 27211) ;
- la décision de la commission qui statue sur l'attribution du complément mentionne la nécessité de recourir à une tierce personne.
Aux personnes qui ont la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %, ou est compris entre 50 % et 80 % s'il remplit certaines conditions, notamment :
- la fréquentation d'un établissement spécialisé dans l'éducation et l'accompagnement des mineurs ou jeunes adultes handicapés ;
- le recours à un dispositif d'éducation ou d'accompagnement adapté.
Les parents et l'enfant doivent résider en France.
Il n'y a aucune condition de ressources.
L'AEEH est versée à la personne qui a la charge permanente et effective de l'enfant, soit dans la grande majorité des cas aux parents. Il peut également s'agir de la personne qui assure financièrement l'entretien de l'enfant et qui en assume la responsabilité affective et éducative bien que n'ayant pas de lien de parenté avec lui.
En cas de séparation de parents, la prestation de compensation (qui peut remplacer le complément d'AEEH, voir no 27211) peut servir à couvrir des dépenses du parent qui n'a pas la charge de l'enfant, sous réserve d'un compromis écrit des deux parents sur les modalités d'aides qui incombent à chacun.
Elle est versée dès la naissance de l'enfant et en principe jusqu'à ses 20 ans.
A partir de 16 ans, l'enfant cesse d'ouvrir droit à l'AEEH s'il perçoit des revenus professionnels excédant 55 % du Smic calculés sur la base de 169 heures de travail par mois, soit 893,25 € (1 624,09 € × 55 %) depuis le 1er janvier 2015. A noter que l'adolescent pourra, le cas échéant, prétendre à l'allocation pour adultes handicapés.
Lorsque le handicap de l'enfant entraîne des dépenses spécialement lourdes et/ou nécessite l'aide d'une tierce personne, un complément s'ajoute à l'AEEH.
Il existe six montants différents de complément. Le montant versé est fonction de la catégorie dans laquelle l'enfant a été classé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui se substitue à la commission départementale d'éducation spéciale (CDES). Les critères de classement dans chaque catégorie et les montants de complément d'AEEH au 1er avril 2015 figurent dans le tableau ci-après.
|
Catégories |
Critères de classement |
Complément |
Majoration personne isolée |
|---|---|---|---|
|
1e catégorie |
Enfant dont le handicap entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 227,48 € |
97,49 € |
|
|
2e catégorie |
Enfant dont le handicap : - contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à un temps plein ; - ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins 8 h par semaine ; - ou entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 394,02 € |
264,04 € |
52,81 € |
|
3e catégorie |
Enfant dont le handicap entraîne l'une des 3 situations suivantes : - il contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50 % par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins 20 h par semaine ; - il contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 20 % par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins 8 h par semaine et il entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 239,66 € ; - il entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 503,70 €. |
373,71 € |
73,12 € |
|
4e catégorie |
Enfant dont le handicap entraîne l'une des 4 situations suivantes : - il contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein ; - il contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50 % par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins 20 h par semaine et il entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 335,41 € ; - il contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 20 % par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée au moins 8 h par semaine et il entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 445,08 € ; - il entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 709,12 €. |
579,13 € |
231,54 € |
|
5e catégorie |
Enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 291,01 €. |
740,16 € |
296,53 € |
|
6e catégorie |
Enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein et dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. |
1 103,08 € |
434,64 € |
Les enfants handicapés ont le choix entre la prestation de compensation (étudiée aux nos 27395 s.) et le complément d'AEEH. Ce choix doit être exercé dans les 15 jours suivant la transmission du plan personnalisé de compensation par la maison départementale des personnes handicapées. Lorsque la personne n'exprime aucun choix, soit elle bénéficie déjà d'une de ces deux prestations, et, dans ce cas, elle continue de la percevoir, soit elle ne perçoit aucune des deux prestations, et elle percevra alors le complément d'AEEH.
Les parents d'enfants handicapés bénéficiant de l'AEEH peuvent prétendre à la prestation de compensation pour les seuls frais exposés pour l'aménagement du logement ou du véhicule ou le transport de l'enfant. Dans ce cas et si les conditions énumérées dans le tableau ci-dessus sont remplies, les familles peuvent conserver le droit à un complément d'AEEH mais ces frais ne seront pas pris en compte pour l'attribution de ce complément.
Les parents ont-ils droit à l'AEEH lorsque leur enfant est placé dans une structure spécialisée ?
Si l'enfant est confié à une structure d'hébergement ou à une famille d'accueil en vue de la fréquentation en externat ou semi-internat d'un établissement spécialisé dans l'éducation et l'accompagnement des jeunes handicapés, l'AEEH est versée aux parents si l'enfant revient à leur domicile pour le week-end et si la pension versée à la structure d'hébergement ou à la famille d'accueil suffit à couvrir les frais d'entretien (nourriture et hébergement). A défaut, la famille d'accueil ou la structure d'hébergement perçoit l'allocation.
Si l'enfant fréquente un établissement en semi-internat mais est admis certains mois en internat, l'allocation est versée si la période d'internat a duré moins de la moitié du mois.
Si l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, l'AEEH est due pour les périodes de retour au foyer (week-end, vacances, etc.). Elle est versée une fois par an pour l'ensemble des périodes.
Il faut en faire la demande. Celle-ci est établie sur un imprimé spécial disponible auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Elle doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées, qui la transmet à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Prise par la CDAPH, elle porte sur le pourcentage d'incapacité de l'enfant, le droit à l'allocation et à l'un ou l'autre complément et la durée de versement de l'allocation (entre un et cinq ans).
En principe, le président de la CDAPH notifie la décision à la personne handicapée (ou son représentant légal) et à la caisse d'allocations familiales.
La décision doit être motivée et indiquer les délais et les organismes de recours.
Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet (on parle alors de décision « implicite » de rejet).
Si l'état de l'enfant s'aggrave, il est possible de faire une nouvelle demande avant le terme fixé par la commission, par exemple pour obtenir le complément d'AEEH ou un complément de montant supérieur.
Le versement peut aussi cesser avant terme lorsque les conditions générales d'octroi des prestations familiales ne sont plus remplies, par exemple si l'enfant ne réside plus en France.
Notons que la CAF (organisme payeur) est tenue d'appliquer la décision de la commission dès lors que les conditions d'ouverture du droit, c'est-à-dire les conditions générales d'ordre administratif (résidence, charge effective de l'enfant, etc.) sont bien remplies.
Lorsque la CDAPH préconise des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, la demande d'allocation est réexaminée dans les deux ans. S'il apparaît alors que la personne en charge de l'enfant n'a pas suivi ces recommandations, l'allocation peut être suspendue ou supprimée, après audition de la personne en charge de l'enfant si elle en fait la demande.
Si le recours concerne les conditions médicales, les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la charge peuvent intenter un recours contentieux dans les deux mois de la réception de la décision explicite ou implicite de la CDAPH. Le recours est porté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (le tribunal compétent est celui de la résidence de l'enfant). Il est possible de faire appel de la décision du tribunal devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Avant le recours contentieux, il est aussi possible (mais pas obligatoire) de faire un recours gracieux auprès de la commission elle-même. La procédure de conciliation mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées a vocation à permettre ce recours gracieux : voir no 27011.
Lorsque la décision de la CDAPH diffère des propositions faites dans le plan personnalisé de compensation (modification du montant du complément d'AEEH ou du montant de la prestation de compensation), les parents ou la personne qui a l'enfant en charge ont un mois, à partir de la notification de la CDAPH, pour modifier leur choix.
Si le recours porte sur l'appréciation des conditions administratives, les intéressés doivent saisir, dans les 2 mois qui suivent la décision, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale (CAF). La décision de la commission peut, elle-même, être contestée dans le délai de 2 mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le cas échéant, un appel puis un recours en cassation sont ensuite possibles.
L'AEEH est versée par la CAF ou la caisse de MSA pour les agriculteurs.
L'allocation est due à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les compléments sont dus le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies (par exemple si l'un des parents cesse son activité le 15 mai, le complément sera dû à compter du 1er juin).
En pratique, eu égard à la durée de la procédure, le 1er versement intervient souvent après la date à laquelle les sommes sont dues. Il comporte alors un rappel d'une ou plusieurs échéances antérieures.
Par la suite, allocation et complément sont versés mensuellement.
En règle générale, l'AEEH et son complément sont revalorisés le 1er janvier de chaque année.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement de l'AEEH et de son complément cesse à compter du 1er jour du 3e mois civil suivant le début de l'hospitalisation, sauf si les contraintes liées à celle-ci entraînent pour les parents une réduction ou une cessation de l'activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses identiques à celles requises pour l'attribution du complément. La prestation peut alors être maintenue sur décision de la CDAPH.
L'allocation et son complément ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu, ni à la CSG, ni à la CRDS. Ils ne sont pas cessibles et ne peuvent pas être saisis sauf pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation de l'enfant, notamment en établissement.
A côté de l'AEEH et de son complément auxquels ils peuvent prétendre, les parents d'enfants handicapés bénéficient d'autres aides. On exposera ci-après nos 27236 s. le régime des plus importantes. Evoquons ici pour mémoire les mesures analysées ailleurs dans le Mémento :
- droit de prendre un congé de présence parentale ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant handicapé ;
- exonération de cotisations patronales de sécurité sociale accordée aux personnes ayant la charge d'un enfant handicapé et employant une aide à domicile.
Certaines municipalités, notamment les plus importantes, accordent des aides aux parents d'enfants handicapés qui viennent s'ajouter à celles accordées par l'Etat. Par exemple, la Ville de Paris verse une « allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés », de 153 € par mois en 2014, accordée sans condition de ressources. Renseignez-vous à la mairie de votre domicile.
Le père (ou la mère) contraint de rester au foyer pour s'occuper d'un enfant handicapé et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle peut être affilié gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Les conditions requises pour cette affiliation gratuite sont notamment les suivantes :
- les ressources des parents ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'octroi du complément familial (les plafonds de ressources ainsi que les formalités à accomplir pour bénéficier de cette prestation sont détaillés sur le site www.caf.fr) ;
- l'enfant doit avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 % et ne doit pas être admis en internat.
L'affiliation est accordée à l'un des parents ou à la personne seule en charge de l'enfant.
En principe, l'affiliation est faite à la diligence de l'organisme qui verse les prestations familiales.
Le montant de la pension est celui auquel le parent aurait eu droit en travaillant à temps plein au Smic.
L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse bénéficie aussi à la personne qui assume la charge au foyer familial d'un handicapé adulte dont la CDAPH a reconnu qu'il avait besoin d'une présence ou d'une assistance, pourvu que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire de Pacs, un ascendant, un descendant ou un collatéral, ou un ascendant, un descendant ou un collatéral de l'un des membres du couple.
Les conditions de ressources doivent également être remplies.
L'affiliation est faite par l'organisme qui verse les prestations, après avis motivé de la CDAPH.
Les enfants handicapés qui ne peuvent pas utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap ont droit au remboursement des frais de transport qu'ils engagent pour se rendre de leur domicile à l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent.
Il peut s'agir d'un établissement primaire, secondaire, ou d'enseignement supérieur.
La gravité du handicap et l'impossibilité de prendre les transports en commun sont constatées par la CDAPH.
Les frais sont pris en charge par le département (par le syndicat des transports d'Ile-de-France). Ils sont remboursés sur justificatifs à la famille de l'enfant si celui-ci est mineur, à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Si la scolarité comprend une période de formation en entreprise, la prise en charge concerne également les frais engagés pour se rendre sur le lieu de formation.
Certaines personnes handicapées sont dans l'incapacité de travailler ou ne peuvent exercer qu'une activité professionnelle réduite. Quelles sont alors leurs ressources ?
Celles dont le handicap a été précédé d'une période d'activité professionnelle, assurées contre l'invalidité, perçoivent une pension d'invalidité.
Les autres personnes, par exemple handicapées de naissance ou dont le handicap est survenu pendant l'enfance, ont droit, lorsqu'elles n'ont pas de ressources personnelles ou que celles-ci sont insuffisantes, à une allocation aux adultes handicapés (AAH), assortie, le cas échéant, d'un ou plusieurs compléments.
Enfin, les personnes handicapées confrontées à des frais supplémentaires spécifiques liés à leur handicap peuvent prétendre à la prestation de compensation.
En principe, l'arrivée à l'âge minimum ouvrant droit à la pension de vieillesse entraîne la suppression du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsqu'ils atteignent cet âge, les intéressés doivent demander la liquidation de leur retraite ou le bénéfice du minimum vieillesse s'ils n'ont pas acquis de droits à retraite. Pour les personnes percevant une pension d'invalidité, des règles particulières s'appliquent si elles exercent encore une activité professionnelle (voir no 27444).
L'AAH vise à garantir un minimum de ressources aux personnes handicapées en âge de travailler, mais qui n'en ont pas la capacité ou ont une capacité de travail réduite et qui n'ont pas ou n'ont que peu de revenus.
Pour la percevoir, il faut :
- avoir dépassé l'âge auquel on peut prétendre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est-à-dire en principe 20 ans (16 ans en cas d'exercice d'une activité professionnelle procurant un minimum de ressources : voir no 27206) ;
- présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou un taux compris entre 50 % et 80 % à condition de subir, du fait du handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi, c'est-à-dire rencontrer d'importantes difficultés pour accéder à l'emploi, liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées (pour apprécier si ces difficultés sont liées au handicap, la CDAPH les compare à celles d'une personne sans handicap placée dans les mêmes conditions d'accès à l'emploi) ;
- avoir des ressources inférieures à un certain plafond (voir nos 27251 s.) ;
- avoir sa résidence en France (des dispositions particulières sont prévues afin de permettre aux bénéficiaires de l'allocation des séjours prolongés à l'étranger dans un but d'étude, d'apprentissage d'une langue étrangère ou de formation professionnelle).
Les étrangers doivent être en situation régulière. Des règles particulières s'appliquent, par ailleurs, aux ressortissants communautaires.
En outre, pour bénéficier de l'AAH, allocation subsidaire, il ne faut pas avoir droit à un avantage vieillesse, invalidité ou accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. Cela signifie que :
- si on a droit à un tel avantage et qu'il est supérieur à l'AAH à laquelle on pourrait prétendre, l'AAH n'est pas versée ;
- s'il est inférieur, l'AAH est versée mais sous la forme d'une allocation « différentielle ».
La notion d'avantage retraite, invalidité ou accident du travail recouvre notamment les retraites des régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés, personnelles et de réversion, ainsi que les retraites complémentaires obligatoires. Elle ne concerne ni les allocations de préretraite ASFNE, ni les prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire (mais les sommes concernées sont prises en compte dans la condition de ressources).
La majoration pour tierce personne (ou la prestation complémentaire pour recours à tierce personne) perçue par les titulaires d'un avantage invalidité ou accidents du travail n'est pas prise en compte dans l'évaluation de cet avantage pour l'attribution et le calcul de l'AAH (mais elle sera déduite de la prestation de compensation).
Le droit à l'AAH est examiné tous les trimestres pour les bénéficiaires de l'AAH exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les ressources prises en compte pour le calcul des droits sont celles perçues le trimestre précédent (trimestre de référence). Ainsi, l'allocation versée en avril, mai et juin 2015 est calculée sur la base des ressources déclarées en janvier, février et mars 2015.
L'évaluation des ressources est annuelle (période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre) pour tous les autres titulaires de l'AAH, sans activité professionnelle, dont ceux admis en Esat. On prend les ressources de l'année civile de l'avant-dernière année précédant la période de paiement et on les compare au plafond de ressources (égal à 12 fois le montant de l'AAH). Par exemple, pour savoir si une personne a droit à l'AAH pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, on compare les ressources qu'elle a perçues pendant l'année 2013 au plafond de ressources. Les droits sont réexaminés chaque année le 1er janvier.
Le plafond de ressources étant égal selon le cas à 3 ou à 12 fois le montant de l'AAH, il est augmenté lorsque des revalorisations interviennent en cours d'année.
Pour avoir droit à l'AAH en 2015, les ressources perçues en 2013 (en cas d'évaluation annuelle) ou perçues pendant le trimestre de référence (en cas d'évaluation trimestrielle) doivent être inférieures ou égales aux montants suivants :
- pour une personne seule : 9 605,40 € (2 401,35 € pour une évaluation trimestrielle) ;
- pour un couple sans enfant : 19 210,80 €, soit le double du plafond pour une personne seule (4 802,70 € pour une évaluation trimestrielle) ;
- majoration pour enfant à charge : 4 802,70 €, soit la moitié du plafond pour une personne seule (1 200,68 € pour une évaluation trimestrielle).
La situation familiale du handicapé est prise en compte : s'il est marié, a conclu un Pacs ou vit en concubinage, on retient les ressources du couple, le plafond étant alors doublé ; en cas d'enfant à charge, le plafond est augmenté en conséquence (on fait abstraction des ressources des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune).
Vous travaillez en milieu ordinaire de travail et vous percevez les revenus de cette activité professionnelle : vous êtes concerné par la DTR.
Quand déclarer vos ressources ? Votre CAF vous envoie automatiquement votre première DTR (formulaire Cerfa no 14208*01). Vous devez la remplir et la lui renvoyer le plus rapidement possible (il est recommandé de renvoyer la DTR au plus tard le 25 du mois pour un versement de l'AAH le 5 du mois suivant). Une fois que vous aurez rempli cette première déclaration, vous recevrez les suivantes tous les trois mois. Attention : n'oubliez pas de signer votre DTR avant de la renvoyer et d'y joindre les copies des documents demandés.
Comment déclarer vos ressources ? La DTR est à votre nom, mais concerne aussi votre conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Vous devez déclarer les changements éventuels survenus au cours du dernier trimestre (nouvelle activité, cessation d'activité, changement de situation familiale, déménagement, etc.) Vous devez envoyer une DTR tous les trois mois, même si vos revenus ou votre situation professionnelle ou personnelle ne changent pas. Vous pouvez également déclarer vos ressources directement en ligne sur le site www.caf.fr (espace « Mon compte », rubrique « Mes démarches, déclarations trimestrielles »).
Que se passe-t-il si vous ne renvoyez pas votre DTR à temps ? Vos droits sont maintenus à 50 % pendant 2 mois seulement et à titre d'avance. Si vous n'avez toujours pas renvoyé votre DTR au bout de 3 mois, vos droits sont suspendus et l'avance versée pendant 2 mois devra être restituée. Soyez donc vigilant.
Pouvez-vous passer de la DTR à la déclaration annuelle des ressources ? Oui. Si vous cessez de travailler en milieu ordinaire et si vous ne reprenez pas d'activité pendant 9 mois consécutifs. Le 1er janvier suivant, vos droits seront à nouveau évalués annuellement. Avant cette date, vous restez soumis à la DTR.
En principe, celles retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par la personne handicapée et son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, auxquelles on applique un coefficient de 0,8 dès lorsqu'il s'agit de salaires, rentes et pensions, revenus non salariés, à l'exception de certaines prestations à caractère social.
Sont pris en compte les revenus nets. On applique à chaque catégorie de revenus les abattements et déductions qui lui sont propres.
Ce principe supporte plusieurs exceptions, les unes favorables, les autres non.
Au titre des exceptions favorables, sont exclus du décompte des ressources :
- les rentes versées dans le cadre de contrats de rente-survie (c'est-à-dire constituées pour le handicapé par un tiers) ;
- les rentes issues de contrats d'épargne-handicap (constituées par le handicapé pour lui-même) dans la limite de 1 830 € par an (sans limite pour les contrats souscrits dans le cadre des plans d'épargne populaire, à condition que le versement intervienne au-delà de la 8e année suivant l'ouverture du plan). Cette limite s'apprécie non pas par rapport au montant brut mais par rapport à la fraction imposable ;
- les salaires perçus en tant qu'aidant familial par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de l'allocataire ;
- la prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise en Esat.
Lorsque l'allocataire débute ou reprend une activité professionnelle, les revenus de cette activité ne sont pas pris en compte pendant les 6 premiers mois. Après cette période, les revenus d'activité professionnelle sont pris en compte mais avec un abattement égal à : 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % du Smic mensuel (base 151,67 heures) en vigueur le dernier jour du trimestre précédent ; 40 % pour la tranche de revenus supérieure.
Un abattement de 20 % est appliqué aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus d'activité professionnelle ou d'activité en Esat perçus par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs.
Enfin, les revenus d'activité à caractère professionnel des personnes handicapées admises en Esat bénéficient d'un abattement de 3,5 % à 5 % en fonction du niveau du salaire direct (0,5 % par tranche de 5 % de salaire direct, jusqu'à 25 %).
ConseilLes personnes handicapées sans activité professionnelle ou admises en Esat n'ont pas de déclaration de ressources à fournir. Elles doivent donc mentionner dans la déclaration de revenus les rentes-survie dont elles sont bénéficiaires dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. Cette déclaration ne faisant pas de distinction entre les différents types de rentes, les CAF n'ont pas la possibilité de savoir s'il s'agit d'une ressource exclue du décompte pour le calcul du montant des droits. Nous conseillons donc aux bénéficiaires d'une rente-survie de l'indiquer par courrier à la CAF dont ils dépendent.
Au titre des exceptions défavorables, sont pris en compte dans le décompte des ressources :
- les indemnités journalières servies par la sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, après déduction de 10 % pour frais professionnels ;
- les revenus d'origine étrangère ou versés par des organisations internationales.
Enfin, on applique au total des revenus nets les déductions et abattements qui suivent :
- l'abattement en faveur des personnes âgées ou invalides à revenus modestes (cet abattement ne s'applique pas aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire) ;
- la déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants, descendants ou en cas de divorce ou de séparation ;
- la déduction de frais de garde des jeunes enfants ;
- les frais de tutelle et de curatelle.
Qu'arrive-t-il si les ressources de la personne handicapée diminuent ou augmentent, ou encore si sa situation familiale est modifiée après la fin de la période de référence (année ou trimestre) ?
Ces modifications sont sans effet sur le calcul de l'allocation pour la période en cours.
Par exception, le droit à allocation peut être réexaminé et le montant de celle-ci modifié :
- dans les cas qui ouvrent droit à révision des prestations familiales et selon les mêmes modalités (séparation, décès, cessation d'activité, maladie ou encore augmentation des revenus) ;
- lorsque l'allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs réduit, pendant 2 mois consécutifs, la durée de son activité professionnelle ou de son activité en Esat, il est appliqué aux revenus annuels ou trimestriels un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure (sans que cet abattement puisse dépasser 80 %) ; l'abattement s'applique à compter du 1er jour du mois civil qui suit la réduction de la durée d'activité et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours ;
- lorsque le bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement : le droit est réexaminé sans tenir compte des revenus d'activité professionnelle ou des allocations chômage perçus pendant la période de référence annuelle ou trimestrielle ; cette mesure s'applique du 1er jour du mois civil suivant la cessation d'activité jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle.
Le montant de l'AAH est fixé à 800,45 € par mois.
Il s'agit là d'un montant maximum que tous les bénéficiaires de l'AAH ne perçoivent pas. En effet, lorsque la personne handicapée a des revenus (par hypothèse inférieurs au plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de l'AAH), elle perçoit une allocation réduite selon des modalités qui diffèrent en fonction de la nature de ces ressources.
Bien entendu, la perception de ressources personnelles non prises en compte pour l'attribution de l'AAH n'entraîne aucune réduction de l'allocation. Par exemple, une personne qui a pour seules ressources une rente résultant d'un contrat de rente-survie, même d'un montant élevé, est considérée comme n'ayant aucune ressource et perçoit le montant total maximum de l'AAH.
Signalons enfin que le cumul entre AAH et garantie de rémunération des handicapés travaillant en Esat fait l'objet d'un plafonnement spécifique en fonction du Smic. En cas d'admission dans un Esat, les éventuels trop-perçus sont déduits des montants d'allocations versés ultérieurement (ou reversés par l'allocataire).
L'allocation aux adultes handicapés ne subit aucun prélèvement social, ni cotisations de sécurité sociale, ni CSG, ni CRDS.
Lorsque le bénéficiaire de l'AAH a des ressources (autres qu'un avantage retraite, invalidité ou accident du travail), par exemple des salaires, des loyers ou des dividendes, son allocation mensuelle est égale à la différence entre le plafond d'octroi de l'AAH et ces ressources, divisée par 3 (en cas d'appréciation trimestrielle) ou par 12, dans la limite du montant mensuel de l'AAH.
Exemples. 1. Soit une personne handicapée vivant seule. Les ressources nettes qu'elle a perçues en 2013, provenant par exemple du loyer d'un appartement ou d'un portefeuille d'actions, se sont élevées à 2 800 €. Au 1er septembre 2015, son allocation mensuelle est égale à (9 605,40 € - 2 800 €)/12, soit 567,11 €.
2. Soit une personne handicapée vivant en couple. Les ressources nettes du couple en 2013 se sont élevées à 10 500 €, correspondant par exemple à la rémunération perçue par le conjoint salarié. Au 1er septembre 2015, son allocation mensuelle est de (19 210,80 € - 10 500 €)/12, soit 725,90 €.
Il existe une exception à l'application du différentiel : les allocataires travaillant en milieu ordinaire peuvent cumuler intégralement l'AAH et les revenus tirés de leur activité pendant 6 mois, à compter de la reprise d'activité. Après cette période de cumul intégral, l'allocataire bénéficie d'un cumul partiel avec un abattement dont le pourcentage est fonction du revenu (voir no 27260).
Lorsque le bénéficiaire de l'AAH perçoit un avantage retraite, invalidité ou accident du travail (hors majoration pour tierce personne), on effectue d'abord le calcul décrit ci-dessus.
Puis on retranche du montant maximum de l'AAH le montant mensuel de l'avantage perçu par l'intéressé au cours du trimestre qui précède la période d'ouverture du droit à l'AAH.
On compare les deux résultats et on applique la réduction la plus importante, c'est-à-dire la plus défavorable à l'intéressé.
Soit une personne handicapée vivant seule qui a eu pour seules ressources en 2013 et 2014 une pension d'invalidité de 340 € par mois. Son revenu brut pour 2013 a donc été de 4 080 € et son revenu net (après application de la déduction pour frais professionnels de 10 %) de 3 672 €. Si l'on effectue le premier calcul, on obtient une AAH de (9605,40 € - 3 672 €)/12, soit 494,45 €, d'où une réduction de (800,45 € - 494,45 €) = 306 €. Le second calcul aboutit à une réduction de 340 € par mois. C'est la réduction de 340 € par mois qui sera appliquée. L'intéressé percevra donc une AAH de 460,45 € par mois (800,45 € - 340 €).
Reprenons l'exemple de la personne handicapée vivant en couple du no 27272, mais supposons que les 10 500 € de ressources nettes annuelles du couple se composent pour une part d'une pension d'invalidité versée à la personne handicapée et égale en 2013 et 2014 à 450 € par mois, et pour le reste de la rémunération du conjoint salarié.
Le premier calcul aboutit à une réduction du montant de l'AAH de 74,55 € par mois (soit 800,45 € - 725,90 €).
Le second calcul aboutit à une réduction de 450 € par mois.
C'est la réduction de 450 € qui est appliquée. L'intéressé percevra donc une AAH de 350,45 € par mois (soit 800,45 € - 450 €).
Il faut en faire la demande auprès de la MDPH de son lieu de résidence, au moyen d'un formulaire « demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources » et d'un certificat médical.
La demande est remplie par la personne handicapée elle-même ou son représentant légal, le certificat médical par le médecin traitant.
Une fois remplis, datés et signés, les documents, accompagnés des pièces justificatives, doivent être déposés ou adressés à la MDPH (voir liste sur le site de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie www.cnsa.fr).
La maison départementale transmet un exemplaire du dossier à la CAF et à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
La CDAPH se prononce sur le taux d'invalidité de l'intéressé et sur ses capacités à se procurer un emploi.
Pour cela, chaque dossier est instruit par une équipe technique spécialisée qui procède à des investigations d'ordre social, médical et professionnel.
Le handicapé (ou son représentant légal) est convoqué à la séance au cours de laquelle la commission examine son cas.
La commission a deux possibilités :
- prendre une décision et envoyer le dossier à la CAF ;
- demander à la CAF de procéder à l'examen des conditions administratives avant de prendre sa décision.
L'instruction d'une demande d'AAH déclenche automatiquement la procédure de reconnaissance de travailleur handicapé. Toutefois, aucune obligation d'insertion professionnelle n'est imposée aux titulaires d'AAH ; par ailleurs, le bénéficiaire n'est pas obligé d'informer son employeur de cette reconnaissance.
En principe, l'organisme qui verse les prestations familiales procède à la notification de la décision à l'intéressé. Celle-ci doit être motivée et indiquer les voies et les délais de recours ainsi que l'adresse des instances auxquelles ces recours doivent être adressés.
Toutefois, le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH à compter de la date de dépôt de la demande vaut décision de rejet (on parle alors de « décision implicite » de rejet). Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme qui verse les prestations familiales vaut également décision de rejet.
Si le refus est motivé par un taux d'invalidité jugé insuffisant et/ou la capacité du handicapé à se procurer un emploi, le recours doit être fait devant une juridiction spécialisée, le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de l'intéressé. Le recours doit être présenté dans les 2 mois de la notification de la décision explicite ou de l'intervention de la décision implicite. Les jugements du tribunal sont susceptibles d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité dans le délai d'un mois.
Il est possible, avant d'intenter un recours contentieux, de revenir devant la MDPH en vue d'un réexamen du dossier. Ce recours gracieux d'une durée maximale de 2 mois suspend le délai de recours contentieux.
Sur la procédure de conciliation, voir no 27011.
Si le motif du refus est administratif, notamment s'il tient aux ressources de l'intéressé, le recours doit être porté devant la commission de recours amiable de l'organisme qui verse les prestations dans les 2 mois de la notification de la décision implicite ou de l'intervention de la décision implicite, la décision de la commission pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, également dans un délai de 2 mois.
En principe pour une durée comprise entre un et cinq ans. Mais la CDAPH peut fixer une durée d'attribution supérieure - sans dépasser dix ans - lorsque le taux d'incapacité est d'au moins 80 % et que le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
Dans tous les cas, si l'état du handicapé évolue, le droit à l'AAH peut être révisé avant la fin de la période initialement fixée, sur demande de l'intéressé ou de l'organisme qui verse les prestations familiales.
A la fin de la période de cinq ou dix ans, une nouvelle demande pourra être effectuée dans les conditions décrites au no 27278.
L'AAH est due à compter du 1er jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande (compte tenu des délais d'instruction du dossier, le premier versement intervient généralement après cette date, surtout pour les premières demandes ; il comporte alors le paiement d'arriérés).
L'allocation est versée tous les mois par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence des intéressés (pour les agriculteurs par la caisse de MSA).
L'AAH est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. La personne ou l'organisme qui en assume la charge peut alors obtenir que l'allocation lui soit versée directement par la caisse qui verse les prestations.
Lorsqu'un handicapé séjourne pendant plus de 60 jours dans un établissement de santé ou une maison d'accueil spécialisée, son allocation est réduite de 70 %. Elle laisse un « reste à vivre » de 240,14 € pour 2015. Toutefois, aucune réduction n'est effectuée si le bénéficiaire est astreint au paiement du forfait journalier hospitalier, s'il a au moins un enfant ou un ascendant à charge ou si son conjoint, son concubin ou partenaire de Pacs ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDAPH.
Avant le 1er juillet 2005, les règles de réduction de l'AAH en cas d'hospitalisation ou d'hébergement dans une maison d'accueil spécialisée étaient différentes. Lorsque ces anciennes règles leur sont plus favorables, les bénéficiaires de l'AAH dont l'allocation a été réduite peuvent continuer, sous certaines conditions, à en bénéficier.
Les personnes qui perçoivent l'AAH peuvent prétendre :
- à une affiliation gratuite à l'assurance maladie-maternité du régime général de la sécurité sociale lorsqu'elles ne sont pas affiliées à un autre titre à un régime obligatoire d'assurance maladie ; en principe, l'organisme qui verse l'AAH procède à l'affiliation ;
- sous certaines conditions, à l'allocation logement à caractère social.
Par ailleurs, certaines municipalités prévoient des allocations spécifiques pour les adultes handicapés.
Les frais de transport des personnes handicapées entre leur domicile et les foyers ou maisons d'accueil spécialisées où elles sont accueillies de jour sont intégrés dans les budgets de ces structures. S'agissant des modalités de prise en charge des frais visant les autres modes d'accueil, des dispositions doivent être prises. En attendant, les caisses primaires d'assurance maladie maintiennent, en principe, les remboursements.
Les titulaires de l'AAH habitant dans un logement indépendant ont droit, sous certaines conditions, à deux allocations : le complément de ressources des personnes handicapées sans activité professionnelle et la majoration pour vie autonome.
Jusqu'au 30 juin 2005, ces personnes pouvaient prétendre à un complément d'AAH pour logement indépendant. Celles qui en bénéficiaient avant le 1er juillet 2005 continueront à le percevoir :
- jusqu'à la fin de la période pour laquelle il leur a été attribué ;
- ou jusqu'à la date à laquelle elles bénéficieront du complément de ressources ou de la majoration pour vie autonome (si elles ont droit à ces allocations).
Ces deux compléments d'allocations ne sont pas cumulables. La personne qui remplit les conditions d'octroi des deux avantages doit choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre.
Il est versé au titulaire de l'AAH qui remplit quatre conditions :
- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 % ;
- ne pas avoir perçu de revenu professionnel depuis un an ;
- percevoir l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- disposer d'un logement indépendant. La personne handicapée hébergée par son conjoint, son concubin ou partenaire de Pacs peut prétendre au complément.
Le montant du complément de ressources est fixé à 179,31 € par mois.
Il prend fin en cas de reprise d'une activité professionnelle ou à l'âge minimal de la retraite.
Le versement du complément est suspendu après 60 jours d'hospitalisation ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social. Il reprend, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois qui suit la fin de l'hospitalisation ou de l'hébergement.
Pour la percevoir, il faut remplir les conditions suivantes :
- avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ;
- ne pas percevoir de revenu professionnel ;
- percevoir l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
- disposer d'un logement indépendant pour lequel on reçoit une aide personnelle au logement (la personne handicapée hébergée par son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs peut prétendre à la majoration). Sont, sous certaines conditions, considérées comme disposant d'un logement indépendant les personnes handicapées hébergées en familles d'accueil, dans la mesure où elles s'acquittent d'une indemnité représentative de mise à disposition des pièces qui leur sont réservées et peuvent bénéficier, à ce titre, d'une allocation de logement.
Son montant mensuel est de 104,77 €.
Les personnes travaillant en milieu protégé n'ont pas droit au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome (contrairement aux règles établies pour l'AAH).
Destinée aux handicapés disposant de faibles ressources, l'allocation compensatrice pour tierce personne, en abrégé ACTP, peut encore être versée aux personnes qui en bénéficiaient avant la mise en place de la prestation de compensation.
Il est fonction de l'aide nécessaire et des frais supplémentaires supportés par le handicapé.
Il est de 882,47 € par mois (80 % de la majoration des invalides du 3e groupe) lorsque le handicapé a besoin de l'assistance d'un tiers pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qu'il justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées, un ou plusieurs membres de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, ou dans un établissement d'hébergement. On parle d'allocation « au taux maximal ». Lorsque ces deux conditions ne sont pas réunies, le montant de l'ACTP est compris entre 441,23 € et 772,16 € (entre 40 % et 70 % de la majoration des invalides du 3e groupe). C'est l'allocation « à taux variable ».
Les actes essentiels de l'existence comprennent le lever, la toilette, l'habillage, les repas et les sorties à proximité du domicile. En revanche, s'occuper de ses enfants ou de l'entretien de son domicile n'en fait pas partie.
Les personnes atteintes de cécité (vision centrale inférieure à 1/20e de la vision normale) ont droit à l'allocation au taux maximal.
Versée mensuellement par les services du conseil général, l'allocation est suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et si le handicapé n'a pas recours à l'assistance d'un tiers. Des contrôles peuvent être effectués sur ce dernier point.
Cette allocation est progressivement supprimée et intégrée à la prestation de compensation au titre des aides humaines.
Mais pour l'heure, elle reste d'actualité. Elle est versée aux travailleurs handicapés résidant en France, âgés d'au moins 16 ans, dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 %, dont les ressources n'excèdent pas le plafond de l'AAH et qui exercent une activité professionnelle entraînant des frais supplémentaires que ne causerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.
Son montant est fonction des frais engagés, dans la limite de 882,47 € par mois (80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe), ces frais pouvant être réguliers et courants (transport, usure anormale des vêtements et, pour les non-salariés, téléphone et secrétariat) ou exceptionnels (appareils permettant d'exercer une profession, aménagement du véhicule ou du poste de travail).
Sa procédure d'obtention et les voies de recours sont celles applicables à l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Elle vise à aider les handicapés qui s'installent comme non-salariés à financer les équipements nécessaires. Son montant maximal est de 2 290 €. Pour la percevoir, il faut être français ou résider en France depuis au moins trois ans, être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 45 ans, avoir obtenu les diplômes nécessaires à l'exercice de la profession, être inscrit au registre du commerce, au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel et disposer d'un local remplissant les conditions habituelles d'exploitation. La profession choisie doit être conforme à l'avis d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La demande doit être déposée auprès de la CDAPH dans les 12 mois de la sortie de l'université ou de la fin du stage de formation permettant d'exercer la profession concernée. La décision est prise par le préfet au vu de l'avis motivé de la commission. Une convention est signée, précisant l'objet de la subvention et les modalités de contrôle de son utilisation.
Le salarié qui cesse de percevoir les indemnités journalières maladie de la sécurité sociale parce que son état s'est stabilisé ou parce que la durée maximale des versements est expirée peut en général prétendre, s'il ne peut pas reprendre une activité professionnelle ou si sa capacité de travail est réduite de manière importante et durable, à une pension d'invalidité.
Dans leur quasi-totalité, les non-salariés ont aussi une couverture invalidité : les commerçants et les artisans (régime social des indépendants ou RSI) et presque toutes les professions libérales (régime géré par leur caisse de retraite complémentaire). Attention : les prestations versées diffèrent considérablement selon les professions et peuvent être sensiblement moins élevées que la pension d'invalidité des salariés.
Peuvent prétendre à une pension d'invalidité les personnes qui justifient :
- d'une durée d'immatriculation minimale au régime général de la sécurité sociale ;
- d'un montant minimal de cotisations à ce régime ou d'un nombre d'heures de travail minimal ;
- d'un état d'invalidité reconnu par la sécurité sociale.
Pour avoir droit à une pension d'invalidité, il faut, au 1er jour du mois où l'interruption du travail suivie d'invalidité est intervenue, être immatriculé depuis au moins 12 mois au régime général de la sécurité sociale. C'est la première condition.
Pour apprécier la durée d'immatriculation, on prend en compte, sous certaines conditions, les périodes d'immatriculation aux régimes spéciaux des étudiants et des non-salariés.
Deuxième condition, il faut avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant l'interruption du travail suivie d'invalidité, sur un salaire égal à 2 030 fois le Smic horaire, dont la moitié au cours des 6 premiers mois. La valeur du Smic prise en considération est celle en vigueur au 1er janvier antérieur aux 12 mois civils précédant l'interruption de travail.
Ou bien il faut justifier d'un nombre d'heures minimal de travail : 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'arrêt de travail, dont 150 au moins au cours des 3 premiers mois.
Sont assimilés à du travail effectif les congés payés, le préavis et les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu des indemnités journalières maladie ou accident du travail, ces dernières périodes étant toutefois comptabilisées selon des modalités particulières.
Toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite des 2/3 est en état d'invalidité. Plus précisément, il faut être incapable de percevoir, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi occupé précédemment. C'est la troisième condition. L'état d'invalidité peut résulter d'un accident, d'une maladie ou de « l'usure prématurée de l'organisme ». Il est apprécié globalement en tenant compte des capacités physiques ou mentales du salarié, mais aussi de son âge et de sa formation professionnelle. Bref, l'invalidité est une question de fait.
L'état d'invalidité est apprécié par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. Le médecin traitant n'a pas de pouvoir de décision même si, en pratique, il est souvent en relation avec le médecin-conseil de la sécurité sociale.
En même temps qu'elle reconnaît qu'une personne est en état d'invalidité, la caisse primaire d'assurance maladie la classe en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie :
- la première catégorie regroupe les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- la deuxième, les invalides incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque ;
- la troisième, les invalides incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque et tenus de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le classement n'est pas définitif : une personne invalide peut passer de la 2e catégorie à la 1e catégorie. Reste que l'invalidité de 3e catégorie est souvent définitive.
Le classement dans une catégorie détermine le montant de la pension versée.
La pension d'invalidité est égale au produit du « salaire moyen de base » perçu par l'assuré avant la reconnaissance de son invalidité et d'un taux, fonction de la catégorie dans laquelle il a été classé.
Il est de 30 % pour les personnes classées en première catégorie et de 50 % pour celles classées dans la deuxième. La pension de la troisième catégorie est égale à la pension de la deuxième catégorie à laquelle s'ajoute une majoration pour tierce personne fixée à 1 103,08 € par mois.
AttentionEn cas d'hospitalisation, les invalides de 3e catégorie cessent de percevoir la majoration pour tierce personne le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'hospitalisation est intervenue, sauf en cas d'hospitalisation dans un établissement « de long séjour ».
Il est égal à la moyenne des salaires perçus par l'assuré au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui.
Pour calculer cette moyenne, on procède de la manière suivante :
- on reprend les salaires versés depuis que l'assuré a commencé à travailler, année par année ;
- lorsque le salaire d'une année est supérieur au plafond de la sécurité sociale applicable au cours de cette même année, on ne retient que ce plafond ;
- on applique à chaque salaire retenu un coefficient de revalorisation (identique à celui appliqué pour le calcul de la retraite de la sécurité sociale) ;
- on retient les dix rémunérations les plus élevées et on divise par dix.
Lorsque l'assuré a moins de dix années d'activité, on les retient toutes, les rémunérations de la première et de la dernière année étant cependant prises en compte selon des modalités particulières afin de ne pas pénaliser l'assuré (en effet, lorsque ces années sont des années d'activité incomplètes, ce qui est souvent le cas, les rémunérations correspondantes sont faibles ; si elles étaient prises en compte selon les modalités de droit commun, le salaire moyen servant de base au calcul de la pension s'en trouverait excessivement diminué).
La pension d'invalidité ne peut pas être inférieure à un minimum fixé à 281,65 € par mois. S'il n'a pas d'autres ressources ou si celles-ci sont peu importantes, l'invalide peut demander à bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité égale à 403,76 € par mois pour une personne seule et à 666,27 € pour un couple.
Les bénéficiaires d'une allocation supplémentaire peuvent, sous certaines conditions, avoir droit à la majoration pour vie autonome ou au complément de ressources dû à certains bénéficiaires de l'AAH (voir nos 27306 et 27308).
La pension d'invalidité ne peut pas excéder un maximum égal en 2015 à 951 € par mois pour les invalides de la 1e catégorie (30 % du plafond de la sécurité sociale), à 1 585 € par mois pour les invalides de la 2e catégorie (50 % du plafond de la sécurité sociale) et à 2 688,08 € par mois pour les invalides de la 3e catégorie (50 % du plafond de la sécurité sociale + majoration spécifique).
Dans certaines entreprises, notamment les plus importantes, les salariés bénéficient d'une assurance invalidité souscrite par l'employeur. En cas d'invalidité, ils perçoivent une pension qui vient compléter celle versée par la sécurité sociale.
La pension d'invalidité servie par la sécurité sociale est exonérée de cotisations sociales.
Elle supporte en revanche la CSG au taux de 6,6 % et la CRDS au taux de 0,5 %.
Cependant :
- sont exonérées de CSG et de CRDS la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie, la pension d'invalidité servie aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'invalidité ainsi que la pension d'invalidité servie aux personnes dont les revenus de l'avant-dernière année n'ont pas excédé un certain seuil : ainsi les personnes dont les revenus 2013 qui ont servi de base à l'impôt prélevé en 2014 étaient inférieurs ou égaux au revenu maximal fixé pour avoir droit à l'exonération partielle de taxe d'habitation verront leur pension d'invalidité de l'année 2015 exonérée de CSG et de CRDS ;
- la pension d'invalidité servie aux personnes dont l'impôt sur le revenu de l'année précédente a été inférieur à 61 € est soumise à la CSG au taux réduit de 3,8 % (mais supporte normalement la CRDS).
Depuis 2013, une cotisation annuelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) d'un montant de 0,3 % est prélevée sur les pensions d'invalidité assujetties à la CSG au taux plein de 6,6 %
Le titulaire d'une pension d'invalidité :
- perçoit les prestations en nature du régime général d'assurance maladie-maternité de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il est remboursé de ses frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc. ; il en est de même de ses ayants droit, c'est-à-dire des personnes qui lui sont rattachées au sens de ce régime ; il bénéficie de l'exonération du ticket modérateur, mais seulement pour les frais qu'il engage pour lui-même ;
- ouvre droit au capital décès de la sécurité sociale, calculé sur la base des dernières paies versées avant l'interruption du travail.
En règle générale les choses se déroulent en trois étapes :
- information de l'assuré ;
- instruction administrative et médicale du dossier ;
- décision d'attribution de la pension d'invalidité.
Lorsqu'une personne ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie parce que son état s'est stabilisé ou que la période maximale d'attribution de ces indemnités est expirée, la caisse primaire d'assurance maladie doit l'en informer.
Si le médecin-conseil de la sécurité sociale qui a suivi son dossier estime que sa capacité de travail est réduite des 2/3 et qu'il est en état d'invalidité, la caisse lui fait connaître sa décision de lui accorder une pension d'invalidité.
Pour bénéficier de la pension d'invalidité, il est nécessaire de remplir le formulaire « demande de pension » (disponible sur le site www.service-public.fr ou www.ameli.fr) et de l'adresser, accompagné des pièces justificatives, à la caisse primaire d'assurance maladie (ou à la Cramif en Ile-de-France).
Prise par la CPAM (par la Cramif en Ile-de-France) au vu d'un rapport du médecin-conseil, elle précise le degré d'invalidité de l'assuré, le montant de la pension qui lui est attribuée, ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertes.
Elle fait l'objet d'une notification à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
En principe, la caisse statue dans les 2 mois de la date à laquelle elle a informé l'assuré de sa décision de principe d'accorder une pension d'invalidité.
Il peut arriver que la CPAM notifie à une personne la fin de ses indemnités journalières d'assurance maladie parce qu'elle considère qu'elle est en mesure de reprendre son travail. Si cette personne (ou son médecin traitant) estime qu'elle est en état d'invalidité, elle peut présenter à la CPAM une demande de pension d'invalidité.
La demande doit être présentée dans les 12 mois de la date à laquelle la caisse a notifié à l'assuré la fin de ses indemnités journalières. Il est conseillé, même si ce n'est pas obligatoire, de procéder par lettre recommandée avec avis de réception.
A réception de la demande, la caisse adresse à l'assuré un formulaire de demande de pension d'invalidité et une attestation de l'employeur. Une fois remplis, ces documents doivent être retournés dans les meilleurs délais. Dans le même temps la caisse convoque l'intéressé à une visite médicale.
En principe, la caisse doit notifier sa décision dans les 2 mois de la réception de la demande de l'assuré, l'absence de réponse dans ce délai équivalant au rejet implicite de la demande.
Lorsque l'assuré n'est pas satisfait de la décision de la caisse, il peut faire un recours, qui doit être porté :
- s'il conteste le refus de la caisse de reconnaître son invalidité ou son classement dans telle ou telle catégorie, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans un délai de 2 mois ;
- si le refus de la caisse est motivé par des raisons administratives (durée d'immatriculation, cotisations ou heures de travail insuffisantes), devant la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois. La décision de la commission peut être portée, également dans un délai de 2 mois, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Lorsque le refus de la CPAM résulte de son silence gardé pendant 2 mois à compter de la demande de l'assuré, celui-ci ne peut pas savoir si la raison est d'ordre médical ou administratif. Il faut donc faire 2 recours, un devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et un devant la commission de recours amiable suivi d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La pension est due à la date de constatation de l'invalidité.
Elle est versée chaque mois par la caisse régionale d'assurance maladie, entre le 5e et le 8e jour du mois suivant celui auquel elle se rapporte.
Tous les trimestres, les titulaires de pension d'invalidité reçoivent un questionnaire de la caisse d'assurance maladie. Ils doivent le retourner, rempli, daté et signé. A défaut, le versement de la pension est suspendu.
La pension d'invalidité est toujours versée à titre temporaire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée si l'état d'invalidité de l'assuré évolue ou s'il reprend une activité professionnelle rémunérée.
Bien que cela puisse sembler paradoxal, l'hypothèse d'une reprise d'activité professionnelle concerne les invalides de 1e , 2e et 3e catégorie. En effet, aucune disposition légale n'interdit à une personne invalide de travailler, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée.
La pension est révisée, c'est-à-dire réduite ou augmentée, lorsque l'évolution de l'état de l'invalide justifie une modification de son classement. La caisse peut ainsi décider le passage de 3e en 2e catégorie d'une personne atteinte de cécité qui, s'adaptant à son handicap, parvient à une autonomie totale. A l'inverse, en cas de maladie grave et évolutive, un invalide peut passer de la 1e à la 2e catégorie, puis à la 3e .
La pension est suspendue lorsque l'invalide retrouve une capacité de gain supérieure à 50 % de sa capacité antérieure, c'est-à-dire lorsqu'il est en mesure de se procurer un salaire supérieur à la moitié de la rémunération normale d'un travailleur de même catégorie dans la profession exercée avant l'invalidité. Il n'en va autrement que dans certains cas de réadaptation professionnelle.
La caisse d'assurance maladie est en droit de faire passer à tout moment une visite médicale au titulaire d'une pension d'invalidité. Celle-ci a lieu dans les locaux de la caisse ou au domicile de l'intéressé s'il ne peut pas se déplacer. En cas de non-réponse à la convocation de la caisse primaire ou d'opposition à la visite du médecin, la pension peut être suspendue ou supprimée.
La pension d'invalidité est réduite ou même suspendue si son titulaire reprend une activité salariée ou non salariée et si, pendant deux trimestres consécutifs, la somme « pension d'invalidité + rémunération » excède le salaire trimestriel moyen revalorisé de l'année civile antérieure à l'arrêt de travail suivi d'invalidité. On retranche alors de la pension mensuelle le tiers du dépassement constaté au cours du trimestre qui précède.
La suspension ou la réduction de la pension ne touche pas la majoration pour tierce personne qui continue à être versée.
La prestation de compensation a pour objet d'aider les personnes handicapées à faire face aux dépenses qui sont liées à leur handicap, au contraire des autres prestations (AAH, pension d'invalidité et rentes d'accident du travail) qui visent à financer les dépenses de la vie courante qu'effectuent, comme les autres, les personnes handicapées.
Pour bénéficier de la prestation de compensation, il faut avoir sa résidence en France de façon stable et régulière et remplir deux conditions.
Une condition d'âge tout d'abord.
La prestation est attribuée jusqu'à 60 ans. Toutefois, les personnes plus âgées ont droit à la prestation dans deux cas :
- si leur handicap répondait avant cet âge aux conditions requises. Elles doivent alors faire leur demande avant 75 ans ;
- si elles continuent d'exercer une activité professionnelle.
De plus, les bénéficiaires de la prestation de compensation atteignant l'âge limite et pouvant prétendre à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) peuvent choisir de continuer à percevoir la prestation de compensation.
La prestation de compensation peut être attribuée aux parents d'enfants handicapés :
- sur option, à la place de compléments auxquels l'enfant pourrait ouvrir droit ; dans ce cas, la prestation de compensation couvre toutes les charges liées aux besoins résultant du handicap (voir no 27211) ;
- ou pour les seules dépenses liées à l'aménagement de leur véhicule ou de leur logement ou aux surcoûts de transport. Dans ce cas, ces charges ne sont pas prises en compte pour l'attribution du complément.
Une condition de handicap ensuite. Le handicap doit entraîner une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités. Ces activités sont classées en quatre domaines :
- la mobilité (se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement, à l'extérieur, avoir des activités de motricité fine, etc.) ;
- l'entretien personnel (se laver, utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas) ;
- la communication (parler, entendre, voir et utiliser des appareils et techniques de communication) ;
- les tâches et exigences générales et relations avec autrui (par exemple, s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si une personne a droit à une prestation de même nature dans un régime de sécurité sociale, celle-ci est déduite de la prestation de compensation. Sont visées les majorations « tierce personne » complétant les avantages retraites, invalidité ou accident du travail.
La prestation de compensation n'est soumise à aucune condition de ressources, mais les ressources du bénéficiaire affectent son montant.
A compenser les charges supportées par les personnes handicapées qui :
- ont besoin d'une aide humaine pour les assister dans les actes essentiels de l'existence ou parce que leur état requiert une surveillance régulière. La prestation peut servir à rémunérer un ou plusieurs salariés. Il peut s'agir d'un service d'aide à domicile agréé ou de membres de la famille du handicapé. L'aide peut notamment servir à salarier le conjoint, le concubin ou certaines autres personnes (père, mère, enfant...) lorsque l'état de la personne nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. L'aide peut aussi dédommager un aidant familial sans lien de salariat avec l'intéressé. Le montant attribué est calculé en fonction du nombre d'heures de présence nécessaires et de la rémunération des intervenants. La prestation ouvre droit à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux employés de maison. La prestation de compensation versée au titre des aides humaines peut aussi servir à compenser les frais professionnels spécifiques engagés par les travailleurs handicapés ;
- ont besoin d'aides techniques. Sont visés les frais d'appareillage laissés à la charge du handicapé par l'assurance maladie, par exemple les fauteuils ou les lits médicalisés ; sont également concernés certains équipements pour les enfants tels que les casques de protection, les poussettes, certains types de fauteuils ;
- doivent aménager leur logement ou leur véhicule ou supporter des surcoûts de transport ;
- doivent faire face à des charges spécifiques ou exceptionnelles, par exemple acquérir ou entretenir des produits liés à leur handicap ;
- ont besoin d'aides animalières.
La prestation de compensation doit être utilisée conformément à son objet : à défaut, l'organisme qui la sert peut cesser de la payer (et même récupérer les sommes mal utilisées). Par exemple, la prestation allouée pour faire face aux charges correspondant à l'acquisition et l'entretien d'un chien d'aveugle ne peut pas être affectée à l'acquisition d'un ordinateur ! Ce contrôle est encadré pour les personnes sourdes ou atteintes de cécité bénéficiant d'un forfait d'aides humaines : aucun contrôle ne peut être opéré sur l'utilisation de ce forfait ; pour elles, seules les conditions d'attribution de la prestation peuvent être vérifiées.
La prestation est calculée à partir de tarifs variables selon la nature des dépenses, auxquels on applique des taux de prise en charge, qui peuvent diminuer en fonction des ressources du bénéficiaire. Le taux de prise en charge est de 100 % si les ressources de la personne sont inférieures à 26 473,96 € par an et de 80 % si elles sont supérieures à ce montant.
Les tarifs et les taux pour 2014 sont donnés dans le tableau ci-après.
Certaines ressources ne sont pas prises en compte pour le calcul des taux : revenus professionnels du bénéficiaire ; revenus d'activité de l'autre membre du couple, de l'aide familial vivant au foyer du bénéficiaire, de ses parents même s'il est domicilié chez eux ; indemnités temporaires et rentes aux accidentés du travail et à leurs ayants droit ; rentes viagères constituées pour lui-même par le bénéficiaire, ou en sa faveur par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ; certains revenus de remplacement ou prestations sociales (indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail, avantage vieillesse ou invalidité, RSA notamment).
Les personnes vivant en établissement social ou médico-social ou hospitalisées ont droit à la prestation, sous des conditions et pour des montants particuliers (une réduction de l'aide est applicable dans la limite d'un plancher et d'un plafond). C'est ainsi que peuvent notamment être pris en compte les frais d'aménagement du logement exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou les personnes séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile.
Dans tous les cas, les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire ne doivent pas excéder 10 % de ses ressources personnelles, nettes d'impôt.
|
Aides humaines | ||
|---|---|---|
|
Nature des dépenses |
Utilisation du temps |
Tarifs applicables aux aides humaines |
|
Entretien personnel |
|
Les tarifs sont les mêmes quelle que soit la nature des dépenses. |
|
Toilette (se laver, prendre soin de son corps) |
70 minutes par jour |
|
|
Habillage |
40 minutes par jour |
Dans la limite des frais supportés par la personne handicapée : - recours à une aide à domicile : 12,49 € de l'heure (majorée de 10 % en cas de mandataire) - recours à des services prestataires : tarif du service d'aide à domicile fixé par le président du conseil général - recours à un service à la personne agréé : tarif égal soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté (17,77 €), soit au prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service - dédommagement de l'aidant familial : de 3,67 à 5,51 € avec un montant maximal de 946,25 € par mois ; majoration de 20 % en cas d'aide totale pour la plupart des actes de la vie quotidienne et présence constante ou quasi constante |
|
Alimentation |
1 heure et 45 minutes par jour | |
|
Forfait surdité et forfait cécité |
Personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale : forfait d'aides humaines de 30 heures par mois |
Tarif de l'emploi direct, soit un maximum de 374,70 € |
|
|
Personnes atteintes de cécité : forfait d'aides humaines de 50 heures par mois |
Tarif de l'emploi direct, soit un maximum de 624,50 € |
|
|
Possibilité d'un forfait supérieur, selon appréciation. |
|
|
Déplacements |
|
|
|
Dans le logement |
35 minutes |
|
|
A l'extérieur : démarches administratives ou autres liées au handicap |
30 heures par an |
|
|
Participation à la vie sociale |
30 heures par mois, capitalisables sur 12 mois |
|
|
Besoins éducatifs |
30 heures par mois |
|
|
Surveillance régulière |
|
|
|
Personnes atteintes d'une altération substantielle |
3 heures par jour |
|
|
Ou nécessité d'une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne |
Cumul des temps d'aides humaines jusqu'à 24 heures par jour |
|
|
Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective |
156 heures sur 12 mois |
|
|
Aides techniques | ||
|---|---|---|
|
Nature des aides |
Montant maximal |
Délais de mise en oeuvre |
|
Aides techniques (cyclomoteur, aide au transfert, etc.) |
3 960 € pour toute période de 3 ans (sous réserve de certaines règles spécifiques) |
12 mois suivant la notification de l'attribution de la prestation |
|
Déménagement |
3 000 € par période de 10 ans |
|
|
Aménagements du logement |
Travaux jusqu'à 1 500 € : 100 % du tarif ; au-delà de 1 500 € : 50 % du tarif |
Début des travaux dans les 12 mois suivant la notification de l'attribution |
|
|
Montant maximal : 10 000 € pour toute période de 10 ans |
Achèvement des travaux dans les 3 ans suivant cette notification |
|
Aménagements du véhicule ou surcoûts dus aux transports |
Travaux jusqu'à 1 500 € : 100 % du tarif ; au-delà de 1 500 € : 75 % du tarif |
|
|
Montant maximal : 5 000 € pour toute période de 5 ans. Montant maximal porté à 12 000 € sur certains trajets (par exemple entre le domicile et le lieu de travail) soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres | ||
|
Aides spécifiques (dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap) |
100 € par mois pour les charges spécifiques |
|
|
Aides exceptionnelles (dépenses ponctuelles) |
1 800 € pour toute période de 3 ans |
|
|
Aides animalières |
3 000 € pour toute période de 5 ans ; en cas de versement mensuel tarif forfaitaire de 50 € par mois |
|
La décision d'attribution est prise par la CDAPH, au terme d'une procédure d'instruction qui comporte une évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation réalisés par une équipe pluridisciplinaire.
Les décisions notifiées sont valables entre un et dix ans. La prestation est versée par le département par le biais de la maison départementale des personnes handicapées. Elle est versée en principe mensuellement, mais le bénéficiaire ou son représentant peut demander des versements ponctuels si elle vise à couvrir des aides techniques, des frais liés au logement, au véhicule ou au transport, des produits ou des aides animalières.
En cas d'urgence attestée, la prestation peut être attribuée à titre provisoire. Le président du conseil général statue dans un délai de 15 jours ouvrés.
En principe, l'AAH n'est plus versée aux personnes de plus de 60 ans (l'âge légal de départ à la retraite étant appelé à évoluer, l'AAH devrait continuer à être versée jusque-là). Lorsqu'ils atteignent cet âge, les titulaires de l'AAH doivent demander le bénéfice des avantages vieillesse auxquels ils ont droit, c'est-à-dire leur pension de retraite ou le minimum vieillesse.
Lorsqu'un titulaire de l'AAH atteint 59 ans et 5 mois (cet âge devrait évoluer en même temps que l'âge légal de départ à la retraite), sa caisse d'allocations familiales prend contact avec sa caisse d'assurance vieillesse afin que celle-ci recherche s'il peut prétendre à une pension de retraite. En effet, toute personne ayant cotisé, même quelques mois, au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale a un compte individuel d'assurance vieillesse ouvert à son nom auprès de cette institution.
Plusieurs cas peuvent alors se présenter.
Lorsque la personne handicapée peut prétendre à une pension de retraite, la caisse d'assurance vieillesse l'invite à déposer une demande de pension.
L'intéressé doit alors présenter sa demande. A défaut, il se trouvera sans ressources à partir de 60 ans.
Lorsque la caisse vieillesse instruit le dossier de l'assuré rapidement, la pension de retraite est payée dès le mois qui suit celui à partir duquel la pension est due, le dernier versement de l'AAH intervenant au cours du mois qui précède.
Dans le cas contraire, le versement de l'AAH est maintenu au-delà de 60 ans jusqu'à ce que la pension soit payée. Les mensualités de retraite dues à l'assuré pendant cette période de maintien des droits sont versées non pas au retraité, mais à la CAF, qui fait l'avance du montant de sa pension de retraite au bénéficiaire de l'AAH.
Les handicapés ayant cotisé aux régimes complémentaires Arrco et Agirc doivent aussi demander la liquidation de leurs retraites complémentaires à ces régimes.
Si l'ensemble des pensions versées reste inférieur au montant de l'AAH, l'intéressé doit faire une demande d'allocation de solidarité des personnes âgées auprès de la caisse d'assurance vieillesse du régime de base qui lui verse une pension.
Si le bénéficiaire de l'AAH n'a pas droit à une pension de retraite, ce qui sera le cas s'il n'a pas ou très peu travaillé, la caisse d'allocations familiales l'invite à faire une demande de minimum vieillesse auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Certaines personnes handicapées dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 % exercent une activité professionnelle et perçoivent l'AAH (en général différentielle). Ces personnes peuvent, si elles souhaitent poursuivre leur activité professionnelle, continuer à percevoir l'allocation jusqu'à un âge limite fixé en fonction de l'âge légal de la retraite.
Lorsqu'elles atteignent l'âge légal de départ à la retraite, elles doivent demander la liquidation « pour ordre » de leur pension de vieillesse : la caisse vieillesse calcule alors le montant de leur retraite comme si elles avaient cessé de travailler à cet âge (elles n'acquièrent aucun droit à la retraite pour les périodes d'activité postérieures à cet âge) ; le versement de la pension est suspendu jusqu'à ce que les intéressés cessent effectivement de travailler. Le montant de l'avantage vieillesse demandé doit être inférieur au plafond de l'AAH.
Bien qu'elles aient le même montant, le passage d'une allocation à l'autre peut être pénalisant pour les intéressés, du fait de conditions de ressources plus sévères pour le minimum vieillesse que pour l'AAH.
En particulier, pour savoir si une personne a droit ou non au minimum vieillesse et pour déterminer le montant de celui-ci, on prend en considération :
- les biens mobiliers et immobiliers de la personne, qui sont censés produire un revenu fictif ;
- les rentes perçues dans le cadre des contrats de rente-survie et d'épargne-handicap.
En outre, les plafonds applicables pour l'octroi de l'AAH sont plus « généreux » que ceux du minimum vieillesse (plafond plus élevé pour les ménages ; existence d'une majoration pour enfant à charge).
Certains handicapés qui avaient droit à l'AAH n'ont donc pas droit au minimum vieillesse ou perçoivent une allocation vieillesse sensiblement inférieure à l'AAH.
Deux cas doivent alors être distingués :
- les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 % peuvent continuer à percevoir un différentiel d'AAH sur avis de la commission des droits et de l'autonomie ;
- ceux dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 % perdent tout droit à l'AAH même à titre différentiel.
Lorsqu'un titulaire de l'ACTP atteint 60 ans, il a le choix entre le maintien de cette allocation ou son remplacement par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Pour bénéficier de l'APA, il doit déposer un dossier de demande soit deux mois avant son 60e anniversaire, soit deux mois avant l'expiration de la période de versement de l'ACTP fixée par la commission des droits et de l'autonomie. Dans les 30 jours, le président du conseil général l'informe du montant d'APA auquel il aura droit et de la participation financière qu'il devra acquitter. L'intéressé doit alors faire connaître son choix dans les huit jours. S'il ne le fait pas, il est supposé avoir opté pour le maintien de l'ACTP.
Signalons que si la prestation servie au titre de l'APA est inférieure à l'ACTP qu'il percevait, il bénéficie d'une allocation différentielle lui garantissant ce second montant.
Les conditions d'attribution et le montant de l'APA sont exposés au no 27472.
Lorsqu'un invalide atteint l'âge légal d'ouverture d'une pension de retraite, celle-ci se substitue à sa pension d'invalidité.
Le dernier versement de la pension d'invalidité correspond au mois au cours duquel l'invalide atteint cet âge (si ce jour tombe le 1er jour d'un mois, au mois qui précède).
L'invalide ne peut pas s'opposer à la liquidation de sa retraite, sauf s'il exerce une activité professionnelle. La pension est suspendue si son titulaire bénéficie d'une retraite anticipée.
En règle générale, six mois environ avant que la personne invalide atteigne l'âge légal de départ en retraite, sa caisse d'assurance maladie l'informe par courrier de la cessation prochaine du versement de sa pension d'invalidité et de la substitution à celle-ci d'une pension de retraite.
Parallèlement, sa caisse de retraite lui adresse un formulaire de demande de retraite du régime général de la sécurité sociale.
La personne invalide doit remplir le formulaire de retraite et l'adresser à sa caisse vieillesse. Si elle ne le fait pas, sa pension de retraite ne sera pas versée.
Lorsque l'assuré invalide exerce une activité professionnelle, la pension de retraite n'est liquidée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui, à l'âge légal de départ en retraite, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il la demande et, au plus tard, jusqu'à l'âge auquel est accordée une retraite à taux plein quelle que soit la durée de cotisations.
Il dépend du nombre d'années pendant lequel la personne a cotisé à l'assurance vieillesse ainsi que du salaire sur lequel elle a cotisé.
La pension de vieillesse versée par la sécurité sociale ne peut pas être inférieure :
- à un minimum fixé à 281,66 € par mois depuis le 1er avril 2015 pour les pensions qui ont pris effet depuis le 1er avril 1983 ;
- au montant de la pension d'invalidité pour les pensions d'invalidité qui ont pris effet avant le 1er avril 1983.
La majoration des invalides de 3e catégorie est remplacée par la majoration pour tierce personne de la pension de retraite de la sécurité sociale.
L'invalide ayant cotisé aux régimes complémentaires de retraite Arrco et Agirc devra demander la liquidation des pensions correspondantes.
Si ses ressources restent inférieures à un certain plafond, il pourra demander le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse.
Accordée sous condition de ressources, elle est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes d'au moins 65 ans (60 ans en cas d'inaptitude au travail). Elle remplace depuis le 1er janvier 2006 le « minimum vieillesse ». Les personnes qui bénéficiaient de ce dernier à cette date peuvent continuer à le percevoir. Mais elles peuvent également, à tout moment, y renoncer pour percevoir l'Aspa. Cette décision est irrévocable.
Pour bénéficier de l'Aspa, il faut :
- avoir fait valoir ses droits aux avantages vieillesse ;
- avoir 65 ans. Cet âge est abaissé à 60 ans quand l'inaptitude au travail a été reconnue par le médecin-conseil de l'organisme qui verse l'allocation ; les titulaires de l'AAH, d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail substituée à une pension d'invalidité, de la carte d'invalidité au taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, d'une retraite anticipée de travailleur handicapé notamment, sont réputés inaptes au travail de plein droit ;
- avoir une résidence stable et régulière en France, ou y avoir son foyer ou son lieu de séjour principal (présence de plus de 6 mois) ;
- avoir des ressources ne dépassant pas un certain plafond.
Ce sont les ressources des 3 mois qui précèdent la date d'effet de l'Aspa qui sont retenues. Si leur montant dépasse le quart des plafonds de ressources, une seconde évaluation est effectuée. Elle porte sur les ressources des 12 mois précédant la prise d'effet de l'Aspa comparées aux plafonds annuels. L'appréciation est plus large et plus contraignante que pour l'AAH. Ainsi, l'ensemble des avantages vieillesse ou d'invalidité du demandeur, les revenus professionnels y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers sont pris en compte. Mais les prestations familiales, la valeur de l'habitation principale et les avantages perçus au titre de l'aide sociale ne sont pas retenus.
Toutes les ressources du bénéficiaire ou du couple ajoutées à l'Aspa doivent assurer, depuis le 1er octobre 2014, un revenu minimum égal à :
- 9 600 €/an (800 €/mois) pour une personne seule ;
- 14 904 €/an (1 242 €/mois) pour un couple.
Il s'agit d'une allocation différentielle. Lorsque le total de l'Aspa et des ressources dépasse le plafond autorisé, l'allocation est réduite du montant du dépassement.
L'Aspa est, en principe, revalorisée chaque année, dans les mêmes proportions que les pensions de vieillesse du régime général.
Le demandeur, célibataire, dispose d'un revenu annuel de 7 000 €. Le montant de l'Aspa sur un an sera égal à : 9 600 - 7 000, soit 2 600 €.
L'Aspa n'est pas automatique. Il faut donc en faire la demande auprès de la caisse d'assurance vieillesse qui verse la retraite et pour les veufs ou veuves à celle qui versait la retraite au conjoint.
Un formulaire de demande Cerfa no 13710*02 est disponible sur le site de la Cnav (www.lassuranceretraite.fr).
Si le demandeur ne peut prétendre à aucune pension (bénéficiaire de l'AAH n'ayant jamais travaillé par exemple), l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Saspa) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le dossier peut être déposé à la mairie de son lieu de résidence qui transmet ensuite le dossier.
Les services ou organismes débiteurs de l'Aspa en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse versé au bénéficiaire. Pour les personnes qui relèvent de la Caisse des dépôts et consignations, l'allocation est payée par le Saspa, le premier jour de chaque mois.
Les sommes versées à tort restent acquises aux bénéficiaires sauf en cas de fraude, d'absence de déclaration de ressources ou d'omission de ressources dans la déclaration. Il est donc important de bien déclarer à l'organisme débiteur tout changement survenu dans les ressources, la situation familiale ou la résidence.
L'allocation personnalisée d'autonomie, en abrégé « APA », est une aide financière versée aux personnes âgées qui ont besoin d'une tierce personne pour les assister dans leur vie quotidienne.
Qui a droit à l'APA ?
Pour avoir droit à l'APA, il faut avoir atteint l'âge de 60 ans, avoir sa résidence en France et avoir subi une perte d'autonomie minimale.
La perte d'autonomie requise est appréciée à l'aide d'une grille de référence nationale (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources ou AGGIR), qui permet de répartir les personnes âgées dans six catégories intitulées Groupes Iso-Ressources (GIR). Le modèle n'est qu'un des éléments de l'ensemble des informations indispensables à la mise en place d'un plan d'aides et de soins personnalisés. Il a évolué afin de mieux prendre en compte les troubles psychiques.
Peuvent bénéficier de l'APA les personnes classées dans les GIR 1 à 4, à savoir celles :
- confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées et qui nécessitent la présence continue d'intervenants (GIR 1) ;
- confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé la capacité de se déplacer (GIR 2) ;
- ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, et partiellement leur capacité à se déplacer, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle (GIR 3) ;
- qui n'ont pas de problème pour se déplacer, mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les repas, ainsi que celles qui n'assument pas seules leur « transfert » (lever et coucher notamment), mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement ; elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage et s'alimentent seules dans leur grande majorité (GIR 4).
L'APA n'est soumise à aucune condition de ressources. Une somme (le « ticket modérateur ») reste à la charge du bénéficiaire, sauf si ses revenus sont inférieurs à 739,06 € par mois.
L'APA est calculée différemment selon le mode d'hébergement de son bénéficiaire : domicile ou établissement. Seul est exposé ici le premier mode de calcul, qui comprend trois étapes.
1. Classement du bénéficiaire
Première étape, le demandeur d'APA est classé dans l'un des quatre Groupes Iso-Ressources donnant droit à l'allocation. A chaque groupe correspond un tarif maximal d'allocation. Les tarifs applicables depuis le 1er janvier 2015 figurent dans le tableau ci-après.
|
Groupe Iso-Ressources (GIR) |
Tarifs maximaux de l'APA depuis le 1er janvier 2015 |
|---|---|
|
GIR 1 |
1 312,67 € |
|
GIR 2 |
1 125,14 € |
|
GIR 3 |
843,86 € |
|
GIR 4 |
562,57 € |
2. Détermination du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire
Deuxième étape, on établit un « plan d'aide », c'est-à-dire la liste des prestations dont le bénéficiaire a effectivement besoin. En fonction du contenu de ce plan, il a droit au tarif maximal ou à une fraction de celui-ci.
3. Détermination de la participation financière du bénéficiaire en fonction de ses ressources
Troisième étape enfin, on examine les ressources de l'intéressé et on calcule la participation financière qui doit éventuellement rester à sa charge compte tenu de ces ressources.
Les ressources prises en considération :
- sont celles du couple (marié, pacsé ou de concubins) ;
- sont celles de l'année civile précédant la demande (mais lorsque le bénéficiaire vit en couple, l'APA peut être révisée si la situation du conjoint ou du concubin est modifiée au cours de la période de versement : chômage, invalidité, retraite notamment) ;
- comprennent tous ses revenus, à quelques exceptions près : notamment retraite du combattant, pensions attachées aux distinctions honorifiques et rentes viagères constituées par la personne, son conjoint ou ses enfants pour se prémunir contre le risque de dépendance ; en outre, les biens non productifs de revenus (y compris les contrats d'assurance-vie), c'est-à-dire non exploités, et les capitaux non placés sont censés procurer un revenu fictif : 50 % de leur valeur locative pour les immeubles bâtis, 80 % de cette valeur pour les immeubles non bâtis et 3 % pour les capitaux.
Le mode de calcul de la participation du bénéficiaire est le suivant pour les demandes formulées depuis le 1er avril 2003 (pour celles formulées avant, le mode de calcul antérieur, plus favorable aux allocataires, continue à s'appliquer et sera remplacé par les nouvelles règles lors de la révision de leurs droits).
Lorsque le revenu mensuel du bénéficiaire est inférieur à 0,67 fois la majoration pour aide constante d'une tierce personne (739,06 € depuis le 1er janvier 2015), il ne verse aucune participation.
Lorsque son revenu mensuel est compris entre 0,67 fois et 2,67 fois la majoration pour aide constante d'une tierce personne (entre 739,06 € et 2 945,23 € depuis le 1er janvier 2015), on applique la formule :
P = A [R - (S × 0,67)] × 90 %, divisé par (S × 2)
où P est la participation du bénéficiaire, A le montant de la fraction du plan d'aide qu'il utilise, R son revenu mensuel, S la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
Lorsque le revenu mensuel du bénéficiaire est supérieur à 2,67 fois la majoration pour aide constante d'une tierce personne (2 945,23 € depuis le 1er janvier 2015), sa participation est de 90 % de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
Attention : si le montant mensuel de l'allocation après déduction de la participation financière du demandeur est inférieur à 3 fois le Smic horaire, l'APA n'est pas versée (les versements indus n'excédant pas ce montant ne sont pas non plus réclamés à l'intéressé).
Prenons le cas d'une personne classée dans le groupe GIR 1 et qui utilise 65 % du plan d'aide : le montant de son APA avant prélèvement du ticket modérateur sera de 1 312,67 € × 65 %, soit 853,23 €.
Si le revenu mensuel de cette personne est inférieur à 739,06 €, elle ne versera aucune participation et touchera 853,23 €.
Si son revenu mensuel est de 2 000 €, sa participation sera égale à :
853,23 € [2 000 € - (1 103,07 € × 0,67)] × 90 %, divisés par (1 103,07 € × 2), soit 438,90 €. Elle touchera 853,23 € - 438,90 €, soit 414,33 €.
Si le revenu mensuel de la personne est de 4 000 €, elle versera 90 % de 853,23 €, soit 767,90 €. Il lui sera versé 853,23 € - 767,90 €, soit 85,33 €.
Il faut présenter une demande au président du conseil général du département de résidence, faite sur un imprimé spécial et accompagnée de justificatifs de l'état civil et des ressources de l'intéressé.
Dans les 10 jours de sa réception, le président du conseil général doit :
- si le dossier est complet, adresser au demandeur un accusé de réception mentionnant la date d'enregistrement du dossier ;
- si le dossier est incomplet, faire connaître au demandeur le nombre et la nature des pièces manquantes.
Une fois le dossier de demande complet déposé, son instruction est confiée à une équipe médico-sociale qui doit, dans les 30 jours et après une visite au domicile du demandeur, lui faire une proposition de plan d'aide et de taux de participation financière. L'intéressé a 10 jours pour faire ses observations et demander des modifications, une proposition définitive devant alors lui être adressée dans les 8 jours. Lorsque le degré de dépendance ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte rendu de visite doit être établi.
Le président du conseil général notifie sa décision dans les 2 mois : celle-ci, prise sur proposition d'une commission spécifique, la commission de l'APA, mentionne les montants de l'allocation mensuelle, de la participation du bénéficiaire et du premier versement, ainsi que le délai de révision de la prestation (la prestation peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation initiale, à la demande du bénéficiaire ou du président du conseil général).
A défaut de réponse dans les deux mois ou en cas d'urgence, l'APA est accordée pour un montant forfaitaire égal à 656,33 € depuis le 1er janvier 2015 (la moitié du tarif maximal du GIR 1).
L'allocation est due à compter de la notification de la décision d'attribution et son premier versement intervient dans le mois qui suit cette notification. Par la suite, elle est versée mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois.
Les recours contentieux contre les décisions du président du conseil général (refus ou suspension de l'allocation, révision de son montant) sont portés devant la commission départementale d'aide sociale, dans les 2 mois de la notification. Il est aussi possible de faire un recours gracieux devant la commission de l'APA.
L'APA doit être affectée aux dépenses prévues dans le plan d'aide : rémunération d'intervenants à domicile (tierce personne ou aide ménagère), frais de transport, d'adaptation du logement ou autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire (par exemple, téléalarme ou portage des repas).
Le bénéficiaire de l'APA peut employer un ou plusieurs membres de la famille, sauf le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs.
Toutefois :
- pour les personnes classées dans les groupes 1 et 2 ainsi que pour celles nécessitant une surveillance régulière, l'allocation est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé, sauf refus exprès du bénéficiaire ;
- lorsque le bénéficiaire de l'APA fait appel à des prestataires jugés « moins qualifiés » (service d'aide ménagère non agréé ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, tierce personne ne justifiant pas d'une expérience ou d'un niveau de qualification minimaux), sa participation est majorée de 10 %.
Le bénéficiaire de l'APA doit produire, si le président du conseil général le demande, les justificatifs de ses dépenses ; s'il ne le fait pas dans le délai d'un mois, l'allocation peut être suspendue. L'utilisation de l'APA conformément à son objet donne lieu à des contrôles de la part des services du département.
Les personnes handicapées hébergées dans des établissements ou des services financés par les départements peuvent demander à bénéficier de l'aide sociale. Cette aide est accordée dans certaines conditions (de ressources notamment) qui peuvent varier en fonction du type de structures, du mode d'accueil et des politiques départementales. Elle permet de prendre en charge les frais d'hébergement et d'entretien que les personnes handicapées ne peuvent pas supporter seules.
L'admission à l'aide sociale a des conséquences importantes sur les ressources des bénéficiaires.
Pour bénéficier de l'aide sociale, il faut :
- avoir une résidence stable et régulière en France ;
- disposer de ressources insuffisantes pour faire face aux frais d'hébergement et d'entretien en établissement.
Seules ces deux conditions doivent être remplies. Le département ne peut en exiger d'autres.
La demande doit être effectuée au centre communal (ou intercommunal) d'action sociale (CCAS) ou, à défaut, à la mairie du lieu de résidence du demandeur. Le CCAS établit le dossier et rassemble les pièces utiles. Il transmet le dossier dans le mois qui suit la demande au président du conseil général. La décision d'admission, qui relève de ce dernier, doit être motivée et notifiée au demandeur. Elle doit mentionner le délai de recours de 2 mois ouvert à compter de la notification et les voies de recours (avec l'adresse où il doit être envoyé). A défaut, le recours peut être formé à tout moment.
Il s'agit, sauf exceptions, de l'ensemble des revenus professionnels et autres, imposables ou non : AAH, rémunération du travail en Esat, intérêts des livrets A, des livrets à développement durable, etc. Est aussi retenue la valeur en capital des biens non productifs de revenus, sauf celle de l'habitation principale, évaluée dans des conditions spécifiques. Ces biens sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
- 50 % de la valeur locative pour les immeubles bâtis ;
- 80 % de la valeur locative pour les terrains non bâtis ;
- 3 % du montant des capitaux.
Seuls les revenus réels ou reconstitués peuvent être pris en compte pour l'admission à l'aide sociale. Les capitaux en tant que tels ne peuvent en aucun cas être retenus pour refuser l'admission. Ainsi, un département ne peut exiger du demandeur qu'il épuise son épargne avant de bénéficier de l'aide sociale.
Les demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale doivent remplir une déclaration de ressources, plus ou moins précise et détaillée selon les départements. Il y est fait appel à la bonne foi des intéressés. Par souci de transparence et afin d'éviter d'éventuelles erreurs, il est conseillé de déclarer l'ensemble de ses revenus et de ses capitaux au conseil général.
Mais il convient aussi de vérifier que les services des départements n'utilisent pas ces informations de façon détournée ou illégale. Ils ne sauraient en effet prendre en compte les capitaux placés en tant que tels, en plus des revenus, pour refuser l'admission à l'aide sociale ; ou ne pas respecter les dispositions légales prévoyant que certaines ressources, comme la rente-survie, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la participation mensuelle des intéressés à leurs frais d'entretien ou d'hébergement.
Les ressources, quelle que soit leur nature et à l'exception des prestations familiales, sont en principe affectées au paiement de la contribution aux frais d'entretien et d'hébergement. Une augmentation des ressources (qu'elles soient disponibles ou pas) du bénéficiaire de l'aide sociale peut entraîner une augmentation de sa contribution à ces frais. Ce mécanisme atténue fortement l'intérêt de nombreux placements financiers et rend complexe la gestion du patrimoine des intéressés.
Il existe cependant des exceptions à la prise en compte de certains revenus spécifiques. Les rentes viagères issues des contrats de rente-survie ou encore les contrats d'épargne handicap (et les intérêts produits par ces contrats) ne sont pas pris en compte. Les sommes correspondantes viennent donc en plus des minima de ressources garantis.
Depuis février 2005, les personnes handicapées hébergées dans des maisons de retraites « classiques » (et dans les unités de soins de longue durée) peuvent bénéficier, sous conditions, de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées. Avant cette date, elles relevaient du régime moins favorable de l'aide sociale aux personnes âgées.
Les conditions requises sont les suivantes :
- avoir été accueilli dans un établissement ou un service pour handicapé adulte (foyer d'hébergement, foyer de vie, SAVS ; ne sont pas visés les IME et les Esat) avant l'établissement pour personnes âgées ;
- ou avoir un taux d'incapacité de 80 %. Cette disposition concerne les personnes qui n'ont pas été accueillies dans un établissement ou service pour adultes handicapés (ou seulement dans un IME ou un Esat) avant l'établissement pour personnes âgées.
En cas de désaccord avec une décision du président du conseil général sur l'admission à l'aide sociale, un recours peut être déposé auprès de la Commission départementale d'aide sociale dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Le jugement est susceptible d'appel devant la Commission centrale d'aide sociale et de cassation devant le Conseil d'Etat.
Cette action consiste, pour les organismes ayant financièrement pris en charge une prestation pour le compte d'une personne, à se rembourser des sommes correspondantes. Elle ne doit pas être confondue avec la participation aux frais d'entretien et d'hébergement en foyer ni avec la répétition de l'indu par laquelle un organisme se rembourse les sommes versées à tort.
Les prestations récupérables sont les sommes prises en charge au titre des frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers mais aussi les aides ménagères, l'allocation supplémentaire d'invalidité versée en complément des pensions d'invalidité, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
L'AAH, les frais d'IME, les frais de MAS, les frais de fonctionnement en Esat, la prestation de compensation et l'allocation compensatrice pour tierce personne ne sont pas récupérables.
SavoirLes réformes successives de janvier et mars 2002 et de février 2005 ont mis fin à la récupération de l'allocation compensatrice en cas de retour à meilleure fortune, à la récupération des frais d'entretien et d'hébergement en foyer en cas de retour à meilleure fortune, à la récupération sur succession, légataire et donataire, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et enfin, à la récupération à l'encontre du légataire et du donataire, des frais d'entretien et d'hébergement en foyer.
Le droit à récupération varie selon la nature du lien unissant l'héritier à la personne handicapée.
Les prestations ne sont pas récupérables si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée décédée.
Pour les autres héritiers, la récupération sur l'actif net successoral (dès le 1er euro) peut intervenir au décès de la personne handicapée.
C'est le président du conseil général qui décide de procéder au recouvrement des prestations et qui fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. La prescription des recours en récupération est de 30 ans.
Les décisions du président du conseil général peuvent faire l'objet de recours dans les mêmes conditions que celui ouvert contre les décisions d'admission.
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre