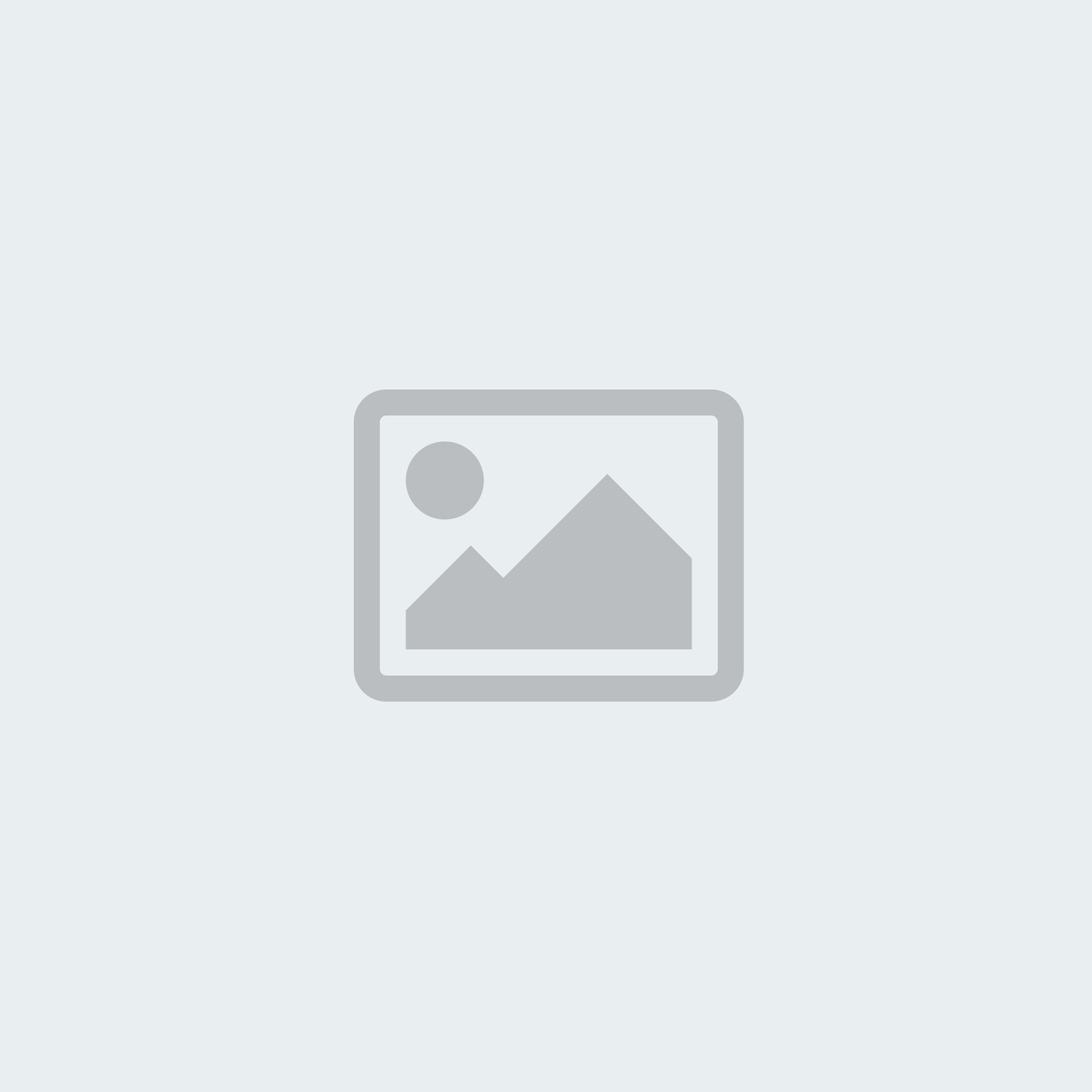Le droit français consacre le droit à l'éducation pour chaque enfant, qu'il soit handicapé ou non. Outre cette obligation, la loi reconnaît aux handicapés un droit à la scolarisation. La scolarisation en milieu ordinaire est la priorité. Mais certains enfants ont besoin d'un accompagnement que seul un institut médico-éducatif (IME) peut apporter. Quelle que soit son orientation, chaque enfant handicapé peut être inscrit dans l'école de son quartier.
Tout enfant ou adolescent supportant un handicap peut être inscrit dans l'école la plus proche de chez lui, qui constitue alors son établissement de référence. Ce peut être l'école (maternelle ou primaire), le collège ou le lycée de son secteur (celui de ses frères et soeurs par exemple). L'enfant y sera effectivement scolarisé, à moins qu'une autre orientation n'ait été décidée par la CDAPH. Mais, même dans ce cas, l'enfant conserve une inscription dans l'école de référence. Cette inscription a pour but de rappeler que le maintien ou le retour de l'enfant dans l'école de référence doit être privilégié et que l'Education nationale est responsable de tous les enfants, même s'ils sont orientés vers un IME.
AttentionSi l'enfant handicapé a déjà fait l'objet d'une décision d'orientation en IME qui n'a pas pu être mise en oeuvre faute de place, il est possible de l'inscrire dans l'école la plus proche de son domicile. Cependant, cette inscription n'apporte aucune réponse immédiate à la situation de l'enfant car elle n'annule ni ne remplace la décision d'orientation. L'école n'est donc pas tenue de l'accueillir.
Comme pour tous les enfants, les démarches d'inscription sont à accomplir auprès de la mairie de la commune de résidence. La mairie délivre un certificat d'inscription indiquant l'école où est affecté l'enfant. Il faut ensuite se présenter à l'école afin d'y faire enregistrer l'inscription.
Pour le collège ou le lycée, il faut s'adresser au service scolarité du rectorat de l'académie qui indiquera l'établissement scolaire où est affecté l'adolescent. Il faut ensuite prendre contact avec le principal (collège) ou le proviseur (lycée) de l'établissement en question.
L'inscription d'un enfant handicapé à l'école étant un droit, personne ne peut la lui refuser. En cas de difficultés, une association peut conseiller et assister les parents dans leurs démarches.
L'inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire. Certaines communes les acceptent plus tôt. Mais il est conseillé de prévoir au moins un an à l'avance la future scolarisation de l'enfant.
Il est indispensable de signaler le handicap de l'enfant dès l'inscription afin qu'un aménagement particulier de l'action pédagogique et éducative soit mis en place. L'école demande parallèlement aux parents de saisir la MDPH pour l'élaboration du plan personnalisé de scolarisation (PPS). Elle communique à la famille les coordonnées de l'enseignant référent qui les informera des soutiens qui peuvent être apportés dans le cadre de ce projet et les aidera à saisir la MDPH. Les parents disposent de 4 mois pour effectuer cette démarche, à compter du courrier leur conseillant de le faire. Si, passé ce délai, les parents ne donnent pas suite, l'inspecteur d'académie informe la MDPH qui peut alors prendre toutes les mesures utiles pour engager un dialogue avec eux.
En cas de désaccord avec une décision de la CDAPH sur l'orientation ou la désignation des établissements ou services adaptés aux besoins de l'enfant, les parents peuvent exercer un recours gracieux ou contentieux contre cette décision (voir no 27034).
En cas de refus de scolarisation de l'Education nationale, trois solutions sont possibles.
Les parents peuvent d'abord exercer un recours gracieux ou hiérarchique. C'est un recours administratif préalable non obligatoire. La demande, écrite et adressée à l'auteur de la décision ou à son supérieur hiérarchique, doit être faite dans les 2 mois suivant la réception de la décision contestée. A défaut de réponse dans un délai de 2 mois, le recours est considéré comme rejeté. Le délai de recours contentieux court à compter de cette date. En cas de réponse défavorable dans les 2 mois, le délai de recours contentieux court à compter de la date de réception de la réponse.
Avant de s'engager dans une procédure contentieuse, les parents peuvent opter pour la deuxième solution et saisir le médiateur de l'Education nationale ou académique. Il pourra faire des recommandations aux services et établissements concernés mais n'a pas de pouvoir d'injonction.
Enfin, les parents peuvent saisir le tribunal administratif.
A établir sur une simple feuille de papier, à adresser de préférence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Monsieur le Médiateur académique,
Le 21 janvier dernier, nous avons été informés du refus d'inscription à l'école primaire (Nom et coordonnées de l'établissement) de notre fils handicapé, Léo, âgé de six ans, par l'Inspection d'académie des Hauts-de-Seine. En attendant que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de notre enfant, cette école reste son établissement de référence et Léo y conserve obligatoirement une inscription.
L'accès à l'instruction des élèves handicapés en milieu ordinaire est un droit fondamental dont le principe a été posé par la loi du 11 février 2005 et réaffirmé dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant en référé, du 15 décembre 2010.
L'inscription de Léo nous a été refusée car l'école ne disposerait pas des moyens humains et des infrastructures nécessaires à l'accueil d'enfants présentant des troubles physiques ou mentaux...
Avant de nous adresser à vous, nous avons déposé un recours gracieux auprès de l'Inspection d'académie des Hauts-de-Seine qui a refusé de reconsidérer sa position (variante : qui n'a pas répondu).
C'est pour cette raison que nous vous demandons d'intervenir au plus vite afin d'essayer de résoudre notre différend.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Médiateur académique, l'expression de nos sentiments distingués.
Pièces jointes : copies de la décision contestée, du recours gracieux introduit le 24 janvier 2015 et de la réponse négative de l'Inspection d'académie en date du 12 mars 2015.
Le PPS est un élément du plan personnalisé de compensation, qui concerne aussi les autres besoins de l'enfant, comme l'AEEH ou la prestation de compensation. C'est un écrit fondamental pour l'intégration de l'enfant handicapé en milieu ordinaire ou adapté. Il définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins de l'enfant.
Le volet scolaire du PPS comprend une première partie sur le déroulement de la scolarité. L'enfant peut être orienté ou maintenu dans une classe ordinaire ou au sein d'une classe spécialisée en milieu ordinaire ou en établissement adapté. Des solutions mixtes peuvent être envisagées. Des aménagements de la scolarité décidés par la CDAPH peuvent concerner l'organisation de la scolarité et les adaptations nécessaires à l'apprentissage de la vie scolaire (aménagement de l'emploi du temps par exemple). Le PPS peut enfin préconiser des mesures d'accompagnement ou de suivi de l'enfant avec l'intervention d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) ou encore l'attribution d'un auxiliaire de vie scolaire.
Les parents ont l'initiative du PPS. Ils en font la demande à la MDPH. Le dossier est instruit par l'équipe pluridisciplinaire qui élabore le plan avec la famille et/ou l'enfant en consultant le projet de vie élaboré pour lui. Les professionnels qui connaissent et suivent l'enfant sont souvent sollicités (médecin traitant par exemple). Le PPS est ensuite soumis pour validation à la CDAPH.
Elle facilite la mise en oeuvre du PPS et en assure le suivi. Elle veille à ce que l'enfant bénéficie des accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou rééducatifs que sa situation nécessite et à ce que le parcours scolaire permette à l'élève de réaliser ses apprentissages à son rythme.
L'ESS est formée de l'ensemble des personnes qui contribuent à l'élaboration du PPS : parents, enseignant référent, enseignants en charge de la scolarité de l'enfant, psychologue scolaire, infirmière, établissements et services sociaux. Elle se réunit au moins une fois par an sur demande de l'enseignant référent (ou de l'élève, de ses parents, de l'équipe éducative ou de l'IME) pour évaluer le PPS. Ses observations peuvent conduire à des modifications du plan et éventuellement à une réorientation de l'enfant.
L'enseignant référent a reçu une formation spécifique pour la scolarisation des enfants handicapés. Il est nommé par l'inspecteur d'académie. Il est au centre des actions conduites en faveur des élèves handicapés, qu'il suit tout au long de leur scolarité.
Il intervient dans tous les types d'établissements, quel que soit le mode de scolarisation de l'enfant : à domicile, en milieu hospitalier ou en établissement adapté.
Son rôle est d'accueillir et d'informer les parents d'enfants handicapés puisqu'il intervient avant toute évaluation de l'équipe pluridisciplinaire. Il contribue à aider les familles et, si nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, il doit s'assurer que le PPS est mis en oeuvre de la meilleure façon qui soit, veiller à sa continuité et à sa cohérence en favorisant la coordination entre les actions conduites par les équipes pédagogiques des établissements scolaires, les services ou établissements médico-sociaux et les autres professionnels tels que les médecins, les psychologues et les orthophonistes.
Enfin, l'enseignant référent est chargé de réunir et d'animer les équipes de suivi de la scolarisation.
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH prévoit l'évolution du PPS vers une formation professionnelle puis vers une insertion dans la vie active, l'enseignant référent doit s'assurer que la transition entre la vie scolaire et la vie professionnelle se fait dans les meilleures conditions possibles.
Elle se fait souvent avec l'aide d'un service d'accompagnement ou de soutien scolaire comme le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad).
Les Sessad sont des structures légères destinées à maintenir ou réintégrer l'enfant handicapé dans son milieu naturel de vie en assurant les soins, le soutien éducatif et le suivi nécessaires. Ils interviennent dans les différents lieux de vie de l'enfant (domicile, crèche, école) et dans les locaux du service. La prise en charge est globale. Les équipes pluridisciplinaires sont notamment composées de médecins, d'éducateurs spécialisés, de psychomotriciens, d'orthophonistes et d'assistantes sociales.
Le Sessad conseille et accompagne les familles et favorise l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie. L'âge des enfants pris en charge est compris entre 0 et 20 ans. Son action est orientée vers la prise en charge précoce (de la naissance à 6 ans) et vers le soutien à l'intégration scolaire (après la scolarisation).
L'intégration individuelle dans une classe ordinaire se fait également grâce à l'aide des auxiliaires de vie scolaire (AVS).
Ils ont deux types de mission. Ils aident une équipe dans une structure d'intégration collective, type classe d'intégration scolaire (Clis) ou unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), ou concourent à l'intégration individualisée d'élèves handicapés pour lesquels cette aide a été reconnue nécessaire par la CDAPH.
Ces missions s'articulent autour de quatre types d'activités :
- des interventions pendant le temps scolaire, décidées en concertation avec l'enseignant (aide pour écrire ou manipuler le matériel dont l'enfant a besoin), mais aussi dans les activités périscolaires (cantine, garderie). Les AVS ne peuvent pas intervenir au domicile de l'élève ;
- l'accomplissement de gestes techniques ;
- la collaboration au suivi des projets personnalisés de scolarisation ;
- la participation aux sorties de classes.
C'est la MDPH qui attribue l'auxiliaire de vie scolaire à la demande de l'école ou de la famille.
La présence d'auxiliaires de vie scolaire donne lieu à la signature de conventions entre l'Etat et des associations représentant les personnes handicapées. Deux conventions, dont une convention-cadre, signées en juin 2010, doivent permettre d'assurer la continuité de l'accompagnement.
Quand l'AVS est absent, l'enfant handicapé peut-il être accueilli à l'école ? Oui, sauf cas particuliers ou circonstances exceptionnelles. Le caractère exceptionnel ou particulier de la situation peut découler d'un accord amiable avec les parents qui sont, par exemple, conscients de la difficulté qu'a l'enseignant à s'occuper de l'enfant sans l'aide de l'AVS. Il est conseillé que cette disposition figure dans le PPS de l'enfant.
L'enfant ou l'adolescent handicapé est scolarisé dans une classe spéciale au sein d'un établissement scolaire ordinaire (Clis ou Ulis). Ce type de structure permet d'accueillir et de dispenser un enseignement aménagé avec une pédagogie adaptée. Une scolarisation à temps plein ou à temps partiel peut y être organisée.
Les classes d'intégration scolaire (Clis) permettent à un petit groupe d'enfants présentant le même handicap d'être accueillis dans une école primaire ordinaire. Elles sont différenciées par type de handicap : mental (Clis 1), auditif (Clis 2), visuel (Clis 3) et moteur (Clis 4). L'enfant admis en Clis doit être capable d'assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu'implique la vie à l'école et avoir acquis ou être en voie d'acquérir une capacité de communication compatible avec des enseignements scolaires, les situations de vie et d'éducation collectives.
Les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) (ex-Upi) concernent les collèges et les lycées pour la scolarisation de jeunes porteurs de handicaps, de maladies invalidantes, de troubles importants des fonctions cognitives (retard mental, difficultés psychiques graves). Comme les Clis, elles sont répertoriées en fonction des troubles de l'élève : Ulis TFC (troubles des fonctions cognitives ou mentales), Ulis TED (troubles envahissants du développement, dont l'autisme), Ulis TFM (troubles des fonctions motrices, dont les troubles dyspraxiques), Ulis TFA (troubles de la fonction auditive), Ulis TFV (troubles de la fonction visuelle) et Ulis TMA (troubles multiples associés - plurihandicap ou maladie invalidante).
Le dispositif est fondé sur l'alternance entre, d'une part, des regroupements pédagogiques spécifiques d'élèves handicapés et, d'autre part, des périodes d'intégration dans des classes ordinaires.
L'orientation en Clis ou en Ulis est décidée par la CDAPH.
L'IME est un établissement d'éducation adapté aux enfants et adolescents déficients intellectuels assurant en parallèle un accompagnement médico-social. Cet accompagnement global doit favoriser l'intégration dans les différents domaines de la vie, de la formation générale et professionnelle. Il passe par l'accompagnement des familles et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, par la surveillance médicale régulière et générale de la déficience et des situations de handicap, par les soins et les rééducations, par l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un niveau intellectuel optimal, et enfin, par des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
Les IME sont constitués d'établissements médico-pédagogiques (IMP) recevant des enfants de 3 à 14 ans et d'établissements médico-professionnels (IMPro) pour les 14-20 ans.
L'IMP assure l'éducation générale et pratique en fonction des capacités intellectuelles des enfants, notamment par une formation gestuelle visant à développer au maximum l'habileté manuelle et l'autonomie. Il procure une scolarité élémentaire selon les aptitudes de chacun.
L'IMPro est l'établissement qui suit l'IMP et où les adolescents reçoivent, en parallèle à un enseignement général, une formation professionnelle adaptée au handicap.
L'orientation en IME est décidée par la CDAPH après évaluation des besoins de l'enfant par l'équipe pluridisciplinaire.
SavoirLes enfants ou adolescents accueillis en IME sont atteints de déficience mentale légère, moyenne ou profonde, avec ou sans troubles associés. Ils peuvent, selon l'amendement « Creton », être maintenus en IME au-delà de 20 ans dans le cas où ils ne peuvent être immédiatement admis dans un établissement pour adultes handicapés désigné par la CDAPH.
Les dépenses d'enseignement sont prises en charge par l'Etat. Les frais d'hébergement, les soins et l'éducation adaptée sont financés par l'assurance maladie. Si l'établissement n'est pas en mesure d'assurer certaines prestations, le médecin attaché à l'établissement ou au service peut diriger l'enfant ou l'adolescent vers le secteur libéral ; ces soins seront alors remboursés par la CPAM. Si les parents font le choix du secteur libéral, alors que l'établissement était à même d'assurer les soins à l'enfant, ils auront à supporter l'intégralité des frais engagés.
Les frais de séjour des jeunes maintenus en IME au-delà de 20 ans sont à la charge de l'organisme ou de la collectivité compétente pour assumer les frais d'hébergement et de soins de l'établissement vers lequel le jeune a été orienté par la CDAPH (le département par exemple s'il s'agit d'un foyer de vie).
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être supérieure à celle qui lui aurait été effectivement demandée par l'établissement pour adultes vers lequel elle a été orientée. Elle doit pouvoir disposer d'un minimum de ressources égal à 30 % de l'AAH (soit 240,14 € depuis le 1er septembre 2014).
Les personnes adultes handicapées peuvent être accompagnées dans un établissement ou un service médico-social quels que soient leur degré de handicap et leur âge. En principe, l'admission se fait, pour les jeunes adultes, à l'issue de la prise en charge dans les établissements pour enfants, soit autour de 20 ans.
Ces établissements et services doivent respecter les droits et libertés fondamentaux des personnes qu'ils accueillent : droit à la dignité, à la sécurité, à l'information notamment. Ils doivent mettre en place les outils destinés à en garantir l'exercice.
Elle est soumise à autorisation délivrée soit par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, soit par le président du Conseil général, soit par les deux. Ensuite, l'établissement peut fonctionner et accueillir des personnes handicapées. Les autorités administratives peuvent effectuer des contrôles qui portent sur le fonctionnement ou le bien-être des personnes accompagnées.
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux ont plusieurs modes de fonctionnement.
Les personnes handicapées peuvent être admises dans un établissement médico-social ou être suivies par un service à domicile ou en milieu ouvert. Elles peuvent y être accueillies de façon permanente, à titre temporaire (90 jours par an au maximum) ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
Les établissements et services ne proposent pas systématiquement toutes les formes d'accompagnement. C'est la CDAPH qui oriente les personnes handicapées vers un type de structure et qui peut prévoir la forme d'accueil ou d'accompagnement.
Il a été développé pour assurer principalement l'hébergement et l'entretien des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail (Esat). Il permet de nouer des liens sociaux et l'intégration des règles de vie collective. Il offre deux formules d'accueil soit l'internat de semaine, soit l'internat complet (y compris le week-end). Le foyer d'hébergement n'est pas médicalisé. Il emploie majoritairement des travailleurs sociaux.
Sa création est autorisée par le président du Conseil général. Les coûts de fonctionnement sont à la charge du département et financés par le Conseil général au titre de l'aide sociale. L'adulte handicapé participe, en fonction de ses ressources, à ses frais d'entretien et d'hébergement. Un minimum de ressources mensuelles doit lui être laissé (correspondant à 30 % du montant mensuel de l'AAH soit 240,14 € depuis le 1er septembre 2014).
Il propose aux personnes qui y sont accueillies des activités occupationnelles et des animations quotidiennes en lien avec le projet individuel de la personne. Le foyer peut proposer une formule d'internat, de semi-internat ou un accueil de jour. On l'appelle également centre d'accueil de jour, service d'accueil de jour et/ou d'hébergement.
Cette structure s'adresse aux personnes handicapées adultes ne relevant ni d'un Esat ni d'une maison d'accueil spécialisée (MAS) et qui ont une autonomie réduite, qui ne peuvent pas travailler mais qui ne nécessitent pas pour autant une surveillance médicale et des soins constants, ces foyers n'étant pas médicalisés. Le foyer de vie emploie des aides médico-psychologiques qui assurent l'encadrement.
La création du foyer de vie, son coût de fonctionnement et la participation de l'adulte handicapé à ses frais d'entretien sont identiques à ceux du foyer d'hébergement.
C'est un lieu d'accueil et de vie ouvert sur l'extérieur, le plus proche possible des familles et de la vie sociale. Cette structure propose trois modalités d'accueil : permanent, vocation première des MAS, de jour permettant d'alléger la charge qui pèse sur les familles ou encore temporaire.
Elle est destinée aux personnes adultes lourdement handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie, impliquant le recours permanent à une tierce personne et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. La MAS assure l'hébergement et répond aux besoins de la vie courante, apporte l'aide et l'assistance que demande l'absence d'autonomie des personnes handicapées et prodigue les soins médicaux et paramédicaux. Elle assure également une surveillance médicale régulière et propose des activités d'épanouissement, d'éveil, d'animation et d'ouverture à la vie sociale et culturelle pour prévenir toute régression.
Un médecin est désigné pour assurer la surveillance médicale de l'établissement. Des spécialistes interviennent en fonction des types de handicaps et de la nature des dépendances des personnes (psychiatres, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc.), ainsi qu'un infirmier et des personnels pour les aides et les soins quotidiens.
C'est l'assurance maladie qui finance les prix de journée en MAS, par l'intermédiaire des CPAM. Les personnes handicapées paient le forfait journalier qui s'applique à toute personne admise dans un établissement hospitalier ou médico-social financé par l'assurance maladie. Elles perçoivent un minimum de ressources égal à 30 % du montant mensuel de l'AAH (soit 240,14 € depuis le 1er septembre 2014).
Ce service propose aux adultes handicapés (y compris ceux ayant la qualité de travailleur handicapé) un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de ses liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels. Il prend en charge la personne qui demande une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de sa vie et/ou un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage de l'autonomie.
Les prestations sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire et doivent respecter le projet de vie de la personne et ses capacités d'autonomie (évaluation des besoins et des capacités d'autonomie, assistance, accompagnement dans la réalisation des actes quotidiens, suivi éducatif et psychologique, appui à l'insertion scolaire ou professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion, etc.).
Sa création est autorisée par le président du Conseil général. Les coûts de fonctionnement sont à la charge du département et financés par le Conseil général au titre de l'aide sociale.
Il s'agit des services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ou encore des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD). Chaque structure a sa vocation. La CDAPH a pour mission d'orienter la personne handicapée vers l'établissement qui lui est le mieux adapté.
Chaque personne prise en charge et accompagnée par un établissement ou un service médico-social a droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Elle a le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes et a droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisé favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins et respectant son consentement éclairé si elle est en mesure d'exprimer sa volonté (à défaut, celui de son tuteur sera recherché). La confidentialité des informations la concernant et l'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge (sauf dispositions législatives contraires) doivent être respectés. Enfin, la personne prise en charge doit pouvoir accéder à l'information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que sur les voies de recours à sa disposition.
Pour garantir l'exercice effectif des droits énumérés ci-dessus, un certain nombre d'instruments doivent être mis en place dans les établissements et les services :
- un livret d'accueil, qui présente l'établissement ;
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
- le règlement de fonctionnement de l'établissement ou service ;
- le médiateur ou la personne qualifiée pour faire valoir les droits de l'usager (liste élaborée par le préfet et le président du Conseil général, mais peu de personnes qualifiées ont été désignées) ;
- le contrat de séjour et le document individuel de prise en charge, qui permet de formaliser la relation entre l'usager et l'établissement ;
- le contrat de soutien et d'aide par le travail ;
- le conseil de la vie sociale qui permet de favoriser la participation et l'expression des personnes handicapées et celles de leur famille.
Les Esat (ex-CAT) sont des établissements médico-sociaux, accessibles sur décision d'orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ils permettent aux personnes handicapées qui n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, d'exercer une activité à caractère professionnel dans un milieu de travail protégé. Le statut d'un travailleur handicapé en Esat est particulier car il n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail. Il ne peut donc pas être licencié. Toutefois, certaines règles du Code du travail lui sont applicables : hygiène et sécurité, médecine du travail, congés payés.
L'Esat fonctionne avec deux budgets. L'un « social », financé par l'aide sociale de l'Etat et qui a vocation à prendre en charge notamment les frais de personnels salariés de l'établissements, les frais entraînés par les activités de soutien et les frais de transport collectif des travailleurs handicapés quand des contraintes d'environnement ou de capacité l'exigent. L'autre « commercial », financé grâce aux activités de production et de commercialisation de l'Esat et donc par la richesse créée par les travailleurs handicapés. Il permet notamment de rémunérer ces derniers, d'acheter des matières premières et d'investir dans des appareils de production.
Pour être accueillie en Esat, la personne doit présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir au moins 20 ans ;
- avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité de gain ou de travail d'une personne valide ou avoir une capacité de travail supérieure ou égale au tiers de la capacité d'une personne valide et avoir besoin d'un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques ;
- être orientée vers ce type de structure par la CDAPH.
Une orientation en Esat peut intervenir dès l'âge de 16 ans sur décision de la CDAPH réunie en formation plénière.
La demande doit être formulée au moyen d'un formulaire unique, envoyé ou déposé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui le transmet sans délai à la CDAPH. Celle-ci prend dans un premier temps une décision provisoire d'orientation, valable pour six mois au plus et renouvelable une fois.
L'admission en Esat vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La personne handicapée admise en Esat n'a pas le statut de travailleur soumis au Code du travail. Sa rémunération n'est pas un salaire et elle n'a pas de contrat de travail. Son licenciement est donc impossible. Toutefois, le directeur de l'Esat peut, à titre de mesure conservatoire, décider de suspendre le maintien d'un travailleur dans la structure si son comportement met gravement en danger sa santé ou sa sécurité ou celles d'autrui. Cette suspension peut aller jusqu'à l'exclusion.
L'Esat a trois sortes de missions. Il doit proposer une activité à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et enfin un épanouissement personnel et une intégration sociale.
Les activités à caractère professionnel sont très diverses (activités artisanales, conditionnement, entretien des espaces verts, hôtellerie, restauration, sous-traitance industrielle, etc.) et leur difficulté variable. Elles doivent tenir compte de la capacité des travailleurs à les réaliser.
Cette activité ne peut se concevoir que si elle comprend les soutiens qui conditionnent l'exercice de toute activité productive (dits de type 1) et ceux qui favorisent l'insertion sociale (dits de type 2). L'objectif est de permettre au travailleur handicapé d'exprimer, de la manière la plus profitable pour lui, sa faculté à travailler. L'importance et la nature des soutiens doivent dans tous les cas être adaptées à la spécificité du handicap et aux attentes de la personne handicapée. Il peut s'agir de formation, d'éducation gestuelle ou d'apprentissage. Les soutiens doivent aussi permettre l'épanouissement global de la personne handicapée en lui donnant les moyens de mieux s'insérer socialement et professionnellement, immédiatement ou ultérieurement. Cela peut passer par l'organisation de loisirs, d'ouverture sur l'extérieur ou d'initiatives à la vie quotidienne.
La durée d'activité des travailleurs en Esat ne peut excéder 35 heures hebdomadaires. Le règlement de l'établissement peut toutefois prévoir une durée de travail inférieure sans que cela ait d'incidence sur la rémunération. Le temps de présence, qui ne doit pas être confondu avec le temps de travail, peut être dépassé et consacré par exemple aux soutiens de type 2, aux repas, aux temps de pause.
Chaque travailleur handicapé accueilli en Esat a droit à une rémunération garantie qui lui est versée par l'établissement ou le service dans lequel il exerce son activité. Cette rémunération est fixée selon que l'activité est exercée à temps plein ou à temps partiel.
Pour aider l'Esat à financer cette rémunération garantie, l'Etat lui verse une aide au poste. Concrètement, l'Esat verse au travailleur handicapé une rémunération appelée salaire direct ou rémunération directe, complétée par une aide au poste servie par l'Etat. Cette rémunération garantie est comprise entre 55 % et 110 % du Smic brut pour une activité à temps plein. En plus de cette rémunération, une prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation (non prise en compte dans le calcul de l'AAH) peut, dans certaines conditions, être versée aux travailleurs d'Esat.
En principe, la rémunération garantie est versée dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail. Elle est due dès l'admission en période d'essai lorsqu'elle est prévue et quelle que soit sa durée (et sous réserve d'avoir conclu le contrat).
Certaines situations ouvrent droit au maintien de la rémunération garantie en cas d'absence du travailleur handicapé de l'Esat.
L'exclusion temporaire dans le cadre de la procédure de suspension qui sanctionne le comportement particulièrement dangereux d'un travailleur handicapé est sans conséquence sur le droit au maintien de la rémunération garantie. Elle est maintenue tant que la CDAPH n'a pas confirmé la décision de l'établissement.
Les congés et absences, liés à la maternité et à l'éducation des enfants par exemple, ouverts aux travailleurs handicapés d'Esat, sont également rémunérés. Il s'agit notamment des congés payés qui peuvent être augmentés de trois jours mobiles, des absences pour événements familiaux, des absences pour surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, du congé de paternité, de maternité ou d'adoption, du congé de naissance et des absences en cas d'arrêt maladie.
La rémunération garantie ne constitue pas la seule ressource du travailleur handicapé. Elle se cumule presque toujours avec l'AAH (voir nos 27245).
Chaque travailleur handicapé accueilli en Esat et sous contrat de soutien et d'aide par le travail cumule 2 jours 1/2 de congés payés par mois d'accueil. La durée totale de ces congés ne peut excéder 30 jours. Elle peut être augmentée de 3 jours mobiles (une possibilité accordée par la direction de l'Esat et non un droit pour le travailleur handicapé).
Les entreprises adaptées (ex-ateliers protégés) relèvent du marché du travail et non plus du milieu protégé du travail. Elles peuvent être créées par les collectivités ou des organismes privés ou publics et notamment par les sociétés commerciales. Elles doivent être économiquement viables.
Elles permettent aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé et orientées par la CDAPH vers le marché du travail d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
Les EA, bien que relevant du marché du travail, ont une vocation sociale et emploient majoritairement des travailleurs handicapés à efficience réduite. Leur effectif doit être composé d'au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail et concourant directement à la production. En fonction des nécessités de leur production, elles peuvent recruter des salariés « valides », dans la limite de 20 % de leur effectif.
Le travailleur handicapé en EA est un salarié de droit commun avec un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Il possède tous les droits des salariés soumis au Code du travail (ou à la convention collective de l'entreprise) et bénéficie de la sécurité sociale. L'entreprise adaptée est considérée comme un employeur.
Sur la déclaration trimestrielle de ressources et les règles de cumul entre l'AAH et les revenus d'activité en milieu ordinaire, voir nos 27251
SavoirLe travailleur handicapé qui démissionne d'une EA pour aller vers une entreprise ordinaire bénéficie, dans un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat et dans le cas où il souhaite réintégrer l'EA, d'une priorité à l'embauche. L'EA doit l'informer de tout emploi compatible avec sa qualification. Les salariés handicapés bénéficient aussi d'une procédure de mise à disposition leur permettant d'exercer de manière temporaire un emploi dans une entreprise ordinaire.
Le travailleur handicapé en entreprise adaptée reçoit un salaire fixé en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification, par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité. Ce salaire ne peut être inférieur au Smic.
Sous certaines conditions, l'entreprise adaptée perçoit, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la CDAPH qu'elle emploie, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat.
La qualité de travailleur handicapé reconnue par la CDPAH permet de bénéficier de mesures et d'obligations légales spécifiques, propres à favoriser l'insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi en milieu ordinaire.
Tout employeur de 20 salariés et plus dans un même établissement est tenu d'employer 6 % de travailleurs handicapés ou de contribuer, selon d'autres modalités, à leur insertion professionnelle. A défaut, il doit verser une contribution financière à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
L'employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi en accueillant en stage des bénéficiaires de cette obligation ou des plus de 16 ans bénéficiant de la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Pour être pris en compte, chaque stage doit avoir une durée d'au moins 40 heures et donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou d'insertion.
Les personnes handicapées peuvent avoir recours à des appuis spécifiques dans leur recherche d'emploi auprès des organismes suivants :
- Pôle emploi, qui dispose dans chaque agence locale de conseillers à l'emploi et dans chaque département d'un conseiller à l'emploi spécialisé pour les travailleurs handicapés ;
- le réseau Cap Emploi, composé de structures privées en relation avec les entreprises et chargées de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Ces structures reçoivent, informent et conseillent les travailleurs handicapés orientés par la CDAPH en vue de leur placement et assurent un suivi après l'embauche ;
- l'Agefiph, qui peut accorder notamment des aides financières destinées à compenser le handicap ;
- des associations de personnes handicapées ou des établissements spécialisés qui ont constitué des services d'accompagnement vers l'emploi ;
- des actions menées dans le cadre des programmes départementaux pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PDITH).
Les personnes handicapées font partie des publics prioritaires et, à ce titre, ont un accès privilégié aux contrats aidés.
Le travailleur handicapé exerçant une activité en milieu ordinaire bénéficie du statut de salarié et donc des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable à l'entreprise.
Il doit percevoir une rémunération correspondant à l'emploi occupé et à sa qualification.
Il ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (rémunération, formation, qualification, promotion professionnelle, etc.), en raison de son handicap ou de son état de santé.
Sur la déclaration trimestrielle de ressources et les règles de cumul entre l'AAH et les revenus d'activité en milieu ordinaire, voir nos 27251
Des mesures d'adaptation du poste de travail doivent être prises par l'employeur : aménagements du poste et des horaires, accompagnement et équipements individuels nécessaires, accès au lieu du travail.
Cette obligation concerne d'autres bénéficiaires que ceux ayant la qualité de travailleur handicapé, comme les titulaires de la carte d'invalidité et les titulaires de l'AAH.
Les salariés handicapés doivent accéder à l'ensemble du dispositif de formation professionnelle continue, dans le respect du principe d'égalité de traitement avec les personnes valides. Des actions spécifiques peuvent être mises en place permettant l'insertion ou la réinsertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification. La formation professionnelle est aménagée pour tenir compte des contraintes liées au handicap (temps partiel ou discontinu, durée de formation adaptée).
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie, et si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement.
En cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette durée puisse aller au-delà de trois mois. Mais ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit tenir compte de la priorité d'emploi réservée aux personnes handicapées pour établir l'ordre des licenciements.
Les personnes handicapées qui ont travaillé en milieu ordinaire, adapté ou protégé (Esat) ont droit, comme tous les salariés, à une pension de retraite. Les conditions de leur passage à la retraite font l'objet de particularités et d'aménagement.
Elle permet aux personnes reconnues médicalement inaptes au travail de bénéficier, dès l'âge légal de départ à la retraite et quelle que soit leur durée d'assurance, d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire au taux de 50 %. Ce taux plein permet de percevoir une pension dont le montant ne peut être inférieur à un minimum contributif déterminé en fonction des trimestres cotisés lors de la liquidation.
SavoirLa substitution d'une retraite à la pension d'invalidité n'est pas automatique à l'âge légal d'ouverture des droits à la pension de vieillesse (par exemple : 60 ans pour les assurés nés au 1er semestre 1951 ; 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955). La retraite doit être demandée expressément. Si aucune demande en ce sens n'est formulée, la pension d'invalidité continue d'être versée jusqu'à la date à laquelle l'assuré fait liquider sa retraite et au plus tard jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein (par exemple : 65 ans pour les assurés nés au 1er semestre 1951 ; 67 ans pour les assurés nés à partir de 1955). La pension de vieillesse qui est alors versée à l'assuré ne peut pas être inférieure à celle dont il aurait bénéficié s'il avait liquidé ses droits à l'âge légal de départ à la retraite.
Sont concernées les personnes suivantes :
- celles réputées inaptes au travail dont l'incapacité, liée au handicap, a déjà fait l'objet d'une évaluation. Elles ne sont donc pas soumises au contrôle médical de la caisse de retraite. Ce sont les titulaires de l'AAH, les titulaires d'une carte d'invalidité (taux d'incapacité d'au moins 80 %), les personnes reconnues invalides avant l'âge légal de départ à la retraite et les titulaires d'une pension d'invalidité ;
- celles reconnues inaptes au travail par le service de contrôle médical de la caisse de retraite et dont la capacité de travail est réduite d'au moins 50 %.
La demande doit être faite par le biais d'un imprimé à retirer à la caisse régionale d'assurance maladie (Cram). Cet imprimé doit être complété et les pièces justificatives retournées à la caisse du dernier régime d'affiliation. Pour plus de renseignements, consulter :
www.legislation.cnav.fr, www.lassuranceretraite.fr, www.info-retraite.fr, www.social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites
Les personnes ayant peu travaillé et qui ne perçoivent qu'une faible retraite (de base et complémentaire) peuvent demander à bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) qui leur garantit en principe un minimum de ressources (voir nos 27460).
L'assuré doit justifier d'une durée d'assurance minimum dont une partie doit avoir donné lieu à cotisation. Cette durée dépend de l'âge de départ à la retraite.
L'âge minimum d'attribution de la retraite anticipée handicapée est fixé à 55 ans. L'âge limite d'attribution intervient par paliers (60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ; 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952, etc.)
L'assuré doit être atteint ou avoir été atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % durant l'intégralité des périodes d'assurance et de cotisation ou justifier de la qualité de travailleur handicapé. Ce dernier critère sera supprimé à compter du 1er janvier 2016.
Les travailleurs d'Esat ayant automatiquement la qualité de travailleur handicapé bénéficient de la retraite anticipée.
Les assurés concernés bénéficient automatiquement du taux plein de 50 %. Le montant de la pension est calculé comme pour la retraite pour inaptitude. Mais une majoration peut s'ajouter à la pension quand la personne ne réunit pas la durée d'assurance requise pour le versement d'une retraite complète. Selon les cas, cette majoration permet d'atténuer l'effet de proratisation des durées d'assurance sur le montant de la pension, voire de le supprimer. Mais le montant de la retraite majorée ne peut pas dépasser le montant correspondant à la pension entière de l'assuré. S'il est inférieur au minimum contributif, il est porté à son niveau.
AttentionEn cas de départ à la retraite anticipé de l'assuré handicapé, la pension d'invalidité, qu'il pouvait cumuler jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite avec la pension vieillesse, est suspendue. Ses avantages accessoires (majoration pour tierce personne, allocation supplémentaire d'invalidité ou exonération du ticket modérateur) sont maintenus.
Si le total de la retraite de base et de la retraite complémentaire perçues avant l'âge légal de départ à la retraite est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, il est préférable de demander à bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en priorité à l'AAH (qui a un caractère subsidiaire). L'ASI est versée, sous certaines conditions, en complément d'un avantage viager attribué au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse. Elle peut être versée jusqu'à ce que le titulaire atteigne l'âge d'ouverture des droits à l'Aspa, soit 60 ans. Contrairement à l'AAH, l'ASI est récupérable, sous certaines conditions, au décès de l'allocataire.
La demande de retraite anticipée doit être faite auprès de la caisse de retraite qui fournit l'imprimé de demande de situation à remplir et qui doit lui être renvoyé accompagné de toutes les pièces justifiant du handicap pendant la période d'assurance et de cotisation (photocopies de la carte d'invalidité, de la décision d'attribution de l'AAH, etc.).
Si certaines pièces sont manquantes, une demande d'attestation peut être demandée à la CDAPH qui détient le dossier du demandeur. Si elle ne le détient plus : attestation sur l'honneur.
Après vérification que les conditions requises sont remplies, la caisse transmet au demandeur un document justificatif, accompagné d'un document de retraite spécifique et d'un calcul estimatif de sa pension. Cet imprimé rempli doit être renvoyé à la caisse pour instruction du dossier.
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre