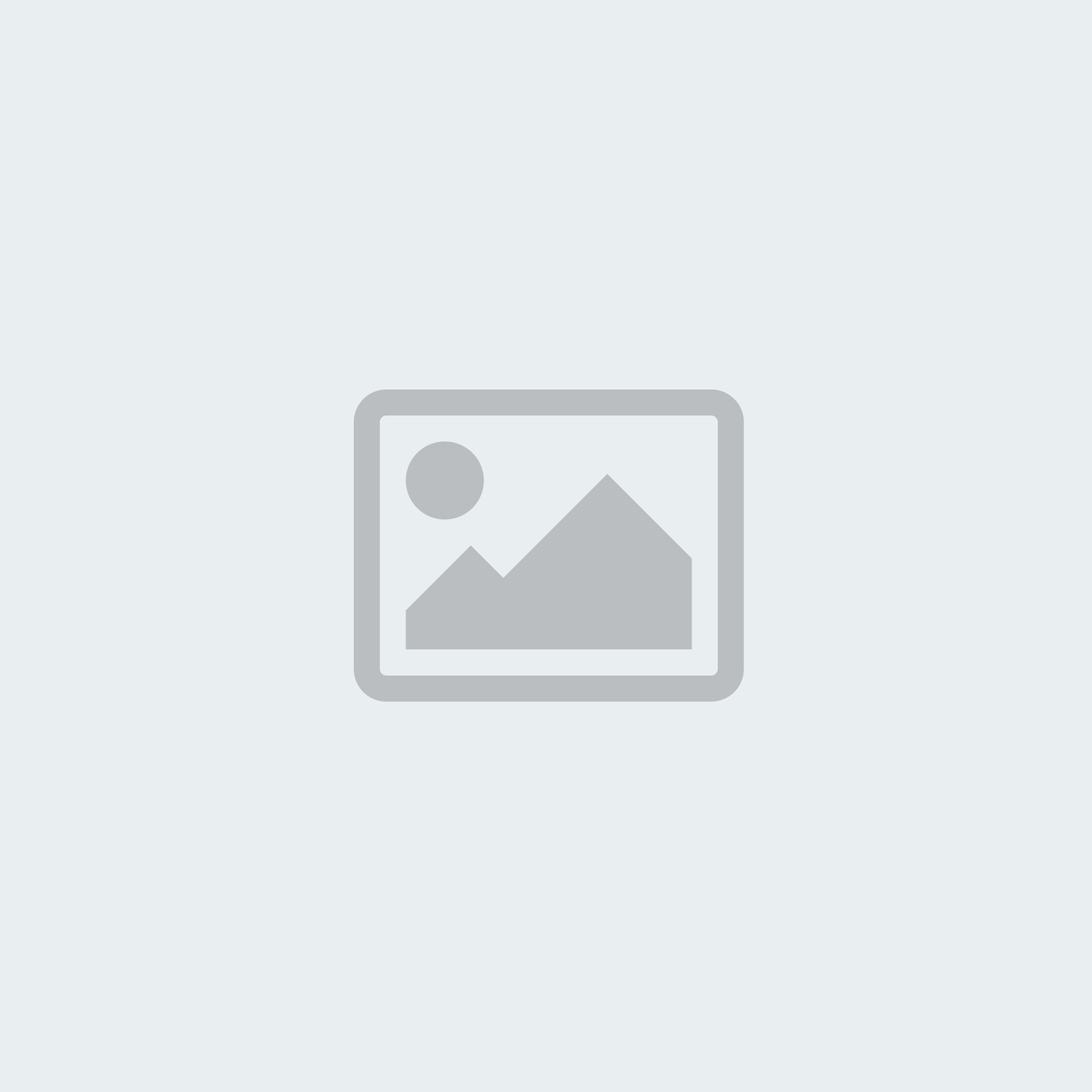C'est un droit sur une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise (C. trav. art. L 3321-1 à L 3326-2). En pratique, le système est le suivant : à la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise calcule la fraction des bénéfices réservée à l'ensemble des salariés (la « réserve spéciale de participation »), puis la quote-part individuelle devant revenir à chacun.
La participation est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés ayant dégagé des bénéfices (les entreprises nouvelles n'y sont toutefois soumises qu'à compter du 3e exercice clos après leur création et celles ayant conclu un accord d'intéressement peuvent attendre l'expiration de cet accord). Le dispositif est mis en place par accord entre l'employeur et les salariés ou leurs représentants. En l'absence d'accord, un régime dit « d'autorité », moins favorable, est mis en place.
SavoirLes entreprises qui attribuent effectivement de la participation au titre d'un exercice peuvent décider le versement d'un supplément de participation au titre de cet exercice selon les modalités prévues par l'accord ou par un accord spécifique. Ce supplément ne peut pas conduire à dépasser le plafond de répartition individuelle visé au no 22356, soit 28 530 € pour 2015. Ces sommes sont soumises au même régime social et fiscal que celles versées au titre des accords de base.
Tous les salariés présents dans l'entreprise pendant l'exercice, y compris ceux sous contrat à durée déterminée. Une ancienneté minimale peut cependant être requise ; elle ne peut être supérieure à trois mois (C. trav. art. L 3342-1). Aucune autre condition ne peut être prévue. Même en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés conservent leur droit à participation né au cours de la période pendant laquelle ils appartenaient à l'entreprise.
Les dirigeants d'entreprises et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent bénéficier de la participation dans deux catégories d'entreprises :
- celles qui, ayant moins de 50 salariés, appliquent volontairement la participation ;
- celles dont l'effectif est compris entre 1 et 250 salariés et qui ont conclu un accord dérogatoire comportant une formule de calcul plus avantageuse que la formule de droit commun. Les dirigeants et leurs conjoints ne peuvent bénéficier de la participation que pour la seule part qui excède le montant résultant de la formule légale.
La participation peut être répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire, à la durée de présence au cours de l'exercice, uniformément entre les salariés ou selon une utilisation conjointe de plusieurs critères.
S'agissant des dirigeants d'entreprises et de leurs conjoints collaborateurs ou associés, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Sont en tout état de cause soumis à un plafond :
- le salaire (ou la rémunération annuelle ou le revenu professionnel) pris en compte, qui ne peut dépasser 152 160 € pour la participation calculée au titre de 2015 ;
- la quote-part de chaque bénéficiaire, qui ne peut excéder 28 530 € pour la participation attribuée au titre de 2015.
En cas de congé maternité ou adoption, d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle :
- la rémunération à prendre en compte pour la répartition en fonction du salaire est celle qui aurait été versée aux intéressés s'ils n'avaient pas été absents ;
- lorsqu'une partie de la réserve est répartie au prorata de la durée de présence, les congés maternité ou adoption, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont obligatoirement assimilés à de la présence.
Chaque bénéficiaire a le choix entre le versement immédiat de tout ou partie de ses droits et le blocage des sommes pendant cinq ans (ou huit ans). Par exception, les accords dérogatoires comportant une formule de calcul plus avantageuse que celle de droit commun peuvent prévoir que le supplément de participation en résultant sera bloqué d'office.
Le bénéficiaire qui souhaite obtenir le versement immédiat de sa participation doit en faire la demande dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. La demande, qui doit être effectuée chaque année, peut porter sur tout ou partie des droits. Le silence gardé par le bénéficiaire pendant ce délai vaut option pour le blocage des droits pendant cinq ans (ou huit ans).
Les sommes versées bénéficient d'exonérations sociales mais supportent l'impôt sur le revenu.
Les droits attribués au titre d'un exercice qui n'ont pas été versés immédiatement au bénéficiaire ou affectés par défaut au Perco (no 22360) ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans, sauf dans certaines situations énumérées par la loi, appelées « cas de déblocage anticipé ». Ces sommes sont placées pour le compte des salariés.
Le délai est porté à huit ans en cas d'absence d'accord de participation (régime d'autorité) et les sommes sont versées sur des comptes courants bloqués ouverts au nom des bénéficiaires. Elles sont rémunérées à un taux fixé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Le point de départ du délai de cinq ou huit ans est le 1er jour du 5e mois qui suit la fin de l'exercice comptable. Par exemple, la participation calculée début 2016 au titre de l'exercice civil 2015 ne sera disponible que le 1er mai 2021 (ou le 1er mai 2024).
Les sommes bloquées et les revenus qu'elles produisent bénéficient d'exonérations sociales et fiscales.
- La loi sur l'épargne salariale du 19 février 2001 a supprimé la possibilité de ramener le délai d'indisponibilité des droits des salariés à trois ans (en contrepartie d'un régime fiscal et social moins avantageux). Cette suppression ne remet pas en cause les accords en vigueur à la date de la publication de la loi prévoyant un délai d'indisponibilité de trois ans.
- Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet de loi « Macron » prévoit de fixer le point de départ de l'indisponibilité des sommes bloquées au titre de la participation au premier jour du 6e mois suivant l'exercice au titre duquel ils sont nés, soit le 1er juin pour un exercice clos le 31 décembre (article 36 du projet tel qu'adopté définitivement par le Parlement).
Les accords peuvent prévoir :
- soit l'affectation de la totalité de la participation à un plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou Perco) ;
- soit la combinaison, dans des conditions qu'il leur appartient de déterminer, de cette affectation à un plan d'épargne salariale avec le placement dans un compte courant bloqué que l'entreprise doit consacrer à des investissements.
Dans les entreprises disposant d'un Perco, la moitié de la participation calculée selon la formule légale est affectée à ce plan si les bénéficiaires n'ont demandé ni le versement immédiat de leur participation ni son affectation à un autre emploi autorisé, l'autre moitié étant affectée selon les modalités prévues par l'accord de participation.
L'intéressement consiste à associer financièrement les salariés à la marche de leur entreprise (C. trav. art. L 3311-1 à L 3315-5). Il constitue un complément de rémunération de nature aléatoire dont le niveau est lié à la réalisation d'objectifs. Il peut s'agir d'objectifs mesurant la rentabilité économique ou financière de l'entreprise. C'est l'intéressement aux résultats. Mais l'accord mettant en place le dispositif peut retenir d'autres objectifs : amélioration de la productivité, diminution des délais de production, réduction de l'absentéisme... On parle alors d'intéressement aux performances de l'entreprise. L'intéressement est facultatif. S'il est mis en place, il doit concerner tous les salariés (sauf condition d'ancienneté minimale ; en tout état de cause, une ancienneté supérieure à trois mois ne peut pas être exigée). L'intéressement peut également concerner les dirigeants et leur conjoint collaborateur ou associé dans les entreprises employant au moins 1 et au plus 250 salariés si l'accord le prévoit. Les primes d'intéressement peuvent être réparties entre les salariés de manière uniforme ou proportionnelle en fonction du salaire ou de la durée de présence (ces différents critères pouvant être combinés : par exemple, 30 % répartis de manière uniforme, 30 % au prorata du temps de présence et 40 % proportionnellement aux salaires).
Les primes d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales. Elles sont en revanche soumises, lors de leur versement, à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %). Elles sont également, en principe, soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si les salariés les affectent, dans les 15 jours qui suivent leur versement, à un PEE ou un Perco. Les sommes considérées sont alors exonérées d'impôt sur le revenu (dans la limite d'un plafond de 19 020 € pour 2015), mais ni de CSG ni de CRDS. Les sommes attribuées aux non-salariés ne sont pas imposées à l'impôt sur le revenu mais restent soumises à la CSG et à la CRDS. Signalons que le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit qu'à compter du 1er janvier 2016, l'intéressement serait placé par défaut sur un PEE, dans les conditions prévues par l'accord, si les bénéficiaires ne demandent pas le versement des sommes qui leur sont attribuées ou leur affectation à un PEE. Toutefois, pour les droits attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les bénéficiaires bénéficieraient d'un droit de rétractation : ils pourraient demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de son affectation par défaut sur le PEE (article 35 decies du projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015).
Les entreprises qui attribuent déjà de l'intéressement peuvent accorder librement un supplément d'intéressement à leurs salariés, étant précisé que la somme des droits attribués à un même salarié ne peut pas excéder 19 020 € en 2015. Ce supplément d'intéressement est soumis au même régime social et fiscal que les primes d'intéressement.
La quote-part revenant à chaque bénéficiaire est exonérée de cotisations sociales dans tous les cas (versement immédiat à la demande de l'intéressé ou blocage des sommes).
En revanche, elle supporte la CSG et la CRDS au titre des revenus d'activité. Ces contributions sont prélevées dès la répartition des droits entre les bénéficiaires.
La participation est imposable à l'impôt sur le revenu lorsqu'elle fait l'objet d'un versement immédiat à la demande du salarié. Il en est de même des droits de faible montant n'excédant pas 80 € par personne versés à l'initiative de l'entreprise. Elle est exonérée lorsque les sommes sont bloquées pendant cinq ans (ou huit ans) ou dans certaines situations énumérées par la loi, appelées « cas de déblocage anticipé ».
Les dividendes, plus-values de cession et autres revenus produits par les sommes bloquées pendant la période d'indisponibilité sont définitivement exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dès lors qu'ils sont intégralement réinvestis.
Lorsque les salariés demandent la délivrance de leurs droits, les produits de la participation, y compris les plus-values réalisées, sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 0,5 % pour la fraction acquise entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 1996, de 3,9 % pour celle acquise en 1997, de 10 % pour la fraction acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004, de 10,3 % pour la fraction acquise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004, de 11 % pour la fraction acquise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, de 12,1 % pour la fraction acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, de 12,3 % pour la fraction acquise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011, de 13,5 % pour la fraction acquise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 et de 15,5 % pour la fraction acquise depuis le 1er juillet 2012. Ces contributions sont prélevées par l'employeur ou par l'organisme chargé de la gestion des droits. Elles sont calculées sur la différence entre le montant des droits délivrés et le montant de la quote-part attribuée lors de la répartition de la réserve spéciale de participation (lorsque cette différence est négative, c'est-à-dire en cas de « moins-value », aucun prélèvement n'est dû). Elles ne sont pas déductibles au regard de l'impôt sur le revenu.
A l'issue de la période d'indisponibilité, vous n'êtes pas obligé de débloquer votre participation si les sommes sont placées en actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placements extérieurs à l'entreprise (Sicav, FCP, FCPE, Sicavas). Vos revenus continuent à s'accumuler en franchise d'impôt sur le revenu à condition d'être réinvestis comme la participation elle-même. Vous pouvez effectuer des retraits partiels (par exemple, débloquer la moitié des fonds disponibles) en franchise d'impôt sur le revenu, mais avec application des prélèvements sociaux sur la fraction des produits relatifs aux retraits effectués.
Pour les sommes placées sur des comptes courants bloqués, l'entreprise n'est pas tenue de les conserver ni de continuer à les rémunérer : si elle le fait, les revenus ne seront pas exonérés d'impôt sur le revenu. Ce n'est que si ces sommes sont transférées dès la fin de l'indisponibilité à un organisme extérieur à l'entreprise (FCPE, par exemple) que vos revenus seront exonérés d'impôt.
Les plans d'épargne salariale sont des systèmes d'épargne collective qui permettent aux salariés de se constituer et de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (C. trav. art. L 3331-1 à L 3335-2). L'originalité de ces plans réside :
- d'une part, dans le régime fiscal qui les régit : à condition de respecter la durée minimale de blocage des fonds, les produits des sommes placées sur ces plans, y compris les plus-values de cession, sont exonérés d'impôt sur le revenu ;
- d'autre part, dans l'aide apportée par l'entreprise : les versements des participants peuvent être complétés par des versements de l'employeur qui augmentent la rentabilité réelle de leur épargne.
Il existe deux types de plan d'épargne salariale :
- le plan d'épargne d'entreprise (PEE), qui se caractérise par une durée minimale de blocage des fonds de cinq ans ;
- le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), dans lequel les fonds placés sont bloqués jusqu'à la retraite du participant.
PEE et Perco peuvent être créés au niveau d'une entreprise ou d'un groupe (PEG), ou en commun entre plusieurs entreprises n'appartenant pas juridiquement au même groupe (PEI).
La mise en place d'un plan d'épargne salariale est obligatoire pour les entreprises qui ont signé un accord de participation (voir no 22360). Dans tous les autres cas, la mise en place de ces plans est doublement facultative : l'employeur peut ou non les mettre en place et les salariés sont libres d'y participer ou non.
Tous les salariés. Mais l'accord peut prévoir une ancienneté minimale au cours de l'exercice, limitée à trois mois (C. trav. art. L 3342-1).
Les retraités et préretraités peuvent continuer à en bénéficier pourvu qu'ils aient commencé leurs versements avant leur départ de l'entreprise et n'aient pas demandé à cette occasion le déblocage de leurs avoirs. Ils peuvent continuer à effectuer des versements dans un PEE ou un Perco avec les mêmes contraintes et avantages que les salariés, à l'exception toutefois de l'abondement de l'employeur auquel ils n'ont plus droit.
Les salariés démissionnaires ou licenciés peuvent maintenir sur le PEE les sommes qu'ils y ont placées avant leur départ de l'entreprise, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements. Ils peuvent toutefois y affecter l'intéressement ou la participation perçus après leur départ de l'entreprise, ces versements pouvant donner lieu à abondement de l'employeur. Ils peuvent également continuer à effectuer des versements sur le Perco de leur ancienne entreprise s'il n'existe pas un tel plan chez leur nouvel employeur, sans toutefois pouvoir bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
SavoirMême s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les dirigeants (entrepreneurs individuels, professions libérales et gérants, présidents, directeurs généraux ou membres de directoires de sociétés) peuvent participer au plan de leur entreprise, à condition qu'elle ait entre 1 et 250 salariés. Leur conjoint collaborateur ou associé peut également y participer. L'accès au plan pour le dirigeant et, le cas échéant, pour son conjoint est de droit : il n'est pas nécessaire que le règlement le prévoit.
PEE et Perco sont alimentés par des versements volontaires des participants. Ces versements peuvent être effectués à tout moment. Ils sont plafonnés, par salarié et par an, au quart de la rémunération annuelle perçue par le salarié (le quart du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants). Les conjoints collaborateurs ou associés des chefs d'entreprises employant au moins 1 et au plus 250 salariés ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu qui ne perçoivent aucune rémunération au titre de l'année de versement peuvent effectuer des versements sur les plans dans la limite de 9 510 € en 2015.
Le plan peut prévoir un versement minimum annuel qui ne peut pas dépasser 160 € par salarié.
PEE et Perco peuvent aussi recevoir la participation dont le salarié ne demande pas le versement immédiat. Les plans peuvent également être alimentés par l'intéressement, par des transferts de droits détenus sur un autre plan d'épargne salariale, par des avoirs détenus sur un compte épargne-temps (CET) et sous certaines conditions par les actions gratuites attribuées aux salariés.
Dans les entreprises qui n'ont pas de CET, les salariés peuvent affecter au Perco, dans la limite de 5 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos ou de congés non pris, sans pouvoir réduire le congé annuel en deçà de 24 jours ouvrables. Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit d'autoriser les salariés à verser l'équivalent de dix jours de congés non pris dans un Perco (article 39 du projet tel qu'adopté définitivement par le Parlement).
Le PEE et le Perco peuvent être alimentés par des versements additionnels de l'entreprise, appelés abondement.
L'abondement ne peut pas dépasser le triple des versements personnels du bénéficiaire et est limité en valeur absolue :
- pour les PEE, à 3 043 € en 2015 ; ce plafond peut être porté à 5 477 € si une partie des sommes versées par le participant est consacrée à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une autre entreprise liée à celle-ci ;
- pour les Perco, à 6 086 € en 2015.
L'employeur peut, si le règlement du plan le prévoit, effectuer un versement initial dans le Perco lors de l'adhésion du salarié en l'absence de contribution préalable de celui-ci. Ce versement qui ne peut excéder 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 380 € pour 2015) est pris en compte pour apprécier la limite de 6 086 € pour 2015. Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit d'autoriser l'employeur à effectuer des versements périodiques sur le Perco même en l'absence de contribution du salarié, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés (article 35 duodecies du projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015).
SavoirL'abondement de l'entreprise n'est pas obligatoire. Le plan comporte obligatoirement une aide de l'entreprise, mais celle-ci peut se limiter à la prise en charge de ses frais de tenue des comptes. L'entreprise est également libre de choisir le mode de calcul de l'abondement à condition qu'il résulte de l'application de règles à caractère général : par exemple, abondement inversement proportionnel au salaire (plus le salaire est élevé, moins l'abondement est important).
Les sommes versées dans le cadre des PEE sont uniquement consacrées à l'acquisition de valeurs mobilières soit par l'intermédiaire de Sicav, d'un FCPE ou d'une Sicavas (avec possibilité d'acquérir des parts de fonds investis en entreprises solidaires), soit directement lorsqu'il s'agit de titres émis par l'entreprise, soit encore dans le cadre du rachat de tout ou partie du capital de la société (RES).
Le règlement du plan peut contenir plusieurs formules de placement entre lesquelles les adhérents peuvent choisir. Mais il doit leur offrir au moins une possibilité de placer leur épargne dans un OPCVM à vocation générale, c'est-à-dire dont l'actif est essentiellement composé de titres cotés ou de parts d'OPCVM eux-mêmes principalement investis en titres cotés. En pratique, cette disposition interdit de ne proposer qu'un seul OPCVM investi en titres de l'entreprise, sauf lorsque les participants au plan ont accès à un plan d'épargne de groupe ou interentreprises de même durée minimum de placement leur offrant la possibilité d'investir dans un OPCVM à vocation générale.
Le placement des fonds versés sur le Perco est soumis à des conditions plus restrictives : le Perco doit offrir le choix entre au moins trois OPCVM présentant différents profils d'investissement ; l'acquisition de titres de l'entreprise n'est possible que dans certaines limites et par l'intermédiaire d'un OPCVM ; le plan doit proposer une possibilité d'investissement dans un FCP solidaire ; les FCP dans lesquels les sommes affectées au Perco peuvent être investies doivent respecter des règles garantissant la diversification et la liquidité des placements ; enfin, le plan doit proposer aux participants une allocation sécurisée de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers.
Les avoirs détenus sur un PEE sont délivrés sous forme de capital. Toutefois, lorsque des sommes ont été affectées à un FCPE investi en titres de l'entreprise ou à une Sicavas, leurs titulaires peuvent demander individuellement, à condition que le règlement du fonds ou les statuts de la Sicavas le prévoient, la disponibilité immédiate des produits attachés aux titres qu'ils détiennent. Ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu.
La délivrance des sommes ou valeurs détenues sur un Perco se fait en principe sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, mais l'accord peut prévoir un capital, qui peut être versé en une seule fois ou de manière échelonnée. Dans ce cas, chaque participant exprime son choix au moment du déblocage.
Les sommes investies sur un PEE ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans (sauf dans certaines situations énumérées par la loi, appelées « cas de déblocage anticipé »), étant précisé que le règlement du plan peut prévoir une durée de blocage plus longue (10 ans par exemple). Ce délai court à compter, soit de la date d'acquisition des actions ou des parts, soit d'une date fixée par le règlement du plan et qui est commune à toutes les acquisitions effectuées au cours d'une période d'un an (par exemple, le 1er juillet). Les revenus de leurs avoirs peuvent toutefois être immédiatement disponibles dans certains cas (no 22404).
Les sommes investies sur un Perco sont bloquées jusqu'à la retraite du participant, sauf dans les « cas de déblocage anticipé » prévus par la loi.
Lorsque vous quittez votre entreprise, vous avez le choix entre maintenir les sommes acquises au titre de la participation ou placées sur un ou plusieurs plans d'épargne salariale de votre ancien employeur chez ce dernier (mais vous ne pourrez plus faire de nouveaux versements, sauf dans certains cas : voir no 22393), demander le déblocage de vos droits, sauf s'ils sont investis sur un Perco, ou transférer ces sommes vers un ou plusieurs plans d'épargne salariale de votre nouvel employeur. A cette fin, vous devez recevoir au moment de votre départ un état récapitulatif de l'ensemble de vos avoirs épargnés au sein de votre ancienne entreprise. Cet état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.
Vous devez indiquer à votre entreprise l'adresse à laquelle elle peut vous faire parvenir toutes les informations concernant vos droits. Si vous déménagez par la suite, il vous appartient de lui communiquer vos nouvelles coordonnées. Dans tous les cas, vous avez un délai de 30 ans pour réclamer votre participation :
- directement auprès de l'organisme gestionnaire lorsque les sommes sont investies en parts de fonds commun de placement ou en actions de Sicav (C. trav. art. D 3324-38) ;
- ou, s'il s'agit de sommes investies dans l'entreprise, directement auprès de cette dernière dans l'année qui suit la date d'expiration de leur période d'indisponibilité et, passé ce délai, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (C. trav. art. D 3324-37).
Les sommes perçues au titre de l'abondement de l'entreprise échappent à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, mais supportent 7,5 % de CSG et 0,5 % de CRDS (en tant que salaire sans application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ou en tant que revenu non salarié). Ces contributions sont prélevées par l'employeur au moment du versement de l'abondement.
Les produits des sommes placées sur un plan d'épargne salariale - dividendes, plus-values de cession et autres revenus - sont définitivement exonérés d'impôt sur le revenu, à condition d'être immédiatement et intégralement réinvestis dans le plan. Ils doivent être réemployés dans les mêmes conditions que les titres auxquels ils se rapportent et rester indisponibles pendant le même délai. Autrement dit, leur durée d'indisponibilité est celle qui reste à courir pour les titres dont ils sont issus (et non 5 ou 10 ans à compter de la date de leur réinvestissement). Cette exonération est maintenue jusqu'à ce que les bénéficiaires demandent le remboursement de leurs droits.
Lorsque les salariés demandent le remboursement de leurs droits, les produits des plans, y compris les plus-values de cession, sont soumis aux prélèvements sociaux. Ces contributions sont calculées sur la différence entre le montant des droits dont le remboursement est demandé et celui des versements effectués sur le plan (y compris l'abondement de l'employeur). Elles sont prélevées par l'employeur ou par l'organisme chargé de la gestion des droits au taux global indiqué au no 22371.
Lorsque la sortie du Perco s'effectue en rente viagère, la rente n'est imposable à l'impôt sur le revenu que sur la partie qui correspond aux intérêts produits par le capital postérieurement à la conversion de la rente. L'imposition s'effectue selon le régime des rentes viagères à titre onéreux, c'est-à-dire sur une fraction de son montant déterminée forfaitairement d'après l'âge de l'adhérent lors de l'entrée en jouissance, c'est-à-dire le premier versement. Cette fraction de la rente supporte les prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.
|
|
CSG |
CRDS |
Prélèvement social, contributions additionnelles et prélèvement de solidarité |
Evénement déclenchant l'imposition |
|---|---|---|---|---|
|
Participation |
|
|
|
|
|
Sommes attribuées aux salariés |
7,5 % |
0,5 % |
Non assujetties |
Attribution des droits individuels au début de chaque année |
|
Revenus de la participation |
3,4 % pour la part acquise entre le 1-1-1997 et le 31-12-1997 7,5 % pour la part acquise entre le 1-1-1998 et le 31-12-2004 8,2 % pour la part acquise depuis le 1-1-2005 |
0,5 % pour la part acquise depuis le 1-2-1996 |
2 % pour la part acquise entre le 1-1-1998 et le 30-6-2004 2,3 % pour la part acquise entre le 1-7-2004 et le 31-12-2008 3,4 % pour la part acquise entre le 1-1-2009 et le 31-12-2010 3,6 % pour la part acquise entre le 1-1-2011 et le 30-9-2011 4,8 % pour la part acquise entre le 1-10-2011 et le 30-6-2012 6,8 % pour la part acquise depuis le 1-7-2012 |
Remboursement des droits après 5 ans ou déblocage anticipé |
|
Plans d'épargne salariale |
|
|
|
|
|
Versements du salarié |
Non assujettis |
Non assujettis |
Non assujettis |
|
|
Versements de l'entreprise* |
7,5 % |
0,5 % |
Non assujettis |
Versement |
|
Revenus du plan |
3,4 % pour la part acquise entre le 1-1-1997 et le 31-12-1997 7,5 % pour la part acquise entre le 1-1-1998 et le 31-12-2004 8,2 % pour la part acquise depuis le 1-1-2005 |
0,5 % pour la part acquise depuis le 1-2-1996 |
2 % pour la part acquise entre le 1-1-1998 et le 30-6-2004 2,3 % pour la part acquise entre le 1-7-2004 et le 31-12-2008 3,4 % pour la part acquise entre le 1-1-2009 et le 31-12-2010 3,6 % pour la part acquise entre le 1-1-2011 et le 30-9-2011 4,8 % pour la part acquise entre le 1-10-2011 et le 30-6-2012 6,8 % pour la part acquise depuis le 1-7-2012 |
Remboursement des droits après 5 ans ou 10 ans et déblocage anticipé |
|
* A l'exclusion des frais de gestion éventuellement pris en charge par l'employeur. | ||||
Dans les cas énumérés par la loi, et eux seuls, le salarié peut débloquer les droits qu'il a acquis au titre de la participation ou sur un plan d'épargne salariale (y compris les sommes provenant de l'intéressement) avant l'expiration de la période d'indisponibilité. Ces cas de déblocage ne remettent pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont le salarié a bénéficié. Autrement dit, il n'a pas à payer d'impôt sur le revenu s'il demande ce déblocage. En revanche, il supporte au moment du déblocage les différents prélèvements sociaux : voir no 22371 et no 22412.
En plus des motifs de déblocage étudiés ci-après liés à la situation personnelle du bénéficiaire, les droits acquis au titre de la participation non échus sont rendus immédiatement exigibles par le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant sa liquidation judiciaire en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
Les cas sont les suivants (C. trav. art. R 3324-22 et R 3332-28) :
- mariage ou conclusion d'un Pacs ;
- naissance ou adoption d'un enfant dès lors qu'elle porte à trois ou plus le nombre d'enfants à la charge du foyer, quelle que soit la configuration de la famille (famille recomposée) ;
- jugement prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé en cas de divorce, séparation ou de dissolution d'un Pacs ; en cas de résidence partagée, chacun des parents peut demander le déblocage anticipé ;
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (mais pas le décès d'un enfant) ;
- rupture du contrat de travail : licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée, rupture de la période d'essai, départ en retraite ou en préretraite totales (mais non en retraite progressive), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social ou perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- situation de surendettement à la demande du juge ou du président de la commission d'examen des situations de surendettement ;
- invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; l'invalidité doit entraîner l'incapacité d'exercer une profession quelconque (classement en 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, invalidité reconnue par une décision de la commission compétente sous réserve que le taux d'incapacité atteigne 80 %) ;
- création ou reprise d'une entreprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs, à titre individuel ou sous la forme d'une société commerciale (à condition d'en exercer effectivement le contrôle), ou installation en tant que profession libérale ou acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; lorsque le créateur est le conjoint de l'intéressé, un de ses enfants ou son partenaire de Pacs, il peut demander le déblocage de tout ou partie de ses droits pour la même opération ;
- acquisition ou construction de la résidence principale ; l'occupation doit être immédiate, sauf pour le salarié proche de la retraite, qui peut demander le déblocage en s'engageant à occuper le logement avant le 1er janvier de la 3e année suivant la date du déblocage ;
- agrandissement de la résidence principale comportant la création d'une surface habitable nouvelle et sous réserve de l'obtention d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux (sont donc exclues la construction de garages, caves, terrasses ou la rénovation d'un logement ancien) ;
- remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel : les travaux permettant d'obtenir le déblocage doivent toucher à la structure de l'habitation et être indispensables à son intégrité. Le déblocage peut intervenir jusqu'à concurrence du montant des travaux sur production de devis acceptés ou de factures ;
La liste est la suivante (C. trav. art. R 3334-4) :
- décès, invalidité, surendettement, acquisition ou remise en état de la résidence principale dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-avant ;
- expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs, c'est-à-dire le rachat de ses actions ou de ses parts si ces avoirs sont placés sur un OPCVM. Si cette demande est effectuée après la fin du 6e mois qui suit le décès, l'exonération d'impôt sur le revenu attachée aux plus-values réalisées lors de la cession des titres détenus dans le cadre de la participation ou du plan d'épargne cesse de s'appliquer (C. trav. art. D 3324-39). En tout état de cause, le décès entraîne l'exigibilité des prélèvements sociaux : ces prélèvements sont recouvrés lors de la remise des sommes aux ayants droit.
Le salarié qui souhaite un déblocage anticipé doit en faire la demande dans un délai de six mois à compter de la survenance de l'événement autorisant le déblocage, sauf :
- cas de cessation du contrat de travail, décès de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, invalidité, surendettement et expiration de ses droits à l'assurance chômage (Perco) pour lesquels la demande peut être faite à tout moment ;
- cas de création d'entreprise et d'acquisition de la résidence principale, pour lesquels les fonds sont susceptibles d'être débloqués sur présentation du plan de financement de ces opérations.
Le déblocage doit intervenir en principe sous forme d'un versement unique qui porte sur la totalité (tous les avoirs) ou une partie des droits (un nombre de parts X ou un montant Y) susceptibles d'être débloqués, au choix du salarié. Lorsque le déblocage est seulement partiel, les droits les plus anciens sont versés en priorité. Un même cas de déblocage anticipé ne peut donner lieu à des déblocages successifs, sauf, s'agissant de la seule participation, lorsque la participation due au titre d'un exercice n'est pas encore répartie au moment de la demande de déblocage : un second versement est alors possible (voir no 22427).
En cas d'acquisition ou d'agrandissement de la résidence principale, les sommes débloquées doivent uniquement servir à constituer ou compléter l'apport personnel du salarié. Le montant du déblocage est donc plafonné à la différence entre le prix total d'acquisition (augmenté des frais d'actes notariés, d'enregistrement et d'hypothèque supportés par le salarié) et les différents prêts accordés à l'intéressé. A titre de preuve, l'intéressé devra fournir une attestation du notaire ou une promesse de vente, accompagnées de la copie des contrats de prêt immobilier.
Le déblocage de la participation doit porter sur les exercices clos à la date de l'événement qui y donne droit : autrement dit, les droits relatifs à l'exercice en cours restent indisponibles. Par exemple, un salarié qui se marie le 20 juin 2016 ne pourra percevoir que la participation des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Ses droits acquis au cours de l'année 2016 restent indisponibles en totalité : il ne pourra les percevoir qu'après le 1er mai 2022.
Il existe deux exceptions à ce principe : celle du décès du salarié et celle du déblocage anticipé consécutif à une rupture du contrat de travail. Les droits revenant au salarié ou à ses héritiers au titre de l'exercice en cours à la date du décès ou de la rupture du contrat de travail deviennent immédiatement disponibles, mais ne seront versés que lors de la répartition de la réserve entre les salariés. Par exemple, un salarié qui quitte son entreprise le 1er octobre 2016 pourra immédiatement débloquer sa participation de l'année 2016 et des années antérieures, mais le versement de ses droits sera effectué en deux fois : les années antérieures à 2016 seront débloquées et versées immédiatement alors qu'il devra attendre le 1er mai 2017 pour percevoir sa participation 2016.
SavoirLorsque la demande du salarié concerne la construction ou l'acquisition de sa résidence principale, la date à prendre en compte pour déterminer le montant des droits disponibles est celle de la signature de l'acte d'achat ou du contrat conclu avec le constructeur ou promoteur. Par exemple, dans le cas d'une promesse de vente signée en décembre 2015 pour une acquisition en février 2016, la date à retenir est celle de février 2016.
Lorsque les droits du dernier exercice clos ne sont pas encore déterminés et individualisés lors de la demande du salarié, le déblocage et le versement peuvent être effectués en deux fois.
Prenons l'exemple d'un salarié dont le troisième enfant naît le 15 janvier 2016. A cette date, seuls ses droits relatifs aux exercices antérieurs à 2015 sont déjà déterminés : ils deviennent immédiatement disponibles. Les droits qu'il a acquis au titre de 2015, mais qui ne sont pas encore répartis entre les salariés à la date de la naissance de son enfant, ne pourront lui être versés qu'au moment de la répartition de la réserve entre les salariés, soit le 1er mai 2016. Il percevra donc ses droits en deux fois : en janvier 2016 pour la participation des années antérieures à 2015, en mai 2016 pour la participation de l'année 2015.
L'opération de transfert consiste à déplacer ses droits acquis au titre de la participation ou sur un plan d'épargne salariale vers un autre support d'épargne salariale, sans en demander la délivrance. Ce transfert peut porter sur des droits disponibles ou non. Il peut intervenir :
- après la rupture du contrat de travail : les droits acquis au titre des différents régimes d'épargne salariale sont alors transférés vers un ou plusieurs plans d'épargne du nouvel employeur. Ce transfert entraîne la clôture du compte ouvert sur le plan de l'ancien employeur : il doit donc porter sur la totalité des avoirs détenus. Il n'est soumis à aucune condition de délai ;
- en l'absence de rupture du contrat de travail. Ce transfert n'entraîne pas la clôture du plan : le participant peut transférer tout ou partie des sommes qu'il détient.
Le transfert doit être distingué de l'opération qui consiste à demander la délivrance de sommes devenues disponibles pour les replacer ensuite sur un autre plan d'épargne : cette opération s'analyse comme une affectation d'une épargne nouvelle, susceptible de bénéficier à ce titre de l'abondement de l'employeur.
Le transfert doit porter sur des sommes d'argent et non sur des titres : l'organisme chargé de la gestion des droits ou l'entreprise elle-même pour la participation placée en comptes bloqués doit procéder à la liquidation des sommes bloquées et/ou des actions et parts détenues au sein des différents régimes d'épargne salariale et les transférer directement sur le plan ou les plans désignés par le bénéficiaire, sans les remettre à sa disposition. En cas de transfert après rupture du contrat de travail, l'organisme chargé de la gestion du ou des plans sur lesquels les sommes sont transférées doit acquérir, dans un délai maximum de 15 jours, les titres correspondants.
Le salarié peut transférer :
- les sommes acquises au titre de la participation vers un PEE, un PEI ou un Perco ;
- les sommes détenues sur un PEE ou un PEI vers un PEE ou un PEI à condition que le plan de destination comporte dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine ;
- les sommes détenues sur un PEE, un PEI ou un Perco vers un Perco.
Le transfert de sommes détenues sur un Perco vers un PEE ou un PEI n'est pas possible. En cas de rupture de votre contrat de travail, vous devez conserver vos avoirs sur le Perco de votre ancien employeur s'il n'existe pas de Perco chez votre nouvel employeur ou si vous n'avez pas rejoint une nouvelle entreprise (si vous êtes en congé formation de longue durée ou en recherche d'emploi par exemple).
Si les sommes transférées sont en cours d'indisponibilité, les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir, sauf :
- si les sommes transférées sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE : les sommes sont indisponibles pour la durée du nouveau plan ;
- si les sommes sont transférées sur un Perco : les sommes sont indisponibles jusqu'à la retraite.
Si le transfert porte sur des sommes devenues disponibles, ces sommes deviennent indisponibles pour la durée du nouveau plan (jusqu'à la retraite en cas de transfert sur un Perco). Il n'en va autrement qu'en cas de transfert, en cours de contrat de travail, de la participation devenue disponible vers un PEE ou un PEI : les sommes transférées ne sont pas bloquées et demeurent disponibles.
Non, les sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le montant des versements volontaires aux différents plans d'épargne salariale plafonnés chaque année au quart de la rémunération annuelle de l'intéressé.
Non, sauf dans les cas suivants :
- transfert de sommes issues de la participation, qu'elles soient ou non disponibles, vers un Perco ;
- transfert de sommes d'un PEE ou d'un PEI, qu'elles soient ou non disponibles, vers un Perco ;
- transfert, à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, de sommes détenues dans un PEE ou dans un PEI vers un PEE ou un PEI ;
- transfert, à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, de sommes issues de la participation vers le PEE ou le PEI du nouvel employeur. Il n'y a abondement de l'employeur dans cette situation qu'en cas de rupture du contrat de travail. En l'absence de rupture de contrat de travail le transfert de la participation ne donne pas lieu à abondement de l'employeur, même si les sommes sont disponibles ; pour bénéficier de l'abondement de l'employeur, le salarié doit demander la délivrance de sa participation devenue disponible puis la replacer sur le PEE ou le PEI.
|
Origine des sommes |
Nature du transfert |
Droit à abondement de l'entreprise |
Indisponibilité des sommes après transfert (1) |
|---|---|---|---|
|
Participation |
Participation vers PEE ou PEI en cours de contrat de travail : versement en cours d'indisponibilité, ou immédiatement à l'expiration de l'indisponibilité. |
Non |
Pour la durée du nouveau plan. Il est tenu compte des périodes de blocage déjà courues, sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital. En cas de transfert en fin d'indisponibilité, les sommes demeurent disponibles. |
|
Participation vers PEE ou PEI après la rupture du contrat de travail. |
Sommes transférées en cours de période d'indisponibilité de trois ou cinq ans : non. |
Pour la durée du nouveau plan. Il est tenu compte des périodes de blocage déjà courues sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital. | |
|
Sommes transférées à l'expiration de la période d'indisponibilité de trois ou cinq ans : oui. |
Pour la durée du nouveau plan. | ||
|
Participation vers Perco (en cours de contrat de travail ou après la rupture de celui-ci). |
Oui |
Jusqu'à la retraite. | |
|
PEE ou PEI |
PEE vers PEE ou PEI ou PEI vers PEE ou PEI (rupture ou non du contrat de travail) à condition que le nouveau plan ait une durée de blocage aussi longue que celle du plan d'origine. |
Sommes transférées en cours de période d'indisponibilité : non. |
Pour la durée du nouveau plan. Il est tenu compte des périodes de blocage déjà courues sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital. |
|
Sommes transférées à l'expiration de la période d'indisponibilité : oui. |
Pour la durée du nouveau plan. | ||
|
PEE ou PEI vers Perco (rupture ou non du contrat de travail). |
Oui |
Jusqu'à la retraite. | |
|
Perco |
Perco vers Perco. |
Non |
Jusqu'à la retraite. |
|
(1) Sauf cas de déblocage anticipé du plan recevant les sommes transférées. | |||
Dans la mesure où les sommes transférées ne sont pas délivrées à leur bénéficiaire, le transfert est sans incidence sur l'exonération d'impôt sur le revenu dont elles ont bénéficié et n'entraîne pas l'exigibilité des prélèvements sociaux. Ces prélèvements ne seront perçus qu'au moment de la délivrance des avoirs.
Les stock-options donnent le droit à leurs bénéficiaires de souscrire à une augmentation de capital ou d'acheter des actions de la société qui les emploie à un prix fixé à l'avance et pendant une durée déterminée. Ainsi, en cas de hausse de la valeur des actions, les bénéficiaires peuvent en souscrire ou en acquérir à un prix inférieur à leur valeur du moment.
Ce dispositif est facultatif et les entreprises peuvent en réserver le bénéfice à une partie seulement des salariés.
Le gain réalisé par le bénéficiaire de l'option se décompose en trois éléments. Il peut d'abord comprendre un rabais accordé par la société sur le prix de souscription ou d'achat des actions. Ce rabais correspond à la différence entre la valeur du titre au moment où l'option est accordée et le prix fixé pour l'exercice de l'option. Le montant du rabais maximum autorisé par la loi ne peut être supérieur à 20 % de la moyenne des cours de bourse des 20 séances précédant la date d'attribution de l'option ou du cours moyen d'achat.
La deuxième partie de ce gain réside dans l'avantage tiré de la levée de l'option. Cet avantage résulte de la différence entre la valeur de l'action au moment où le bénéficiaire lève son option et le prix de l'option ou prix d'acquisition des titres.
Enfin, la troisième composante de ce gain correspond à l'éventuelle plus-value de cession réalisée au moment de la revente des titres. Elle correspond au profit supplémentaire qu'encaissera le bénéficiaire de l'option s'il revend ses actions à un prix supérieur à la valeur des actions à la date de la levée de l'option (dans la situation inverse, c'est-à-dire si le prix de cession est inférieur à la valeur des actions à la date de la levée de l'option, la cession entraînera la perte de tout ou partie de l'avantage lié à la levée de l'option).
Si la moyenne des cours de bourse des 20 séances précédant la date d'attribution de l'option s'élève à 30 €, le montant maximum du rabais que peut consentir la société aux bénéficiaires des stock-options s'élève à 6 € (30 × 20 %), soit un prix de souscription ou d'achat minimal de 24 €.
Si la valeur du titre au moment où le bénéficiaire lève l'option s'établit à 33 €, l'avantage tiré de la levée de l'option est de 9 €.
Si le bénéficiaire revend ses actions 45 €, il fait une plus-value de cession de 12 € qui vient s'ajouter à l'avantage tiré de la levée de l'option. S'il les revend 30 €, il n'enregistre pas de plus-value de cession et la valeur de l'avantage se trouve ramenée à 6 € (au lieu de 9 € au moment de la levée).
Lorsqu'il exerce son option, le bénéficiaire de l'option est taxable sur la fraction du rabais qui excède 5 % de la valeur de l'action. Cette fraction excédentaire est taxée comme un salaire et doit être comprise dans la déclaration annuelle de revenus établie au titre de l'année de la levée de l'option pour être soumise au barème progressif de l'impôt (CGI art. 80 bis, II). La fraction excédentaire du rabais est également soumise à la CSG au taux de 7,5 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.
Reprenons l'exemple précédent d'une option proposée au prix de 24 € avec un rabais de 6 € : le bénéficiaire de l'option est imposable sur la fraction du rabais supérieure à 1,5 € (5 % de 30 €), soit 4,5 € par action.
Cette imposition est définitive et ne peut être remise en cause en cas de baisse ultérieure de la valeur du titre. Lors de la cession des titres, la fraction du rabais déjà taxée viendra en diminution de la valeur de l'avantage tiré de la levée de l'option pour la détermination de l'impôt dû.
SavoirIl est possible d'utiliser l'épargne bloquée sur un PEE ou PEI pour financer la levée de l'option. Ce déblocage anticipé ne remet pas en cause l'exonération d'impôt acquise sur les revenus des sommes débloquées, mais entraîne l'exigibilité des prélèvements sociaux. En contrepartie, les actions levées doivent être inscrites sur le PEE ou PEI et y rester pendant un délai minimum de cinq ans sans aucune possibilité de déblocage anticipé pour événement personnel (sauf décès de l'intéressé).
L'avantage tiré de la levée de l'option (ou plus-value d'acquisition) et la plus-value de cession sont imposés au moment de la revente des titres acquis au moyen de l'option.
Quelle que soit la date d'attribution de l'option, la plus-value de cession suit le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières : elle est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu (sur une base réduite, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention) auquel s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (dont 5,1 % de CSG déductible).
Les modalités d'imposition de l'avantage tiré de la levée de l'option diffèrent selon la date d'attribution des options.
Le bénéficiaire supporte également au moment de la revente, pour les options attribuées depuis le 16 octobre 2007, une contribution sociale de 10 % sur le montant de l'avantage tiré de la levée de l'option (CSS art. L 137-14).
L'avantage tiré de la levée de l'option est imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières (ou selon un régime spécifique similaire) si les actions revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles pendant un certain délai. Ce délai qualifié de durée d'indisponibilité court à partir de la date d'attribution de l'option et non à partir de celle de la levée de l'option. Cette durée ainsi que les taux d'imposition applicables dépendent de la date d'attribution de l'option.
Par exception, le respect de la durée d'indisponibilité n'est pas exigé dans certaines situations parmi lesquelles :
- invalidité du bénéficiaire (classement dans la 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
- décès du bénéficiaire ;
- mise à la retraite ou licenciement du bénéficiaire à condition que les options aient été levées au moins trois mois avant la date de la cessation du contrat de travail ou avant la notification du licenciement. Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n'ouvre pas droit, selon l'administration, à levée anticipée de l'indisponibilité (BOI-RSA-ES-20-10-20-20 no 390).
L'avantage tiré de la levée de l'option est expressément exclu du bénéfice des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, quelle que soit la date d'attribution des options.
SavoirMême s'il remplit les conditions pour bénéficier du régime d'imposition des plus-values, le bénéficiaire peut avoir intérêt à opter pour l'imposition de l'avantage tiré de l'option en tant que salaire. Cette option (qui ne concerne que les options attribuées depuis le 20 septembre 1995) est sans incidence sur le régime applicable à la plus-value de cession. A l'impôt sur le revenu s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration annuelle de revenus souscrite au titre de l'année d'imposition de l'avantage.
L'avantage tiré de la levée de l'option peut être imposé comme plus-value de cession lorsque la revente des titres intervient plus de cinq ans après la date à laquelle l'option a été attribuée. Le taux d'imposition dépend de la date à laquelle l'option a été attribuée.
Pour les options attribuées avant le 20 septembre 1995, c'est le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui s'applique, ce qui revient en pratique à soumettre l'avantage tiré de l'option à une imposition commune avec l'imposition de la plus-value de cession du titre.
Pour les options attribuées entre le 20 septembre 1995 et le 26 avril 2000, c'est un taux spécifique de 30 % qui s'applique. En conséquence, l'avantage tiré de la levée de l'option, à l'exception de la partie du rabais déjà taxée, est imposable au taux de 30 % tandis que la plus-value de cession est imposable au barème de l'impôt sur le revenu. Le bénéficiaire de l'option peut donc revendre ses titres immédiatement après les avoir acquis sans perdre le bénéfice de l'imposition au taux forfaitaire et sans prendre aucun risque de perte en capital, pour peu que cette revente intervienne plus de cinq ans après l'attribution de l'option. Cette stratégie lui permet notamment de ne pas avoir à avancer les fonds nécessaires à la levée de l'option.
Dans tous les cas, l'avantage tiré de la levée de l'option est soumis aux prélèvements sociaux de 15,5 % sur les revenus du patrimoine.
L'avantage tiré de la levée de l'option bénéficie du régime fiscal des plus-values de cession à des taux spécifiques si la revente des titres intervient plus de quatre ans après la date à laquelle l'option a été attribuée. L'avantage tiré de la levée de l'option est alors imposable dans les conditions suivantes :
- si les titres sont cédés dans un délai de deux ans à compter de la levée de l'option, le taux est de 30 % pour la partie de l'avantage inférieure à 152 500 € et de 41 % pour le surplus (45,5 % et 56,5 % avec les prélèvements sociaux) ;
- si les titres sont cédés après l'expiration de ce délai, le taux est de 18 % pour la partie de l'avantage inférieure à 152 500 € et de 30 % au-delà (33,5 % et 45,5 % avec les prélèvements sociaux).
La plus-value de cession reste dans tous les cas imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Le bénéficiaire de l'option peut donc lever son option et revendre immédiatement ses titres sans perdre le bénéfice de l'imposition comme plus-value de cession à des taux forfaitaires, à condition que cette revente intervienne plus de quatre ans après l'attribution de l'option. Toutefois, dans ce cas, l'avantage est imposé à un taux majoré.
Ainsi, dans le cas d'une option attribuée le 1er mars 2011 et levée le 1er mars 2015, si le bénéficiaire de l'option revend immédiatement ses actions, la partie de l'avantage inférieure à 152 500 € sera taxée au taux global de 45,5 % tandis que celle supérieure à 152 500 € supportera un taux de 56,5 %. Ce n'est que s'il revend ses actions le 1er mars 2017, c'est-à-dire s'il les a conservées deux ans après l'achèvement de la période d'indisponibilité de quatre ans, qu'il bénéficiera du taux réduit de 33,5 % pour la fraction inférieure à 152 500 € et sera imposé à 45,5 % pour le surplus. Au total, il aura dû attendre six ans à compter de l'attribution de l'option pour pouvoir revendre ses titres et bénéficier du taux réduit.
S'il ne lève son option que six ans après son attribution, soit le 1er mars 2017, il devra attendre encore deux ans avant de les revendre pour bénéficier du taux réduit de taxation : dans ce cas, il faut un délai minimum de huit ans entre la date d'attribution de l'option et la date de revente des titres pour bénéficier du taux réduit.
Lorsque le bénéficiaire revend ses titres avant la fin de la période d'indisponibilité de quatre ans, l'avantage tiré de la levée de l'option est imposable comme un salaire et soumis aux prélèvements sociaux au taux de 8 % sur les revenus d'activité.
L'imposition se fait selon un système de quotient qui s'applique automatiquement sans que le contribuable ait à le demander. La fraction du rabais déjà taxée viendra en diminution de l'avantage tiré de la levée de l'option pour la détermination de l'impôt dû. L'imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle les actions sont cédées.
L'avantage tiré de la levée de l'option est soumis au moment de la cession du titre au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, quelle que soit la durée de détention des actions (CGI art. 80 bis). Il est soumis aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS) au taux de 8 % (dont 5,1 % de CSG déductible) sur les revenus d'activité.
La plus-value de cession reste imposable au barème de l'impôt sur le revenu en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières.
Lorsque les titres acquis au moyen d'options sont cédés à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l'option, la moins-value réalisée est imputable en priorité sur le montant de l'avantage tiré de la levée de l'option. L'abattement pour durée de détention s'applique à la totalité de la moins-value réalisée sauf pour les options attribuées avant le 28 septembre 2012 pour lesquelles l'administration admet que l'abattement ne s'applique qu'à la fraction de la moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d'options (BOI-RSA-ES-20-10-20-20 no 83). Si le montant de la moins-value est supérieur au montant de l'avantage, le solde de perte peut être compensé avec d'autres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par ailleurs au cours de la même année ou des dix années suivantes.
En l'absence de clause contraire dans le règlement du plan de stock-options, les titulaires d'options peuvent exercer leurs droits même s'ils ont quitté la société depuis l'attribution des options et ce, quelle que soit la cause de leur départ. Mais, le plus souvent, le règlement contient une clause soumettant le droit de lever les options à une condition de présence dans l'entreprise. Une telle clause n'est toutefois opposable au bénéficiaire des options que si elle a été portée à sa connaissance et des dérogations sont parfois prévues dans le règlement du plan en faveur des personnes qui partent à la retraite ou qui doivent cesser leur activité pour cause d'invalidité.
En présence d'une clause de présence, le bénéficiaire du plan qui quitte la société perd le droit d'exercer les options même si la date limite d'exercice du droit n'est pas encore expirée. Il en est ainsi même en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que dans cette situation le titulaire des options a droit à des dommages et intérêts de son ancien employeur en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 2-2-2006 no 03-47.180 : RJDA 7/06 no 542 ; Cass. soc. 29-1-2013 no 11-24.406). Ce préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance, d'où il résulte que l'indemnisation ne saurait atteindre le montant de la plus-value que le salarié aurait réalisée s'il avait pu lever ses options (Cass. soc. 18-5-2011 no 10-12.043 : RJS 11/11 no 895 ; Cass. soc. 8-10-2014 no 13-10.857).
En revanche, la clause d'un règlement qui fait obstacle à la levée des options exclusivement en cas de licenciement pour faute du bénéficiaire est illégale dès lors qu'elle constitue une sanction pécuniaire interdite. Le salarié conserve dans cette situation la possibilité de lever ses options (Cass. soc. 21-10-2009 no 08-42.026 : RJS 1/10 no 79).
Cette stratégie, qui concerne les options attribuées du 20 septembre 1995 au 28 septembre 2012, est applicable lorsque les options ne sont pas encore exercées. Elle consiste à lever l'option lorsque le cours est bas pour réduire le montant de l'avantage tiré de la levée de l'option, taxable selon les cas à 45,5 % ou 56,5 %. Si le cours remonte, l'essentiel du gain réalisé lors de la revente des actions sera alors constitué de la seule plus-value de cession taxable à l'impôt sur le revenu au taux marginal d'imposition après abattement en fonction de la durée de détention. L'anticipation de la levée n'a d'intérêt que si le taux d'imposition prévisible lors de la cession est inférieur au taux forfaitaire applicable à la plus-value d'acquisition.
AttentionEn contrepartie de l'avantage éventuel, on peut relever trois inconvénients à cette stratégie :
- alors que les options ne sont pas imposables à l'ISF, les titres issus de l'exercice de l'option le sont si le seuil d'imposition est dépassé ;
- la levée anticipée entraîne un coût de portage lié au financement du prix d'exercice ;
- le détenteur de l'option supporte un risque financier si le cours du titre chute en deçà du prix d'exercice.
Cette stratégie, qui concerne les options attribuées du 20 septembre 1995 au 28 septembre 2012, est l'inverse de la précédente. Elle est applicable lorsque les options ne sont pas encore exercées. Elle consiste à exercer la levée de l'option lorsque le cours est élevé et le plus proche possible du cours auquel le contribuable déclenchera la cession. La fraction de la plus-value d'acquisition imposable au taux forfaitaire (45,5 % ou 56,5 % selon le cas) sera maximisée. La partie excédant la valeur du titre au jour de la levée sera imposable selon le régime de droit commun d'imposition des valeurs mobilières (barème de l'impôt sur le revenu). Cet stratégie n'a d'intérêt que si le taux forfaitaire est inférieur au taux résultant du barème progressif de l'impôt sur le revenu qui peut atteindre 60,5 % (45 % + 15,5 %) en cas de cession après un délai de détention des titres inférieur à 2 ans à compter de la levée.
Lorsque le cours des actions a baissé depuis le jour de l'exercice de l'option et que la période d'indisponibilité (pour les options attribuées avant le 28 septembre 2012) est respectée, le détenteur des titres peut avoir intérêt à conserver ses titres s'il pense que le cours va remonter et s'il peut financièrement attendre cette remontée. Il peut alors être judicieux pour lui, si son taux marginal d'imposition futur est faible (départ à la retraite par exemple), de vendre ses actions pour les racheter immédiatement : cette stratégie lui permet de transformer la plus-value future entre le cours actuel et le cours au jour de la cession en une plus-value taxable selon le régime d'imposition des plus-values des particuliers plutôt qu'à 45,5 % ou 56,5 %. La stratégie dépendra donc largement du taux marginal d'imposition prévisible du porteur à la date de la cession.
Cette stratégie n'est pas sans risque car si, au lieu de remonter, le cours continue à baisser, la vente des titres déclenchera une moins-value ordinaire.
Soit une option dont le prix d'exercice est de 25 €. Le porteur a exercé son option lorsque le cours était à 75 € et a conservé les titres. Le cours est ensuite tombé à 48 € mais le porteur pense qu'il va remonter et se fixe un objectif de vente à 70 €. Sur la base de cette anticipation, il vend son action au cours de 48 € et la rachète immédiatement. L'avantage tiré de la levée de l'option s'élève à 50 € (75 - 25). La revente des titres entraîne la perte d'une partie de cet avantage, soit 27 € (75 - 48). La différence de 23 € (50 - 27) est imposable comme avantage tiré de la levée de l'option à 45,5 % (ou 56,5 %). Si le cours remonte et qu'il revend son action à 70 €, la plus-value de cession de 22 € (70 - 48) est taxable à son taux marginal d'imposition après abattement pour durée de détention.
Si, au contraire, il n'avait pas revendu l'action lorsqu'elle cotait 48 €, la revente des titres à 70 € diminue l'avantage de la levée de l'option de 5 € seulement (70 - 75). L'intégralité de sa plus-value est alors constituée de l'avantage tiré de l'option imposable à 45,5 % (ou 56,5 %).
Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement des actions à tout ou partie de leurs salariés et de leurs dirigeants.
Les bénéficiaires d'actions gratuites n'ont aucun versement à effectuer et sont certains de réaliser un gain quelle que soit l'évolution du marché.
L'attribution d'actions gratuites peut être subordonnée à des conditions telles que la réalisation de certains objectifs par les bénéficiaires (conditions de performance individuelle) ou par la société (augmentation du chiffre d'affaires, performance boursière) ou encore à une durée minimale de présence dans l'entreprise. Ces conditions doivent être fixées par le règlement du plan. Les bénéficiaires ne deviennent propriétaires des actions qui leur sont attribuées qu'au terme d'une période minimale de deux ans appelée « période d'acquisition ». Ils doivent ensuite conserver les actions pendant une période qui ne peut être inférieure, elle aussi, à deux ans et qui court à compter de l'attribution définitive des actions. Les actions distribuées gratuitement sont donc indisponibles pendant au moins quatre ans.
Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque. En cas de décès du bénéficiaire, les actions dont les héritiers ont demandé l'attribution sont elles aussi librement cessibles.
Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit de réduire la durée de la période d'acquisition à un an étant précisé que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourrait être inférieure à deux ans (article 34 du projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015).
Le gain réalisé par le bénéficiaire se décompose en deux éléments :
- l'avantage tiré de l'attribution gratuite d'actions (ou plus-value d'acquisition), égale à la valeur des actions au jour de l'attribution définitive ;
- et l'éventuelle plus-value de cession réalisée au moment de la revente des actions : elle est égale à la différence entre le prix de vente et la valeur des titres au jour de l'attribution définitive.
L'avantage tiré de l'attribution gratuite d'actions est imposé au moment de la vente des titres :
- pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012, au taux de 30 % si la période d'indisponibilité est respectée. Le bénéficiaire peut, s'il y trouve intérêt, exercer une option pour l'imposition de cet avantage selon le régime des traitements et salaires. Dans les deux cas, l'avantage est en plus soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %. Si la période d'indisponibilité n'est pas respectée, l'avantage est imposé comme un salaire ;
- pour les actions attribuées depuis le 28 septembre 2012, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et aux prélèvements sociaux au taux global de 8 % (dont 5,1 % de CSG déductible) (CGI art. 80 quaterdecies). Si la période d'indisponibilité n'est pas respectée, l'avantage est imposable l'année de l'acquisition définitive de l'action gratuite (et non l'année de la revente du titre).
La plus-value de cession est dans tous les cas imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu (sur une base réduite, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention), auquel s'ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (dont 5,1 % de CSG déductible). La moins-value éventuellement réalisée est déduite du montant de l'avantage tiré de l'attribution des actions.
- Les actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont soumises à une contribution salariale de 10 % sur la valeur des actions à leur date d'acquisition. Cette contribution est due par le salarié au moment de la vente des titres (CSS art. L 137-14). Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit de supprimer cette contribution salariale pour les actions dont l'attribution serait accordée à compter de l'entrée en vigueur de la loi (article 34 du projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015).
- Le projet de loi pour la croissance et l'activité dit projet « Macron » prévoit, pour les actions dont l'attribution serait accordée à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'imposer l'avantage tiré de l'attribution comme une plus-value de cession : il serait imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant des abattements pour durée de détention et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5 % (article 34 du projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 18 juin 2015).
| Votre rubrique Conseils au quotidien sera mise à jour régulièrement. |
© Copyright Editions Francis Lefebvre